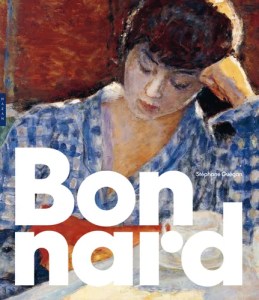Puni de mort pour avoir fauté et surtout foutré de façon peu catholique, Sade prend la route de l’Italie en juillet 1775. Louis XVI vient de monter sur le trône, il a fait le ménage parmi le personnel de son lubrique grand-père. Les temps changent, pas Sade. Le bon air de la Toscane l’attire d’abord, Donatien s’éloigne du théâtre de ses méfaits, Arcueil, Marseille, Lacoste, convaincu que d’autres plaisirs, licites ou pas, l’attendent à Florence, en plus des trésors de la Renaissance. C’est son Grand Tour, certes obligé, mais ouvert aux rencontres et à l’imprévu. De jeunes Italiennes se donnent à lui sans pouvoir se l’attacher. Après Florence, Rome, bientôt Naples. Stendhal s’annonce. L’écrivain qu’il n’est pas encore le devient en noircissant cahier après cahier, les impressions s’y mêlent aux documents, pratique que les Goncourt prolongeront après leur propre traversée de l’Italie. Convention d’époque, le mode épistolaire, souligne Michel Delon, déploie ici les premiers vertiges d’une parole singulière. Outre les beautés du tourisme moderne, auquel il touche par l’intermédiaire de peintres qui guident ses visites, les mœurs du haut clergé lui sont d’un enseignement utile. Son oncle l’avait déniaisé très tôt quant aux successeurs et serviteurs de saint Pierre. Le cardinal de Bernis, cher à Jean-Marie Rouart, complète son éducation. C’est déjà Sodoma, mais en mieux écrit et plus varié. Du reste, Sade pratique les deux sexes avec le même entrain. Sa peinture des hypocrisies de l’institution cléricale, autre différence, reste étanche au ton victimaire actuel. Face à « l’orgueil et l’intolérance […] des hommes enfroqués », la révolte lui va mieux déjà. Somptueusement présenté, enrichi d’un entretien avec Pierre Leroy, l’heureux propriétaire de ces cahiers que Delon et la Fondation Bodmer exposaient en 2014, Voyage en Italie a bien des charmes, celui du génie français en plus. SG/ Sade, Voyage d’Italie, édition établie et commenté par Michel Delon, Flammarion, 2019, 22€.
Puni de mort pour avoir fauté et surtout foutré de façon peu catholique, Sade prend la route de l’Italie en juillet 1775. Louis XVI vient de monter sur le trône, il a fait le ménage parmi le personnel de son lubrique grand-père. Les temps changent, pas Sade. Le bon air de la Toscane l’attire d’abord, Donatien s’éloigne du théâtre de ses méfaits, Arcueil, Marseille, Lacoste, convaincu que d’autres plaisirs, licites ou pas, l’attendent à Florence, en plus des trésors de la Renaissance. C’est son Grand Tour, certes obligé, mais ouvert aux rencontres et à l’imprévu. De jeunes Italiennes se donnent à lui sans pouvoir se l’attacher. Après Florence, Rome, bientôt Naples. Stendhal s’annonce. L’écrivain qu’il n’est pas encore le devient en noircissant cahier après cahier, les impressions s’y mêlent aux documents, pratique que les Goncourt prolongeront après leur propre traversée de l’Italie. Convention d’époque, le mode épistolaire, souligne Michel Delon, déploie ici les premiers vertiges d’une parole singulière. Outre les beautés du tourisme moderne, auquel il touche par l’intermédiaire de peintres qui guident ses visites, les mœurs du haut clergé lui sont d’un enseignement utile. Son oncle l’avait déniaisé très tôt quant aux successeurs et serviteurs de saint Pierre. Le cardinal de Bernis, cher à Jean-Marie Rouart, complète son éducation. C’est déjà Sodoma, mais en mieux écrit et plus varié. Du reste, Sade pratique les deux sexes avec le même entrain. Sa peinture des hypocrisies de l’institution cléricale, autre différence, reste étanche au ton victimaire actuel. Face à « l’orgueil et l’intolérance […] des hommes enfroqués », la révolte lui va mieux déjà. Somptueusement présenté, enrichi d’un entretien avec Pierre Leroy, l’heureux propriétaire de ces cahiers que Delon et la Fondation Bodmer exposaient en 2014, Voyage en Italie a bien des charmes, celui du génie français en plus. SG/ Sade, Voyage d’Italie, édition établie et commenté par Michel Delon, Flammarion, 2019, 22€.
 Monde ingrat, oublieux des gloires les moins usurpées ! L’immense Senancour, cher au regretté Jean Borie, aurait raté sa sortie, le 10 janvier 1846, au dire de sa fille… A 76 ans, l’immortel auteur d’Obermann se serait vu souffler la vedette par le mime Jean-Gaspard Debureau, mort pourtant en juin de cette année, et que les journaux encensent. La presse, encombrée du mime, enterra donc l’écrivain discret sous son indifférence. Ce pieux mensonge, aux couleurs de l’hagiographie nécessairement contrite, éclaire toutefois une situation. Malgré le soutien actif des romantiques, de Sainte-Beuve à George Sand, en passant par Nerval, Senancour, au moment de retrouver un Créateur dont l’existence lui semblait incertaine, n’avait pas acquis sa place au Paradis des lettres modernes. Est-ce une cause perdue ? Béatrice Didier et ses disciples se refusent à le penser. Avec un soin digne des plus grands éloges, ils ressuscitent les premiers écrits de Senancour, tout parfumés de la Révolution naissante et de l’inventaire que cette jeune plume exilée (volontaire), depuis la Suisse, opère parmi les ténors des Lumières. Buffon et Rousseau, à la faveur de ce tri, entraînent le « rêveur des Alpes », ce marcheur malheureux en amour, vers des réflexions que France Culture dirait actuelles. Mieux, (op)pressantes. Senancour, rousseauiste déniaisé, ne croit pas à la bonté de Dieu, ni à celle de l’homme, n’idéalise pas plus la civilisation et le progrès que les origines de l’humanité. Il faut raison garder en tout, art, éthique et politique. Les bassesses sucrées de Chateaubriand à la chute de Napoléon l’écœurent. Témoin des veuleries de l’âge moderne, il aimait à reporter ses espoirs vers les liens renouvelés de la nature et du citoyen, chacun faisant un pas vers l’autre, hors de toute mystique primitiviste et de toute barbarie libératrice. Actuel, ô combien ! SG / Etienne Pivert de Senancour, Œuvres complètes sous la direction de Fabienne Bercegol, Tome I, Les Premiers Âges, Sur les générations actuelles édition de Dominique Giovacchini, Classiques Garnier, 2019, 42€
Monde ingrat, oublieux des gloires les moins usurpées ! L’immense Senancour, cher au regretté Jean Borie, aurait raté sa sortie, le 10 janvier 1846, au dire de sa fille… A 76 ans, l’immortel auteur d’Obermann se serait vu souffler la vedette par le mime Jean-Gaspard Debureau, mort pourtant en juin de cette année, et que les journaux encensent. La presse, encombrée du mime, enterra donc l’écrivain discret sous son indifférence. Ce pieux mensonge, aux couleurs de l’hagiographie nécessairement contrite, éclaire toutefois une situation. Malgré le soutien actif des romantiques, de Sainte-Beuve à George Sand, en passant par Nerval, Senancour, au moment de retrouver un Créateur dont l’existence lui semblait incertaine, n’avait pas acquis sa place au Paradis des lettres modernes. Est-ce une cause perdue ? Béatrice Didier et ses disciples se refusent à le penser. Avec un soin digne des plus grands éloges, ils ressuscitent les premiers écrits de Senancour, tout parfumés de la Révolution naissante et de l’inventaire que cette jeune plume exilée (volontaire), depuis la Suisse, opère parmi les ténors des Lumières. Buffon et Rousseau, à la faveur de ce tri, entraînent le « rêveur des Alpes », ce marcheur malheureux en amour, vers des réflexions que France Culture dirait actuelles. Mieux, (op)pressantes. Senancour, rousseauiste déniaisé, ne croit pas à la bonté de Dieu, ni à celle de l’homme, n’idéalise pas plus la civilisation et le progrès que les origines de l’humanité. Il faut raison garder en tout, art, éthique et politique. Les bassesses sucrées de Chateaubriand à la chute de Napoléon l’écœurent. Témoin des veuleries de l’âge moderne, il aimait à reporter ses espoirs vers les liens renouvelés de la nature et du citoyen, chacun faisant un pas vers l’autre, hors de toute mystique primitiviste et de toute barbarie libératrice. Actuel, ô combien ! SG / Etienne Pivert de Senancour, Œuvres complètes sous la direction de Fabienne Bercegol, Tome I, Les Premiers Âges, Sur les générations actuelles édition de Dominique Giovacchini, Classiques Garnier, 2019, 42€
 Senancour et Chateaubriand, son aîné de peu, appartiennent à cette génération, celle qui a 20 ans quand implose le monde de leur enfance protégée, mais frottée aux lectures portant à l’exotisme, de Raynal aux digressions de Rousseau sur l’homme primitif et le paradis perdu. « Sous-lieutenant d’artillerie en disponibilité » (Marc Fumaroli), le jeune François-René laisse également son imagination s’allumer aux récits de Peaux-Rouges. Mais, point de naïveté ici, sa décision de passer dans le nouveau monde, en avril 1791, ne répondait pas seulement au besoin de charger sa palette et d’alimenter sa « Muse vierge ». La politique, son intérêt propre d’abord, est toujours entrée dans les desseins du futur enchanteur. Songeons avec effroi qu’un an plus tôt il hésitait à rejoindre Saint-Domingue, pierre angulaire du commerce américain, et bientôt terre de révolte des esclaves, à laquelle la République reste attachée. Bonaparte, jusqu’à la vente de la Louisiane, en était obsédé. Le nouveau monde, bien fait pour attirer un rejeton de l’aristocratie malouine, lui paraît, donc, une « terre d’opportunités » alternative. De ces huit mois passés dans la région des grands lacs et du Mississippi, où les Français ne manquent pas, il devait tirer, en 1829, son Voyage en Amérique. En quarante ans, ses impressions viatiques ont eu le temps de se décanter, les Indiens et la nature de devenir plus sauvages. Sébastien Baudouin, éditeur inspiré de ce grand texte nostalgique et déjà critique du technicisme Etats-Unien, en a bien repéré l’arrière-plan : la perte de l’empire colonial en sa composante atlantique, le mariage manqué entre l’Ancien régime et la première révolution, la promesse non tenue du « genre humain recommencé », le tout écrit à la lumière de son opposition croissante aux ultras de la Restauration agonisante. Un livre clef, prélude aux Mémoires d’outre-tombe. SG / Chateaubriand, Voyage en Amérique, édition de Sébastien Baudoin, Gallimard, Folio Classique, 2019, 10,80€.
Senancour et Chateaubriand, son aîné de peu, appartiennent à cette génération, celle qui a 20 ans quand implose le monde de leur enfance protégée, mais frottée aux lectures portant à l’exotisme, de Raynal aux digressions de Rousseau sur l’homme primitif et le paradis perdu. « Sous-lieutenant d’artillerie en disponibilité » (Marc Fumaroli), le jeune François-René laisse également son imagination s’allumer aux récits de Peaux-Rouges. Mais, point de naïveté ici, sa décision de passer dans le nouveau monde, en avril 1791, ne répondait pas seulement au besoin de charger sa palette et d’alimenter sa « Muse vierge ». La politique, son intérêt propre d’abord, est toujours entrée dans les desseins du futur enchanteur. Songeons avec effroi qu’un an plus tôt il hésitait à rejoindre Saint-Domingue, pierre angulaire du commerce américain, et bientôt terre de révolte des esclaves, à laquelle la République reste attachée. Bonaparte, jusqu’à la vente de la Louisiane, en était obsédé. Le nouveau monde, bien fait pour attirer un rejeton de l’aristocratie malouine, lui paraît, donc, une « terre d’opportunités » alternative. De ces huit mois passés dans la région des grands lacs et du Mississippi, où les Français ne manquent pas, il devait tirer, en 1829, son Voyage en Amérique. En quarante ans, ses impressions viatiques ont eu le temps de se décanter, les Indiens et la nature de devenir plus sauvages. Sébastien Baudouin, éditeur inspiré de ce grand texte nostalgique et déjà critique du technicisme Etats-Unien, en a bien repéré l’arrière-plan : la perte de l’empire colonial en sa composante atlantique, le mariage manqué entre l’Ancien régime et la première révolution, la promesse non tenue du « genre humain recommencé », le tout écrit à la lumière de son opposition croissante aux ultras de la Restauration agonisante. Un livre clef, prélude aux Mémoires d’outre-tombe. SG / Chateaubriand, Voyage en Amérique, édition de Sébastien Baudoin, Gallimard, Folio Classique, 2019, 10,80€.
 Après avoir fait entrer Le Roi s’amuse, Lucrèce Borgia et Marie Tudor en Folio-Théâtre, Clélia Anfray y intronise doctement le moins joué aujourd’hui des drames de Victor Hugo, Marion de Lorme. Se pourrait-il qu’il scandalisât notre époque pourtant riche en prostitutions et en bassesses politiques de toutes natures ? Les empêchements forment le cortège historique d’un ouvrage où Hugo voit d’abord l’occasion de défier Corneille, son idole, et Charles X, son roi, le premier avec admiration, le second avec dépit. Quel caillou dans sa chaussure de poète pensionné que la fin lamentable de la Restauration (les libéraux y mirent du leur) ! La chose, tragique et comique, d’une langue bondissante quand elle évite le sentimental, s’appela d’abord Un duel sous Richelieu. En 1829, Dumas et Taylor s’emballent. Le second voit déjà la pièce triompher sur la scène de la Comédie-Française. La Censure s’y oppose : on ne traite pas ainsi Louis XIII et Richelieu. La pièce bâillonnée attendra l’éclair de juillet pour être jouée. Maigre succès, déjà. Les vrais romantiques, Gautier en tête, ne s’identifient pas aux larmes de la courtisane au grand cœur, qui n’est pas la seule entorse à l’histoire. « Maintenant l’art est libre : c’est à lui de rester digne », proclame la préface d’août 1831. Ce n’est pas la « dignité » du drame, ce sont ses traits baroques, comme le costume bleu et orange d’un des protagonistes, ce sont ses saillies comiques et sexuées, qui ont le mieux vécu. « Pas de grâce ! », prononce le Dieu caché qu’est Richelieu, invisible au spectateur. Au contraire, grâce, grâce, pour Marion de Lorme. SG/ Victor Hugo, Marion de Lorme, édition présentée, établie et annotée par Clélia Anfray, Gallimard, Folio-Théâtre, 6,80€.
Après avoir fait entrer Le Roi s’amuse, Lucrèce Borgia et Marie Tudor en Folio-Théâtre, Clélia Anfray y intronise doctement le moins joué aujourd’hui des drames de Victor Hugo, Marion de Lorme. Se pourrait-il qu’il scandalisât notre époque pourtant riche en prostitutions et en bassesses politiques de toutes natures ? Les empêchements forment le cortège historique d’un ouvrage où Hugo voit d’abord l’occasion de défier Corneille, son idole, et Charles X, son roi, le premier avec admiration, le second avec dépit. Quel caillou dans sa chaussure de poète pensionné que la fin lamentable de la Restauration (les libéraux y mirent du leur) ! La chose, tragique et comique, d’une langue bondissante quand elle évite le sentimental, s’appela d’abord Un duel sous Richelieu. En 1829, Dumas et Taylor s’emballent. Le second voit déjà la pièce triompher sur la scène de la Comédie-Française. La Censure s’y oppose : on ne traite pas ainsi Louis XIII et Richelieu. La pièce bâillonnée attendra l’éclair de juillet pour être jouée. Maigre succès, déjà. Les vrais romantiques, Gautier en tête, ne s’identifient pas aux larmes de la courtisane au grand cœur, qui n’est pas la seule entorse à l’histoire. « Maintenant l’art est libre : c’est à lui de rester digne », proclame la préface d’août 1831. Ce n’est pas la « dignité » du drame, ce sont ses traits baroques, comme le costume bleu et orange d’un des protagonistes, ce sont ses saillies comiques et sexuées, qui ont le mieux vécu. « Pas de grâce ! », prononce le Dieu caché qu’est Richelieu, invisible au spectateur. Au contraire, grâce, grâce, pour Marion de Lorme. SG/ Victor Hugo, Marion de Lorme, édition présentée, établie et annotée par Clélia Anfray, Gallimard, Folio-Théâtre, 6,80€.
 Avant de devenir les historiens de leur temps, les Gavarni, voire les Degas des mœurs contemporaines, Jules et Edmond de Goncourt se firent les chiffonniers de la France d’avant 1789, avant le règne du nombre et de la bigoterie morale. On sait ce que Baudelaire doit à leur Femme du XVIIIe siècle (1862). Précédemment, avec le zèle des dépités du présent, ils publièrent toutes sortes de précis où revivait la société ancienne, croquée à partir des traces qu’elle avait laissées dans les correspondances, les journaux intimes et la presse de l’Ancien Régime. En 1857, l’année des Fleurs du mal et sous la même enseigne, paraissait le livre qu’ils consacrèrent à l’actrice Sophie Arnould, nourri essentiellement de sa correspondance et de ses mémoires inédits. Il en allait plus que de la simple curiosité maladive de chineurs invétérés. Emboîtant le pas d’Arsène Houssaye et de Gautier, les deux frères, partis à la recherche d’eux-mêmes, reconquièrent, réinventent l’âge du rococo, leur âge d’or, temps des libertés individuelles, d’un hédonisme qui transcendait les classes et électrisait les arts et les lettres. Barbey exagère en les accusant d’avoir chanté les beautés et les licences qui auraient été fatales à la royauté. Au contraire, Les Portraits intimes du XVIIIe siècle (1857-1858), admirablement réédités, en s’intéressant aussi bien à Louis XV et Louis XVI qu’à Beaumarchais et Madame du Barry, rêvent d’un siècle qui eût très bien pu accoucher d’une révolution heureuse. Il y a beaucoup plus réactionnaires qu’eux, il y a surtout plus mauvais écrivains. Les Goncourt, comme Paul de Saint-Victor le voit aussitôt, inventent un style accordé à leur enquête, d’un faux laisser-aller et d’un vrai bonheur. Cette « entreprise de résurrection d’une société morte » (Catherine Thomas) marquerait tout le siècle suivant. SG / Edmond et Jules de Goncourt, Œuvres complètes, Œuvres d’histoire sous la direction de Pierre-Jean Dufief, tome IV, Portraits intimes du XVIIIe siècle, textes établis, annotés et préfacés par Catherine Thomas, Honoré Champion, 2019, 80€
Avant de devenir les historiens de leur temps, les Gavarni, voire les Degas des mœurs contemporaines, Jules et Edmond de Goncourt se firent les chiffonniers de la France d’avant 1789, avant le règne du nombre et de la bigoterie morale. On sait ce que Baudelaire doit à leur Femme du XVIIIe siècle (1862). Précédemment, avec le zèle des dépités du présent, ils publièrent toutes sortes de précis où revivait la société ancienne, croquée à partir des traces qu’elle avait laissées dans les correspondances, les journaux intimes et la presse de l’Ancien Régime. En 1857, l’année des Fleurs du mal et sous la même enseigne, paraissait le livre qu’ils consacrèrent à l’actrice Sophie Arnould, nourri essentiellement de sa correspondance et de ses mémoires inédits. Il en allait plus que de la simple curiosité maladive de chineurs invétérés. Emboîtant le pas d’Arsène Houssaye et de Gautier, les deux frères, partis à la recherche d’eux-mêmes, reconquièrent, réinventent l’âge du rococo, leur âge d’or, temps des libertés individuelles, d’un hédonisme qui transcendait les classes et électrisait les arts et les lettres. Barbey exagère en les accusant d’avoir chanté les beautés et les licences qui auraient été fatales à la royauté. Au contraire, Les Portraits intimes du XVIIIe siècle (1857-1858), admirablement réédités, en s’intéressant aussi bien à Louis XV et Louis XVI qu’à Beaumarchais et Madame du Barry, rêvent d’un siècle qui eût très bien pu accoucher d’une révolution heureuse. Il y a beaucoup plus réactionnaires qu’eux, il y a surtout plus mauvais écrivains. Les Goncourt, comme Paul de Saint-Victor le voit aussitôt, inventent un style accordé à leur enquête, d’un faux laisser-aller et d’un vrai bonheur. Cette « entreprise de résurrection d’une société morte » (Catherine Thomas) marquerait tout le siècle suivant. SG / Edmond et Jules de Goncourt, Œuvres complètes, Œuvres d’histoire sous la direction de Pierre-Jean Dufief, tome IV, Portraits intimes du XVIIIe siècle, textes établis, annotés et préfacés par Catherine Thomas, Honoré Champion, 2019, 80€
 De toutes les nouvelles qui composent Les Diaboliques de Barbey d’Aurevilly, la moins gazée est La Vengeance d’une femme, la plus apte assurément à avoir attiré la censure sur le volume de 1874. Le connétable sulfureux, par un double retour sur soi, y arpente d’un même pas le Paris de la monarchie de Juillet finissante, la mémoire du roman balzacien et la réalité brutale de la haute prostitution qui les relie. On rappellera l’intrigue. Une superbe créature en robe safran surgit aux alentours du café Tortoni, au coin du boulevard des Italiens et de la rue Taitbout. Elle lève un lovelace dont le sang bout à sa vue. Ils rejoignent un hôtel rue Basse-du-Rempart, près de la Chaussée d’Antin, où règne le sexe tarifé. Le récit n’épargne rien au lecteur des « détails libertins » qui mirent Barbey et les censeurs en émoi. Parce que toute jouissance se complique de fantasmes, nés de lectures et de tableaux pour certains, le récit se tresse de représentations, ici la Judith de Vernet (Salon de 1831), là quelque bronze élégamment salace dont Pradier pourrait avoir été l’auteur. Ces références actives préparent la révélation finale. La « fille » n’en est pas pas une, la pierreuse de luxe n’est que le masque d’une grande d’Espagne qui se donne pour salir son mari, qui a fait tuer l’homme qu’elle aimait. Sa vengeance appelle aussi l’image, un médaillon enchâssant celle du bien-aimé pur de tout commerce charnel ! Aussi le plaisir qu’elle feint d’éprouver dans le coït ancillaire, autre piège, n’est-il que celui qu’elle se donne en utilisant ses partenaires d’occasion comme autant de substituts du défunt idéalisé. Judith Lyon-Caen, dans ce livre foisonnant, fait la démonstration des vertus de la « lecture documentaire » : tout grand livre fait sens en faisant signe vers le réel, dépose sur la matière du temps une griffe unique. SG / Judith Lyon-Caen, La Griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature, Gallimard, NRF Essais, 22€.
De toutes les nouvelles qui composent Les Diaboliques de Barbey d’Aurevilly, la moins gazée est La Vengeance d’une femme, la plus apte assurément à avoir attiré la censure sur le volume de 1874. Le connétable sulfureux, par un double retour sur soi, y arpente d’un même pas le Paris de la monarchie de Juillet finissante, la mémoire du roman balzacien et la réalité brutale de la haute prostitution qui les relie. On rappellera l’intrigue. Une superbe créature en robe safran surgit aux alentours du café Tortoni, au coin du boulevard des Italiens et de la rue Taitbout. Elle lève un lovelace dont le sang bout à sa vue. Ils rejoignent un hôtel rue Basse-du-Rempart, près de la Chaussée d’Antin, où règne le sexe tarifé. Le récit n’épargne rien au lecteur des « détails libertins » qui mirent Barbey et les censeurs en émoi. Parce que toute jouissance se complique de fantasmes, nés de lectures et de tableaux pour certains, le récit se tresse de représentations, ici la Judith de Vernet (Salon de 1831), là quelque bronze élégamment salace dont Pradier pourrait avoir été l’auteur. Ces références actives préparent la révélation finale. La « fille » n’en est pas pas une, la pierreuse de luxe n’est que le masque d’une grande d’Espagne qui se donne pour salir son mari, qui a fait tuer l’homme qu’elle aimait. Sa vengeance appelle aussi l’image, un médaillon enchâssant celle du bien-aimé pur de tout commerce charnel ! Aussi le plaisir qu’elle feint d’éprouver dans le coït ancillaire, autre piège, n’est-il que celui qu’elle se donne en utilisant ses partenaires d’occasion comme autant de substituts du défunt idéalisé. Judith Lyon-Caen, dans ce livre foisonnant, fait la démonstration des vertus de la « lecture documentaire » : tout grand livre fait sens en faisant signe vers le réel, dépose sur la matière du temps une griffe unique. SG / Judith Lyon-Caen, La Griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature, Gallimard, NRF Essais, 22€.
 Aurélie Petiot n’a pas tort d’user de la formule rituelle au sujet du préraphaélisme britannique : son ouvrage, dont l’illustration est aussi riche que variée et même surprenante, comble une lacune de la librairie française. Un beau livre manquait qui fît la synthèse de «l’abondante et récente littérature anglophone sur le sujet». Il ne s’écoule pas une année sans qu’une ou deux expositions ne mobilisent ces artistes que l’outre-Manche tient pour ses premiers modernes. Puisque cette modernité se voulut aussi esthétique que politique vers 1848, Petiot ne fait pas l’économie d’une analyse du réalisme et de la pensée sociale dont Millais, Hunt et Rossetti se prévalaient. Au sujet des femmes du cercle, on n’évite pas toujours les protestations anachroniques ou simplement sans fondement. A-t-on besoin, dans le même esprit, de parler de « queer » au sujet de l’androgynie chère à Burne-Jones, suiveur de Michel-Ange ? A propos des maîtres anciens que ces faux naïfs pillent tant et plus, Petiot apporte beaucoup, texte et images. On regrettera d’autant plus que l’inspiration religieuse de nos « rebel(les) » ne soit pas confrontée aux différences confessionnelles propres aux artistes anglais et au contexte anglican. Alors que ces mêmes artistes se réclamaient d’une probité anti-académique et d’un primitivisme réparateur, leur usage de la littérature ne fait jamais l’objet d’une véritable approche sémiologique. Plutôt que d’opposer les Préraphaélites à la peinture victorienne, l’auteur enfin aurait pu montrer l’évolution mondaine d’un Millais, portraitiste très vite recherché. Le chapitre final sur la réception française ne laisse pas moins à désirer, il souffre d’approximations pour le fou de Gautier que je suis. Le texte que Théophile consacre à l’école anglaise, lors de l’Exposition universelle de 1855, est mal cité, ce qui fausse sa lecture de l’Ophélie de Millais, l’un des trois tableaux dont le poète dit explicitement qu’il comptait parmi « les plus singuliers » de la compétition internationale voulue par Napoléon III. De chauvinisme et de cécité, point. Le texte de Gautier ne parut pas dans la Gazette des Beaux-Arts, qui n’existait pas encore, mais dans Les Beaux-Arts en Europe, deux volumes promis à être lus par Baudelaire, Huysmans, Mallarmé. La crème du génie français ne détestait pas, de temps à autre, changer de rivage. SG / Aurélie Petiot, Le Préraphaélisme, Citadelles et Mazenod, 189€.
Aurélie Petiot n’a pas tort d’user de la formule rituelle au sujet du préraphaélisme britannique : son ouvrage, dont l’illustration est aussi riche que variée et même surprenante, comble une lacune de la librairie française. Un beau livre manquait qui fît la synthèse de «l’abondante et récente littérature anglophone sur le sujet». Il ne s’écoule pas une année sans qu’une ou deux expositions ne mobilisent ces artistes que l’outre-Manche tient pour ses premiers modernes. Puisque cette modernité se voulut aussi esthétique que politique vers 1848, Petiot ne fait pas l’économie d’une analyse du réalisme et de la pensée sociale dont Millais, Hunt et Rossetti se prévalaient. Au sujet des femmes du cercle, on n’évite pas toujours les protestations anachroniques ou simplement sans fondement. A-t-on besoin, dans le même esprit, de parler de « queer » au sujet de l’androgynie chère à Burne-Jones, suiveur de Michel-Ange ? A propos des maîtres anciens que ces faux naïfs pillent tant et plus, Petiot apporte beaucoup, texte et images. On regrettera d’autant plus que l’inspiration religieuse de nos « rebel(les) » ne soit pas confrontée aux différences confessionnelles propres aux artistes anglais et au contexte anglican. Alors que ces mêmes artistes se réclamaient d’une probité anti-académique et d’un primitivisme réparateur, leur usage de la littérature ne fait jamais l’objet d’une véritable approche sémiologique. Plutôt que d’opposer les Préraphaélites à la peinture victorienne, l’auteur enfin aurait pu montrer l’évolution mondaine d’un Millais, portraitiste très vite recherché. Le chapitre final sur la réception française ne laisse pas moins à désirer, il souffre d’approximations pour le fou de Gautier que je suis. Le texte que Théophile consacre à l’école anglaise, lors de l’Exposition universelle de 1855, est mal cité, ce qui fausse sa lecture de l’Ophélie de Millais, l’un des trois tableaux dont le poète dit explicitement qu’il comptait parmi « les plus singuliers » de la compétition internationale voulue par Napoléon III. De chauvinisme et de cécité, point. Le texte de Gautier ne parut pas dans la Gazette des Beaux-Arts, qui n’existait pas encore, mais dans Les Beaux-Arts en Europe, deux volumes promis à être lus par Baudelaire, Huysmans, Mallarmé. La crème du génie français ne détestait pas, de temps à autre, changer de rivage. SG / Aurélie Petiot, Le Préraphaélisme, Citadelles et Mazenod, 189€.
 On sait la terrible gêne financière où se débat le dernier Verlaine, celui des années 1892-1896, durant lesquelles le poète revenu au Christ n’échappe pas à la fée verte. Étrange cocktail ! Le prince de la Décadence y noie doucement un reste de génie et de vie. Les conférences qu’il donne alors le soutiennent un peu sans l’enrichir. C’est le cas de celle qu’il prononça péniblement au Procope, lieu idoine, le 29 mars 1894, dont le texte était supposé perdu et sur lequel Patrice Locmant a remis la main. Dans la salle, Catulle Mendès, Armand Silvestre et Gabriel Yturri, le secrétaire de Robert de Montesquiou. Lors de la causerie en question, il dira la haute estime que ce dernier portait à Marceline Desbordes-Valmore. Que diable Verlaine, direz-vous, avait-il besoin de priser en public la poétesse romantique, au Procope, en cette année d’attentats anarchistes ? A la demande de l’association des Rosati, une société anacréontique née en Artois au XVIIIe siècle, il avait accepté de chanter les fortes vertus du régionalisme et notamment la santé de ces félibres du Nord, dont il rapprochait, outre Marceline, le Sainte-Beuve des Rayons jaunes. L’absence d’emphase qui les caractérise lui semble préférable à la lyre des grands romantiques… Au-delà, Verlaine en vient à exalter la « réaction des patries contre, non pas au grand jamais et Dieu Merci ! la Patrie, mais contre l’unité factice, forcée, contre l’absorption par le préjugé jacobin et monarchique de toutes les forces intellectuelles et morales françaises… » Ne sourions pas trop vite, son ami Mallarmé, à la même époque, lié au Félibre de longue date, ne manquait pas une occasion de célébrer les expressions régionales du génie français (voir notre recension de la Correspondance du faune dans le numéro d’été de la Revue des deux mondes). SG / Paul Verlaine, Les Poètes du Nord, édition établie, présentée et annotée par Patrice Locmant, Gallimard, 12€.
On sait la terrible gêne financière où se débat le dernier Verlaine, celui des années 1892-1896, durant lesquelles le poète revenu au Christ n’échappe pas à la fée verte. Étrange cocktail ! Le prince de la Décadence y noie doucement un reste de génie et de vie. Les conférences qu’il donne alors le soutiennent un peu sans l’enrichir. C’est le cas de celle qu’il prononça péniblement au Procope, lieu idoine, le 29 mars 1894, dont le texte était supposé perdu et sur lequel Patrice Locmant a remis la main. Dans la salle, Catulle Mendès, Armand Silvestre et Gabriel Yturri, le secrétaire de Robert de Montesquiou. Lors de la causerie en question, il dira la haute estime que ce dernier portait à Marceline Desbordes-Valmore. Que diable Verlaine, direz-vous, avait-il besoin de priser en public la poétesse romantique, au Procope, en cette année d’attentats anarchistes ? A la demande de l’association des Rosati, une société anacréontique née en Artois au XVIIIe siècle, il avait accepté de chanter les fortes vertus du régionalisme et notamment la santé de ces félibres du Nord, dont il rapprochait, outre Marceline, le Sainte-Beuve des Rayons jaunes. L’absence d’emphase qui les caractérise lui semble préférable à la lyre des grands romantiques… Au-delà, Verlaine en vient à exalter la « réaction des patries contre, non pas au grand jamais et Dieu Merci ! la Patrie, mais contre l’unité factice, forcée, contre l’absorption par le préjugé jacobin et monarchique de toutes les forces intellectuelles et morales françaises… » Ne sourions pas trop vite, son ami Mallarmé, à la même époque, lié au Félibre de longue date, ne manquait pas une occasion de célébrer les expressions régionales du génie français (voir notre recension de la Correspondance du faune dans le numéro d’été de la Revue des deux mondes). SG / Paul Verlaine, Les Poètes du Nord, édition établie, présentée et annotée par Patrice Locmant, Gallimard, 12€.
 De 1898, Elisabeth II aurait pu dire qu’elle fut une « annus horribilis », expression qui n’aurait pas déplu à Jean de Tinan pour toutes sortes de raisons. La première, c’est qu’il se meurt à 24 ans, en pleine possession de sa tête et de ses moyens littéraires. 1898, c’est aussi L’Affaire, bien sûr, qui affleure sous sa plume vive, exacte et drôle, chargée de cette « ironie tendre » qu’il aimait chez Fargue. A force de le lire trop vite, on l’a classé parmi les anti-dreyfusards. Ses Lettres à Madame Bulteau, une bénédiction que l’on doit à l’impeccable curiosité de Claude Sicard, obligent à corriger cette fausse évidence. Évidemment, son humour fera jaser les tristes sires. Ce trait d’élégance amusée, il le partageait avec un groupe qui ne se confond ni avec le décadentisme fin-de-siècle, ni avec le grave et ennuyeux symbolisme. Augustine Bulteau, collaboratrice du Gaulois et du Figaro, sa mère de substitution, l’associait à « la fleur de l’esprit français », ce dont Mallarmé, qui correspond avec Tinan, eût convenu. Inédit décisif, au même titre que le Journal intime des années 1894-1895 édité par Jean-Paul Goujon (Bartillat, 2016), cet ensemble de lettres a été sauvé par le grand Jean-Louis Vaudoyer. On vérifie à chaque page la valeur de la constellation des amis de Tinan, notamment Maxime Dethomas et un certain Toulouse. Les experts de Lautrec ne se soucient pas de ses accointances littéraires, bien que Paul Leclercq ait été catégorique à ce sujet et notamment le lien qui unissait le peintre et l’auteur de L’Exemple de Ninon de Lenclos dont il dessina la couverture, en 1898 ! SG/Jean de Tinan, Lettres à Madame Bulteau, édition établie, présentée et annotée par Claude Sicard, Honoré Champion, 2019, 48€.
De 1898, Elisabeth II aurait pu dire qu’elle fut une « annus horribilis », expression qui n’aurait pas déplu à Jean de Tinan pour toutes sortes de raisons. La première, c’est qu’il se meurt à 24 ans, en pleine possession de sa tête et de ses moyens littéraires. 1898, c’est aussi L’Affaire, bien sûr, qui affleure sous sa plume vive, exacte et drôle, chargée de cette « ironie tendre » qu’il aimait chez Fargue. A force de le lire trop vite, on l’a classé parmi les anti-dreyfusards. Ses Lettres à Madame Bulteau, une bénédiction que l’on doit à l’impeccable curiosité de Claude Sicard, obligent à corriger cette fausse évidence. Évidemment, son humour fera jaser les tristes sires. Ce trait d’élégance amusée, il le partageait avec un groupe qui ne se confond ni avec le décadentisme fin-de-siècle, ni avec le grave et ennuyeux symbolisme. Augustine Bulteau, collaboratrice du Gaulois et du Figaro, sa mère de substitution, l’associait à « la fleur de l’esprit français », ce dont Mallarmé, qui correspond avec Tinan, eût convenu. Inédit décisif, au même titre que le Journal intime des années 1894-1895 édité par Jean-Paul Goujon (Bartillat, 2016), cet ensemble de lettres a été sauvé par le grand Jean-Louis Vaudoyer. On vérifie à chaque page la valeur de la constellation des amis de Tinan, notamment Maxime Dethomas et un certain Toulouse. Les experts de Lautrec ne se soucient pas de ses accointances littéraires, bien que Paul Leclercq ait été catégorique à ce sujet et notamment le lien qui unissait le peintre et l’auteur de L’Exemple de Ninon de Lenclos dont il dessina la couverture, en 1898 ! SG/Jean de Tinan, Lettres à Madame Bulteau, édition établie, présentée et annotée par Claude Sicard, Honoré Champion, 2019, 48€.
 C’est l’histoire de l’exhumeur exhumé ! Car qui connaît Frédéric Lachèvre (1855-1943) en dehors des fanatiques du libertinage français des XVIIe et XVIIIe siècles ? En le tirant de cet oubli relatif, Aurélie Julia, son arrière-arrière-petite-fille, aujourd’hui très active à la Revue des deux mondes, ne s’est pas seulement acquittée d’une dette de famille. Du reste, elle aborde la figure et la frénésie bibliophilique de ce burgrave maurrassien avec la bonne distance, bien qu’on ne puisse pas se défendre de tendresse et d’admiration pour ce rentier austère qui aura donné sa vie, et une partie de sa fortune, aux grandes plumes de la libre pensée et des mauvaises mœurs. Certes, il y a libertins et libertins, surtout aux yeux d’un chercheur, d’un dénicheur de livres rares, dont la vie rangée, politiquement, moralement et religieusement nette, s’opposait aux écarts de ses sujets d’étude. Sans doute, moins inquisitrice, son exigence éditoriale eût-elle été moins scrupuleuse et son héritage plus sujet à caution aujourd’hui. Aurélie Julia fait entendre la voix de ses adversaires, ceux qui ne lui pardonnent pas « l’exécration morale et idéologique » dont il accablait les responsables du grand naufrage. Les lecteurs des Grotesques de Gautier, résurrection flamboyante de la littérature mousquetaire, sauront apprécier cette douche froide. Par ailleurs, l’homme de Théophile de Viau, Claude le Petit, Cyrano de Bergerac (le vrai) et Blessebois, « Casanova du XVIIe siècle », n’a pas négligé, parmi les ombres et les oubliés à repêcher, la cohorte des petits romantiques. Un saint ! SG / Aurélie Julia, Frédéric Lachèvre (1855-1943). Un érudit à la découverte du XVIIe siècle libertin, Honoré Champion, 2019, 35€.
C’est l’histoire de l’exhumeur exhumé ! Car qui connaît Frédéric Lachèvre (1855-1943) en dehors des fanatiques du libertinage français des XVIIe et XVIIIe siècles ? En le tirant de cet oubli relatif, Aurélie Julia, son arrière-arrière-petite-fille, aujourd’hui très active à la Revue des deux mondes, ne s’est pas seulement acquittée d’une dette de famille. Du reste, elle aborde la figure et la frénésie bibliophilique de ce burgrave maurrassien avec la bonne distance, bien qu’on ne puisse pas se défendre de tendresse et d’admiration pour ce rentier austère qui aura donné sa vie, et une partie de sa fortune, aux grandes plumes de la libre pensée et des mauvaises mœurs. Certes, il y a libertins et libertins, surtout aux yeux d’un chercheur, d’un dénicheur de livres rares, dont la vie rangée, politiquement, moralement et religieusement nette, s’opposait aux écarts de ses sujets d’étude. Sans doute, moins inquisitrice, son exigence éditoriale eût-elle été moins scrupuleuse et son héritage plus sujet à caution aujourd’hui. Aurélie Julia fait entendre la voix de ses adversaires, ceux qui ne lui pardonnent pas « l’exécration morale et idéologique » dont il accablait les responsables du grand naufrage. Les lecteurs des Grotesques de Gautier, résurrection flamboyante de la littérature mousquetaire, sauront apprécier cette douche froide. Par ailleurs, l’homme de Théophile de Viau, Claude le Petit, Cyrano de Bergerac (le vrai) et Blessebois, « Casanova du XVIIe siècle », n’a pas négligé, parmi les ombres et les oubliés à repêcher, la cohorte des petits romantiques. Un saint ! SG / Aurélie Julia, Frédéric Lachèvre (1855-1943). Un érudit à la découverte du XVIIe siècle libertin, Honoré Champion, 2019, 35€.
 Louise Bourgeois (1911-2010), que son Amérique d’adoption aura tant tardé à consacrer, était française jusqu’au bout des ongles. Son élégance, précoce et durable, ne trompe pas. La famille a des moyens et sa fierté. L’enfant, puis la jeune fille, porte des robes Poiret et Chanel dans les années 20-30, tient un journal, découvre son pouvoir sur les hommes. L’un d’entre eux, le brillant Robert Goldwater l’épouse en 1937, mais n’étouffe pas les ambitions artistiques de Louise. A l’Académie de la Grande-Chaumière, où elle se forme, les rencontres comptent autant que l’apprentissage. Elle croit, Louise, au savoir-faire, n’idéalise pas l’instinct. En 1938, l’année où Goldwater organise la mythique exposition Primitivism in Modern Art (qui lui vaudrait aujourd’hui les foudres du communautarisme bien-pensant ), le couple a rejoint New York, la ville du MoMa. Auprès de ses amis restés en France, elle se fait mousser ingénument, en prétendant, par exemple y avoir croisé Picasso. Cette tendance à l’affabulation, Marie-Laure Bernadac, dans l’excellente et très sourcée biographie qu’elle lui consacre, en donne d’autres exemples. Mais, Dieu soit loué, elle ne les condamne pas. Louise, épouse infidèle, ne voit simplement pas la nécessité de ne pas colorer sa vie, présente et passée, d’un peu de fiction, de même qu’elle laissera croire que son œuvre découle du « roman familial », œdipien en diable, où elle aurait grandi… Comment y voir clair dans le vertige des apparences? Bernadac, qui a déjà beaucoup publié sur l’artiste, en connaît bien l’archive, très fournie. Elle parle et exploite aussi bien le fétichisme de Bourgeois, qui n’est pas sans rappeler celui de Picasso. Ce dernier, par un hasard qui n’en est peut-être pas un, fascine très tôt Louise, on l’a vu. L’emprise picassienne ne saurait, évidemment, faire oublier l’attention qu’elle porte vite au surréalisme dont New York devient la seconde capitale bien avant l’exil de Masson et Breton. Il lui répugne vite, toutefois, de n’être qu’une séide des marchands de rêves. Le sexe, dans sa crudité, fait souvent défaut à l’art du cercle de Breton. « Je suis femme. Je n’ai pas besoin d’être féministe », aimait-elle à rappeler. Il est peu de Françaises qui aient autant montré de génie dans les arts visuels et su leur donner un sexe, le sien. SG / Marie-Laure Bernadac, Louise Bourgeois, Flammarion, 32€.
Louise Bourgeois (1911-2010), que son Amérique d’adoption aura tant tardé à consacrer, était française jusqu’au bout des ongles. Son élégance, précoce et durable, ne trompe pas. La famille a des moyens et sa fierté. L’enfant, puis la jeune fille, porte des robes Poiret et Chanel dans les années 20-30, tient un journal, découvre son pouvoir sur les hommes. L’un d’entre eux, le brillant Robert Goldwater l’épouse en 1937, mais n’étouffe pas les ambitions artistiques de Louise. A l’Académie de la Grande-Chaumière, où elle se forme, les rencontres comptent autant que l’apprentissage. Elle croit, Louise, au savoir-faire, n’idéalise pas l’instinct. En 1938, l’année où Goldwater organise la mythique exposition Primitivism in Modern Art (qui lui vaudrait aujourd’hui les foudres du communautarisme bien-pensant ), le couple a rejoint New York, la ville du MoMa. Auprès de ses amis restés en France, elle se fait mousser ingénument, en prétendant, par exemple y avoir croisé Picasso. Cette tendance à l’affabulation, Marie-Laure Bernadac, dans l’excellente et très sourcée biographie qu’elle lui consacre, en donne d’autres exemples. Mais, Dieu soit loué, elle ne les condamne pas. Louise, épouse infidèle, ne voit simplement pas la nécessité de ne pas colorer sa vie, présente et passée, d’un peu de fiction, de même qu’elle laissera croire que son œuvre découle du « roman familial », œdipien en diable, où elle aurait grandi… Comment y voir clair dans le vertige des apparences? Bernadac, qui a déjà beaucoup publié sur l’artiste, en connaît bien l’archive, très fournie. Elle parle et exploite aussi bien le fétichisme de Bourgeois, qui n’est pas sans rappeler celui de Picasso. Ce dernier, par un hasard qui n’en est peut-être pas un, fascine très tôt Louise, on l’a vu. L’emprise picassienne ne saurait, évidemment, faire oublier l’attention qu’elle porte vite au surréalisme dont New York devient la seconde capitale bien avant l’exil de Masson et Breton. Il lui répugne vite, toutefois, de n’être qu’une séide des marchands de rêves. Le sexe, dans sa crudité, fait souvent défaut à l’art du cercle de Breton. « Je suis femme. Je n’ai pas besoin d’être féministe », aimait-elle à rappeler. Il est peu de Françaises qui aient autant montré de génie dans les arts visuels et su leur donner un sexe, le sien. SG / Marie-Laure Bernadac, Louise Bourgeois, Flammarion, 32€.
 Genre littéraire, la visite à l’écrivain, a accouché du meilleur et du pire depuis la fin du XIXe siècle, son premier pic… Patricia Boyer de Latour, cent ans plus tard, est entrée dans la vie de Dominique Rolin et n’en est jamais sortie. Aux questions qu’elle pose, aux réponses qu’elle obtient, aux livres qu’elle a tirés de leurs longues et libres conversations, recommencées selon un rituel intangible, on comprend la raison de leur confiance mutuelle. Quand le dialogue s’amorce, Dominique Rolin aborde le grand âge sans crainte du grand saut. Elle a tellement charmé la vie qu’elle charme sa mort, en parle comme d’une présence familière qui va et vient, à la manière de souris. L’écrivain arrachera, du reste, une douzaine d’années à cette complice espiègle. « Oui, pas de morbidité », intime-t-elle avec douceur à Patricia Boyer de Latour, devenue vite une amie aussi chère que les vivants et les ombres avec lesquels elle chemine chaque jour. Les entretiens que forment Plaisirs et Messages secrets se veulent d’outre-tombe, la formule ne surgit pas fortuitement au cours des échanges. Elle n’est porteuse d’aucun dolorisme et d’apitoiement. Célèbre à moins de trente ans, dans le Paris de l’Occupation, elle est proche alors de Cocteau, qui a fait un accueil triomphal au Marais, publié chez Denoël. Première histoire d’amour avec l’éditeur, son aîné, belge comme elle, dont la mort la bouleversera. Plaisirs évoque sans cachoterie cette époque et certaines amitiés littéraires, de Marcel Aymé à Blondin, que d’autres auraient préféré ne pas commenter. L’auteur du Singe en hiver, siégeant au Prix Nimier, aimait à lui dire : « Sois belge et tais-toi ». Conseil que Blondin ne lui demandait pas de suivre, bien sûr. La preuve, ce sont ces deux livres du souvenir, réunis dans la lumière du bonheur d’avoir à parler littérature, peinture, amants et amours, Europe buissonnière, musique, toutes les musiques. « Il faut faire attention à la vie », conseillait-elle au jeune Sollers, en pleine guerre d’Algérie. Plus qu’un avis, une philosophie, une esthétique de l’existence. SG / Dominique Rolin, Plaisirs suivi de Messages secrets. Entretiens avec Patricia Boyer de Latour, Gallimard, L’Infini, 2019, 15,25€.
Genre littéraire, la visite à l’écrivain, a accouché du meilleur et du pire depuis la fin du XIXe siècle, son premier pic… Patricia Boyer de Latour, cent ans plus tard, est entrée dans la vie de Dominique Rolin et n’en est jamais sortie. Aux questions qu’elle pose, aux réponses qu’elle obtient, aux livres qu’elle a tirés de leurs longues et libres conversations, recommencées selon un rituel intangible, on comprend la raison de leur confiance mutuelle. Quand le dialogue s’amorce, Dominique Rolin aborde le grand âge sans crainte du grand saut. Elle a tellement charmé la vie qu’elle charme sa mort, en parle comme d’une présence familière qui va et vient, à la manière de souris. L’écrivain arrachera, du reste, une douzaine d’années à cette complice espiègle. « Oui, pas de morbidité », intime-t-elle avec douceur à Patricia Boyer de Latour, devenue vite une amie aussi chère que les vivants et les ombres avec lesquels elle chemine chaque jour. Les entretiens que forment Plaisirs et Messages secrets se veulent d’outre-tombe, la formule ne surgit pas fortuitement au cours des échanges. Elle n’est porteuse d’aucun dolorisme et d’apitoiement. Célèbre à moins de trente ans, dans le Paris de l’Occupation, elle est proche alors de Cocteau, qui a fait un accueil triomphal au Marais, publié chez Denoël. Première histoire d’amour avec l’éditeur, son aîné, belge comme elle, dont la mort la bouleversera. Plaisirs évoque sans cachoterie cette époque et certaines amitiés littéraires, de Marcel Aymé à Blondin, que d’autres auraient préféré ne pas commenter. L’auteur du Singe en hiver, siégeant au Prix Nimier, aimait à lui dire : « Sois belge et tais-toi ». Conseil que Blondin ne lui demandait pas de suivre, bien sûr. La preuve, ce sont ces deux livres du souvenir, réunis dans la lumière du bonheur d’avoir à parler littérature, peinture, amants et amours, Europe buissonnière, musique, toutes les musiques. « Il faut faire attention à la vie », conseillait-elle au jeune Sollers, en pleine guerre d’Algérie. Plus qu’un avis, une philosophie, une esthétique de l’existence. SG / Dominique Rolin, Plaisirs suivi de Messages secrets. Entretiens avec Patricia Boyer de Latour, Gallimard, L’Infini, 2019, 15,25€.
 Nos Dioscures n’ont pas toujours roulé en habits verts, mais une même fureur de vivre et d’écrire, durant un demi-siècle, les anima, les aimanta. Cette amitié, qui tient du pacte amoureux et avale les brouilles passagères, ne s’est pas éteinte avec la disparition de Jean d’O, comme Jean-Marie Rouart aime à le désigner dans ce livre ému, ce dialogue continué, qui respire l’hédonisme, l’espièglerie, la noblesse et l’irrévérence des Hussards. Ce fut, certains l’ont oublié, la première famille de Jean d’Ormesson. On peut s’étonner à cet égard qu’il ait précédé, sous les dorures de la Pléiade, Nimier, Déon, Blondin et Jacques Laurent, auprès de qui, au temps d’Arts, il fit ses armes. Et quelles armes! Jean d’Ormesson n’avait pas son stylo dans sa poche. Au meilleur des années 1950, on tirait à vue, à gauche et à droite, on tirait son épée, veux-je dire. D’un roman de Pierre Brisson, le grand homme de presse et l’ami de Wladimir d’Ormesson, son oncle, le cadet n’hésite pas s’écrier : « On ne peut pas être directeur du Figaro et avoir du talent. » Du talent, Jean d’Ormesson en eut à revendre. Mais le roman, comme Rouart le note à plusieurs reprises, convenait mal à son grand ami, écrivain plus cérébral que tripal. Paul Morand, le premier mentor, le pensait déjà, avant que les romans de Jean d’Ormesson se mettent à ne plus ressembler à des romans… La formule était trouvée, où son intelligence, sa culture et sa passion des femmes ne s’embarrassaient plus d’aucune limite. L’éclatement du dictionnaire rend justice aux jouisseurs insatiables de son espèce, la plus raffinée, la plus opiniâtre aussi. Qu’il ait mis Chateaubriand au-dessus de tout ne surprend, ni ne choque. Il aura également, personne n’est parfait, chéri Aragon autant que Rouart vénère Drieu. Les amitiés indéfectibles, les âmes soeurs ont aussi besoin de petites divergences pour se reconnaître. SG / Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, Dictionnaire amoureux de Jean d’Ormesson, Plon, 25€.
Nos Dioscures n’ont pas toujours roulé en habits verts, mais une même fureur de vivre et d’écrire, durant un demi-siècle, les anima, les aimanta. Cette amitié, qui tient du pacte amoureux et avale les brouilles passagères, ne s’est pas éteinte avec la disparition de Jean d’O, comme Jean-Marie Rouart aime à le désigner dans ce livre ému, ce dialogue continué, qui respire l’hédonisme, l’espièglerie, la noblesse et l’irrévérence des Hussards. Ce fut, certains l’ont oublié, la première famille de Jean d’Ormesson. On peut s’étonner à cet égard qu’il ait précédé, sous les dorures de la Pléiade, Nimier, Déon, Blondin et Jacques Laurent, auprès de qui, au temps d’Arts, il fit ses armes. Et quelles armes! Jean d’Ormesson n’avait pas son stylo dans sa poche. Au meilleur des années 1950, on tirait à vue, à gauche et à droite, on tirait son épée, veux-je dire. D’un roman de Pierre Brisson, le grand homme de presse et l’ami de Wladimir d’Ormesson, son oncle, le cadet n’hésite pas s’écrier : « On ne peut pas être directeur du Figaro et avoir du talent. » Du talent, Jean d’Ormesson en eut à revendre. Mais le roman, comme Rouart le note à plusieurs reprises, convenait mal à son grand ami, écrivain plus cérébral que tripal. Paul Morand, le premier mentor, le pensait déjà, avant que les romans de Jean d’Ormesson se mettent à ne plus ressembler à des romans… La formule était trouvée, où son intelligence, sa culture et sa passion des femmes ne s’embarrassaient plus d’aucune limite. L’éclatement du dictionnaire rend justice aux jouisseurs insatiables de son espèce, la plus raffinée, la plus opiniâtre aussi. Qu’il ait mis Chateaubriand au-dessus de tout ne surprend, ni ne choque. Il aura également, personne n’est parfait, chéri Aragon autant que Rouart vénère Drieu. Les amitiés indéfectibles, les âmes soeurs ont aussi besoin de petites divergences pour se reconnaître. SG / Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, Dictionnaire amoureux de Jean d’Ormesson, Plon, 25€.