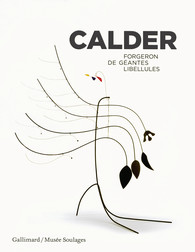Bien que la descendance de Walter Sickert (1860-1942) se nomme principalement Alfred Hitchcock et Stanley Spencer, Francis Bacon ou Lucian Freud, Michael Andrews ou Paula Rego, et s’étende aujourd’hui à la délicieuse Lynette Yiadom-Boakye, sa vraie patrie reste la France, où se recrutèrent toujours ses interprètes les plus aigus, car les mieux préparés à retrouver en lui Degas et Baudelaire, Balzac et Poe, le Manet du Bar aux Folies-Bergère (tableau connu de Walter), le Lautrec des jambes en l’air et le Bonnard des nus impudiques, femmes et hommes 1900. Le livre de la regrettée Delphine Lévy, partie trop tôt, le confirme s’il était besoin, et nous fait entendre ceux qui, avant elle, depuis Paris ou Dieppe, accueillirent à bras ouverts cette peinture si peu victorienne, et rapidement peu whistlerienne. Quelles sont-elles ces voix bienveillantes à l’artiste dont on ne pas assez dit combien il fut hostile, entre autres purismes, à la conception anti-littéraire, anti-narrative, de son art ? Ses trois plus prestigieux chaperons en milieu français furent, bien sûr, Jacques-Emile Blanche, André Gide et Félix Fénéon, lequel vendit à Signac (dont Orsay s’apprête à célébrer la collection) The Camden Town Murder, sur la foi duquel Patricia Cornwell a échafaudé l’idée farfelue que notre peintre se confondait avec Jack The Ripper. Nothing more… Il est vrai que l’univers de Sickert, riche en ventres toisonnés et seins lourds, ne déroule pas seulement de longues plages normandes aux baignades revigorantes, et que ses huis-clos respirent l’odeur du sexe et du crime, quand l’ennui domestique, cher à Caillebotte, n’appelle pas une violence compensatoire. Selon Blanche, la passion que Gide vouait à Sickert éclairait la vraie nature de l’auteur de L’Immoraliste, sa « subtilité sadique » (Henri Ghéon). « Je crois que c’est l’homme le plus absolument distingué que j’ai connu », disait perfidement Blanche, de Sickert, à Gide. La valorisation parisienne de l’œuvre, à laquelle œuvrèrent les trois susnommés en le collectionnant et le poussant, s’appuya aussi sur les galeristes, Durand-Ruel et Bernheim-Jeune, et quelques plumes de la presse. Autour de 1906, un Louis Vauxcelles sacrifiait sans mal l’Arcadie fauve au « poème nocturne de la misère et de la prostitution » que Sickert débitait en petites toiles aux pénombres inquiétantes ou perverses. Citons encore cette belle page interlope du raffiné Paul Jamot, manetomaniaque averti, en janvier 1907, empreinte d’une rêverie qui balance de Lucain à Constantin Guys : « Le visiteur n’est pas étonné que ce peintre anglais très francisé se plaise, comme Baudelaire, à lire les poètes latins. Nue ou habillée, sous les panaches de plume de la soupeuse ou le châle noir de la Vénitienne, il observe, dans ses poses coutumières, professionnelles, de lassitude, d’ennui ou d’affût, la fille stupide, inconsciente ou lamentable, jouet méprisable et attirant du caprice masculin. Il la peint avec un humour dont l’âcreté n’est pas sans saveur ; et il fait preuve d’un talent qui, parti du dilettantisme whistlérien, semble s’être humanisé au contact de notre jeune école. »

La monographie que Delphine Lévy nous offre, merveilleux message d’outre-tombe, est aussi complète qu’affranchie dans ses analyses, complète parce qu’elle revisite la production tardive autant que ce que savons et aimons du peintre, affranchie parce que la cancel culture n’y a aucune prise sur cette peinture que les musées d’aujourd’hui n’osent montrer. Avant de nous quitter, le 13 juillet 2020, l’auteure avait mis la dernière main à ce livre monumental et au projet de l’exposition qu’elle préparait avec Christophe Leribault, et que nous verrons au Petit-Palais dans un an très exactement. Près de 600 pages abondamment illustrées, nul ne s’en plaindra, ont été nécessaires à cette lecture élargie du destin mobile d’un peintre né à Munich, et mort à Bath, 82 ans plus tard. L’ascendance paternelle, danoise, compte plusieurs générations de peintres, dont un élève de Couture, comme Manet. Autre bénédiction, le « charbonnier pornographique » qui divisa le Paris de la Belle époque aura fait quelques rencontres miraculeuses, la première le fit entrer dans la confiance de Whistler, qui se dira très impressionné par ce jeune homme au visage de voyou (et qu’il peindra tel). Avec Degas, autre choc, la vie et l’art de Sickert bifurquent à partir de 1885. Les scènes de music-hall, où migre la fascination collective que Daumier a explorée avant lui, se charge d’une indétermination morale qui n’a d’égal que la spirale des espaces aux reflets infinis et parfois infernaux : « La volonté de perdre le spectateur du tableau grâce au jeu du trompe-l’œil ou du miroir est particulièrement représentative de l’ambiguïté qui caractérise toute l’œuvre de Sickert », résume Delphine Lévy. Le cercle anglophile de Jacques-Emile Blanche achève, au cours des années 1890, de le faire naître à lui-même. Sickert choisit Dieppe pour port d’attache entre 1898 et 1905, puis retrouve Londres et s’installe à Camden Town, quartier très mal famé autour des gares de King’s Cross (les lecteurs de Guignol’s Band ne seront pas dépaysés). La France, nous le savons, plébiscitera ce moment de l’œuvre et sa résistance pugnace à « l’intolérable cliché de la peinture claire ». La guerre de 14 ramène Sickert à la peinture d’histoire et le conduit même à se dresser contre la Prusse qui avait avalé le Schleswig-Hostein danois en 1867… Sa boue colorée, intentionnelle, ses tonalités frugales tutoient alors la boue des soldats livrés à une mort certaine. Les années 1920-1930, souvent tues, se révèlent nettement tournées vers le recyclage des gravures victoriennes et des photographies de presse ou de cinéma. A l’évidence, le 7e art fut d’un apport plus fertile que ces transferts d’image à image. Sickert, à 70 ans passés, s’empare du close-up, du plan américain et même du panoramique avec l’espoir, comblé souvent, de sortir du registre où on l’attendait et d’où, en esprit littéraire, il parvint à se sortir. Si ses nus ont obsédé la peinture britannique de l’entre-deux-guerres, ses ultimes tableaux durent attendre les années 1970 pour être compris. Delphine Lévy s’élançait alors dans l’existence. Son Sickert en concentre toutes les ardeurs. « La mort, et la mort seule, est le grand tamis de l’art », écrivait son héros en 1929.
Stéphane Guégan
Delphine Lévy, Sickert. La provocation de l’énigme, préface de Wendy Baron, Cohen & Cohen, 95€.
Verbatim (car Sickert maniait aussi la plume)
« Un puritanisme incohérent et lubrique a réussi à transformer un idéal qu’il cherche à dignifier en le nommant le NU, avec un N majuscule, et en l’opposant à la nudité. […] Est-ce qu’une personne sensée peut soutenir que l’ensemble de la production et la multiplication des nus qui inondent les expositions en Europe, qui culminent avec la publication et la diffusion de catalogues comme Le Nu au Salon, doit son succès à des enjeux purement artistiques ? »
Walter Sickert, « The Naked and the Nude », The New Age, 1910
« Cela fait presque un siècle que je me suis rangé, pour ma plus grande satisfaction, définitivement contre la théorie anti-littéraire de Whistler en matière de dessin. Tous les grands dessinateurs racontent une histoire […]. Un peintre peut raconter une histoire comme Balzac. »
Walter Sickert, « A Critical Calendar », English Review, mars 1912
En librairie, le 13 octobre, Stéphane Guégan, Caillebotte. Peintre des extrêmes, Hazan, 99€.