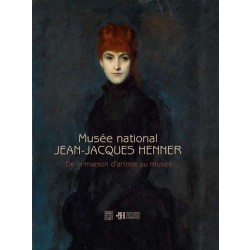La rentrée des classes, sur les Champs-Élysées, a d’abord retenti du flop de la Biennale des Antiquaires ! Mais ce ratage est déjà oublié, deux expositions, Penn au Grand Palais, Zorn en face, ont lancé une saison qui s’annonce historique, Rubens vu de la gentry, François 1er vu du Nord, Degas vu de Paul Valéry, Gauguin vu de l’art total, Dada vu d’Afrique, Derain vu de lui-même… France is back ! La photographie, aussi. Le Grand Palais en est devenu un des lieux obligés et Jérôme Neutres, l’un des artisans de cette sanctuarisation, peut s’en féliciter au seuil du catalogue Penn. L’intruse des Beaux-Arts s’est acquis un public qu’on lui croyait hostile, celui du Grand Palais. Il va, sans nul doute, adorer ce que nous adorons d’Irving Penn, les photographies de mode, si belles qu’on oublierait que cette beauté vient aussi des modèles et des robes, également sublimes, qui s’épousent sous l’œil stylisé du maître. Et aucune des « celebrities » que Penn a accrochées à son gotha personnel ne manque au mur, des murs sobres, un accrochage raffiné et capable d’humour. Tout lui. De parents juifs lituaniens, que la Révolution russe pousse à l’exil, Irving, né en 1917, s’est d’abord rêvé peintre. Et sa solide culture visuelle, son attachement pérenne au graphisme de Daumier et Lautrec, lui viennent d’une formation précoce, notamment auprès d’un certain Brodovitch, qui avait tâté des Ballets russes ! En 1938, ce diplômé de 20 ans se paye un Rolleiflex et commence à déplier sa boîte noire là où ses flâneries le mènent, à la manière du Chiffonnier de Baudelaire dont il est un des héritiers (sujet du prochain livre d’Antoine Compagnon).
La rentrée des classes, sur les Champs-Élysées, a d’abord retenti du flop de la Biennale des Antiquaires ! Mais ce ratage est déjà oublié, deux expositions, Penn au Grand Palais, Zorn en face, ont lancé une saison qui s’annonce historique, Rubens vu de la gentry, François 1er vu du Nord, Degas vu de Paul Valéry, Gauguin vu de l’art total, Dada vu d’Afrique, Derain vu de lui-même… France is back ! La photographie, aussi. Le Grand Palais en est devenu un des lieux obligés et Jérôme Neutres, l’un des artisans de cette sanctuarisation, peut s’en féliciter au seuil du catalogue Penn. L’intruse des Beaux-Arts s’est acquis un public qu’on lui croyait hostile, celui du Grand Palais. Il va, sans nul doute, adorer ce que nous adorons d’Irving Penn, les photographies de mode, si belles qu’on oublierait que cette beauté vient aussi des modèles et des robes, également sublimes, qui s’épousent sous l’œil stylisé du maître. Et aucune des « celebrities » que Penn a accrochées à son gotha personnel ne manque au mur, des murs sobres, un accrochage raffiné et capable d’humour. Tout lui. De parents juifs lituaniens, que la Révolution russe pousse à l’exil, Irving, né en 1917, s’est d’abord rêvé peintre. Et sa solide culture visuelle, son attachement pérenne au graphisme de Daumier et Lautrec, lui viennent d’une formation précoce, notamment auprès d’un certain Brodovitch, qui avait tâté des Ballets russes ! En 1938, ce diplômé de 20 ans se paye un Rolleiflex et commence à déplier sa boîte noire là où ses flâneries le mènent, à la manière du Chiffonnier de Baudelaire dont il est un des héritiers (sujet du prochain livre d’Antoine Compagnon).
 En devenant photographe, Penn ne cesse pas de peindre, il peint autrement. Très vite, il use de la couleur dont les puristes du médium ont horreur. Très vite, il jongle avec les codes hors de tout essentialisme. Travailler pour la presse le protège des tocades modernistes, il se jette toujours au « cœur du sujet », même si son approche du réel refuse la littéralité illusoire du documentaire. A l’évidence, et le premier moment du parcours le montre assez, il intègre tôt les marottes du surréalisme, la rue, les vitrines, le Mexique… Shop Window Mexico, en 1942, paraît dans VVV, la publication new-yorkaise de Breton et Duchamp. Le merveilleux n’est pas affaire d’arrière-monde, mais surgit du décalage entre le banal et l’imprévu. Penn appartient enfin à un temps, les débuts de la presse glamour, où l’art et le papier glacé faisaient encore alliance. L’erreur serait de croire qu’il bouscula les patrons de Vogue et leur imposa sa modernité : c’est le pragmatisme américain, pour qui le commerce et la publicité ne relèvent pas du grand Satan, qui fusionne les talents. Car la photographie n’est pas chose inerte, c’est une force d’entraînement, Éros, dollar, art. Dès 1939, Shadow of Key, Gun and Photographer, établit le théâtre d’ombres où tout advient. Le photographe scrute son absence à venir. Dans le haut du cliché, deux ombres, une clef et un révolver. La première dit l’infini déchiffrage du monde, l’autre pointe la résolution des conflits dont chaque image se fait le fragile refuge.
En devenant photographe, Penn ne cesse pas de peindre, il peint autrement. Très vite, il use de la couleur dont les puristes du médium ont horreur. Très vite, il jongle avec les codes hors de tout essentialisme. Travailler pour la presse le protège des tocades modernistes, il se jette toujours au « cœur du sujet », même si son approche du réel refuse la littéralité illusoire du documentaire. A l’évidence, et le premier moment du parcours le montre assez, il intègre tôt les marottes du surréalisme, la rue, les vitrines, le Mexique… Shop Window Mexico, en 1942, paraît dans VVV, la publication new-yorkaise de Breton et Duchamp. Le merveilleux n’est pas affaire d’arrière-monde, mais surgit du décalage entre le banal et l’imprévu. Penn appartient enfin à un temps, les débuts de la presse glamour, où l’art et le papier glacé faisaient encore alliance. L’erreur serait de croire qu’il bouscula les patrons de Vogue et leur imposa sa modernité : c’est le pragmatisme américain, pour qui le commerce et la publicité ne relèvent pas du grand Satan, qui fusionne les talents. Car la photographie n’est pas chose inerte, c’est une force d’entraînement, Éros, dollar, art. Dès 1939, Shadow of Key, Gun and Photographer, établit le théâtre d’ombres où tout advient. Le photographe scrute son absence à venir. Dans le haut du cliché, deux ombres, une clef et un révolver. La première dit l’infini déchiffrage du monde, l’autre pointe la résolution des conflits dont chaque image se fait le fragile refuge.
 Mais la rétrospective Penn vaut aussi par la divine surprise qui cueille le visiteur au premier étage du Grand Palais, le parcours ménage alors un déferlement de nus féminins ballottés entre Man Ray et Lucian Freud, le galbe irradié et la chair dilatée. Aussi cru et caressant, aussi inspiré surtout, se montra Anders Zorn (1860-1920), héros du Petit Palais, lorsqu’il modelait, à la surface de ses robustes toiles, de robustes Suédoises, si plantureuses et indécentes, à l’occasion, qu’on les a longtemps occultées. Ce sont de fières Vénus du Nord, elles préfèrent la froidure des fjords à l’onde amère de la mythologie. Zorn les photographie, avant de les peindre, comme autant de divinités universelles. Elles couronnaient une carrière aux débuts moins fracassants. Lorsqu’il commence à exposer à Paris, en 1882, on le tient plutôt pour un aquarelliste de bon ton. Lumières et reflets dissolvent un peu le sujet, sagement accrocheur, de ces feuilles délicates, aux antipodes de la tournure qu’allait prendre le style du viking. En quelques années, il passe du luminisme précieux de Fortuny père à une peinture autrement incarnée. A l’évidence, le choc du naturalisme Troisième République a précipité la mue. Du reste, parmi ses soutiens français, on trouve alors Antonin Proust, le chantre de Manet, et Rodin, qui savait faire saillir les corps de femme dans l’espace. Zorn le rubénien sait même les faire danser dès qu’il se tourne, réflexe identitaire innocent et souvent délectable, vers le monde rural des fêtes et tablées villageoises.
Mais la rétrospective Penn vaut aussi par la divine surprise qui cueille le visiteur au premier étage du Grand Palais, le parcours ménage alors un déferlement de nus féminins ballottés entre Man Ray et Lucian Freud, le galbe irradié et la chair dilatée. Aussi cru et caressant, aussi inspiré surtout, se montra Anders Zorn (1860-1920), héros du Petit Palais, lorsqu’il modelait, à la surface de ses robustes toiles, de robustes Suédoises, si plantureuses et indécentes, à l’occasion, qu’on les a longtemps occultées. Ce sont de fières Vénus du Nord, elles préfèrent la froidure des fjords à l’onde amère de la mythologie. Zorn les photographie, avant de les peindre, comme autant de divinités universelles. Elles couronnaient une carrière aux débuts moins fracassants. Lorsqu’il commence à exposer à Paris, en 1882, on le tient plutôt pour un aquarelliste de bon ton. Lumières et reflets dissolvent un peu le sujet, sagement accrocheur, de ces feuilles délicates, aux antipodes de la tournure qu’allait prendre le style du viking. En quelques années, il passe du luminisme précieux de Fortuny père à une peinture autrement incarnée. A l’évidence, le choc du naturalisme Troisième République a précipité la mue. Du reste, parmi ses soutiens français, on trouve alors Antonin Proust, le chantre de Manet, et Rodin, qui savait faire saillir les corps de femme dans l’espace. Zorn le rubénien sait même les faire danser dès qu’il se tourne, réflexe identitaire innocent et souvent délectable, vers le monde rural des fêtes et tablées villageoises.
 Comme chez Sargent ou Sorolla, les rouges et les noirs donnent de la voix, et la lumière, loin de boire les formes désormais, les fait vivre d’une manière si intense que ses dons de portraitistes sont de plus en plus recherchés au tournant des deux siècles. Le Petit Palais, sans lésiner sur le vernaculaire de la scénographie, en a rassemblé de très puissants. Là encore les femmes dominent l’autre sexe, moins libre des convenances et de l’impératif de l’habit noir. Le feu d’artifice eut la préférence, notamment, des étrangères de passage. Comme Mme Richard Howe s’habille de rouge et Elizabeth Sherman Cameron de satin fleuri, Zorn débride ses couleurs les plus rutilantes. Manet en était la preuve vivante : qui triomphe des tons les plus fous peut exceller dans le noir. Zorn reste l’un des aquafortistes les plus forts et poétiques de la fin-de-siècle. L’incomplétude de l’eau-forte, ses noirs griffés, ses effets de dévoilement, conviennent au portrait, Verlaine ou Strindberg, comme aux instantanés urbains. Une certaine Europe cosmopolite continue à palpiter ici… Les Français, qui ont la mémoire courte, ont-ils conservé à ce peintre de tempérament l’estime dont Zorn put se prévaloir, à Paris, jusqu’au bout de la Belle Époque ? En 1906, alors que Durand-Ruel lui déroulait le tapis rouge d’un vaste bilan, le critique Louis Vauxcelles clamait haut et fort sa « luminosité audacieuse », son « métier simple, large, aisé », sa façon d’étaler la matière « d’une brosse alerte et hardie ». Merci au Petit Palais de nous la remettre sous les yeux.
Comme chez Sargent ou Sorolla, les rouges et les noirs donnent de la voix, et la lumière, loin de boire les formes désormais, les fait vivre d’une manière si intense que ses dons de portraitistes sont de plus en plus recherchés au tournant des deux siècles. Le Petit Palais, sans lésiner sur le vernaculaire de la scénographie, en a rassemblé de très puissants. Là encore les femmes dominent l’autre sexe, moins libre des convenances et de l’impératif de l’habit noir. Le feu d’artifice eut la préférence, notamment, des étrangères de passage. Comme Mme Richard Howe s’habille de rouge et Elizabeth Sherman Cameron de satin fleuri, Zorn débride ses couleurs les plus rutilantes. Manet en était la preuve vivante : qui triomphe des tons les plus fous peut exceller dans le noir. Zorn reste l’un des aquafortistes les plus forts et poétiques de la fin-de-siècle. L’incomplétude de l’eau-forte, ses noirs griffés, ses effets de dévoilement, conviennent au portrait, Verlaine ou Strindberg, comme aux instantanés urbains. Une certaine Europe cosmopolite continue à palpiter ici… Les Français, qui ont la mémoire courte, ont-ils conservé à ce peintre de tempérament l’estime dont Zorn put se prévaloir, à Paris, jusqu’au bout de la Belle Époque ? En 1906, alors que Durand-Ruel lui déroulait le tapis rouge d’un vaste bilan, le critique Louis Vauxcelles clamait haut et fort sa « luminosité audacieuse », son « métier simple, large, aisé », sa façon d’étaler la matière « d’une brosse alerte et hardie ». Merci au Petit Palais de nous la remettre sous les yeux.
 Il y a 30 ou 40 ans, on aurait dit de Zorn qu’il appartenait à « l’autre XIXe siècle », à ce siècle qui n’était pas celui de Delacroix, Courbet, Manet, Gauguin ou Cézanne. Autre par ses origines géographiques, ou autre par son langage distinct des grands ismes… Peu d’historiens alors plaidaient la nécessité d’appréhender la période en son entier, s’aventuraient à faire tomber les frontières et les clivages hérités du premier XXe siècle. Jacques Thuillier fut de ceux-là. C’est qu’il appartenait à une génération qui vint à maturité aux lendemains de la seconde guerre mondiale, quand culminait le discrédit de la peinture de Salon, des « pompiers » au naturalisme 1880, discrédit que le futur professeur du Collège de France a combattu par tous les moyens. Aussi ne faut-il pas rejeter aux marges de son corpus scientifique, dominé par le Grand Siècle, la masse des écrits qu’il dédia, d’une plume fervente et caustique, à Géricault, Delacroix, Bonnat, Baudry, Bastien-Lepage ou l’École des Beaux-Arts… L’ouvrage qui les rassemble pourrait bien devenir le plus utile des douze volumes de ses Œuvres complètes. Sa matière, en effet, était très dispersée et elle forme, à sa façon, le livre que Jacques Thuillier n’eut pas le temps d’écrire. Composé d’articles, de préfaces et du catalogue de l’exposition qu’il organisa au Japon, en 1989, sur le romantisme français, l’ensemble pivote sur la fameuse conférence du 27 mars 1980, « Peut-on parler d’une peinture pompier ? » Sous ce titre à double sens, elle faisait entendre une manière de protestation, de résistance aux blocages qui avaient longtemps retardé le réexamen de tout un pan de l’art du XIXe siècle. Dès 1973, il en appelait à la conservation de la gare d’Orsay et à sa conversion en musée. Treize ans plus tard, saluant l’ouverture du lieu controversé, son éditorial de la Revue de l’art marquait la victoire d’un combat gagné de haute lutte. Le texte de 1986 ne postulait pas un simple renversement des valeurs du modernisme. De même qu’il n’y avait pas lieu de tenir Rochegrosse pour l’égal de Degas, ni de substituer une orthodoxie à une autre. Rendre à nouveau visible, protéger de la destruction tableaux et sculptures après un demi-siècle d’incurie, ne relevait pas du révisionnisme, mais de « l’élargissement des horizons » (Catherine Chevillot). La prochaine étape, aux yeux de Jacques Thuillier, eût consisté à faire d’Orsay le laboratoire de nouvelles lectures, plus attentives aux interférences, aux enchaînements inaperçus, qu’aux catégories trop étanches. Il en avait fixé, par avance, le programme dans un article de 1974, « L’impressionnisme : une révision », qui peut être lu comme l’énoncé d’une méthode applicable à l’ensemble du siècle, académique ou non, et aussi soucieuse du langage des formes que du contenu narratif et affectif des œuvres.
Il y a 30 ou 40 ans, on aurait dit de Zorn qu’il appartenait à « l’autre XIXe siècle », à ce siècle qui n’était pas celui de Delacroix, Courbet, Manet, Gauguin ou Cézanne. Autre par ses origines géographiques, ou autre par son langage distinct des grands ismes… Peu d’historiens alors plaidaient la nécessité d’appréhender la période en son entier, s’aventuraient à faire tomber les frontières et les clivages hérités du premier XXe siècle. Jacques Thuillier fut de ceux-là. C’est qu’il appartenait à une génération qui vint à maturité aux lendemains de la seconde guerre mondiale, quand culminait le discrédit de la peinture de Salon, des « pompiers » au naturalisme 1880, discrédit que le futur professeur du Collège de France a combattu par tous les moyens. Aussi ne faut-il pas rejeter aux marges de son corpus scientifique, dominé par le Grand Siècle, la masse des écrits qu’il dédia, d’une plume fervente et caustique, à Géricault, Delacroix, Bonnat, Baudry, Bastien-Lepage ou l’École des Beaux-Arts… L’ouvrage qui les rassemble pourrait bien devenir le plus utile des douze volumes de ses Œuvres complètes. Sa matière, en effet, était très dispersée et elle forme, à sa façon, le livre que Jacques Thuillier n’eut pas le temps d’écrire. Composé d’articles, de préfaces et du catalogue de l’exposition qu’il organisa au Japon, en 1989, sur le romantisme français, l’ensemble pivote sur la fameuse conférence du 27 mars 1980, « Peut-on parler d’une peinture pompier ? » Sous ce titre à double sens, elle faisait entendre une manière de protestation, de résistance aux blocages qui avaient longtemps retardé le réexamen de tout un pan de l’art du XIXe siècle. Dès 1973, il en appelait à la conservation de la gare d’Orsay et à sa conversion en musée. Treize ans plus tard, saluant l’ouverture du lieu controversé, son éditorial de la Revue de l’art marquait la victoire d’un combat gagné de haute lutte. Le texte de 1986 ne postulait pas un simple renversement des valeurs du modernisme. De même qu’il n’y avait pas lieu de tenir Rochegrosse pour l’égal de Degas, ni de substituer une orthodoxie à une autre. Rendre à nouveau visible, protéger de la destruction tableaux et sculptures après un demi-siècle d’incurie, ne relevait pas du révisionnisme, mais de « l’élargissement des horizons » (Catherine Chevillot). La prochaine étape, aux yeux de Jacques Thuillier, eût consisté à faire d’Orsay le laboratoire de nouvelles lectures, plus attentives aux interférences, aux enchaînements inaperçus, qu’aux catégories trop étanches. Il en avait fixé, par avance, le programme dans un article de 1974, « L’impressionnisme : une révision », qui peut être lu comme l’énoncé d’une méthode applicable à l’ensemble du siècle, académique ou non, et aussi soucieuse du langage des formes que du contenu narratif et affectif des œuvres.
Stéphane Guégan
 *Irving Penn. Le Centenaire, Grand Palais, jusqu’au 29 janvier, somptueux catalogue (Editions de la RMN/Grand Palais, 59 €). Parce qu’elles sont révélatrices du dialogue franco-américain à maints égards, l’œuvre et la carrière d’Irving Penn invitent à relire, 17 ans après sa sortie, le désormais classique Un jour, ils auront des peintres d’Annie Cohen-Solal, que Folio Histoire (Gallimard, 11,90€) fait entrer à son catalogue. Elle y étudiait les différentes dynamiques de légitimation et de création au terme desquelles l’idée d’un art proprement américain avait pu s’imposer à la conscience des États-Unis et du reste du monde. En matière d’identité culturelle, concept délicat, les effets de seuil se laissent mal percevoir. Il semble bien pourtant que la France, à partir de l’Exposition Universelle de 1867, ait contribué de façon décisive à la reconnaissance publique des peintres et photographes d’outre-Atlantique. En 1889, note l’auteur, les médailles pleuvent (Sargent, Harrison, Whistler). Après 1900, les émules américains de Monet et de Manet, dont Annie Cohen-Solal souligne bien les divergences, peuvent faire souche sur leur sol même. Il est très éclairant d’avoir dégagé la filiation Gérôme-Eakins-Robert Henri (le maître de Hopper), qui eut Philadelphie pour foyer, avant de conquérir New York ; on comprendrait mal autrement les tensions de la modernité américaine, d’une guerre l’autre, entre modèle européen (Matisse, Picasso, Dali, Masson) et impératif vernaculaire / réalisme indigène. A trop s’être laissé envoûter par le modernisme selon Alfred Barr, et le premier MoMA, on a fini par oublier que la création autochtone le débordait de toutes parts. Les photographes, de Steichen à Walker Evans et Penn, en furent les preuves vivantes. SG
*Irving Penn. Le Centenaire, Grand Palais, jusqu’au 29 janvier, somptueux catalogue (Editions de la RMN/Grand Palais, 59 €). Parce qu’elles sont révélatrices du dialogue franco-américain à maints égards, l’œuvre et la carrière d’Irving Penn invitent à relire, 17 ans après sa sortie, le désormais classique Un jour, ils auront des peintres d’Annie Cohen-Solal, que Folio Histoire (Gallimard, 11,90€) fait entrer à son catalogue. Elle y étudiait les différentes dynamiques de légitimation et de création au terme desquelles l’idée d’un art proprement américain avait pu s’imposer à la conscience des États-Unis et du reste du monde. En matière d’identité culturelle, concept délicat, les effets de seuil se laissent mal percevoir. Il semble bien pourtant que la France, à partir de l’Exposition Universelle de 1867, ait contribué de façon décisive à la reconnaissance publique des peintres et photographes d’outre-Atlantique. En 1889, note l’auteur, les médailles pleuvent (Sargent, Harrison, Whistler). Après 1900, les émules américains de Monet et de Manet, dont Annie Cohen-Solal souligne bien les divergences, peuvent faire souche sur leur sol même. Il est très éclairant d’avoir dégagé la filiation Gérôme-Eakins-Robert Henri (le maître de Hopper), qui eut Philadelphie pour foyer, avant de conquérir New York ; on comprendrait mal autrement les tensions de la modernité américaine, d’une guerre l’autre, entre modèle européen (Matisse, Picasso, Dali, Masson) et impératif vernaculaire / réalisme indigène. A trop s’être laissé envoûter par le modernisme selon Alfred Barr, et le premier MoMA, on a fini par oublier que la création autochtone le débordait de toutes parts. Les photographes, de Steichen à Walker Evans et Penn, en furent les preuves vivantes. SG
*Anders Zorn. Le Maître de la peinture suédoise, Petit Palais, jusqu’au 17 décembre. Le catalogue (Editions Paris Musées, 35€) constitue la première monographie française jamais consacrée au grand peintre suédois. A l’occasion de cette rétrospective haute en couleurs, le Petit Palais dévoile la fleur de ses pastels. En plus des maîtres du genre, de Degas et Morisot à Redon, Charles Léandre (notre photographie) et Lévy-Dhurmer, on y voit et souvent découvre les pouvoirs du médium, en pleine renaissance, sur les artistes les moins sensibles, a priori, à son charme. Le pastel, si propre à faire frémir l’épiderme, entraîne ainsi Alfred Roll au-delà de lui-même, loin des vertueux pâturages, aux confins plutôt de Baudelaire et de Huysmans. La Manette Salomon de Marthe Lefebvre, sur une donnée littéraire voisine, tend à l’Eros de Vallotton et Maillol, le génie féminin en plus. Ajoutons que le catalogue raisonné de la collection des pastels du Petit Palais (Editions Paris Musées, 30,90€), dû à Gaëlle Rio, comble toutes les attentes. SG
 *L’Art au XIXe siècle. Un nouveau regard. Les écrits de Jacques Thuillier, Serge Lemoine (dir.), préface de Catherine Chevillot, Editions Faton, 49€. Dans le dernier numéro de Grande Galerie qu’il dirige, Adrien Goetz rend un très bel hommage à Jacques Thuillier et son œil ivre de tout. Venant d’un historien de l’art peu canonique, et d’un romancier qui aime à broder ses fictions espiègles sur le sévère canevas de sa discipline, le coup de chapeau ne surprendra pas. Née des rêves helléniques de Théodore Reinach, la Villa Kérylos vient d’y retourner sous la plume de Goetz dont l’atticisme, à la manière des Grecs justement, s’autorise des touches incessantes de couleur et d’humour. L’art du contraste et de la pointe a toujours souri à l’auteur, dont on sait qu’il vénère autant Arsène Lupin et Jules Verne que ses chers Racine et Chateaubriand. Plus grave que les précédents, parce qu’il se charge du destin des élites juives de la Belle Époque, et qu’il explore avec le même recul le devenir des fulgurances amoureuses, Villa Kérylos (Grasset, 20 €) donne rendez-vous à une série de fantômes qu’il eût été criminel de ne pas rendre à la vie. Et Goetz sait s’y prendre pour ressusciter certains Lazare de notre mémoire nationale. Les frères Reinach, les cousines Ephrussi, Eiffel et d’autres défilent devant les yeux du personnage central, narrateur de sa vie, une vie miraculeusement arrachée à la modestie de ses origines par la grâce d’un fou de beauté, et d’une femme sans lendemain. Après tant de récits normands et anglais, Goetz entre dans la lumière du Sud et prouve qu’elle peut être la complice du mystère et du temps retrouvé. SG
*L’Art au XIXe siècle. Un nouveau regard. Les écrits de Jacques Thuillier, Serge Lemoine (dir.), préface de Catherine Chevillot, Editions Faton, 49€. Dans le dernier numéro de Grande Galerie qu’il dirige, Adrien Goetz rend un très bel hommage à Jacques Thuillier et son œil ivre de tout. Venant d’un historien de l’art peu canonique, et d’un romancier qui aime à broder ses fictions espiègles sur le sévère canevas de sa discipline, le coup de chapeau ne surprendra pas. Née des rêves helléniques de Théodore Reinach, la Villa Kérylos vient d’y retourner sous la plume de Goetz dont l’atticisme, à la manière des Grecs justement, s’autorise des touches incessantes de couleur et d’humour. L’art du contraste et de la pointe a toujours souri à l’auteur, dont on sait qu’il vénère autant Arsène Lupin et Jules Verne que ses chers Racine et Chateaubriand. Plus grave que les précédents, parce qu’il se charge du destin des élites juives de la Belle Époque, et qu’il explore avec le même recul le devenir des fulgurances amoureuses, Villa Kérylos (Grasset, 20 €) donne rendez-vous à une série de fantômes qu’il eût été criminel de ne pas rendre à la vie. Et Goetz sait s’y prendre pour ressusciter certains Lazare de notre mémoire nationale. Les frères Reinach, les cousines Ephrussi, Eiffel et d’autres défilent devant les yeux du personnage central, narrateur de sa vie, une vie miraculeusement arrachée à la modestie de ses origines par la grâce d’un fou de beauté, et d’une femme sans lendemain. Après tant de récits normands et anglais, Goetz entre dans la lumière du Sud et prouve qu’elle peut être la complice du mystère et du temps retrouvé. SG
Ciné-Billet
 A voir Les Proies de 1970, réalisé par Don Siegel, on comprend en quoi une cinéaste d’aujourd’hui a pu se sentir sollicitée par son scénario et défiée par ses enjeux de mise en scène. Sofia Coppola a donc pris le projet à bras le corps. On sort étonnés et à demi convaincus par son remake. La réalisatrice semble avoir choisi ce matériau narratif au potentiel cinématographique évident, porteur de thématiques qui lui sont chères, sans avoir tranché sur ses décisions. Le traitement du scénario prend mille directions, ce qui déroute et tient le spectateur à distance. Mais on ne peut s’empêcher d’admirer le travail de tri opéré à l’égard de la version originale, un peu vieillie à nos yeux. Peu de cinéastes sont parvenus à offrir une analyse aussi empathique de la réclusion féminine et une vision si fine des rapports entre femmes. Sofia Coppola renoue ici avec l’ambiance glacée de Virgin Suicides tout en actualisant son esthétique pour servir un genre qu’elle n’avait jusqu’ici jamais abordé : le film historique. L’histoire des Proies est, en apparence, très simple : en pleine guerre de sécession, un pensionnat sudiste de jeunes filles tenu par une directrice stricte et autoritaire (Nicole Kidman) recueille à contrecœur un jeune officier yankee, par charité chrétienne. On décide de le « retenir en captivité » jusqu’à ce qu’il soit rétabli, avant de le livrer. Peu à peu, la présence de cet homme agit sur les frustrations sexuelles et sentimentales des différentes protagonistes. Chaque personnage féminin incarne un type de désir inassouvi que réveille la présence du caporal : ce sera le désir sexuel pour l’une, l’amour de conte de fée pour l’autre, l’idéalisation quasi-freudienne pour la petite fille, la simple envie de se sentir encore désirable quand on est une femme de 50 ans. Le choix fondamental qui commande la mise en scène de Coppola est le huis clos, à rebours du film de Siegel qui multiplie les extérieurs. La caméra de Coppola, elle, ne quitte pas la maison, ou très peu. La création d’un univers fermé, pesant, suffocant, s’impose comme la vraie réussite de ces nouvelles Proies.
A voir Les Proies de 1970, réalisé par Don Siegel, on comprend en quoi une cinéaste d’aujourd’hui a pu se sentir sollicitée par son scénario et défiée par ses enjeux de mise en scène. Sofia Coppola a donc pris le projet à bras le corps. On sort étonnés et à demi convaincus par son remake. La réalisatrice semble avoir choisi ce matériau narratif au potentiel cinématographique évident, porteur de thématiques qui lui sont chères, sans avoir tranché sur ses décisions. Le traitement du scénario prend mille directions, ce qui déroute et tient le spectateur à distance. Mais on ne peut s’empêcher d’admirer le travail de tri opéré à l’égard de la version originale, un peu vieillie à nos yeux. Peu de cinéastes sont parvenus à offrir une analyse aussi empathique de la réclusion féminine et une vision si fine des rapports entre femmes. Sofia Coppola renoue ici avec l’ambiance glacée de Virgin Suicides tout en actualisant son esthétique pour servir un genre qu’elle n’avait jusqu’ici jamais abordé : le film historique. L’histoire des Proies est, en apparence, très simple : en pleine guerre de sécession, un pensionnat sudiste de jeunes filles tenu par une directrice stricte et autoritaire (Nicole Kidman) recueille à contrecœur un jeune officier yankee, par charité chrétienne. On décide de le « retenir en captivité » jusqu’à ce qu’il soit rétabli, avant de le livrer. Peu à peu, la présence de cet homme agit sur les frustrations sexuelles et sentimentales des différentes protagonistes. Chaque personnage féminin incarne un type de désir inassouvi que réveille la présence du caporal : ce sera le désir sexuel pour l’une, l’amour de conte de fée pour l’autre, l’idéalisation quasi-freudienne pour la petite fille, la simple envie de se sentir encore désirable quand on est une femme de 50 ans. Le choix fondamental qui commande la mise en scène de Coppola est le huis clos, à rebours du film de Siegel qui multiplie les extérieurs. La caméra de Coppola, elle, ne quitte pas la maison, ou très peu. La création d’un univers fermé, pesant, suffocant, s’impose comme la vraie réussite de ces nouvelles Proies.
 Là où Siegel fouille l’ambivalence des caractères, la perversité des cœurs qui se manifeste aux dépens des personnages (au gré de flashbacks ou de voix-off qui démentent l’impassibilité des visages), Coppola se tient à distance afin que ses personnages perdurent dans leur énigme, et le spectateur dans son incapacité à y voir clair. Autrement dit, convoquant un regard naïf. Coppola nous fait croire au conte de fée mais pour mieux le détruire. Au départ, tout n’est qu’ordre, calme et propreté. Tandis que Siegel développe une gradation narrative, une montée progressive des tensions, et prépare le spectateur au surgissement de la violence physique, Coppola s’intéresse au contraste qui déconcerte, à l’antithèse, et nous montre l’envers violent du décor de la bienséance, sur le mode d’un coup de théâtre impossible à prévoir. Contraste entre la cueillette champêtre du début et le dénouement du drame, entre la manière dont une éducation religieuse peut façonner des esprits, gommer les corps, et la façon dont ces désirs rentrés trouvent un moyen de prendre leur revanche ; contraste enfin entre le corps qui se contient et se contraint et le corps qui se déchaîne à la façon d’une bête sauvage. Bref, à la limpidité narrative choisie par Don Siegel, Coppola substitue une eau trouble d’où surgit l’improbable. C’est s’exposer au danger de perdre à plusieurs reprises le spectateur. Prenons le personnage de Colin Farrell, dont le choix de casting témoigne déjà d’un écart par rapport à la version de 1970. Ce n’est plus un Clint Eastwood au charisme envoûtant, au corps puissant et au regard ténébreux, montré dès le départ comme un indéniable séducteur. Le caporal de Coppola trompe par sa douceur, sa figure calme et peu expressive, ses manières de gentleman. Le spectateur est enclin à rêver d’une romance possible entre lui et le personnage de Kirsten Dunst. Si bien que la « métamorphose » du caporal au milieu du film en personnage bestial et cruel, est surprenante, voire impossible. Le caporal de Siegel attisait volontairement le désir autour de lui, ce sont les femmes, chez Coppola, qui, animées de désirs irrépressibles désormais, se resserrent peu à peu autour du caporal, leur proie. Le film, bien sûr, se prête à une incessante réversibilité des rôles entre le chasseur et le chassé. D’un côté, les femmes, qui tiennent en captivité le caporal, puis deviennent dépendantes de sa présence jusqu’à lui imposer une sorte de chantage sexuel. De l’autre, le caporal, enfermé à double-tour dans une chambre, mais vite conscient que le désir qu’il engendre chez les femmes sera son arme pour s’échapper, vainqueur lorsqu’il prend le « contrôle » de la maison par la terreur, et finalement vaincu par l’ultime piège échafaudé par les femmes dont le machiavélisme a définitivement englouti l’angélisme. De multiples mutations traversent ainsi les personnages, comme si chaque individu contenait tous les tempéraments, tous les comportements, comme si la morale n’était que rapport de force. Un rapport corporel de force. Valentine Guégan
Là où Siegel fouille l’ambivalence des caractères, la perversité des cœurs qui se manifeste aux dépens des personnages (au gré de flashbacks ou de voix-off qui démentent l’impassibilité des visages), Coppola se tient à distance afin que ses personnages perdurent dans leur énigme, et le spectateur dans son incapacité à y voir clair. Autrement dit, convoquant un regard naïf. Coppola nous fait croire au conte de fée mais pour mieux le détruire. Au départ, tout n’est qu’ordre, calme et propreté. Tandis que Siegel développe une gradation narrative, une montée progressive des tensions, et prépare le spectateur au surgissement de la violence physique, Coppola s’intéresse au contraste qui déconcerte, à l’antithèse, et nous montre l’envers violent du décor de la bienséance, sur le mode d’un coup de théâtre impossible à prévoir. Contraste entre la cueillette champêtre du début et le dénouement du drame, entre la manière dont une éducation religieuse peut façonner des esprits, gommer les corps, et la façon dont ces désirs rentrés trouvent un moyen de prendre leur revanche ; contraste enfin entre le corps qui se contient et se contraint et le corps qui se déchaîne à la façon d’une bête sauvage. Bref, à la limpidité narrative choisie par Don Siegel, Coppola substitue une eau trouble d’où surgit l’improbable. C’est s’exposer au danger de perdre à plusieurs reprises le spectateur. Prenons le personnage de Colin Farrell, dont le choix de casting témoigne déjà d’un écart par rapport à la version de 1970. Ce n’est plus un Clint Eastwood au charisme envoûtant, au corps puissant et au regard ténébreux, montré dès le départ comme un indéniable séducteur. Le caporal de Coppola trompe par sa douceur, sa figure calme et peu expressive, ses manières de gentleman. Le spectateur est enclin à rêver d’une romance possible entre lui et le personnage de Kirsten Dunst. Si bien que la « métamorphose » du caporal au milieu du film en personnage bestial et cruel, est surprenante, voire impossible. Le caporal de Siegel attisait volontairement le désir autour de lui, ce sont les femmes, chez Coppola, qui, animées de désirs irrépressibles désormais, se resserrent peu à peu autour du caporal, leur proie. Le film, bien sûr, se prête à une incessante réversibilité des rôles entre le chasseur et le chassé. D’un côté, les femmes, qui tiennent en captivité le caporal, puis deviennent dépendantes de sa présence jusqu’à lui imposer une sorte de chantage sexuel. De l’autre, le caporal, enfermé à double-tour dans une chambre, mais vite conscient que le désir qu’il engendre chez les femmes sera son arme pour s’échapper, vainqueur lorsqu’il prend le « contrôle » de la maison par la terreur, et finalement vaincu par l’ultime piège échafaudé par les femmes dont le machiavélisme a définitivement englouti l’angélisme. De multiples mutations traversent ainsi les personnages, comme si chaque individu contenait tous les tempéraments, tous les comportements, comme si la morale n’était que rapport de force. Un rapport corporel de force. Valentine Guégan