
Les plus grands musées ont leurs abonnés absents, qui risquent même de se multiplier… Ainsi n’ai-je jamais vu le chef-d’œuvre de Christian Bérard, Sur la plage, accroché aux cimaises du MoMA, propriétaire de l’œuvre depuis 1960… James Thrall Soby, lié au musée de New York, liée surtout au peintre précocement disparu, n’avait pourtant pas fait ce don sans une arrière-pensée précise. N’était-il pas temps que le temple du modernisme, où le dernier Monet menait droit à Pollock, et Matisse à Rothko, s’ouvrît à d’autres expressions, moins attendues et peut-être moins convenues, des années 1920-1950 ? Parce qu’il ne partageait pas les préventions d’un Clement Greenberg, qui jugeait fallacieuse et efféminée (pour ne pas dire plus) la peinture de Bérard et des néo-romantiques, Jean Clair fit retraverser l’atlantique au tableau et l’exposa, en 1980, au milieu de la moisson dérangeante de ses Réalismes. Vilipendé à Paris, applaudi en Allemagne, l’iconoclasme bien connu du commissaire ouvrait une brèche. Longtemps toutefois les Français refusèrent de s’y engouffrer. Patrick Mauriès, qui fait paraître le livre juste et complet que nous attendions de lui sur Bérard et les siens, n’en est pourtant pas à son coup d’essai. C’est plutôt le fruit d’un long compagnonnage, d’une restauration discrète, secrète au grand nombre, qui vient aujourd’hui à maturité. Du reste, il ne fallait pas tarder davantage pour faire entendre une voix française, complice de son objet, mais soucieuse de ne pas céder à l’anachronisme, car la vague des queer studies s’est récemment émue de la relégation dont les néo-romantiques furent les victimes : le canon avant-gardiste, assimilée désormais au mâle blanc dominant, les aurait broyés, de même qu’il aurait bridé la création féminine. A la victimisation excessive, Mauriès préfère l’investigation historique. Voilà près d’un siècle qu’à Paris, rue Royale, Galerie Druet, Bérard, les deux frères Berman et Paul Tchelitchev créaient la sensation d’un art nouveau, nouveau de ne pas l’être complètement. Le mal nommé « retour à l’ordre » définirait tout le regain figuratif des années 1920 en son reflux nécessairement réactionnaire. Or, Bérard, ce Français héritier de Degas, Vuillard et Modigliani, et ses compères, trois Russes poussés à l’exil par la Révolution de 17, n’avaient pas sauté d’un dogmatisme à l’autre. Il faut bien lire ce qu’écrit Mauriès de leur modernisme excentrique, c’est-à-dire rebelle à la ligne droite et à la réification des formes vidées d’humanité désirante ou souffrante, bien comprendre la distance poreuse qu’ils maintinrent au surréalisme naissant, voire au magnétisme de De Chirico , bien analyser leur dialogue avec Picasso, bleu, rose et post-cubiste. Issus d’horizons variés, ils aspirent très vite à repousser les limites du chevalet, vers le théâtre, le ballet, la mode et ses revues. Le crime impardonnable de cette activité diasporique les poursuit, mais donne au livre de Mauriès l’un de ses ressorts. Du reste, le néo-romantisme, à l’exception de ses descentes mélancoliques ou de ses clowns 1900, ne s’est pas aligné sur le cafardeux des années 1930-1940. La bonne peinture est une école de vie, Waldemar-George, leur gourou parisien et italien, ne cessa de le répéter. Dès avant la seconde guerre mondiale, nos quatre mousquetaires avaient conquis Paris et Londres, New York et Rome, où, chaque fois, des êtres d’exception, d’Edith Sitwell aux Polignac, d’Edward James à Cocteau, de Soby à Julien Levy, les aimèrent et les poussèrent. Un second marché s’organisa, relayé par la scène et Coco Chanel, Elsa Schiaparelli et Emilio Terry. Certains appartements new yorkais en conservent la marque. De cet art fort de sa fragilité, comme menacé par le lyrisme dont il prend le risque, il convient de réapprendre le langage et l’ambition toujours actuelle, loin des interdits et des nouveaux fanatismes. Ce livre assurément nous y aide.

Les biographies vont s’accroissant sur les actrices oubliées ou négligées du monde de l’art ; le plus souvent, elles ont et auront pour auteurs des femmes conscientes de réparer une injustice. Mêlée à l’histoire de Dada et du surréalisme, l’américaine Mary Reynolds (1891-1950) n’appartient qu’en apparence à la catégorie de ces figures en attente de réhabilitation. En 2015, l’Art Institute de Chicago, riche de 300 livres, catalogues d’exposition et autres documents historiques venant d’elle, lui a rendu un bel hommage. Derrière la créatrice de reliures, parmi les plus inventives de l’entre-deux-guerres, ce joli coup de chapeau laissait entrevoir une existence au diapason du Paris d’alors. La capitale de la « génération perdue » regorge de ces Américaines, pas toujours homosexuelles, qui ont les moyens de vivre et aimer autrement qu’au pays. Pour être moins argentée que son ami Peggy Guggenheim, Mary Reynolds, veuve d’un officier mort au champ d’honneur durant la guerre de 14, demanda un nouveau départ à la France. Marcel Duchamp s’en occupa. Après l’avoir croisé à New York, où il fuit le conflit comme son ami Picabia, Mary le cueille en France, au début des années 1920, et fait de lui son amant. On ne saurait obtenir davantage du prince du dégagement. Ne met-il pas dans ses amours l’ironie, l’aléatoire et le calcul du joueur d’échec ? Le meilleur moyen de se l’attacher, elle le comprit, était de rester désirable et solvable à ses yeux. Mais Mary possédait une autre arme que son argent et sa beauté androgyne. Son sens artistique, comme Christine Oddo y insiste, déborde ses exemplaires bizarrement habillés ou gantés de Jarry, Apollinaire ou Cocteau ! De la fin des tranchées au début de l’Occupation, dont elle s’éloigna moins vite que le « désinvolte » Duchamp ou « l’héroïque » André Breton, cette femme déterminée a tenu son rôle et son verre au milieu des nuits parisiennes. Jazz, alcools et drogues sont les accélérateurs d’un club ouvert au mondains. A son récit alerte, qui cède un peu à la légende dorée du modernisme et qui aurait pu profiter davantage du travail d’archive dont témoigne l’ample bibliographie, Christine Oddo accroche toutes sortes de figures essentielles, Man Ray et Henri-Pierre Roché notamment. Mais le meilleur du livre, on ne s’en plaindra pas, se niche dans ses portraits de femmes, vivifiantes affranchies.
*Patrick Mauriès, Néo-Romantiques. Un moment oublié de l’art moderne. 1926-1972, Flammarion, 39,90 €. / Christine Oddo, Mary Reynolds. Artiste surréaliste et amante de Marcel Duchamp, Tallandier, coll. Libre à elles, 2021, 20,90 €

*Preuve est royalement administrée à Evian qu’une exposition Christian Bérard était possible, en France, sur un grand pied, sans l’appoint, souhaité mais décliné, du MoMA. D’autres musées, d’autres galeries, d’autres particuliers ont joué le jeu, ce qui nous vaut une large sélection du corpus et quelques insignes raretés. Devant pareille réunion d’œuvres, les portraits où il mit le meilleur de lui-même et parfois ses tristesses, les impromptus balnéaires où les odalisques changent de sexe, le caprice de ses décors, c’est-à-dire l’alliance de gravité et de frivolité qu’il forgeait au service de Mozart, Cocteau, Balanchine ou Massine, on en oublie les défections américaines. Louis Jouvet, fréquent et génial complice, disait de Bébé qu’il était aussi paresseux que travailleur. D’autres témoignages de même saveur contradictoire émaillent le catalogue aussi intéressant qu’est belle sa couverture drapée de bleu. Bérard avait la religion des amis, qui ne furent pas que l’alcool et l’opium. On lira ainsi certains des messages (Marie-Laure de Noailles, Jouhandeau, Christian Dior, Henri Sauguet, Julien Green) qui lui furent adressés après sa mort, au gré des expositions, plus ou moins discrètes, de la mémoire. Celle d’Evian, dont on remerciera Jean-Pierre Pastori et William Saadé, est la plus importante jamais organisée depuis l’hommage de 1950, voulu par Jean Cassou, qu’on lira aussi ici. SG / Christian Bérard, au théâtre de la vie, Palais Lumière d’Evian, jusqu’au 22 mai 2022. L’exposition connaîtra une seconde étape, à Monaco, au printemps. Catalogue sous la direction des commissaires, SilvanaEditoriale, 34€.
ROMANTISMES

Reliant le Caïn et le Don Juan de Byron aux plus chauds poèmes des Fleurs du Mal, Feu et flamme fut à la Jeune France de 1829-1832 ce que fut la Barque de Dante aux incertitudes de l’après-Waterloo, et le Sturm und Drang aux Goethe, Schiller et Haydn des années 1770. Ce mince recueil de poèmes, publié en août 1833 avec un grand luxe de soin éditorial, souleva un silence massif malgré la puissance frénétique, spleenétique et ironique de ses vers, que leur noirceur amusée fit passer à tort pour débraillés et vides de sens. Il est vrai que les « camarades » de Philothée O’Neddy , les membres turbulents du Petit Cénacle, surveillés par la police de Louis-Philippe (on vient de le documenter), soupçonnés de républicanisme et de déviances sexuelles, oublièrent d’assurer la réclame de la plaquette. Pas de brûlot de Pétrus Borel, le plus porté sur le nudisme et la Carmagnole anarchisante, pas plus de lancement de la part de Nerval et de Gautier, qui consacra cependant l’un de ses ultimes et plus beaux articles, en février 1872, à O’Neddy et sa poétique des extrêmes, riche de sincérité unique comme de boursoufflure émouvante. A distance, presque un demi-siècle, leurs folies communes avouaient les nécessaires excès du chahut de 1830. Mais, entretemps, Baudelaire avait fait son miel, comme Aurélia Cervoni le montre indubitablement, de la marée noire. Après un relatif oubli que Marcel Hervier, Valery Larbaud, Max Milner et Jean-Luc Steimetz empêchèrent d’être irréversible, Feu et flamme revient assorti d’un certain nombre de textes critiques, en un volume impeccable qui charmera les connaisseurs et comblera les nouveaux lecteurs. SG / Philothée O’Neddy, Feu et flamme et autres textes, édition par Aurélia Cervoni, Honoré Champion, 2021, 55€.

Vingt ans séparaient Victor Pavie, né en 1808, de l’illustre David d’Angers, Prix de Rome de sculpture, né à la veille de la Révolution de 1789 et fanatiquement attaché aux Lumières. La politique creusait un peu l’écart : le jeune et pieux monarchiste, accueilli par le Cénacle de Victor Hugo en 1826, évolue certes vers le catholicisme libéral et social de Lamennais, l’un des dieux de sa première maturité. Comme de juste, Pavie et David piaffent d’impatience sous la monarchie de Juillet qui ne les a pas maltraités. Mais c’est 1848, février, qui dissipe entre eux toute divergence idéologique. La République renaît nimbée, un temps, de l’onction catholique et presque divine. Dieu, la liberté et le Peuple, le programme mennaisien de Lacordaire et Montalembert (qui n’aimait guère le protestantisme de David) devient l’étendard du jour : même un Baudelaire s’en est saisi en ce printemps des révoltes heureuses. Les lettres que Pavie adresse à son aîné, dont Marianne ressuscitée fit presque son Ministre des Beaux-Arts, explosent de joie. La ferveur, du reste, est la tonalité usuelle de cette correspondance qui manquait à notre connaissance du milieu littéraire et artistique de ces années climatériques. Le génie des élus et la justice pour tous étant les sujets du statuaire, l’époque, ses causes et ses combattants défilent dans son atelier, de Delacroix, que Pavie exalte, à Balzac et Dumas, de l’abolition de l’esclavage à l’unité reconquise de la Nation. L’écho d’autres luttes y résonne, internes au romantisme. Pétrus Borel et son journal incendiaire, La Liberté, s’attaquent en septembre 1832 à la réputation d’intégrité de David et donnent voix aux jeunes sculpteurs, hernanistes impatients d’imposer un art plus radical ou plus chrétien d’aspect et d’idée. Les familiers du cercle de Gautier et Nerval, de Duseigneur et Bion, y retrouveront leurs petits et jouiront de l’ample appareil de notes, comme de l’air exalté que respire ce très beau volume. SG / Victor Pavie, Lettres à David (d’Angers), 1825-1854, édition critique par Jacques de Caso et Jean-Luc Marais, Honoré Champion, 2021, 78€.
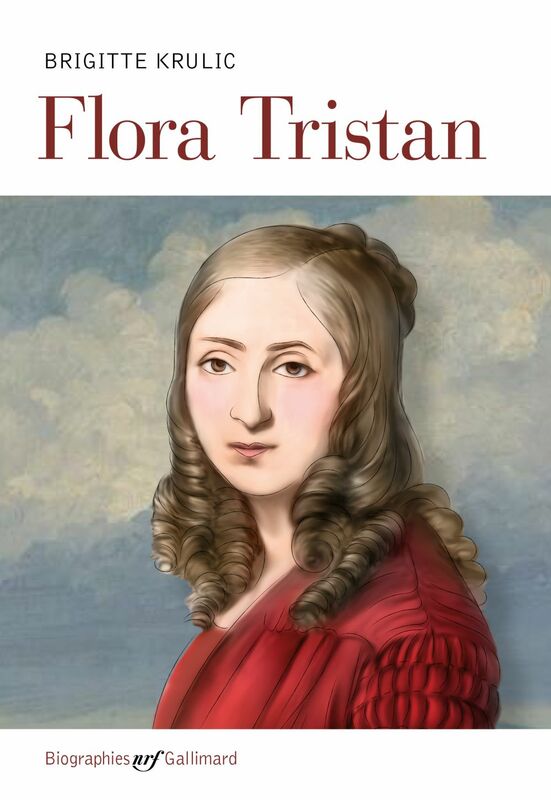
Au promeneur qui s’aventure parmi les allées de l’ancien couvent des Chartreux, devenu un cimetière du Bordeaux révolutionnaire aujourd’hui rattrapé par sa banlieue, plusieurs figures du romantisme adressent un salut amical. Le père et le frère de Delacroix y sont enterrés, le cœur du général Moreau aussi, de même que les restes de Flora Tristan. Sa sépulture, un rien maçonnique avec sa colonne brisée, se pare de deux symboles chrétiens, bien faits pour rappeler que la défunte ne dissocia jamais son socialisme saint-simonien du message évangéliste et de la Providence divine. Le lierre de l’immortalité, de l’énergie toujours renaissante, surprend moins que les deux livres, croisés à la manière du symbole chrétien, qui ornent le sommet du monument. L’un d’entre eux, L’Union ouvrière, fait écho à l’inscription faciale du tombeau, hommage des « travailleurs reconnaissants ». Après nous avoir inquiétés par sa préface très MeToo, la biographie de Brigitte Krulic nous rassure par la conscience des dangers qu’elle a su éviter. On a trop enfermé la grand-mère de Gauguin dans ses affres domestiques et sa légende de paria au grand cœur. Or cette fille naturelle d’un grand d’Espagne, mal mariée au sinistre Chazal, n’eut pas d’autre choix que de prendre son destin en main. Ses dons d’écriture, ses contacts avec le milieu des peintres et écrivains « engagés » (que Krulic effleure), sa condamnation du capitalisme sauvage et de la condition indigène (au Pérou et ailleurs), mais aussi son carriérisme (qui la fit moins négliger ses droits d’auteur que ses devoirs de mère, au dire de George Sand !) et sa probable bisexualité nous intéressent plus que la prétendue pionnière du bolchevisme ou de la dissolution des sexes dans le nirvana post-biologique où notre triste époque voit son salut. « L’Odyssée de Flora Tristan » (Mario Vargas Llosa) n’a nul besoin des prophéties qu’on lui prête pour nous passionner. SG / Brigitte Krulic, Flora Tristan, NRF Biographies, Gallimard, 2022, 21,50€.

Chez Louis-Antoine Prat, derrière la retenue anglaise, le romantique perce partout. En témoignent sa collection de dessins fiévreux et sensuels, son panache à la tête des Amis du Louvre, sa façon de réveiller les dîners en ville, son écriture surtout, qui vient de sortir d’un long silence et promet de ne plus y retourner. Les livres s’enchaînent, courts romans, nouvelles désopilantes et pièces de théâtre à risque. Emu par tant de verve, le quai Conti vient de le gratifier d’un prix, on en parle même dans les rares journaux qui lisent encore. Sa façon bien à lui de mêler littérature et art, de faire de celui-ci le sujet d’étonnement et d’égarement de celle-là, fait merveille à nouveau. Il est vrai que le monde des collectionneurs et des marchands, des artistes et de leurs amis, recèle plus d’un motif à croquer, d’une intrigue à filer, d’un trait à décocher. Elle est si drôle à voir s’agiter, sous sa plume pourtant charitable, cette jet-set des musées et des salles de vente, des plateaux de télévision et des sauteries entre soi… Le lecteur comprendra assez tôt que le titre de son dernier recueil ne doit rien au défaitisme ambiant. Il est simplement bon de ne pas frayer trop longtemps avec certains puissants de la finance ou de la politique. Même les mots, à les écouter, perdent leur valeur d’usage et se corrompent. Au terme de la première nouvelle, une uchronie comme cet auteur à imagination les affectionne, une jeune fonctionnaire, lunettes Armani et tailleur bas de gamme, parle aux journalistes en pleine débâcle boursière. Comme la crème de la création contemporaine est cette fois emportée, le choc ébranle sérieusement les institutions. La presse, longtemps complice de la surchauffe, change de camp et accable l’optimisme d’un discours qu’elle qualifie de « néo-romantique » ! Heureusement que tout le livre n’est pas aussi noir que son début et que Prat parvient à nous émouvoir et nous amuser en nous conviant aux obsèques d’un Balthus du pauvre, ou au tournage d’un film troublant sur Chassériau, le métis aux deux sœurs tendrement aimées. Situations cocasses, personnages à clef, fausses exergues, citations farfelues, l’éternel romantisme, en somme. SG / Louis-Antoine Prat, Reste avec les vaincus et autres nouvelles, Editions El Viso, 15€. Lire aussi sa dernière pièce où revit Goldoni, L’Ambigu vénitien, Editions Samsa, 8€, mais dont la morale est baudelairienne : on ne peut s’attacher à l’image d’un être qui vous a trahi, fût-elle le plus beau tableau du monde. Les canaux de Venise en regorgent.

CAILLEBOTTE SUR LES ONDES.
L’Art et la Matière
https://www.franceculture.fr/oeuvre/caillebotte-peintre-des-extremes
Historiquement vôtre
https://www.europe1.fr/emissions/les-recits-de-stephane-bern/gustave-caillebotte-4093067


















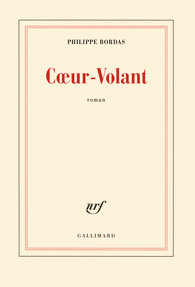







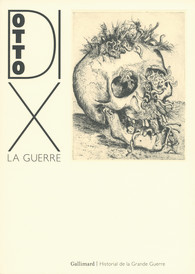
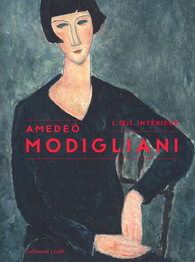

 Sans qu’ils le sachent encore, Bernard et
Sans qu’ils le sachent encore, Bernard et  La vie de Bernard bascule dès sa démobilisation. Le 25 juillet 1940, il épouse Else Reichman, une superbe Juive autrichienne qu’il a abordée au Louvre alors qu’elle tournait autour de la Vénus de Milo (il s’était mis lui-même à tourner autour des deux beautés avant d’aborder la seule qui pût partager son existence précaire). Le 26, il expédie à Paulhan sa profession de foi collaborationniste. Cette concomitance surprend moins quand on réalise que Bernard ne confond pas la
La vie de Bernard bascule dès sa démobilisation. Le 25 juillet 1940, il épouse Else Reichman, une superbe Juive autrichienne qu’il a abordée au Louvre alors qu’elle tournait autour de la Vénus de Milo (il s’était mis lui-même à tourner autour des deux beautés avant d’aborder la seule qui pût partager son existence précaire). Le 26, il expédie à Paulhan sa profession de foi collaborationniste. Cette concomitance surprend moins quand on réalise que Bernard ne confond pas la  Puisque Ulysse revient en Folio Classique (Gallimard, 12,80€) dans l’édition que Jacques Aubert avait dirigée pour La Pléiade, rappelons l’impact de cette grandiose satire homérique sur la génération de Marc Bernard. La traduction de
Puisque Ulysse revient en Folio Classique (Gallimard, 12,80€) dans l’édition que Jacques Aubert avait dirigée pour La Pléiade, rappelons l’impact de cette grandiose satire homérique sur la génération de Marc Bernard. La traduction de  Raconter la vie d’Italo Svevo, qui fuit le sensationnel et ne se livra guère, n’était pas une mince affaire. Plus d’un biographe, assez téméraire pour tenter sa chance, aurait vite abandonné en cours de route.
Raconter la vie d’Italo Svevo, qui fuit le sensationnel et ne se livra guère, n’était pas une mince affaire. Plus d’un biographe, assez téméraire pour tenter sa chance, aurait vite abandonné en cours de route.  De cet effondrement, fruit pourri de la Conférence de Paris,
De cet effondrement, fruit pourri de la Conférence de Paris,