Plus notre lecture progresse dans la correspondance de Zweig et Romain Rolland, plus s’accuse la supériorité du premier sur le second. Supériorité d’ordre humain, littéraire et politique, que la marche accélérée de l’histoire rend plus nette au cours des années 1928-1940. Troisième et dernier d’une publication qui fera date, ce volume en est aussi le plus amer. Les deux amis que le communisme allait séparer font d’abord le deuil de leur idéal fraternitaire. L’esprit de Genève, dirait Drieu, bat en retraite. Partout reculent l’héritage des lumières et «l’espoir de 1919», partout s’affirment l’ère des dictatures, l’envoutement des masses, le culte des chefs et le dressage des artistes. Mars affute sa lame sur le dos du capitalisme failli : «J’observe avec une peur toujours croissante, écrit Zweig en octobre 1930, le terrible flux de la passion guerrière.» Si l’auteur futur du Monde d’hier a pu s’enthousiasmer un temps pour Mussolini, et vibrer au spectacle énergique des jeunes hitlériens, c’est qu’il sut dissocier la force révolutionnaire du fascisme de ses composantes régressives. Romain Rolland et nombre d’historiens ont vivement condamné ce qu’ils considéraient comme d’étranges inconséquences de la part d’un Juif viennois, qui fuirait l’Autriche en février 1934. Barbariser l’Allemagne, comme on le fit durant la guerre de 14, insulte l’intelligence de Zweig et son sens de la realpolitik, qu’il n’aime pas, mais observe comme personne. Le 4 février 1933, quelques jours après qu’Hitler est devenu chancelier, Zweig désignait la main de Moscou derrière la désunion des forces qui auraient dû contenir la folie des nationalistes : « La Grande Guerre recommence, l’Europe est plus menacée que jamais. Et le fait qu’en France la raison s’éveille nuit plutôt, car la peur l’a réveillée et tout ce que la France donnera maintenant à l’Allemagne paiera la Russie et sera écrit au profit de la réaction. Et dire qu’il y a dix ans, nous avons cru à la victoire de la raison ! »
 La Russie, Zweig s’y est rendu en 1928. Avec le «double visage» que présente chaque chose là-bas, l’empire communiste suscite une défiance qui tourne vite à la condamnation. Tandis que Rolland justifie la violence répressive au nom de la défense des «valeurs» menacées, et fait de Moscou le rempart contre la barbarie fasciste, miroir aux alouettes que Gide dénoncerait après s’être laissé piéger, Zweig comprend vite que Staline est décidé à affaiblir l’Europe démocratique et faciliter son futur dépeçage par les nazis, ses alliés potentiels avant l’affrontement final. Rolland, qui n’a rien vu venir, s’effondre à l’annonce du pacte germano-soviétique. Et pourtant lui aussi est allé en Russie, lui aussi a vu et entendu. Dès 1935, les Russes le tenaient et les purges de 1936 n’y feront rien. Le Front populaire et le front anti-franquiste, instrumentalisés l’un et l’autre par les soviétiques, servent à atténuer les ombres d’une dérive dictatoriale que Zweig, lui, n’accepte à aucun prix. Depuis Londres, où il va vivre l’essentiel de son premier exil jusqu’en 1940, Zweig ne s’enferme pas dans l’écriture de nouvelles biographies dont nous avons déjà dit combien les circonstances affectèrent le principe et l’écriture. Face à l’assouplissement criminel des Anglais envers Hitler, il s’indigne sans tarder. Munich et sa nouvelle journée des dupes, en septembre 1938, l’ont révulsé. «L’impossible exil» qui le mènerait jusqu’au suicide a fasciné plus d’un biographe. L’américain George Prochnik, dont le destin familial reste marqué par l’Anschluss et la persécution des Juifs, sait qu’on ne se fuit pas. Impossible… Son livre, plus écrit que docte, plus sensible que neuf, consacre ses meilleures pages au moment new-yorkais du dernier voyage. C’est une star que le «monde libre» fête au printemps 1941. Le Brésil devait le conquérir davantage, pas suffisamment pour l’arracher à la décision d’en finir.
La Russie, Zweig s’y est rendu en 1928. Avec le «double visage» que présente chaque chose là-bas, l’empire communiste suscite une défiance qui tourne vite à la condamnation. Tandis que Rolland justifie la violence répressive au nom de la défense des «valeurs» menacées, et fait de Moscou le rempart contre la barbarie fasciste, miroir aux alouettes que Gide dénoncerait après s’être laissé piéger, Zweig comprend vite que Staline est décidé à affaiblir l’Europe démocratique et faciliter son futur dépeçage par les nazis, ses alliés potentiels avant l’affrontement final. Rolland, qui n’a rien vu venir, s’effondre à l’annonce du pacte germano-soviétique. Et pourtant lui aussi est allé en Russie, lui aussi a vu et entendu. Dès 1935, les Russes le tenaient et les purges de 1936 n’y feront rien. Le Front populaire et le front anti-franquiste, instrumentalisés l’un et l’autre par les soviétiques, servent à atténuer les ombres d’une dérive dictatoriale que Zweig, lui, n’accepte à aucun prix. Depuis Londres, où il va vivre l’essentiel de son premier exil jusqu’en 1940, Zweig ne s’enferme pas dans l’écriture de nouvelles biographies dont nous avons déjà dit combien les circonstances affectèrent le principe et l’écriture. Face à l’assouplissement criminel des Anglais envers Hitler, il s’indigne sans tarder. Munich et sa nouvelle journée des dupes, en septembre 1938, l’ont révulsé. «L’impossible exil» qui le mènerait jusqu’au suicide a fasciné plus d’un biographe. L’américain George Prochnik, dont le destin familial reste marqué par l’Anschluss et la persécution des Juifs, sait qu’on ne se fuit pas. Impossible… Son livre, plus écrit que docte, plus sensible que neuf, consacre ses meilleures pages au moment new-yorkais du dernier voyage. C’est une star que le «monde libre» fête au printemps 1941. Le Brésil devait le conquérir davantage, pas suffisamment pour l’arracher à la décision d’en finir.
 Séparer l’Italie de Mussolini de l’Allemagne d’Hitler fut l’obsession de Pierre Laval, sa grande idée dès avant sa nomination au poste de ministre des affaires étrangères, le 13 octobre 1934, en remplacement de Louis Barthou. Sauf à projeter anachroniquement sur le Duce la future politique de l’axe, c’était une politique défendable. Laval se méfiait de Staline, autre bon point. Au début de septembre 1939, toujours persuadé que Rome pourrait «sauver la paix», il en appelait à une intervention italienne auprès d’Hitler tout en reprochant à Daladier sa politique complaisante envers l’Allemagne. Ce «socialiste dissident» (Jean-Paul Cointet), écarté du pouvoir sous le Front populaire, obéissait déjà au pragmatisme dont il ne s’est jamais écarté, et qui lui vaut de revenir aux affaires en juin 1940… Dans Vichy tel quel, vivante chronique des années 1940-1944 par un observateur répandu et caustique, Dominique Canavaggio trace un portrait très favorable de Laval, qu’il a bien connu et dont il suit pas à pas les mésaventures. Ce brillant normalien, devenu journaliste après avoir renoncé au théâtre, cultivait une authentique graine d’écrivain. Pour avoir fréquenté, à Ulm, de futurs partisans du redressement national, Pucheu et Déat, Canavaggio distinguera les idéologues, fascisants ou non, des hommes qui, venant souvent de la gauche, font de la Collaboration un moyen d’obtenir «que la défaite n’accable, ne ruine pas la France». Cette différence fondamentale allait vite s’ajouter aux conflits de personne et d’ambition qui tissèrent l’ordinaire de Vichy. Canavaggio rassembla ses souvenirs et notes après la Libération, il avait assisté, jour après jour, au drame qu’il n’avait pas su écrire pour Louis Jouvet. Le limogeage de Laval, le 13 décembre 1940, en constitue l’un des actes les plus réussis. Friand de la chose vue ou entendue, Canavaggio décrit la façon progressive dont se met en place la terrible machine répressive d’un gouvernement de plus en plus fantoche, au gré des concessions dont les dociles Flandin et Darlan, successeurs de Laval, ouvrirent la vanne.
Séparer l’Italie de Mussolini de l’Allemagne d’Hitler fut l’obsession de Pierre Laval, sa grande idée dès avant sa nomination au poste de ministre des affaires étrangères, le 13 octobre 1934, en remplacement de Louis Barthou. Sauf à projeter anachroniquement sur le Duce la future politique de l’axe, c’était une politique défendable. Laval se méfiait de Staline, autre bon point. Au début de septembre 1939, toujours persuadé que Rome pourrait «sauver la paix», il en appelait à une intervention italienne auprès d’Hitler tout en reprochant à Daladier sa politique complaisante envers l’Allemagne. Ce «socialiste dissident» (Jean-Paul Cointet), écarté du pouvoir sous le Front populaire, obéissait déjà au pragmatisme dont il ne s’est jamais écarté, et qui lui vaut de revenir aux affaires en juin 1940… Dans Vichy tel quel, vivante chronique des années 1940-1944 par un observateur répandu et caustique, Dominique Canavaggio trace un portrait très favorable de Laval, qu’il a bien connu et dont il suit pas à pas les mésaventures. Ce brillant normalien, devenu journaliste après avoir renoncé au théâtre, cultivait une authentique graine d’écrivain. Pour avoir fréquenté, à Ulm, de futurs partisans du redressement national, Pucheu et Déat, Canavaggio distinguera les idéologues, fascisants ou non, des hommes qui, venant souvent de la gauche, font de la Collaboration un moyen d’obtenir «que la défaite n’accable, ne ruine pas la France». Cette différence fondamentale allait vite s’ajouter aux conflits de personne et d’ambition qui tissèrent l’ordinaire de Vichy. Canavaggio rassembla ses souvenirs et notes après la Libération, il avait assisté, jour après jour, au drame qu’il n’avait pas su écrire pour Louis Jouvet. Le limogeage de Laval, le 13 décembre 1940, en constitue l’un des actes les plus réussis. Friand de la chose vue ou entendue, Canavaggio décrit la façon progressive dont se met en place la terrible machine répressive d’un gouvernement de plus en plus fantoche, au gré des concessions dont les dociles Flandin et Darlan, successeurs de Laval, ouvrirent la vanne.
Stéphane Guégan
 *Romain Rolland / Stefan Zweig, Correspondance 1928-1940, Albin Michel, 32€ ; George Prochnik, L’Impossible exil. Stefan Zweig et la fin du monde, traduit de l’américain par Cécile Dutheil de la Rochère, Grasset, 23€.
*Romain Rolland / Stefan Zweig, Correspondance 1928-1940, Albin Michel, 32€ ; George Prochnik, L’Impossible exil. Stefan Zweig et la fin du monde, traduit de l’américain par Cécile Dutheil de la Rochère, Grasset, 23€.
**Signalons aussi, de Catherine Sauvat, Rilke. Une existence vagabonde, Fayard, 20€, qui fait plusieurs allusions à Zweig, grand admirateur de son aîné. La réciproque est moins vraie… Nulle attache, nulle patrie, pas d’adresse, note Zweig de Rilke, un feu follet qui ne croit qu’à l’art et aux liaisons éphémères. Aux prises avec ce mufle, mauvais fils, mauvais mari, mauvais père, Catherine Sauvat contient un féminisme qu’on sent souvent près d’exploser. Elle se venge en brossant le portrait de celles qui se succédèrent, pas toujours, dans le cœur du poète génial. La fine fleur de ses amoureuses, Lou Andreas-Salomé ou Baladine Klossowska (mère de Balthus), et de ses soupirantes, telle Paula Modersohn-Becker, ne fut guère mieux traitée que les moins fameuses. La laideur sensuelle de Rilke a fait des ravages, ce végétarien était un sanguin compulsif. J’aurais parlé autrement de sa passion pour Rodin, Cézanne et Les Saltimbanques de Picasso, qui inspirèrent la plus autobiographique des Elégies de Duino. Mais Catherine Sauvat saisit bien la duplicité du personnage, sa culture française et allemande, sa mondanité de poète fauché, son peu d’aménité pour les Juifs et son esthétique assez mallarméenne de la suggestion objectale. «Il n’est vérité sans descente aux enfers», écrivait Jean Cassou dans ses Trois poètes (Rilke, Milosz et Machado). Pour Rilke, la grande poésie n’était pas faite de sentiments, mais d’expériences, livrées sans mode d’emploi ni repentance excessive. SG
***Dominique Canavaggio, Vichy Tel quel 1940-1944, avant-propos de Jean Canavaggio, Editions de Fallois, 22€.
DES POCHES BIEN REMPLIES
 «Il n’est poésie que de circonstance», aimait à dire Jean Cassou, citant Goethe… Le premier directeur du musée d’Art moderne, au sortir des années noires, croyait à la poésie et à la peinture de combat. Mal traité par Vichy, alors qu’il a déjà posé un pied légitime dans le milieu muséal (pas toujours aussi bien inspiré), Cassou entre en résistance, croise Paulhan et le réseau du musée de l’Homme avant d’agir à Toulouse, où il se fait coffrer par la police française. Nous sommes en décembre 1941. Relâché en février suivant, il est toutefois jugé en juillet et condamné. Pour un an, à nouveau, c’est la prison, les vers sous les fers. Car Cassou, qu’on prive de livres, écrit et s’élève au-dessus de ses malheurs. Le sonnet vous soigne vite de la tentation de l’épanchement. Début 1944, trente-trois d’entre eux sont publiés clandestinement par les éditions de Minuit, précédés d’une préface flamboyante d’Aragon, alias François La Colère. Cassou lui-même signe Jean Noir sa fine plaquette. «Le tour du sonnet, écrit Henri Scepi dans son excellente édition, opère une relève, annonce une promesse par quoi serait racheté ce temps de misère et d’infortune.» Le premier sonnet, qui rappelle la sublime Ophélie de Rimbaud, s’en tient à une morale inflexible : «il ne te reste plus qu’à mépriser le mépris même». Quant à «l’attachement à sa terre», il peut fort bien s’accompagner d’une aspiration «aux grandes idées qui mènent le monde». La préface d’Aragon, annonce de La Semaine sainte, s’ouvre sur l’évocation de Géricault, dont le Louvre avait protégé La Méduse sous la botte : «En ce temps-là, la France était un radeau à la dérive emportant des naufragés, et les vivres manquaient, les enfants étaient pâles, les femmes déchiraient le ciel de leurs cris ; des hommes, si maigres qu’on voyait leurs douleurs, fixaient sur les lointains sans voiles la malédiction de leurs yeux secs…» Aragon y embarque plus loin les fusillés et les Juifs des «bagnes de Pologne». Cette préface, c’est son Cahier noir (Jean Cassou, Trente-trois sonnets composés au secret, édition d’Henri Scepi, Folioplus classiques 20e siècle, 4,80€). SG
«Il n’est poésie que de circonstance», aimait à dire Jean Cassou, citant Goethe… Le premier directeur du musée d’Art moderne, au sortir des années noires, croyait à la poésie et à la peinture de combat. Mal traité par Vichy, alors qu’il a déjà posé un pied légitime dans le milieu muséal (pas toujours aussi bien inspiré), Cassou entre en résistance, croise Paulhan et le réseau du musée de l’Homme avant d’agir à Toulouse, où il se fait coffrer par la police française. Nous sommes en décembre 1941. Relâché en février suivant, il est toutefois jugé en juillet et condamné. Pour un an, à nouveau, c’est la prison, les vers sous les fers. Car Cassou, qu’on prive de livres, écrit et s’élève au-dessus de ses malheurs. Le sonnet vous soigne vite de la tentation de l’épanchement. Début 1944, trente-trois d’entre eux sont publiés clandestinement par les éditions de Minuit, précédés d’une préface flamboyante d’Aragon, alias François La Colère. Cassou lui-même signe Jean Noir sa fine plaquette. «Le tour du sonnet, écrit Henri Scepi dans son excellente édition, opère une relève, annonce une promesse par quoi serait racheté ce temps de misère et d’infortune.» Le premier sonnet, qui rappelle la sublime Ophélie de Rimbaud, s’en tient à une morale inflexible : «il ne te reste plus qu’à mépriser le mépris même». Quant à «l’attachement à sa terre», il peut fort bien s’accompagner d’une aspiration «aux grandes idées qui mènent le monde». La préface d’Aragon, annonce de La Semaine sainte, s’ouvre sur l’évocation de Géricault, dont le Louvre avait protégé La Méduse sous la botte : «En ce temps-là, la France était un radeau à la dérive emportant des naufragés, et les vivres manquaient, les enfants étaient pâles, les femmes déchiraient le ciel de leurs cris ; des hommes, si maigres qu’on voyait leurs douleurs, fixaient sur les lointains sans voiles la malédiction de leurs yeux secs…» Aragon y embarque plus loin les fusillés et les Juifs des «bagnes de Pologne». Cette préface, c’est son Cahier noir (Jean Cassou, Trente-trois sonnets composés au secret, édition d’Henri Scepi, Folioplus classiques 20e siècle, 4,80€). SG
 Bête noire des écrivains favorables à la Collaboration, Mauriac les tança d’un brûlot de même couleur. Ce classique de la résistance mord encore… Avec le Maréchal, la NRF de Drieu, Fabre-Luce, les écrivains et les peintres du «voyage», le catholique bordelais ne prend pas de gants. C’est qu’il écrit masqué, et crucifie toute allégeance au diable. Les éditions de Minuit publièrent Le Cahier noir clandestinement en 1943, une parution anglaise vit le jour dès 1944. Autant dire que ces quelques feuillets en colère eurent un écho immédiat… Distinct du Journal de l’Occupation dont on trouvera ici quelques fragments, Le Cahier noir poursuit les «amis» de l’Allemagne de la même sévérité. Outre qu’ils s’aveuglent aux yeux de Mauriac, les partisans de la «nouvelle Europe» couvrent de leurs noms, sciemment ou non, des horreurs contraires à toute morale. L’origine du mal, pour un chrétien conséquent, est en chacun de nous. Aussi enjoint-il son lecteur à résister aux prosélytes réducteurs de Machiavel (comme Mussolini) ou de Nietzsche (comme les nazis) : l’action politique et militaire ne saurait se situer par-delà le bien et le mal. A lire Jean Touzot, le meilleur spécialiste de la question, ce J’accuse de l’ombre, sûr d’avancer dans la bonne lumière, confirme les positions qu’avait prises Mauriac depuis 1919. Le vieil humanisme chrétien, victime de la guerre, n’avait pas réussi à empêcher la suivante. Pourtant Mauriac, anti-munichois, aura dénoncé ceux qui ne surent briser à temps le cercle fatal ou caressèrent le «meurtrier du Kremlin» (François Mauriac, Le Cahier noir et autres textes de l’Occupation, édition établie, présentée et annotée par Jean Touzot, Bartillat, 12€ ; une petite erreur, p. 47, s’est glissée au sujet du voyage des artistes de 1941). SG
Bête noire des écrivains favorables à la Collaboration, Mauriac les tança d’un brûlot de même couleur. Ce classique de la résistance mord encore… Avec le Maréchal, la NRF de Drieu, Fabre-Luce, les écrivains et les peintres du «voyage», le catholique bordelais ne prend pas de gants. C’est qu’il écrit masqué, et crucifie toute allégeance au diable. Les éditions de Minuit publièrent Le Cahier noir clandestinement en 1943, une parution anglaise vit le jour dès 1944. Autant dire que ces quelques feuillets en colère eurent un écho immédiat… Distinct du Journal de l’Occupation dont on trouvera ici quelques fragments, Le Cahier noir poursuit les «amis» de l’Allemagne de la même sévérité. Outre qu’ils s’aveuglent aux yeux de Mauriac, les partisans de la «nouvelle Europe» couvrent de leurs noms, sciemment ou non, des horreurs contraires à toute morale. L’origine du mal, pour un chrétien conséquent, est en chacun de nous. Aussi enjoint-il son lecteur à résister aux prosélytes réducteurs de Machiavel (comme Mussolini) ou de Nietzsche (comme les nazis) : l’action politique et militaire ne saurait se situer par-delà le bien et le mal. A lire Jean Touzot, le meilleur spécialiste de la question, ce J’accuse de l’ombre, sûr d’avancer dans la bonne lumière, confirme les positions qu’avait prises Mauriac depuis 1919. Le vieil humanisme chrétien, victime de la guerre, n’avait pas réussi à empêcher la suivante. Pourtant Mauriac, anti-munichois, aura dénoncé ceux qui ne surent briser à temps le cercle fatal ou caressèrent le «meurtrier du Kremlin» (François Mauriac, Le Cahier noir et autres textes de l’Occupation, édition établie, présentée et annotée par Jean Touzot, Bartillat, 12€ ; une petite erreur, p. 47, s’est glissée au sujet du voyage des artistes de 1941). SG
 Big Brother, aujourd’hui, s’appelle Google ou Facebook, l’ami des terroristes… Je me connecte, je me filme, je twitte, je partage, donc je suis… 1984 est bougrement dépassé. L’opium des idéologies s’étant évaporé, place au mourir-ensemble, à la tyrannie du présent. Orwell, en 47 ans d’existence, a enregistré l’accélération du temps, la massification moutonnière et l’attrait des dictatures sous toutes ses formes. S’il n’est pas né dans un milieu défavorisé, la nature ne l’a pas gâté. La faiblesse pulmonaire qui tourmente l’enfant tuera l’écrivain. Orwell avait survécu à la discipline militaire d’Eton (il se félicitera, plus tard, du collège), à la mouise des années parisiennes (son premier livre aurait dû s’intituler Lady Poverty), à la liquidation soviétique du POUM antifranquiste, à la seconde guerre mondiale… Au temps de ses plongées dans les abysses de la misère, à Paris et Londres, il se veut le nouveau Jack London (dont je reparlerai), celui du Peuple d’en-bas… Sur son chemin politique, on croise Barbusse, Huxley (son ancien professeur de français) et Koestler. Cet homme de gauche déniaisé eut une vie, qu’il avait interdit de raconter ! Stéphane Maltère la raconte sobrement, le lecteur français y apprendra beaucoup. Ce spécialiste de Pierre Benoit a fait son brexit (inversé) sans se noyer (Stéphane Maltère, Orwell, Gallimard, Folio biographies, 9,20€). SG
Big Brother, aujourd’hui, s’appelle Google ou Facebook, l’ami des terroristes… Je me connecte, je me filme, je twitte, je partage, donc je suis… 1984 est bougrement dépassé. L’opium des idéologies s’étant évaporé, place au mourir-ensemble, à la tyrannie du présent. Orwell, en 47 ans d’existence, a enregistré l’accélération du temps, la massification moutonnière et l’attrait des dictatures sous toutes ses formes. S’il n’est pas né dans un milieu défavorisé, la nature ne l’a pas gâté. La faiblesse pulmonaire qui tourmente l’enfant tuera l’écrivain. Orwell avait survécu à la discipline militaire d’Eton (il se félicitera, plus tard, du collège), à la mouise des années parisiennes (son premier livre aurait dû s’intituler Lady Poverty), à la liquidation soviétique du POUM antifranquiste, à la seconde guerre mondiale… Au temps de ses plongées dans les abysses de la misère, à Paris et Londres, il se veut le nouveau Jack London (dont je reparlerai), celui du Peuple d’en-bas… Sur son chemin politique, on croise Barbusse, Huxley (son ancien professeur de français) et Koestler. Cet homme de gauche déniaisé eut une vie, qu’il avait interdit de raconter ! Stéphane Maltère la raconte sobrement, le lecteur français y apprendra beaucoup. Ce spécialiste de Pierre Benoit a fait son brexit (inversé) sans se noyer (Stéphane Maltère, Orwell, Gallimard, Folio biographies, 9,20€). SG
 Ils épousèrent tous deux «la France» et l’aimèrent comme une femme, aurait dit Péguy… De Gaulle, privilège de l’âge, de sa formation de Saint-Cyrien et de son passage par l’enfer de Verdun, précéda Malraux dans le culte de la patrie qui les rapprocherait à jamais. Le prurit communiste de l’auteur de La Condition humaine fut pardonné dès la première entrevue, un coup de foudre, qu’Alexandre Duval-Stalla inscrit à sa date précise, le 18 juillet 1945. A rebours de ses prédécesseurs, il a opiniâtrement fouillé toutes sortes d’archives peu accessibles, notamment celles du fameux Gouvernement provisoire de la Libération dont le Général claqua si vite la porte. La guerre avait lié deux destins qui auraient dû s’ignorer, la politique resserra le lien inattendu jusqu’en 1969, au terme d’une «année terrible». Terrible, aussi, pour la France… La biographie croisée d’Alexandre Duval-Stalla avait trouvé son public en 2008, sous les couleurs de L’Infini et de Philippe Sollers, elle reparaît en poche où son souffle et ses coups de plume semblent plus percutants encore (Alexandre Duval-Stalla, André Malraux-Charles de Gaulle, une histoire, deux légendes, Gallimard, Folio, 8,20€ : même éditeur, même collection, même prix : André Malraux, Lettres choisies 1920-1976, parues d’abord dans la Blanche et dont j’ai rendu compte ici). SG
Ils épousèrent tous deux «la France» et l’aimèrent comme une femme, aurait dit Péguy… De Gaulle, privilège de l’âge, de sa formation de Saint-Cyrien et de son passage par l’enfer de Verdun, précéda Malraux dans le culte de la patrie qui les rapprocherait à jamais. Le prurit communiste de l’auteur de La Condition humaine fut pardonné dès la première entrevue, un coup de foudre, qu’Alexandre Duval-Stalla inscrit à sa date précise, le 18 juillet 1945. A rebours de ses prédécesseurs, il a opiniâtrement fouillé toutes sortes d’archives peu accessibles, notamment celles du fameux Gouvernement provisoire de la Libération dont le Général claqua si vite la porte. La guerre avait lié deux destins qui auraient dû s’ignorer, la politique resserra le lien inattendu jusqu’en 1969, au terme d’une «année terrible». Terrible, aussi, pour la France… La biographie croisée d’Alexandre Duval-Stalla avait trouvé son public en 2008, sous les couleurs de L’Infini et de Philippe Sollers, elle reparaît en poche où son souffle et ses coups de plume semblent plus percutants encore (Alexandre Duval-Stalla, André Malraux-Charles de Gaulle, une histoire, deux légendes, Gallimard, Folio, 8,20€ : même éditeur, même collection, même prix : André Malraux, Lettres choisies 1920-1976, parues d’abord dans la Blanche et dont j’ai rendu compte ici). SG
SAVE THE DATE
Mercredi 30 novembre 18h30
Table ronde musée Delacroix/Revue des deux mondes
Transmission et transgression : artistes et écrivains en butte à la censure au 19e siècle
Dominique de Font-Réaulx, Stéphane Guégan et Robert Kopp
Musée Delacroix – Entrée libre sur réservation
Jeudi 1er décembre 20h
Un art d’intérêt général : est-ce possible?
Conférence-débat avec Thomas Schlesser, Maxime Bondu, Camille Morineau, Hervé Aubron
LE BAL – 6 impasse de la Défense 75018 Paris
 Jeudi 8 décembre 2016, 18h30
Jeudi 8 décembre 2016, 18h30
15 mai 1942 : Séguier entre au Louvre! Enrichir les collections à l’heure allemande
Conférence de Stéphane Guégan
Auditorium du Louvre
http://www.louvre.fr/cycles/les-tres-riches-heures-du-louvre/au-programme
Déserté par ses chefs-d’œuvre ou associé au stockage des biens juifs en partance vers l’Allemagne, le Louvre des années sombres, dans nos mémoires, reste le musée du vide et de la honte… Or cette image, nourrie de photographies bien connues, doit être discutée aujourd’hui. Il est un autre Louvre que cette grande maison aux salles orphelines, sinistre cimetière d’une défaite acceptée. Sur ordre des forces d’Occupation, qui n’exigent pas le retour des œuvres mises à l’abri, le musée rouvre dès septembre 1940. Mais c’est une peau de chagrin, tout juste bonne à distraire les soldats de la Wehrmacht… Pour la direction du Louvre, soumise aux demandes contradictoires des Allemands et de Vichy, la marge de manœuvre est étroite, risquée et aléatoire. Elle n’en existe pas moins. Certaines acquisitions, dont le Portrait du Chancelier Séguier de Le Brun, disent une volonté intacte: celle de rendre aux Français un musée enrichi et libre du joug ennemi.

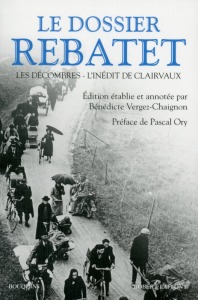
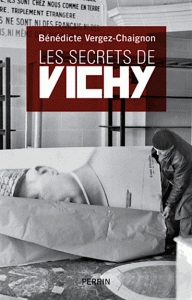

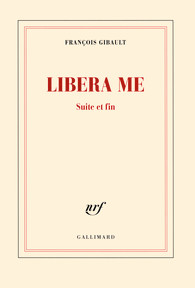
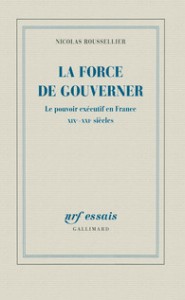

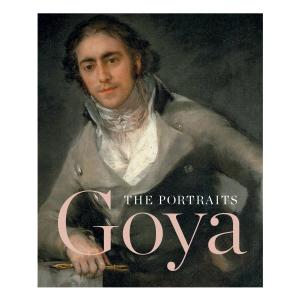






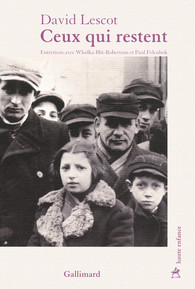








 *Jean Guéhenno, Journal des années noires 1940-1944, Gallimard, Folio, 8,40€.
*Jean Guéhenno, Journal des années noires 1940-1944, Gallimard, Folio, 8,40€. *Paul Valéry, Lettres à Jean Voilier. Choix de lettres 1937-1945, Gallimard, 35€.
*Paul Valéry, Lettres à Jean Voilier. Choix de lettres 1937-1945, Gallimard, 35€.
 Sans qu’ils le sachent encore, Bernard et
Sans qu’ils le sachent encore, Bernard et  La vie de Bernard bascule dès sa démobilisation. Le 25 juillet 1940, il épouse Else Reichman, une superbe Juive autrichienne qu’il a abordée au Louvre alors qu’elle tournait autour de la Vénus de Milo (il s’était mis lui-même à tourner autour des deux beautés avant d’aborder la seule qui pût partager son existence précaire). Le 26, il expédie à Paulhan sa profession de foi collaborationniste. Cette concomitance surprend moins quand on réalise que Bernard ne confond pas la
La vie de Bernard bascule dès sa démobilisation. Le 25 juillet 1940, il épouse Else Reichman, une superbe Juive autrichienne qu’il a abordée au Louvre alors qu’elle tournait autour de la Vénus de Milo (il s’était mis lui-même à tourner autour des deux beautés avant d’aborder la seule qui pût partager son existence précaire). Le 26, il expédie à Paulhan sa profession de foi collaborationniste. Cette concomitance surprend moins quand on réalise que Bernard ne confond pas la  Puisque Ulysse revient en Folio Classique (Gallimard, 12,80€) dans l’édition que Jacques Aubert avait dirigée pour La Pléiade, rappelons l’impact de cette grandiose satire homérique sur la génération de Marc Bernard. La traduction de
Puisque Ulysse revient en Folio Classique (Gallimard, 12,80€) dans l’édition que Jacques Aubert avait dirigée pour La Pléiade, rappelons l’impact de cette grandiose satire homérique sur la génération de Marc Bernard. La traduction de  Il faut plus que du talent pour réussir le portrait de Diderot. Beaucoup, de son vivant, s’y sont essayés. Très peu ont atteint leur but et comblé le modèle qui connaissait bien la peinture et la sculpture, si bien qu’il s’en méfiait. N’étaient-elles pas trop promptes à embellir et donc affadir la réalité ? Du tableau de Louis Michel Van Loo, où
Il faut plus que du talent pour réussir le portrait de Diderot. Beaucoup, de son vivant, s’y sont essayés. Très peu ont atteint leur but et comblé le modèle qui connaissait bien la peinture et la sculpture, si bien qu’il s’en méfiait. N’étaient-elles pas trop promptes à embellir et donc affadir la réalité ? Du tableau de Louis Michel Van Loo, où  Il vero Polichinello, selon la formule que Diderot s’appliquait, a autant fait souffrir les pinceaux de l’Académie royale, cible captive de ses fameux Salons, que les spécialistes de la
Il vero Polichinello, selon la formule que Diderot s’appliquait, a autant fait souffrir les pinceaux de l’Académie royale, cible captive de ses fameux Salons, que les spécialistes de la  Elle aura été, en fin de compte, bien moins énervée que la rentrée scolaire ! À croire que la littérature n’intéresse plus grand monde. Il faut dire qu’elle fait un peu la gueule, notre littérature. Quand par miracle elle renonce à l’invertébré et au nombrilisme, elle distille trop souvent une misanthropie de bon aloi. Cette tradition a ses classiques, du Rolla de Musset à La Nausée de qui vous savez. Le filon du cafardeux aboutit logiquement à
Elle aura été, en fin de compte, bien moins énervée que la rentrée scolaire ! À croire que la littérature n’intéresse plus grand monde. Il faut dire qu’elle fait un peu la gueule, notre littérature. Quand par miracle elle renonce à l’invertébré et au nombrilisme, elle distille trop souvent une misanthropie de bon aloi. Cette tradition a ses classiques, du Rolla de Musset à La Nausée de qui vous savez. Le filon du cafardeux aboutit logiquement à  Le jeu des ressemblances improbables a toujours intrigué les esprits agiles. Qu’Alain Minc en soit un, personne ne saurait le nier. De même, son art du livre bref et son goût des personnalités troublantes, sinon troubles. Sa dernière parution ne déroge pas aux vertus des précédentes. Enlevée et directe, elle parvient à contenir les vies parallèles de Jean Moulin et René Bousquet en 180 pages aérées. À première vue, rien ne rapprochait le symbole de la France libre et le Fouché de la
Le jeu des ressemblances improbables a toujours intrigué les esprits agiles. Qu’Alain Minc en soit un, personne ne saurait le nier. De même, son art du livre bref et son goût des personnalités troublantes, sinon troubles. Sa dernière parution ne déroge pas aux vertus des précédentes. Enlevée et directe, elle parvient à contenir les vies parallèles de Jean Moulin et René Bousquet en 180 pages aérées. À première vue, rien ne rapprochait le symbole de la France libre et le Fouché de la  Minc nous montre surtout un homme pris au piège de son efficacité, de sa puissance d’accommodement et du jeu subtil des Allemands, qui se lasseront du fonctionnaire zélé mais indépendant fin 1943. «De l’exercice auquel je me suis livré, nul ne peut tirer de conclusion définitive», précise Minc avec une belle honnêteté. L’ouvrage de Jacques Gelin, une somme admirablement menée, se veut plus nette sur l’entrelacs de raisons qui aboutirent à la capture de Moulin et à sa liquidation sauvage par les services de Klaus Barbie. De façon assez étonnante, Minc tait le débat que suscite l’arrestation de Moulin depuis celle, voilà trente ans, de l’ancien chef de la Gestapo de Lyon. Or, Moulin a bien été «trahi» avant de tomber, à Caluire, le 21 juin 1943, entre les mains de ses bourreaux. Et trahi par les siens. Une «infamie», avouera De Gaulle. Qu’est-ce à dire? L’enquête de Jacques Gelin est de celles qui remuent des montagnes de silence, de complaisances judiciaires et de paresse historiographique. Sur le détail du travail abattu, seuls les meilleurs spécialistes de la Résistance peuvent se prononcer. Mais tout un chacun sortira ébranlé de cette lecture poignante et de ses révélations. Car elles mettent au jour le fonctionnement, peu orthodoxe et très conflictuel, de l’armée secrète en ses diverses fractions. On savait que Moulin, avec ses manières d’ancien préfet qui plaisaient au Général, eut du fil à retordre avec les ténors du maquis. Il était loin d’imaginer que cette autre guerre, sur fond d’un débarquement que les services américains voulaient faire croire imminent, aboutirait à son sacrifice au nom de la lutte contre Moscou, pour ne pas dire De Gaulle. Stéphane Guégan
Minc nous montre surtout un homme pris au piège de son efficacité, de sa puissance d’accommodement et du jeu subtil des Allemands, qui se lasseront du fonctionnaire zélé mais indépendant fin 1943. «De l’exercice auquel je me suis livré, nul ne peut tirer de conclusion définitive», précise Minc avec une belle honnêteté. L’ouvrage de Jacques Gelin, une somme admirablement menée, se veut plus nette sur l’entrelacs de raisons qui aboutirent à la capture de Moulin et à sa liquidation sauvage par les services de Klaus Barbie. De façon assez étonnante, Minc tait le débat que suscite l’arrestation de Moulin depuis celle, voilà trente ans, de l’ancien chef de la Gestapo de Lyon. Or, Moulin a bien été «trahi» avant de tomber, à Caluire, le 21 juin 1943, entre les mains de ses bourreaux. Et trahi par les siens. Une «infamie», avouera De Gaulle. Qu’est-ce à dire? L’enquête de Jacques Gelin est de celles qui remuent des montagnes de silence, de complaisances judiciaires et de paresse historiographique. Sur le détail du travail abattu, seuls les meilleurs spécialistes de la Résistance peuvent se prononcer. Mais tout un chacun sortira ébranlé de cette lecture poignante et de ses révélations. Car elles mettent au jour le fonctionnement, peu orthodoxe et très conflictuel, de l’armée secrète en ses diverses fractions. On savait que Moulin, avec ses manières d’ancien préfet qui plaisaient au Général, eut du fil à retordre avec les ténors du maquis. Il était loin d’imaginer que cette autre guerre, sur fond d’un débarquement que les services américains voulaient faire croire imminent, aboutirait à son sacrifice au nom de la lutte contre Moscou, pour ne pas dire De Gaulle. Stéphane Guégan