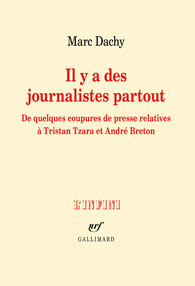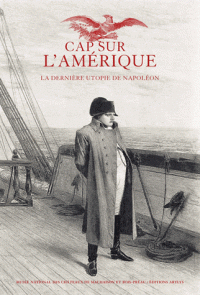Marges et marginaux, l’histoire de l’art a les siennes et les siens. Ce vivier de sensations neuves attire fatalement les intrépides, sûrs d’y trouver matière à chatouiller leur propre singularité. Car le hasard, diraient les surréalistes, ne préside aucunement à ces rencontres-là. Prenez Henry de Groux (1866-1930) et la coterie dont il jouit depuis une vingtaine d’années, curiosité insistante qui nous a valu déjà la publication de son Journal, sorte de monstre littéraire sur lequel soufflent les colères roboratives de Léon Bloy. Autre temps, autres mœurs : le fils de Charles Degroux, fer de lance du réalisme social belge, aura électrisé ses tableaux inqualifiables de passions fort différentes… Ils ressortissent d’un symbolisme qu’on dira véhément, tordu, loufoque, incorrect, un symbolisme qui traque la vérité des hommes dans la folie des formes. S’il fallait lui associer un autre nordique, on citerait James Ensor (deuxième manière) plutôt que Van Gogh, dont il avait horreur. De Groux n’a pas poussé le dévergondage plastique, en effet, jusqu’à trahir son goût des compositions fermes et des fictions savantes. Anar de droite, mais dreyfusard et admirateur de Zola, inclassable en somme, il laisse un corpus incomplètement exploré. Un fonds inédit vient de resurgir aux environs de Rodez, où le succès de Soulages et la direction énergique de Benoît Decron ont réveillé le musée Denys-Puech et le musée Fenaille. Le Front de l’étrange, beau titre, nous jette dans les tranchées de 14-18 dont De Groux fixa la mixité raciale et « l’opulente somptuosité d’horreur parfaite ». Il avait débuté par des charges de Walkyries dépoitraillées. Cette inspiration allemande fut l’une des premières victimes de la guerre, d’autant plus que le peintre, Belge de naissance et de cœur, n’avait aucune raison de ménager l’ennemi. Aux filles du Rhin succéda ainsi le sublime grinçant d’une immémoriale danse des morts.
Marges et marginaux, l’histoire de l’art a les siennes et les siens. Ce vivier de sensations neuves attire fatalement les intrépides, sûrs d’y trouver matière à chatouiller leur propre singularité. Car le hasard, diraient les surréalistes, ne préside aucunement à ces rencontres-là. Prenez Henry de Groux (1866-1930) et la coterie dont il jouit depuis une vingtaine d’années, curiosité insistante qui nous a valu déjà la publication de son Journal, sorte de monstre littéraire sur lequel soufflent les colères roboratives de Léon Bloy. Autre temps, autres mœurs : le fils de Charles Degroux, fer de lance du réalisme social belge, aura électrisé ses tableaux inqualifiables de passions fort différentes… Ils ressortissent d’un symbolisme qu’on dira véhément, tordu, loufoque, incorrect, un symbolisme qui traque la vérité des hommes dans la folie des formes. S’il fallait lui associer un autre nordique, on citerait James Ensor (deuxième manière) plutôt que Van Gogh, dont il avait horreur. De Groux n’a pas poussé le dévergondage plastique, en effet, jusqu’à trahir son goût des compositions fermes et des fictions savantes. Anar de droite, mais dreyfusard et admirateur de Zola, inclassable en somme, il laisse un corpus incomplètement exploré. Un fonds inédit vient de resurgir aux environs de Rodez, où le succès de Soulages et la direction énergique de Benoît Decron ont réveillé le musée Denys-Puech et le musée Fenaille. Le Front de l’étrange, beau titre, nous jette dans les tranchées de 14-18 dont De Groux fixa la mixité raciale et « l’opulente somptuosité d’horreur parfaite ». Il avait débuté par des charges de Walkyries dépoitraillées. Cette inspiration allemande fut l’une des premières victimes de la guerre, d’autant plus que le peintre, Belge de naissance et de cœur, n’avait aucune raison de ménager l’ennemi. Aux filles du Rhin succéda ainsi le sublime grinçant d’une immémoriale danse des morts.
 Jean-David Jumeau-Lafond fait partie des aficionados de l’artiste, il l’a prouvé lors de Crime et Châtiment, l’exposition de Jean Clair, qui montrait le très angoissant Assassiné de De Groux (1899), prémonitoire des charniers à venir. Or l’historique du tableau mène du cercle d’André Breton à celui du dernier médecin d’Artaud. Rodez toujours ! Alexandre Séon (1855-1917), que Jumeau-Lafond célèbre aujourd’hui à Quimper avec courage, a-t-il connu une telle postérité littéraire? Elle reste brillante jusqu’à la guerre de 14, de Marcel Schwob à son disciple Apollinaire. L’homme de Picasso n’est pas indifférent aux «nobles compositions» de Séon, à leur idéalisme forcené et leur purisme rêveur. Ce qui les menace, il le dit aussi. Une certaine inclination à la tristesse humanitaire (il faut moraliser le peuple), et aux soupirs de jeunes vierges (Séon immortalise la pré-puberté androgyne), cela finit par irriter le poète d’Alcools. Sans nul doute, comme nous, préférait-il les œuvres moins sages, voire extravagantes (Séon fut le peintre-lige de l’impayable Sâr Péladan), et ses marines de Bréhat, dont Guillaume Ambroise a bien raison de vanter l’énigmatique attrait. Quitte à dématérialiser la peinture, autant débarrasser l’horizon de toute présence humaine, nécessairement impure.
Jean-David Jumeau-Lafond fait partie des aficionados de l’artiste, il l’a prouvé lors de Crime et Châtiment, l’exposition de Jean Clair, qui montrait le très angoissant Assassiné de De Groux (1899), prémonitoire des charniers à venir. Or l’historique du tableau mène du cercle d’André Breton à celui du dernier médecin d’Artaud. Rodez toujours ! Alexandre Séon (1855-1917), que Jumeau-Lafond célèbre aujourd’hui à Quimper avec courage, a-t-il connu une telle postérité littéraire? Elle reste brillante jusqu’à la guerre de 14, de Marcel Schwob à son disciple Apollinaire. L’homme de Picasso n’est pas indifférent aux «nobles compositions» de Séon, à leur idéalisme forcené et leur purisme rêveur. Ce qui les menace, il le dit aussi. Une certaine inclination à la tristesse humanitaire (il faut moraliser le peuple), et aux soupirs de jeunes vierges (Séon immortalise la pré-puberté androgyne), cela finit par irriter le poète d’Alcools. Sans nul doute, comme nous, préférait-il les œuvres moins sages, voire extravagantes (Séon fut le peintre-lige de l’impayable Sâr Péladan), et ses marines de Bréhat, dont Guillaume Ambroise a bien raison de vanter l’énigmatique attrait. Quitte à dématérialiser la peinture, autant débarrasser l’horizon de toute présence humaine, nécessairement impure.
 L’âme, le corps, vaste question que l’art des années 1880-1920 tranche de façon variée selon qu’il penche vers Platon, Sade ou Baudelaire. Bien connue, on l’espère, est la passion de Rodin pour Les Fleurs du mal, de même que la puissance des dessins dont il noircit l’exemplaire de Paul Gallimard (le père de Gaston) en 1887-1888. Le Guignon fait partie des poèmes qu’il choisit d’accompagner, puisque l’illustration, selon l’ami Mirbeau, doit être une création parallèle au texte. Du sonnet douloureux, il a saisi le sens : la difficulté à créer et la difficulté d’être compris convergent dans le miroir d’une conscience malheureuse et d’un Eros compensatoire. Rodin a creusé la page d’une béance ténébreuse d’où émerge une beauté nue, qui déplie ses membres. Cette Vénus peu pudique incarne donc le principe des métamorphoses où elle a pris elle-même naissance. Comme le démontre admirablement l’exposition que Nathalie Bondil dédie au sculpteur du fragment et du bricolage (au sens de Lévi-Strauss), imaginaire intime et mode d’assemblage forment les deux faces d’une même réalité. Rodin appartient à cette famille d’artistes qui entretiennent le chaos en eux pour tromper leur maîtrise et trouver l’accent juste lorsqu’il s’agit de donner chair aux pensées les plus noires ou les plus chaudes. Les photos de ses ateliers successifs ne trompent pas, ils s’agencent en théâtres d’une cruauté salvatrice, quelque part entre la chambre des tortures, l’étal de boucherie et l’ébat amoureux. Goncourt, qui s’y connaissait, a merveilleusement parlé de la «faunerie» de Rodin tout émoustillé devant ses estampes japonaises. À ces corps mutilés, ces fragments en attente ou pas de nouvelles combinaisons, ces torsions d’espace fulgurantes, il ne manque qu’un éclair de génie. Celui d’un Pygmalion moderne, étranger au chaste Baiser.
L’âme, le corps, vaste question que l’art des années 1880-1920 tranche de façon variée selon qu’il penche vers Platon, Sade ou Baudelaire. Bien connue, on l’espère, est la passion de Rodin pour Les Fleurs du mal, de même que la puissance des dessins dont il noircit l’exemplaire de Paul Gallimard (le père de Gaston) en 1887-1888. Le Guignon fait partie des poèmes qu’il choisit d’accompagner, puisque l’illustration, selon l’ami Mirbeau, doit être une création parallèle au texte. Du sonnet douloureux, il a saisi le sens : la difficulté à créer et la difficulté d’être compris convergent dans le miroir d’une conscience malheureuse et d’un Eros compensatoire. Rodin a creusé la page d’une béance ténébreuse d’où émerge une beauté nue, qui déplie ses membres. Cette Vénus peu pudique incarne donc le principe des métamorphoses où elle a pris elle-même naissance. Comme le démontre admirablement l’exposition que Nathalie Bondil dédie au sculpteur du fragment et du bricolage (au sens de Lévi-Strauss), imaginaire intime et mode d’assemblage forment les deux faces d’une même réalité. Rodin appartient à cette famille d’artistes qui entretiennent le chaos en eux pour tromper leur maîtrise et trouver l’accent juste lorsqu’il s’agit de donner chair aux pensées les plus noires ou les plus chaudes. Les photos de ses ateliers successifs ne trompent pas, ils s’agencent en théâtres d’une cruauté salvatrice, quelque part entre la chambre des tortures, l’étal de boucherie et l’ébat amoureux. Goncourt, qui s’y connaissait, a merveilleusement parlé de la «faunerie» de Rodin tout émoustillé devant ses estampes japonaises. À ces corps mutilés, ces fragments en attente ou pas de nouvelles combinaisons, ces torsions d’espace fulgurantes, il ne manque qu’un éclair de génie. Celui d’un Pygmalion moderne, étranger au chaste Baiser.
 La présence de trois Van Gogh dans la collection de Rodin ne devrait pas étonner outre-mesure. La vraie surprise viendrait qu’il ait acquis le plus célèbre d’entre eux, Le Portrait du père Tanguy, dès 1894. En mars de cette année-là, Mirbeau, toujours lui, signale à Rodin la vente qui s’organise au profit de la veuve du marchand. On ne sait si l’acquisition eut lieu alors. Mais l’anecdote confirme la présence de tableaux de Van Gogh, notre maudit et fou de service, sur les murs très accessibles du négoce parisien. On a beaucoup trop gonflé l’importance de l’exposition des Bernheim-Jeune en 1901. Même les futurs fauves avaient croisé le «feu» de Vincent auparavant. Munch, idem. Sans forcer les analogies que présente l’œuvre du Norvégien avec celles du Batave si parisien, sans pincer la corde sensible comme l’ont fait tant d’expositions inutiles, celle d’Oslo pose calmement les bonnes questions et rapproche les bons tableaux, en tenant compte de ce qu’a été la culture visuelle, aussi nordique que française, de Munch. Les ressemblances sont parfois frappantes, et les souligner aiguise le regard. Par ricochet, en somme, la peinture de Van Gogh retrouve la fraîcheur des premiers chocs. Dans certains cas, autre perspective subtile, la communauté des sources, Rembrandt ou Millet, explique l’air de famille qui se dégage de l’exposition de Magne Bruteig et Maité van Dijk. La folie posthume de Van Gogh n’a pas encore été épuisée. Tant mieux. Stéphane Guégan
La présence de trois Van Gogh dans la collection de Rodin ne devrait pas étonner outre-mesure. La vraie surprise viendrait qu’il ait acquis le plus célèbre d’entre eux, Le Portrait du père Tanguy, dès 1894. En mars de cette année-là, Mirbeau, toujours lui, signale à Rodin la vente qui s’organise au profit de la veuve du marchand. On ne sait si l’acquisition eut lieu alors. Mais l’anecdote confirme la présence de tableaux de Van Gogh, notre maudit et fou de service, sur les murs très accessibles du négoce parisien. On a beaucoup trop gonflé l’importance de l’exposition des Bernheim-Jeune en 1901. Même les futurs fauves avaient croisé le «feu» de Vincent auparavant. Munch, idem. Sans forcer les analogies que présente l’œuvre du Norvégien avec celles du Batave si parisien, sans pincer la corde sensible comme l’ont fait tant d’expositions inutiles, celle d’Oslo pose calmement les bonnes questions et rapproche les bons tableaux, en tenant compte de ce qu’a été la culture visuelle, aussi nordique que française, de Munch. Les ressemblances sont parfois frappantes, et les souligner aiguise le regard. Par ricochet, en somme, la peinture de Van Gogh retrouve la fraîcheur des premiers chocs. Dans certains cas, autre perspective subtile, la communauté des sources, Rembrandt ou Millet, explique l’air de famille qui se dégage de l’exposition de Magne Bruteig et Maité van Dijk. La folie posthume de Van Gogh n’a pas encore été épuisée. Tant mieux. Stéphane Guégan
*Henry De Groux. Le Front de l’étrange, Grand Rodez. Musée Fenaille, jusqu’au 29 novembre 2015. Petit catalogue mais grand réussite, textes, mise en pages et papier, éditions LIENART, 21€.
*Alexandre Séon. La Beauté idéale, musée des Beaux-Art de Quimper, jusqu’au 28 septembre 2015. Le catalogue (SilvanaEditoriale, 35€), principalement rédigé par Jean-David Jumeau-Lafond, est une véritable monographie, aussi ambitieuse que l’exposition qui ira ensuite à Valence.
*Métamorphoses. Dans l’atelier de Rodin, musée des Beaux-Arts de Montréal, jusqu’au 18 octobre 2015. Le catalogue monumental, sous la direction de Nathalie Bondil et Sophie Biass-Fabiani (5 Continents / Musée des beaux-Arts de Montréal, 40€), parvient à fragmenter son propos sans jamais se répéter. Outre une photogravure superbe, il offre une sélection de textes critiques dont, enfin réunis et traduits intégralement, la série d’articles que le sculpteur américain Truman Howe Bartlett fit paraître en 1889. Un témoignage de première main.
*Munch / Van Gogh, Munch Museum, Oslo, jusqu’au 6 septembre (puis Musée Van Gogh, Amsterdam, 24 septembre – 17 janvier 2016). Catalogue sous la direction de Magne Bruteig et Maité van Dijk, Actes Sud, 39,95€. Signalons aussi l’exposition d’Arles qui met en lumière l’espèce de conscience graphique – sorte de surmoi – qu’il faut mentalement exhumer des peintures les plus «follement» lâchées. Fondation Vincent Van Gogh, jusqu’au 20 septembre, catalogue de Sjraar van Heugten, Actes Sud, 30€. /// Le 17 mai dernier se refermait la passionnante exposition de Mons, Van Gogh au borinage, en souvenir du passage crucial que fit l’artiste, en 1878-1880, chez les mineurs de la région. On sait que ses rêves d’évangélisateur populaire, nés en Angleterre au contact des « damnées de la terre », se sont vite brisés en Belgique. On sous-estime, par contre, en quoi cet échec prévisible a précipité son destin artistique. Il reste peu de dessins pour documenter ces deux années de transition, mais ils montrent déjà un désir de s’émanciper d’une iconographie de la mine et des hauts fourneaux, souvent britannique, bien connue du pasteur éphémère. La ferveur prédicatrice qu’on prêtait à Van Gogh est restée longtemps indiscutée, comme le trait essentiel d’un peintre chez qui l’altruisme socialisant aurait conditionné la pratique des pinceaux. La nuance s’imposerait à lire l’excellent catalogue de Fonds Mercator (sous la direction de Sjraar van Heugten, 39€). Si ses auteurs confirment l’abnégation avec laquelle le jeune homme allait au devant des nécessiteux, des malades et des blessés, ils s’émerveillent tous de l’ardeur avec laquelle il se donne enfin les moyens de son ambition artistique. Son coup de crayon était, en effet, loin, très loin d’égaler sa plume, d’emblée admirable, et consciente de ses pouvoirs sur les destinataires de sa correspondance. Après avoir été un exécrable étudiant en théologie, le cancre demande son salut aux livres de modèles, albums de planches à copier, et cours de dessin portatifs, tel le fameux Bargue (un proche de Gérôme). La récompense de tant d’assiduité ne sera pas immédiatement sensible. Et cette lenteur à s’accomplir le déprime. Car les ambitions sont aussi hautes que raisonnées. Hautes puisque Millet est son dieu. Raisonnées puisque Van Gogh, que Paris attire déjà, sait que le tournant républicain de 1879 a créé les conditions favorables à l’essor d’un naturalisme d’État auquel il n’est pas insensible. L’exemple bruxellois de Charles Degroux (le père d’Henri donc !) vient alors s’ajouter à ceux de Lhermitte et de Jules Breton, but fantasmé du fameux pèlerinage de Courrières, qui fut la grande affaire de l’été 1880. SG