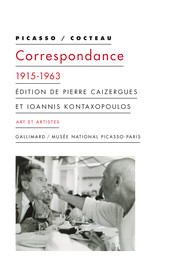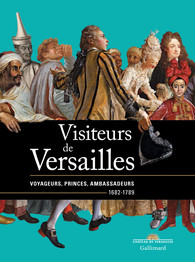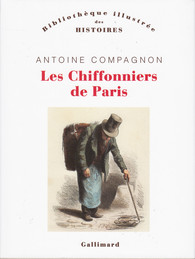De même qu’il y a des fous de David et de Géricault, il y a des fous de Balthus. J’en suis. Tout fanatique du comte de Rola, expression nobiliaire idoine, se doit de posséder le magistral catalogue raisonné de l’œuvre complet (Gallimard, 1999), établi par Virginie Monnier, sous la direction de Jean Clair, le meilleur commentateur du maître disparu en 2001. Parmi les additifs de l’ample publication se trouvent deux feuilles modestes, mais touchantes, dont les sources n’ont pas été reconnues. Dans le premier de ces croquis, page d’un carnet de 1926, Portrait de jeune femme, je propose de voir une copie partielle de l’Autoportrait que David exécuta, en 1794, sous les verrous expiatoires de son passé robespierriste. Cette boule d’énergie rayonnante, image du génie bafoué et intraitable dit la descendance de fer où s’inscrit le jeune Balthus, 25 ans alors. La seconde feuille, Portrait d’une jeune fille, est datée de novembre 1967, c’est l’œuvre d’un artiste comblé d’honneurs, qui règne sur la villa Médicis que Malraux lui a confiée six ans plus tôt. Le charmant visage dont il a tracé amoureusement les traits réguliers tient de l’enfance fragile et d’une sexualité déjà en éveil, autant dire qu’il se charge d’une ambiguïté certaine, révélatrice d’un pan entier de l’œuvre de Balthus. On pourrait penser que ce dernier l’a croqué à Rome, dans le secret de l’atelier et le trouble de ses pensées. Or il s’agit, à l’évidence, d’une copie du beau visage qu’Ingres dessina d’Atala Stamaty en 1818. Balthus l’a isolé, close-up érotique, à partir de la feuille du Louvre. Ingres y campe la séduisante pianiste à l’écart du cercle familial.
De même qu’il y a des fous de David et de Géricault, il y a des fous de Balthus. J’en suis. Tout fanatique du comte de Rola, expression nobiliaire idoine, se doit de posséder le magistral catalogue raisonné de l’œuvre complet (Gallimard, 1999), établi par Virginie Monnier, sous la direction de Jean Clair, le meilleur commentateur du maître disparu en 2001. Parmi les additifs de l’ample publication se trouvent deux feuilles modestes, mais touchantes, dont les sources n’ont pas été reconnues. Dans le premier de ces croquis, page d’un carnet de 1926, Portrait de jeune femme, je propose de voir une copie partielle de l’Autoportrait que David exécuta, en 1794, sous les verrous expiatoires de son passé robespierriste. Cette boule d’énergie rayonnante, image du génie bafoué et intraitable dit la descendance de fer où s’inscrit le jeune Balthus, 25 ans alors. La seconde feuille, Portrait d’une jeune fille, est datée de novembre 1967, c’est l’œuvre d’un artiste comblé d’honneurs, qui règne sur la villa Médicis que Malraux lui a confiée six ans plus tôt. Le charmant visage dont il a tracé amoureusement les traits réguliers tient de l’enfance fragile et d’une sexualité déjà en éveil, autant dire qu’il se charge d’une ambiguïté certaine, révélatrice d’un pan entier de l’œuvre de Balthus. On pourrait penser que ce dernier l’a croqué à Rome, dans le secret de l’atelier et le trouble de ses pensées. Or il s’agit, à l’évidence, d’une copie du beau visage qu’Ingres dessina d’Atala Stamaty en 1818. Balthus l’a isolé, close-up érotique, à partir de la feuille du Louvre. Ingres y campe la séduisante pianiste à l’écart du cercle familial.
 Atala Stamaty, comme un Balthus venue du passé, le comte de Rola l’aura croisée sur l’un des murs de la rétrospective du centenaire d’Ingres, inaugurée en octobre 1968… Le millésime de la copie rend possible la rencontre des deux peintres de longue date aimantés, et auxquels incomba, sous le ciel de Rome, la direction de l’Académie de France. David, Ingres, Géricault… Balthus savait choisir ses tuteurs. Né à Paris en 1908, il est resté, au fond, très français malgré ses origines Mitteleuropa et sa passion de l’art italien. Il faudrait être aveugle pour manquer cette francité en parcourant la splendide exposition de la fondation Beyeler, splendide par ses choix, et d’abord par celui de montrer essentiellement des œuvres décisives. L’absence des dessins, si éclairants lors de l’exposition du centenaire confiée à Jean Clair (Martigny, 2008), sanctuarise cette suite de chefs-d’œuvre et l’espèce d’impertinence racée qui fait de chacun d’entre eux le lieu d’une ambition formelle et d’une confession cryptée également admirables. Sautons sans tarder à la perle inattendue… Pardon à ces bijoux que sont La Rue du MoMa ou La Toilette de Cathy, deux tableaux de viol, plus ou moins mental, qui jetèrent l’effroi, Galerie Pierre, en 1934 : ils ouvraient pour Artaud, qui évoque alors David à leur propos, une troisième voie entre Derain et surréalisme, évidence physique et rêve prédateur. Cette perle généralement invisible, c’est La Jupe blanche de 1937, version ardente du portrait de Mme Récamier. Sur la froide matrice de David, Balthus a greffé Jo l’Irlandaise et Olympia, Courbet et Manet.
Atala Stamaty, comme un Balthus venue du passé, le comte de Rola l’aura croisée sur l’un des murs de la rétrospective du centenaire d’Ingres, inaugurée en octobre 1968… Le millésime de la copie rend possible la rencontre des deux peintres de longue date aimantés, et auxquels incomba, sous le ciel de Rome, la direction de l’Académie de France. David, Ingres, Géricault… Balthus savait choisir ses tuteurs. Né à Paris en 1908, il est resté, au fond, très français malgré ses origines Mitteleuropa et sa passion de l’art italien. Il faudrait être aveugle pour manquer cette francité en parcourant la splendide exposition de la fondation Beyeler, splendide par ses choix, et d’abord par celui de montrer essentiellement des œuvres décisives. L’absence des dessins, si éclairants lors de l’exposition du centenaire confiée à Jean Clair (Martigny, 2008), sanctuarise cette suite de chefs-d’œuvre et l’espèce d’impertinence racée qui fait de chacun d’entre eux le lieu d’une ambition formelle et d’une confession cryptée également admirables. Sautons sans tarder à la perle inattendue… Pardon à ces bijoux que sont La Rue du MoMa ou La Toilette de Cathy, deux tableaux de viol, plus ou moins mental, qui jetèrent l’effroi, Galerie Pierre, en 1934 : ils ouvraient pour Artaud, qui évoque alors David à leur propos, une troisième voie entre Derain et surréalisme, évidence physique et rêve prédateur. Cette perle généralement invisible, c’est La Jupe blanche de 1937, version ardente du portrait de Mme Récamier. Sur la froide matrice de David, Balthus a greffé Jo l’Irlandaise et Olympia, Courbet et Manet.
 Les deux sections suivantes diffusent un parfum de scandale aussi réjouissant, et conforme à l’artiste, que volontaire. Le courage n’a donc pas fait défaut aux deux commissaires, Raphaël Bouvier et Michiko Kono, peu enclins à se laisser impressionner par l’affaire qu’a déclenchée une visiteuse du Met. En 2017, indisposée par ce que Thérèse rêvant libère de résonnances sexuelles et d’impureté adolescente, notre belle âme, pure elle, a évidemment saisi les réseaux de la délation mondialisée, appelant à la censure du tableau qu’il fallait retirer illico de la circulation ou frapper d’un panneau de salle condamnant pareilles saletés. On n’attendait rien de moins du Met que la fermeté qu’il manifesta alors, face à la pétition qui enflait. Le positionnement de la fondation Beyeler rassure aussi… En plus du tableau de 1937, qui renvoie au Cauchemar de Füssli et aux odalisques d’Ingres comme aux chats à double sens de Manet, Bâle s’offre deux autres images insolentes de la chère Thérèse Blanchard, dont le tableau que Picasso acheta dans le Paris de l’Occupation. L’ingénuité se frotte à la sensualité avec plus d’insistance dans Les Beaux Jours, qui célébrait la sortie de la guerre d’une manière que le conseil artistique des musées nationaux trouva choquante lorsque Jean Cassou, proche de la mère de Balthus dans les années 1920, voulut le faire acheter par l’État français. C’est la jolie Odile Bugnon, quatorze ans, qui se prête à l’étrange et perverse fantaisie dont elle ne connaîtra jamais l’image. Balthus ne partage ses fantasmes qu’avec lui-même avant d’en exposer l’énigme à son public. Quand on lui reprochait sa peinture lubrique, ses extases à peine pubères, ses irruptions de petites culottes, son scabreux baudelairien, il affectait de n’en rien savoir.
Les deux sections suivantes diffusent un parfum de scandale aussi réjouissant, et conforme à l’artiste, que volontaire. Le courage n’a donc pas fait défaut aux deux commissaires, Raphaël Bouvier et Michiko Kono, peu enclins à se laisser impressionner par l’affaire qu’a déclenchée une visiteuse du Met. En 2017, indisposée par ce que Thérèse rêvant libère de résonnances sexuelles et d’impureté adolescente, notre belle âme, pure elle, a évidemment saisi les réseaux de la délation mondialisée, appelant à la censure du tableau qu’il fallait retirer illico de la circulation ou frapper d’un panneau de salle condamnant pareilles saletés. On n’attendait rien de moins du Met que la fermeté qu’il manifesta alors, face à la pétition qui enflait. Le positionnement de la fondation Beyeler rassure aussi… En plus du tableau de 1937, qui renvoie au Cauchemar de Füssli et aux odalisques d’Ingres comme aux chats à double sens de Manet, Bâle s’offre deux autres images insolentes de la chère Thérèse Blanchard, dont le tableau que Picasso acheta dans le Paris de l’Occupation. L’ingénuité se frotte à la sensualité avec plus d’insistance dans Les Beaux Jours, qui célébrait la sortie de la guerre d’une manière que le conseil artistique des musées nationaux trouva choquante lorsque Jean Cassou, proche de la mère de Balthus dans les années 1920, voulut le faire acheter par l’État français. C’est la jolie Odile Bugnon, quatorze ans, qui se prête à l’étrange et perverse fantaisie dont elle ne connaîtra jamais l’image. Balthus ne partage ses fantasmes qu’avec lui-même avant d’en exposer l’énigme à son public. Quand on lui reprochait sa peinture lubrique, ses extases à peine pubères, ses irruptions de petites culottes, son scabreux baudelairien, il affectait de n’en rien savoir.
 A la belle et enfantine Antoinette de Watteville, qui hante l’exposition, il avait toutefois avoué en 1937 : « je veux déclamer au grand jour, avec sincérité et émotion, tout le tragique palpitant d’un drame de la chair, proclamer à grand cris les lois inébranlables de l’instinct. » Ici, la jeune femme, visage félin et posture coulante, se rapproche terriblement du Courbet le moins proudhonien. Le corsage à la dérive, la jupe relevée sur de longues jambes et ouverte au feu que tourmente un homme de dos, elle tient le miroir de son narcissisme salé. Les chenets à têtes de chat complètent ce drame intérieur où le feu des passions interdites inquiète la géométrie souveraine de Piero. La belle verdeur du peintre, son arme contre ceux qu’il appelait en vrai freudien les « hypocrites », devait franchir les âges mieux qu’on ne le dit. La sélection de Bâle en contient suffisamment de preuves. L’étonnante Jeune fille au miroir est un Delvaux réussi, La Partie de cartes et son caravagisme dévoyé, un Valentin sadique et magique. A côté de l’Italie des bouges, l’Italie des grands fresquistes le requiert au cours des années 1950-1960. La matière de ses tableaux évolue, leur lumière s’adoucit, l’espace s’ordonne avec la rigueur scénique dont Balthus fait l’expérience, avec son ami André Masson, au festival d’Aix. Malgré ce style plus radieux, « le roi des chats » reste discuté et ses portraits mondains font des jaloux. L’indignation grimpa lorsque Malraux, défiant l’Institut et les derniers Prix de Rome, lui confia la villa Médicis. Ô plaisir aristocratique de déplaire… Malraux et Balthus s’y entendaient. Ceux qui se rendront à Bâle connaissent leur récompense. Stéphane Guégan
A la belle et enfantine Antoinette de Watteville, qui hante l’exposition, il avait toutefois avoué en 1937 : « je veux déclamer au grand jour, avec sincérité et émotion, tout le tragique palpitant d’un drame de la chair, proclamer à grand cris les lois inébranlables de l’instinct. » Ici, la jeune femme, visage félin et posture coulante, se rapproche terriblement du Courbet le moins proudhonien. Le corsage à la dérive, la jupe relevée sur de longues jambes et ouverte au feu que tourmente un homme de dos, elle tient le miroir de son narcissisme salé. Les chenets à têtes de chat complètent ce drame intérieur où le feu des passions interdites inquiète la géométrie souveraine de Piero. La belle verdeur du peintre, son arme contre ceux qu’il appelait en vrai freudien les « hypocrites », devait franchir les âges mieux qu’on ne le dit. La sélection de Bâle en contient suffisamment de preuves. L’étonnante Jeune fille au miroir est un Delvaux réussi, La Partie de cartes et son caravagisme dévoyé, un Valentin sadique et magique. A côté de l’Italie des bouges, l’Italie des grands fresquistes le requiert au cours des années 1950-1960. La matière de ses tableaux évolue, leur lumière s’adoucit, l’espace s’ordonne avec la rigueur scénique dont Balthus fait l’expérience, avec son ami André Masson, au festival d’Aix. Malgré ce style plus radieux, « le roi des chats » reste discuté et ses portraits mondains font des jaloux. L’indignation grimpa lorsque Malraux, défiant l’Institut et les derniers Prix de Rome, lui confia la villa Médicis. Ô plaisir aristocratique de déplaire… Malraux et Balthus s’y entendaient. Ceux qui se rendront à Bâle connaissent leur récompense. Stéphane Guégan
*Balthus, fondation Beyeler, jusqu’au 1er janvier 2019. Excellent catalogue sous la direction des commissaires, il comprend, en plus de leurs contributions, celle de Juan Angel Lopez-Manzanares,finement marquée par les texte d’Artaud sur Balthus, et celles d’Yves Guignard, Christine Burger, Beate Söntgen, Olivier Berggruen et Wim Wenders, 62,50 CHF
La rentrée, c’est aussi…
*Alphonse Mucha, dont les affiches sensuelles et sinueuses à souhait ont fait le tour du monde, a longtemps caché son jeu. Et l’opinion publique, comme dirait Offenbach, chérit béatement ses lionnes serpentines, aux élans et œillades inimitables, sans trop se demander de quoi elles étaient faites. Ce Mucha-là, baigné d’une ambiance Art Nouveau, occupe les premières salles du Musée du Luxembourg et les tapisse d’une myriade d’ensorceleuses. Certaines vantent le génie tragique de Sarah Bernhardt, d’autres tel champagne aphrodisiaque, tel kif tabagique ou telle savonnette faussement virginale. Du très grand art, assurément, nourri d’une double formation morave et française. L’homme a une telle maîtrise du dessin, comme l’exposition le rappelle utilement, qu’on en oublie  parfois les autres ressources de son mundus muliebris… Le Luco porte enfin à notre connaissance, sous la forme de photographies assez crues, les créatures qui peuplaient l’atelier et, à bien y regarder, se devinent derrière leur sublimation fin-de-siècle. Mucha avait donc recours aux « filles » à bas noirs et regards droits, il aimait mettre en scène, bien avant Balthus, leur impudique candeur, les obligeaient à se contorsionner en vue de la pose la plus suggestive et vendeuse. Puis son génial coup de crayon accomplissait la métamorphose finale en se jouant de toutes les difficultés, dynamique de l’espace, explosion capillaire et douceurs caressantes de corps sous l’épure. Ce double jeu n’aura pas échappé au critique de La Plume, en septembre 1897, qui préfère Mucha aux femmes spectrales d’Osbert. Devant les déités du Tchèque, « il y a un peu de notre chair ». Ajoutons que cette féminité triomphante s’exalte dans son cadre géométrique, presque byzantin, à la manière de certains costumes de la grande Sarah…. Le contour marqué partout fait osciller l’image entre marqueterie et mosaïque. En associant clarté figurative et raffinement symboliste, Mucha avouait sa personnalité profonde. L’époque était aux interrogations sur la mort, la foi ou la psyché, nourriture trouble de sa peinture étrange, enfin largement montrée, l’artiste mystique organisait des séances de spiritisme, ce à quoi le visiteur est lui-même convié ici et là. Mais la religion de Mucha, aussi catholique que franc-maçon, aussi patriote que cosmopolite, se compliquait d’un attachement ferme aux vertus de « l’art pour tous ». Vers 1900, on peut décorer la boutique du joailler Fouquet et croire aux vertus de l’affiche, ce musée en plein vent, qui semait dans l’œil de chacun des pépites distinctes du monde de Lautrec. Plus proche des heureuses furies de Chéret, l’arabesque nerveuse de Mucha piège notre regard et y laisse de délicieuses petites morsures. SG / Alphonse Mucha, Musée du Luxembourg, jusqu’au 27 janvier 2019. Intéressant catalogue, éditions de la RMN-Grand Palais, 35€. Mais je ne crois pas aux supposées photographies de Gauguin qu’il contient. Certes les deux hommes se sont connus et fréquentés à Montparnasse entre les deux séjours tahitiens. Quant aux images qui documenteraient leur relation…
parfois les autres ressources de son mundus muliebris… Le Luco porte enfin à notre connaissance, sous la forme de photographies assez crues, les créatures qui peuplaient l’atelier et, à bien y regarder, se devinent derrière leur sublimation fin-de-siècle. Mucha avait donc recours aux « filles » à bas noirs et regards droits, il aimait mettre en scène, bien avant Balthus, leur impudique candeur, les obligeaient à se contorsionner en vue de la pose la plus suggestive et vendeuse. Puis son génial coup de crayon accomplissait la métamorphose finale en se jouant de toutes les difficultés, dynamique de l’espace, explosion capillaire et douceurs caressantes de corps sous l’épure. Ce double jeu n’aura pas échappé au critique de La Plume, en septembre 1897, qui préfère Mucha aux femmes spectrales d’Osbert. Devant les déités du Tchèque, « il y a un peu de notre chair ». Ajoutons que cette féminité triomphante s’exalte dans son cadre géométrique, presque byzantin, à la manière de certains costumes de la grande Sarah…. Le contour marqué partout fait osciller l’image entre marqueterie et mosaïque. En associant clarté figurative et raffinement symboliste, Mucha avouait sa personnalité profonde. L’époque était aux interrogations sur la mort, la foi ou la psyché, nourriture trouble de sa peinture étrange, enfin largement montrée, l’artiste mystique organisait des séances de spiritisme, ce à quoi le visiteur est lui-même convié ici et là. Mais la religion de Mucha, aussi catholique que franc-maçon, aussi patriote que cosmopolite, se compliquait d’un attachement ferme aux vertus de « l’art pour tous ». Vers 1900, on peut décorer la boutique du joailler Fouquet et croire aux vertus de l’affiche, ce musée en plein vent, qui semait dans l’œil de chacun des pépites distinctes du monde de Lautrec. Plus proche des heureuses furies de Chéret, l’arabesque nerveuse de Mucha piège notre regard et y laisse de délicieuses petites morsures. SG / Alphonse Mucha, Musée du Luxembourg, jusqu’au 27 janvier 2019. Intéressant catalogue, éditions de la RMN-Grand Palais, 35€. Mais je ne crois pas aux supposées photographies de Gauguin qu’il contient. Certes les deux hommes se sont connus et fréquentés à Montparnasse entre les deux séjours tahitiens. Quant aux images qui documenteraient leur relation…
 *Au temps de Picasso, qui était un homme du XIXe siècle et un Espagnol attentif aux valeurs, l’idée de chef-d’œuvre avait conservé son entier prestige sur lui. Elle réunissait en elle deux puissances, l’ancienne maîtrise artisanale et le besoin, presque le devoir, d’exhiber les preuves de son génie, comme le pensait l’Académie royale avant la Révolution. Dissocier le faire de l’invention n’a jamais effleuré la verve picassienne, capable de prendre, on le sait, les formes les plus inattendues. Il serait sot d’en déduire qu’il ait renoncé à faire œuvre monumentale, et à mettre ses pas dans ceux des grands aînés. Car la dimension de choses compte autant que l’émulation des siècles. Un dernier élément intervient, le désir, mental et sexuel, d’étreindre la difficulté, de s’étonner et de subjuguer le public. De tout cela, Picasso reste aujourd’hui le nom. Il aura fait le nécessaire pour imposer l’omniprésence de son omnipotence, de la mise en scène de son œuvre à la théâtralisation de sa personne, fautes politiques comprises. Finement, par une sorte de mise en abyme de sa fonction même, le musée Picasso place quelques-uns des « chefs-d’œuvre » de Picasso dans la lumière multiple d’une approche qui fait de l’institution publique l’étape finale du processus analysé. Emilie Bouvard et Coline Zellal enveloppent une suite d’œuvres, souvent majeures, depuis le très naturaliste Science et Charité, du flux documentaire qui fixe leur destin parmi les collections et les hommes. On ne peint pas dans le désert, et chaque image présuppose un public, un marché, une cimaise… Dès avant son installation en France, Picasso se rêve accroché au Louvre et au Prado. Son œuvre, en conséquence, sera toujours plus que son prétendu journal intime, elle fut lutte et conquête d’une visibilité sacrale. La tradition du dialogue des morts se fait entendre, bien qu’elle l’ait égaré de temps à autre. Ennui des séries consacrées aux Femmes d’Alger, aux Ménines… C’est que Picasso n’est jamais plus proche d’Ingres, Delacroix, Courbet, Manet ou Velázquez qu’en se gardant des facilités du pastiche parodique et du sérialisme, cette plaie des modernes. Le parcours, belle idée, s’ouvre et se ferme avec l’évocation du XVIIe siècle, dernier temps de la souveraineté indiscutée. L’illustration du Chef-d’œuvre inconnu, Vollard, 1931, vise Poussin et Pourbus à travers Balzac (et peut-être Gautier). Si la perfection n’est pas de ce monde, c’est qu’elle appartient aux peintres, prît-elle une apparence inaccessible aux incrédules. On ne pouvait imaginer enfin meilleure conclusion que l’autoportrait de Rembrandt, peint en 1660, à l’acmé d’une carrière qui autorisait cette auto-divinisation. Picasso en tirera de la graine. SG/ Picasso. Chefs-d’œuvre ! Musée Picasso, Paris, jusqu’au 13 janvier 2019, catalogue passionnant sous la direction des commissaires, Gallimard / Musée Picasso, 42€. Il reproduit, chose rare, l’ensemble des documents insérés à la scénographie, qui n’oublie pas les jeunes visiteurs.
*Au temps de Picasso, qui était un homme du XIXe siècle et un Espagnol attentif aux valeurs, l’idée de chef-d’œuvre avait conservé son entier prestige sur lui. Elle réunissait en elle deux puissances, l’ancienne maîtrise artisanale et le besoin, presque le devoir, d’exhiber les preuves de son génie, comme le pensait l’Académie royale avant la Révolution. Dissocier le faire de l’invention n’a jamais effleuré la verve picassienne, capable de prendre, on le sait, les formes les plus inattendues. Il serait sot d’en déduire qu’il ait renoncé à faire œuvre monumentale, et à mettre ses pas dans ceux des grands aînés. Car la dimension de choses compte autant que l’émulation des siècles. Un dernier élément intervient, le désir, mental et sexuel, d’étreindre la difficulté, de s’étonner et de subjuguer le public. De tout cela, Picasso reste aujourd’hui le nom. Il aura fait le nécessaire pour imposer l’omniprésence de son omnipotence, de la mise en scène de son œuvre à la théâtralisation de sa personne, fautes politiques comprises. Finement, par une sorte de mise en abyme de sa fonction même, le musée Picasso place quelques-uns des « chefs-d’œuvre » de Picasso dans la lumière multiple d’une approche qui fait de l’institution publique l’étape finale du processus analysé. Emilie Bouvard et Coline Zellal enveloppent une suite d’œuvres, souvent majeures, depuis le très naturaliste Science et Charité, du flux documentaire qui fixe leur destin parmi les collections et les hommes. On ne peint pas dans le désert, et chaque image présuppose un public, un marché, une cimaise… Dès avant son installation en France, Picasso se rêve accroché au Louvre et au Prado. Son œuvre, en conséquence, sera toujours plus que son prétendu journal intime, elle fut lutte et conquête d’une visibilité sacrale. La tradition du dialogue des morts se fait entendre, bien qu’elle l’ait égaré de temps à autre. Ennui des séries consacrées aux Femmes d’Alger, aux Ménines… C’est que Picasso n’est jamais plus proche d’Ingres, Delacroix, Courbet, Manet ou Velázquez qu’en se gardant des facilités du pastiche parodique et du sérialisme, cette plaie des modernes. Le parcours, belle idée, s’ouvre et se ferme avec l’évocation du XVIIe siècle, dernier temps de la souveraineté indiscutée. L’illustration du Chef-d’œuvre inconnu, Vollard, 1931, vise Poussin et Pourbus à travers Balzac (et peut-être Gautier). Si la perfection n’est pas de ce monde, c’est qu’elle appartient aux peintres, prît-elle une apparence inaccessible aux incrédules. On ne pouvait imaginer enfin meilleure conclusion que l’autoportrait de Rembrandt, peint en 1660, à l’acmé d’une carrière qui autorisait cette auto-divinisation. Picasso en tirera de la graine. SG/ Picasso. Chefs-d’œuvre ! Musée Picasso, Paris, jusqu’au 13 janvier 2019, catalogue passionnant sous la direction des commissaires, Gallimard / Musée Picasso, 42€. Il reproduit, chose rare, l’ensemble des documents insérés à la scénographie, qui n’oublie pas les jeunes visiteurs.
 *Quelques mois avant de mourir, Dave Heath (1931-2016) a connu le bonheur de voir ses photographies rassemblées au Nelson-Atkins Museum of Art. Le titre qui avait été donné à ce dernier bilan, Multitude Solitude, faisait écho à l’un des plus célèbres poèmes du Spleen de Paris. «Jouir de la foule est un art», y affirme Baudelaire. Heath, familier du poète des flâneurs comme Irving Penn, a longtemps scruté et fixé les solitaires en solitaire. Quel profond silence il laisse flotter partout… Philadelphie, Chicago ou New York, la ville semble inapte à relier organiquement ses habitants. La rue sépare, elle n’embrasse pas. Peu de couples, peu d’amoureux accèdent à l’objectif. Au contraire, saisis en gros plan on ne sait comment, les visages disent l’enfermement, la rêverie incertaine, un malaise souvent. Quand il ne les isole pas, en figeant leur détresse ou leur vide inquiétant, Heath les juxtapose dans la profondeur très contractée du champ, toujours saturé. Baudelairienne est cette clôture, baudelairienne cette « communion » paradoxale. « Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut à sa guise être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant […]. » Il manquait à la photographie américaine des années 1950-1970, très tournée vers les failles de la société, les individus abandonnés à eux-mêmes, la présence accrue des Noirs venus du Sud, un poète des vacances du jour et de la nuit, de la guerre et des conflits intimes. Après avoir été soldat en Corée, dont il rapporta une série de portraits saisissants d’introspection, Dave Heath fut ce poète, il y mit une gravité qui n’est jamais aussi belle qu’à s’oublier et dériver. On ne sort pas indemne de l’exposition du Bal. Ces clichés «nés de la ville» vous y poursuivent. SG / Dave Heath. Dialogues with Solitudes, Le Bal, 6 impasse de la Défense, 75018, jusqu’au 23 décembre. Somptueuse publication, Le Bal / Steidel, 40€.
*Quelques mois avant de mourir, Dave Heath (1931-2016) a connu le bonheur de voir ses photographies rassemblées au Nelson-Atkins Museum of Art. Le titre qui avait été donné à ce dernier bilan, Multitude Solitude, faisait écho à l’un des plus célèbres poèmes du Spleen de Paris. «Jouir de la foule est un art», y affirme Baudelaire. Heath, familier du poète des flâneurs comme Irving Penn, a longtemps scruté et fixé les solitaires en solitaire. Quel profond silence il laisse flotter partout… Philadelphie, Chicago ou New York, la ville semble inapte à relier organiquement ses habitants. La rue sépare, elle n’embrasse pas. Peu de couples, peu d’amoureux accèdent à l’objectif. Au contraire, saisis en gros plan on ne sait comment, les visages disent l’enfermement, la rêverie incertaine, un malaise souvent. Quand il ne les isole pas, en figeant leur détresse ou leur vide inquiétant, Heath les juxtapose dans la profondeur très contractée du champ, toujours saturé. Baudelairienne est cette clôture, baudelairienne cette « communion » paradoxale. « Le poète jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut à sa guise être lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant […]. » Il manquait à la photographie américaine des années 1950-1970, très tournée vers les failles de la société, les individus abandonnés à eux-mêmes, la présence accrue des Noirs venus du Sud, un poète des vacances du jour et de la nuit, de la guerre et des conflits intimes. Après avoir été soldat en Corée, dont il rapporta une série de portraits saisissants d’introspection, Dave Heath fut ce poète, il y mit une gravité qui n’est jamais aussi belle qu’à s’oublier et dériver. On ne sort pas indemne de l’exposition du Bal. Ces clichés «nés de la ville» vous y poursuivent. SG / Dave Heath. Dialogues with Solitudes, Le Bal, 6 impasse de la Défense, 75018, jusqu’au 23 décembre. Somptueuse publication, Le Bal / Steidel, 40€.
 *Galerie Canesso, on reverra avec grand plaisir le portrait de la marquise de Grollier, qui contribua à l’immense succès de l’exposition Vigée Le Brun du Grand Palais et de son catalogue. La notice que Joseph Baillio y consacre au tableau est un chef-d’œuvre d’érudition, de sensibilité et d’humour. Vigée n’a pas signé le tableau, mais ceux de l’amitié le sont rarement… Le portrait vient de changer de mains mais restera en France, bonne nouvelle. Il eût été regrettable qu’avec son élégante bonhomie et son fond davidien l’œuvre quittât la France. Ne nous rappelle-t-elle pas ces beaux fruits que l’Ancien Régime aura donnés à son crépuscule ? Grande amie de Vigée, favorite du clan Polignac comme elle, la maîtresse du bailli de Crussol a presque fait oublier ses dons de peintre, modestes mais certains. Ils font le charme vif, nordique, presque pimpant, de ses natures mortes plutôt enjouées. L’attrait de l’éphémère à jamais captif en est évident, de même que celui de mêler vision raffinée et coloris franc. La Révolution coupa la tête du marquis ; sa veuve, précoce émigrée, rentra mourir en France sous la Restauration. Son portrait de 1800, peint par François-Xavier Fabre à Florence, visible dans une dernière salle, en portait la promesse. Sur la ceinture de la robe Consulat, on lit : « Je reviens ». SG / L’Art au féminin, excellent petit catalogue de Véronique Damian, Galerie Canesso, jusqu’au 19 octobre 2019.
*Galerie Canesso, on reverra avec grand plaisir le portrait de la marquise de Grollier, qui contribua à l’immense succès de l’exposition Vigée Le Brun du Grand Palais et de son catalogue. La notice que Joseph Baillio y consacre au tableau est un chef-d’œuvre d’érudition, de sensibilité et d’humour. Vigée n’a pas signé le tableau, mais ceux de l’amitié le sont rarement… Le portrait vient de changer de mains mais restera en France, bonne nouvelle. Il eût été regrettable qu’avec son élégante bonhomie et son fond davidien l’œuvre quittât la France. Ne nous rappelle-t-elle pas ces beaux fruits que l’Ancien Régime aura donnés à son crépuscule ? Grande amie de Vigée, favorite du clan Polignac comme elle, la maîtresse du bailli de Crussol a presque fait oublier ses dons de peintre, modestes mais certains. Ils font le charme vif, nordique, presque pimpant, de ses natures mortes plutôt enjouées. L’attrait de l’éphémère à jamais captif en est évident, de même que celui de mêler vision raffinée et coloris franc. La Révolution coupa la tête du marquis ; sa veuve, précoce émigrée, rentra mourir en France sous la Restauration. Son portrait de 1800, peint par François-Xavier Fabre à Florence, visible dans une dernière salle, en portait la promesse. Sur la ceinture de la robe Consulat, on lit : « Je reviens ». SG / L’Art au féminin, excellent petit catalogue de Véronique Damian, Galerie Canesso, jusqu’au 19 octobre 2019.