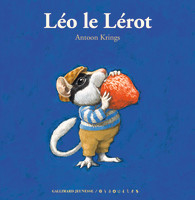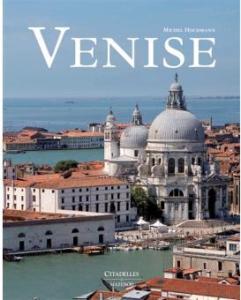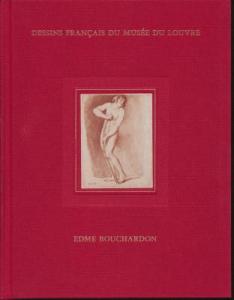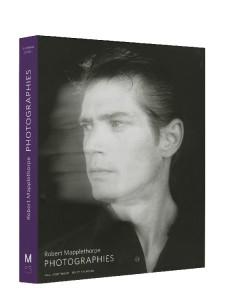Elles furent de bien beaux musées, les églises de Paris, au XVIIIème siècle, et de véritables foyers de peinture ! Le Petit Palais, jusqu’au 16 juillet prochain, en concentre le meilleur et, autre raison d’applaudir, l’expose de manière à évoquer l’espace où ces toiles prirent d’abord place et sens. Christine Gouzi et Christophe Leribault ont sagement renoncé à toute présentation archéologique, l’important était de respecter les hauteurs d’accrochage, le mystère des éclairages et l’esprit de la scénographie qui réglait la relation physique et mentale au fidèle. C’est une chose de travailler pour Notre-Dame-de-Paris, c’en est une autre de travailler pour la chapelle d’une confrérie ou de quelque personnage de haut rang. Le lieu précède la toile, comme l’existence l’essence… Et ce lieu résonne encore, au XVIIIème siècle, d’une parole partagée, d’une culture biblique commune, au même titre, dirait Jean Starobinski, que les Métamorphoses d’Ovide en milieu docte. Cela ne revient pas à dire que le christianisme, les Lumières venues, se soit mué en simple pourvoyeur de fables, exemptes de contenu liturgique et de vertu sociale, et réduites à servir le « théâtre des passions » du peintre. Fausse s’avère donc l’idée d’un siècle déchristianisé, qui opposerait Dieu à la liberté qu’il faut « inventer ». Et la spécialiste de Restout qu’est Christine Gouzi de souligner, à l’attention des visiteurs « pressés », l’apport involontaire du renouveau janséniste au naufrage de la monarchie. Avec le recul, on s’aperçoit que la révocation de l’édit de Nantes, si elle stimula la commande religieuse et le remodelage spectaculaire des églises parisiennes, joua en défaveur du pouvoir royal et du « siècle de fer », selon la formule de Voltaire. De cette Contre-Réforme française aux aléas malheureux, le Petit Palais rallume les deux faces, le baroque issu de l’âge de Louis XIV et « la piété émotive et sensible », qu’on associe au rococo, alors qu’elle procède d’une raison théologique étrangère à toute galanterie gratuite. L’un des chefs-d’œuvre de l’exposition, le Saint Jean Baptiste de François Lemoyne (notre photo), – Lemoyne qui aura Boucher pour élève, baigne de sensualité nouvelle et de lignes serpentines l’annonce du Sauveur. A l’autre extrémité du parcours trône le second phare, Le Christ en croix de David, peint en 1782, retour d’Anvers. Mais la verve des grands Flamands et le fruit des années romaines ne détournent pas le futur peintre des Horaces de la sobriété réaliste française, si l’on accepte d’y réunir Le Brun et Champaigne… Parce que moindres génies, Pierre, Carle Van Loo, Noël Hallé, Doyen ou Vien servent peut-être mieux la démonstration d’ensemble. Le sacré restait un besoin de ces temps agités. Et, au-delà des commandes qu’on se disputait, il agissait même sur les pinceaux moins inspirés comme une liqueur forte et nécessaire.
Elles furent de bien beaux musées, les églises de Paris, au XVIIIème siècle, et de véritables foyers de peinture ! Le Petit Palais, jusqu’au 16 juillet prochain, en concentre le meilleur et, autre raison d’applaudir, l’expose de manière à évoquer l’espace où ces toiles prirent d’abord place et sens. Christine Gouzi et Christophe Leribault ont sagement renoncé à toute présentation archéologique, l’important était de respecter les hauteurs d’accrochage, le mystère des éclairages et l’esprit de la scénographie qui réglait la relation physique et mentale au fidèle. C’est une chose de travailler pour Notre-Dame-de-Paris, c’en est une autre de travailler pour la chapelle d’une confrérie ou de quelque personnage de haut rang. Le lieu précède la toile, comme l’existence l’essence… Et ce lieu résonne encore, au XVIIIème siècle, d’une parole partagée, d’une culture biblique commune, au même titre, dirait Jean Starobinski, que les Métamorphoses d’Ovide en milieu docte. Cela ne revient pas à dire que le christianisme, les Lumières venues, se soit mué en simple pourvoyeur de fables, exemptes de contenu liturgique et de vertu sociale, et réduites à servir le « théâtre des passions » du peintre. Fausse s’avère donc l’idée d’un siècle déchristianisé, qui opposerait Dieu à la liberté qu’il faut « inventer ». Et la spécialiste de Restout qu’est Christine Gouzi de souligner, à l’attention des visiteurs « pressés », l’apport involontaire du renouveau janséniste au naufrage de la monarchie. Avec le recul, on s’aperçoit que la révocation de l’édit de Nantes, si elle stimula la commande religieuse et le remodelage spectaculaire des églises parisiennes, joua en défaveur du pouvoir royal et du « siècle de fer », selon la formule de Voltaire. De cette Contre-Réforme française aux aléas malheureux, le Petit Palais rallume les deux faces, le baroque issu de l’âge de Louis XIV et « la piété émotive et sensible », qu’on associe au rococo, alors qu’elle procède d’une raison théologique étrangère à toute galanterie gratuite. L’un des chefs-d’œuvre de l’exposition, le Saint Jean Baptiste de François Lemoyne (notre photo), – Lemoyne qui aura Boucher pour élève, baigne de sensualité nouvelle et de lignes serpentines l’annonce du Sauveur. A l’autre extrémité du parcours trône le second phare, Le Christ en croix de David, peint en 1782, retour d’Anvers. Mais la verve des grands Flamands et le fruit des années romaines ne détournent pas le futur peintre des Horaces de la sobriété réaliste française, si l’on accepte d’y réunir Le Brun et Champaigne… Parce que moindres génies, Pierre, Carle Van Loo, Noël Hallé, Doyen ou Vien servent peut-être mieux la démonstration d’ensemble. Le sacré restait un besoin de ces temps agités. Et, au-delà des commandes qu’on se disputait, il agissait même sur les pinceaux moins inspirés comme une liqueur forte et nécessaire.
 Après les moissons du Ciel, la gourmandise du collectionneur… Louis-Antoine Prat, dont la plume vaut l’œil, nous livre le troisième et dernier volet du triptyque dont il a voulu orner son, notre musée imaginaire du dessin français. Triptyque magistral, plus de 2000 pages en tout, où l’érudition refuse d’être pesante ou bienpensante, et où l’érudit lui-même se sent libre d’intervenir à la première personne, comme le font les romanciers qui aiment à briser la glace ou casser la distance. Les frères Goncourt, que Prat prend souvent en flagrant délit de mauvaise foi ou de mauvaise attribution, forment évidemment le lointain modèle de cette langue capable d’épouser ce que chaque dessin fait surgir, saillir et vivre en quelques traits. « Il y a dans tous les arts, disait Voltaire, un je ne sais quoi qu’il est bien difficile d’attraper ». A bon entendeur… Le tour était donc venu de traverser le XVIIIème siècle, celui qui débute avec le vieux Louis XIV, avide de jeunesse, et se referme avant David, seuil du volume consacré au XIXème siècle. On reconnait l’écrivain et le dessinateur à leur science des extrémités ! Le XVIIIème siècle de Prat, fier de ses 200 noms et de ses 1500 feuilles, se déploie entre Watteau et Fragonard, deux géants. Le premier soignait sa bile à hautes doses de graphomanie magique, le second, un tout petit moins génial, mais plus varié, s’aventura jusqu’à poser le pied, avec Greuze et Vincent, sur les premières marches de ce qu’il faut appeler, faute de termes appropriés, le préromantisme noir. L’homme de la fête galante et le libertin de Grasse, sont-ce les seuls pics du paysage ainsi déroulé ? Les seuls « sourires », dirait Proust, d’un siècle qui sut saisir la femme comme nul autre ? Prat s’est bien gardé, on l’en remercie, de remeubler le panthéon habituel des dieux du crayon et de la sanguine. Il a étendu au siècle entier le champ de son regard curieux de tout, créateurs et créatrices, produits de l’Académie et contrebandiers, peintres d’histoire, paysagistes et portraitistes, sculpteurs et architectes. Aucune limite générique ne prévaut ici. Tracer un tel panorama sans noyer les hiérarchies, ni perdre le fil du récit, demandait du souffle et du nez, ils y sont. Les prix d’excellence vont à la crème du dessin, Lemoyne, Boucher, Subleyras, Natoire, Saint-Aubin, Quentin de La Tour, Perronneau, Hubert Robert et Boilly, en plus des maîtres déjà cités. Et les réserves tombent aussi juste. Il ne manque rien à ce voyage étourdissant, quelques images en pleine page peut-être, mais la franchise de ton, la sûreté de l’information et la folle générosité de l’iconographie suffisent à notre bonheur.
Après les moissons du Ciel, la gourmandise du collectionneur… Louis-Antoine Prat, dont la plume vaut l’œil, nous livre le troisième et dernier volet du triptyque dont il a voulu orner son, notre musée imaginaire du dessin français. Triptyque magistral, plus de 2000 pages en tout, où l’érudition refuse d’être pesante ou bienpensante, et où l’érudit lui-même se sent libre d’intervenir à la première personne, comme le font les romanciers qui aiment à briser la glace ou casser la distance. Les frères Goncourt, que Prat prend souvent en flagrant délit de mauvaise foi ou de mauvaise attribution, forment évidemment le lointain modèle de cette langue capable d’épouser ce que chaque dessin fait surgir, saillir et vivre en quelques traits. « Il y a dans tous les arts, disait Voltaire, un je ne sais quoi qu’il est bien difficile d’attraper ». A bon entendeur… Le tour était donc venu de traverser le XVIIIème siècle, celui qui débute avec le vieux Louis XIV, avide de jeunesse, et se referme avant David, seuil du volume consacré au XIXème siècle. On reconnait l’écrivain et le dessinateur à leur science des extrémités ! Le XVIIIème siècle de Prat, fier de ses 200 noms et de ses 1500 feuilles, se déploie entre Watteau et Fragonard, deux géants. Le premier soignait sa bile à hautes doses de graphomanie magique, le second, un tout petit moins génial, mais plus varié, s’aventura jusqu’à poser le pied, avec Greuze et Vincent, sur les premières marches de ce qu’il faut appeler, faute de termes appropriés, le préromantisme noir. L’homme de la fête galante et le libertin de Grasse, sont-ce les seuls pics du paysage ainsi déroulé ? Les seuls « sourires », dirait Proust, d’un siècle qui sut saisir la femme comme nul autre ? Prat s’est bien gardé, on l’en remercie, de remeubler le panthéon habituel des dieux du crayon et de la sanguine. Il a étendu au siècle entier le champ de son regard curieux de tout, créateurs et créatrices, produits de l’Académie et contrebandiers, peintres d’histoire, paysagistes et portraitistes, sculpteurs et architectes. Aucune limite générique ne prévaut ici. Tracer un tel panorama sans noyer les hiérarchies, ni perdre le fil du récit, demandait du souffle et du nez, ils y sont. Les prix d’excellence vont à la crème du dessin, Lemoyne, Boucher, Subleyras, Natoire, Saint-Aubin, Quentin de La Tour, Perronneau, Hubert Robert et Boilly, en plus des maîtres déjà cités. Et les réserves tombent aussi juste. Il ne manque rien à ce voyage étourdissant, quelques images en pleine page peut-être, mais la franchise de ton, la sûreté de l’information et la folle générosité de l’iconographie suffisent à notre bonheur.
 Changeons de siècle, mais revenons au Petit-Palais, et levons les yeux ! Au sortir de la guerre de 14-18, dont on rappelait récemment combien elle secoua l’accrochage du Louvre et fit de la continuité affichée de l’École française une priorité patriotique, Maurice Denis décora une des coupoles du musée. Trop vieux pour se battre, ce maurrassien éclairé s’était porté au front avec d’autres artistes, officiellement sélectionnés, pour témoigner de la vie militaire et des terribles destructions. Aussi, fin 1918, proposa-t-il de célébrer « la victoire de nos armées », ce que refusa le Conseil de Paris. On jugea plus subtile de « glorifier les arts français » et leur belle unité à travers les âges. Mais quel art français ? Tout était là. Denis, semble-t-il, ne peina guère à imposer la filiation multiséculaire d’un art de synthèse, à l’aune duquel se complètent et s’épaulent Goujon, Watteau, Poussin, Delacroix et Manet. En un raccourci génial, l’un des compartiments de la voûte fait figurer ces deux derniers, en costumes modernes, façon Fantin-Latour, qu’encadrent La Liberté de 1830 et Le Fifre (il venait d’entrer au Louvre, avec la sublime collection Isaac de Camondo). Si, selon Aragon, Picasso fut le Delacroix du XXème siècle, Manet le fut des années 1860-1880, de même que Gauguin prétendit ensuite à cette succession. Les Nabis, et Denis le premier, ramassèrent la mise vers 1900, et associèrent le vieux Cézanne et le dernier Renoir à leur volonté de dépasser l’impressionnisme, non moins que le symbolisme littéraire et l’horreur salonnarde. Tout en précisant le rôle massif qu’il joua dans la création du lieu et dans sa définition pour ainsi dire spirituelle (ne pas y abriter une collection de plus, mais restituer le climat intellectuel et poétique du Journal), la passionnante exposition du musée Delacroix éclaire cette cordée intergénérationnelle à partir de la peinture même. Et quelle peinture ! Cézanne et son Apothéose de Delacroix, Gauguin et son Vase de fleurs de Londres, acheté dès 1897 par Degas, un Émile Bernard endiablé de 1930, la divine Odalisque à la culotte rouge de Matisse, les cartons de Denis pour le Petit-Palais et l’un des Carnets dits de Biskra du même artiste (plus delacrucien que jamais, en 1921, lors de son séjour algérien). Une vraie réunion de famille, parcourue par l’ivresse légère qui sied aux fêtes de l’intelligence et de l’art français ! Stéphane Guégan
Changeons de siècle, mais revenons au Petit-Palais, et levons les yeux ! Au sortir de la guerre de 14-18, dont on rappelait récemment combien elle secoua l’accrochage du Louvre et fit de la continuité affichée de l’École française une priorité patriotique, Maurice Denis décora une des coupoles du musée. Trop vieux pour se battre, ce maurrassien éclairé s’était porté au front avec d’autres artistes, officiellement sélectionnés, pour témoigner de la vie militaire et des terribles destructions. Aussi, fin 1918, proposa-t-il de célébrer « la victoire de nos armées », ce que refusa le Conseil de Paris. On jugea plus subtile de « glorifier les arts français » et leur belle unité à travers les âges. Mais quel art français ? Tout était là. Denis, semble-t-il, ne peina guère à imposer la filiation multiséculaire d’un art de synthèse, à l’aune duquel se complètent et s’épaulent Goujon, Watteau, Poussin, Delacroix et Manet. En un raccourci génial, l’un des compartiments de la voûte fait figurer ces deux derniers, en costumes modernes, façon Fantin-Latour, qu’encadrent La Liberté de 1830 et Le Fifre (il venait d’entrer au Louvre, avec la sublime collection Isaac de Camondo). Si, selon Aragon, Picasso fut le Delacroix du XXème siècle, Manet le fut des années 1860-1880, de même que Gauguin prétendit ensuite à cette succession. Les Nabis, et Denis le premier, ramassèrent la mise vers 1900, et associèrent le vieux Cézanne et le dernier Renoir à leur volonté de dépasser l’impressionnisme, non moins que le symbolisme littéraire et l’horreur salonnarde. Tout en précisant le rôle massif qu’il joua dans la création du lieu et dans sa définition pour ainsi dire spirituelle (ne pas y abriter une collection de plus, mais restituer le climat intellectuel et poétique du Journal), la passionnante exposition du musée Delacroix éclaire cette cordée intergénérationnelle à partir de la peinture même. Et quelle peinture ! Cézanne et son Apothéose de Delacroix, Gauguin et son Vase de fleurs de Londres, acheté dès 1897 par Degas, un Émile Bernard endiablé de 1930, la divine Odalisque à la culotte rouge de Matisse, les cartons de Denis pour le Petit-Palais et l’un des Carnets dits de Biskra du même artiste (plus delacrucien que jamais, en 1921, lors de son séjour algérien). Une vraie réunion de famille, parcourue par l’ivresse légère qui sied aux fêtes de l’intelligence et de l’art français ! Stéphane Guégan
 Le Baroque des Lumières. Chefs-d’œuvre des églises parisiennes au XVIIIème siècle, Petit Palais. Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, jusqu’au 16 juillet 2017. L’ambitieux catalogue (Paris-Musées, 49,90€) met fin à bien des poncifs. Puisque nous parlions du grand Voltaire, signalons le volume Folio des Lettres choisies (édition de Nicholas Cronk, Gallimard, 9,30€), brillante anthologie, puisqu’elle puise parmi les 15 000 épîtres subsistantes la matière d’un volume à mettre entre toutes les mains et qui n’écarte aucun des principes et combats dont il reste le nom. On en conseillera la lecture à ceux qui souffrent encore de certaines préventions à l’égard de Voltaire. Elles viennent, en gros, du parricide des romantiques, comme des excès de la religion laïque et progressiste. Voltaire a le don d’allumer des bûchers contre lui, c’est bon signe. Ce n’est pas à vous que j’apprendrai qu’il fut en liaison avec les plus grands, politique, arts et philosophie confondus. Frédéric II, à 25 ans, lui déclare que leurs échanges lui sont devenus « indispensables ». Qui d’autre que Voltaire pouvait s’adresser directement à la couronne d’Angleterre ou à la grande Catherine, tout en dénonçant les abus du pouvoir et l’instrumentalisation des préjugés religieux ? On sait qu’il croit à la transcendance de l’humanité à travers les âges et les races, cela ne l’empêche pas de se méfier des hommes (moins que Rousseau, toutefois, comme l’atteste la sublime lettre qu’il adresse au citoyen de Genève en 1755) et de ne pas se brouiller avec Dieu. A ceux qui professent la haine des sociétés humaines ou l’hygiène des lendemains qui chantent, ils préfèrent les modérés altruistes, Diderot en tête. Sa correspondance, pleine d’ironie à l’égard des fâcheux, d’attention envers les femmes, du souci des arts, comme il l’écrit à Caylus en 1739, est une sorte de salon nomade, d’une drôlerie folle. On y croise Boucher et Bouchardon, aussi bien que le milieu de L’Encyclopédie et du théâtre. Du reste, sa morale chevaleresque et galante ne descend-elle pas, en partie, des drames de Corneille et Racine ? Il y a enfin le style, inimitable, qui mettait en extase Flaubert et Brunetière, et qui reste le modèle de quelques vrais écrivains d’aujourd’hui, l’ami Sollers compris. SG
Le Baroque des Lumières. Chefs-d’œuvre des églises parisiennes au XVIIIème siècle, Petit Palais. Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, jusqu’au 16 juillet 2017. L’ambitieux catalogue (Paris-Musées, 49,90€) met fin à bien des poncifs. Puisque nous parlions du grand Voltaire, signalons le volume Folio des Lettres choisies (édition de Nicholas Cronk, Gallimard, 9,30€), brillante anthologie, puisqu’elle puise parmi les 15 000 épîtres subsistantes la matière d’un volume à mettre entre toutes les mains et qui n’écarte aucun des principes et combats dont il reste le nom. On en conseillera la lecture à ceux qui souffrent encore de certaines préventions à l’égard de Voltaire. Elles viennent, en gros, du parricide des romantiques, comme des excès de la religion laïque et progressiste. Voltaire a le don d’allumer des bûchers contre lui, c’est bon signe. Ce n’est pas à vous que j’apprendrai qu’il fut en liaison avec les plus grands, politique, arts et philosophie confondus. Frédéric II, à 25 ans, lui déclare que leurs échanges lui sont devenus « indispensables ». Qui d’autre que Voltaire pouvait s’adresser directement à la couronne d’Angleterre ou à la grande Catherine, tout en dénonçant les abus du pouvoir et l’instrumentalisation des préjugés religieux ? On sait qu’il croit à la transcendance de l’humanité à travers les âges et les races, cela ne l’empêche pas de se méfier des hommes (moins que Rousseau, toutefois, comme l’atteste la sublime lettre qu’il adresse au citoyen de Genève en 1755) et de ne pas se brouiller avec Dieu. A ceux qui professent la haine des sociétés humaines ou l’hygiène des lendemains qui chantent, ils préfèrent les modérés altruistes, Diderot en tête. Sa correspondance, pleine d’ironie à l’égard des fâcheux, d’attention envers les femmes, du souci des arts, comme il l’écrit à Caylus en 1739, est une sorte de salon nomade, d’une drôlerie folle. On y croise Boucher et Bouchardon, aussi bien que le milieu de L’Encyclopédie et du théâtre. Du reste, sa morale chevaleresque et galante ne descend-elle pas, en partie, des drames de Corneille et Racine ? Il y a enfin le style, inimitable, qui mettait en extase Flaubert et Brunetière, et qui reste le modèle de quelques vrais écrivains d’aujourd’hui, l’ami Sollers compris. SG
*Louis-Antoine Prat, Le Dessin français au XVIIIème siècle, Somogy Editions d’art / Louvre Editions / 175€.
 *Maurice Denis et Eugène Delacroix, de l’atelier au musée, jusqu’au 28 août. Catalogue sous la direction de Dominique de Font-Réaulx (Louvre Editions / Le Passage, 28€), avec les excellentes contributions d’Isabelle Collet, Anne Robbins, Arlette Sérullaz, Fabienne Stahl et Marie-Pierre Salé. Comme cette dernière s’y penche avec soin sur les carnets de Biskra, témoignage décisif de l’expérience nécessairement duelle de Denis (« la population misérable » qu’il faut esthétiser / les impressions bibliques devant l’illusion qu’on force un peu de mœurs pastorales inchangées), signalons la parution tardive, mais indispensable, du catalogue Biskra, sortilèges d’une oasis (25€), l’exposition de L’Institut du Monde Arabe (septembre 2016/janvier 2017) dont Roger Benjamin avait été le commissaire. Cet éminent spécialiste de l’orientalisme et Eric Delpont, directeur du musée de l’IMA, y avaient recréé le foisonnement d’images, de toutes sortes comme de goût variable, qui activèrent et accompagnèrent l’immense succès touristique de cette ville du Sud-Est de l’Algérie, où le chemin de fer, à partir de 1888, draine un flot de visiteurs toujours plus nombreux. Certains y soignent l’hiver leurs poumons enrayés, d’autres se paient à bon compte une tranche d’exotisme ou de sexualité tarifée, voire l’une et l’autre. Car, à côté des fameuses Ouled Naïls et des « rues du plaisir », qui plurent davantage à Fromentin qu’à Maurice Denis, il y a d’autres corps, d’autres sexes, ceux qui valurent au jeune Gide, dès 1893, une fameuse « révélation ». Une bonne partie de ses livres en conservent secrètement la trace émue. Quoique l’imagerie de Biskra soit occidentale par essence, et donc informée par le regard colonial, Benjamin refuse de l’enfermer dans ce rapport de domination et de discrimination, écueil des analyses issues de la grande repentance. Ces images nous parlent, au contraire, d’un monde, inégalitaire certes, mais moins clivé que la doxa nous le répète ad nauseam. Du grand Guillaumet, qui fut mieux que le Millet de Biskra, au Matisse du Nu bleu de 1907, nouvelle Olympia plus dévoilée que l’autre, toutes les esthétiques, expériences et fantasmes, fusionnèrent en cette Oasis où le « pittoresque abonde », selon le mot du grand Fauve à Manguin. SG
*Maurice Denis et Eugène Delacroix, de l’atelier au musée, jusqu’au 28 août. Catalogue sous la direction de Dominique de Font-Réaulx (Louvre Editions / Le Passage, 28€), avec les excellentes contributions d’Isabelle Collet, Anne Robbins, Arlette Sérullaz, Fabienne Stahl et Marie-Pierre Salé. Comme cette dernière s’y penche avec soin sur les carnets de Biskra, témoignage décisif de l’expérience nécessairement duelle de Denis (« la population misérable » qu’il faut esthétiser / les impressions bibliques devant l’illusion qu’on force un peu de mœurs pastorales inchangées), signalons la parution tardive, mais indispensable, du catalogue Biskra, sortilèges d’une oasis (25€), l’exposition de L’Institut du Monde Arabe (septembre 2016/janvier 2017) dont Roger Benjamin avait été le commissaire. Cet éminent spécialiste de l’orientalisme et Eric Delpont, directeur du musée de l’IMA, y avaient recréé le foisonnement d’images, de toutes sortes comme de goût variable, qui activèrent et accompagnèrent l’immense succès touristique de cette ville du Sud-Est de l’Algérie, où le chemin de fer, à partir de 1888, draine un flot de visiteurs toujours plus nombreux. Certains y soignent l’hiver leurs poumons enrayés, d’autres se paient à bon compte une tranche d’exotisme ou de sexualité tarifée, voire l’une et l’autre. Car, à côté des fameuses Ouled Naïls et des « rues du plaisir », qui plurent davantage à Fromentin qu’à Maurice Denis, il y a d’autres corps, d’autres sexes, ceux qui valurent au jeune Gide, dès 1893, une fameuse « révélation ». Une bonne partie de ses livres en conservent secrètement la trace émue. Quoique l’imagerie de Biskra soit occidentale par essence, et donc informée par le regard colonial, Benjamin refuse de l’enfermer dans ce rapport de domination et de discrimination, écueil des analyses issues de la grande repentance. Ces images nous parlent, au contraire, d’un monde, inégalitaire certes, mais moins clivé que la doxa nous le répète ad nauseam. Du grand Guillaumet, qui fut mieux que le Millet de Biskra, au Matisse du Nu bleu de 1907, nouvelle Olympia plus dévoilée que l’autre, toutes les esthétiques, expériences et fantasmes, fusionnèrent en cette Oasis où le « pittoresque abonde », selon le mot du grand Fauve à Manguin. SG
 La France encore ! Le plus grand dramaturge des années 1880-1900, Anton Tchekhov parlait, écrivait, traduisait et aimait notre langue et notre littérature, de Dumas père à Zola. Sa correspondance, si elle peut se lire de mille manières, si elle éclate d’humour et de finesse, à l’image de son théâtre dont elle fut parfois le laboratoire, croise sans cesse la littérature, dont la « concision » doit rester la règle d’or, dit-il à son frère Alexandre, en avril 1889. La même année, au sujet de Goethe, il réaffirme la coexistence possible, dans les âmes bien faites, du poète et du naturaliste rivé au réel. Pourquoi fuir la vérité ? L’affaire Dreyfus le fait réagir dès lecture du J’accuse de Zola. Et lors des obsèques d’Alphonse Daudet, il écume les journaux français, félicitant à distance Faguet, Coppée et Rochefort pour leurs hommages. Son admiration, il ne peut la refuser au « trop long et trop immodeste » Dostoïevski et à Tolstoï, mais on le surprend à exalter le « kieff » [sic] de Flaubert et son art de l’ellipse. Pas besoin de bavardage, ni de point de vue central, écrit-il au sujet d’Anna Karénine. Il touche alors à son goût des êtres et des narrations déboussolés. Ces merveilleuses Lettres d’une vie (Robert Laffont, Bouquins, 32€) sont aussi de l’étoffe dont les songes sont faits. SG
La France encore ! Le plus grand dramaturge des années 1880-1900, Anton Tchekhov parlait, écrivait, traduisait et aimait notre langue et notre littérature, de Dumas père à Zola. Sa correspondance, si elle peut se lire de mille manières, si elle éclate d’humour et de finesse, à l’image de son théâtre dont elle fut parfois le laboratoire, croise sans cesse la littérature, dont la « concision » doit rester la règle d’or, dit-il à son frère Alexandre, en avril 1889. La même année, au sujet de Goethe, il réaffirme la coexistence possible, dans les âmes bien faites, du poète et du naturaliste rivé au réel. Pourquoi fuir la vérité ? L’affaire Dreyfus le fait réagir dès lecture du J’accuse de Zola. Et lors des obsèques d’Alphonse Daudet, il écume les journaux français, félicitant à distance Faguet, Coppée et Rochefort pour leurs hommages. Son admiration, il ne peut la refuser au « trop long et trop immodeste » Dostoïevski et à Tolstoï, mais on le surprend à exalter le « kieff » [sic] de Flaubert et son art de l’ellipse. Pas besoin de bavardage, ni de point de vue central, écrit-il au sujet d’Anna Karénine. Il touche alors à son goût des êtres et des narrations déboussolés. Ces merveilleuses Lettres d’une vie (Robert Laffont, Bouquins, 32€) sont aussi de l’étoffe dont les songes sont faits. SG
La France, toujours !
Sur la formidable exposition Le mystère Nain du Louvre-Lens, voir Stéphane Guégan, « Génie national et réalisme au Grand Siècle », La Revue des deux mondes, juin 2017