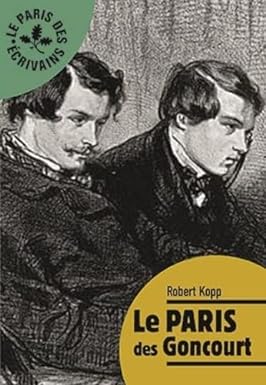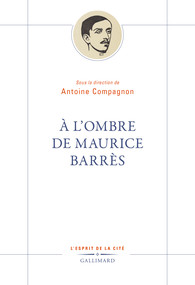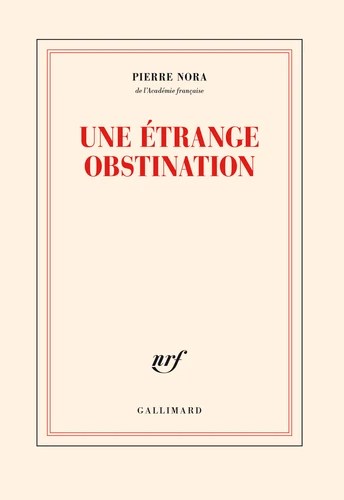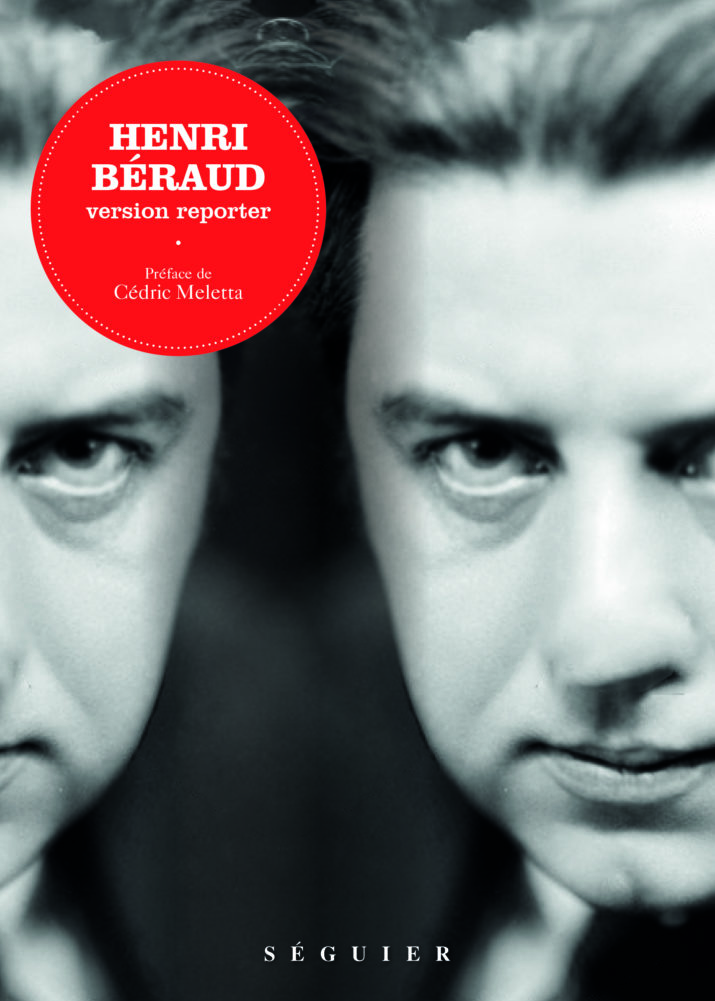De féline mémoire, ce fut sans doute la dernière exposition à avoir eu le culot de réunir les tableaux les moins « fréquentables » du grand Balthus. New York, capitale de la bienpensance infantilisante, n’était pas encore ce qu’elle est devenue. Au MoMA, qui s’en garderait très probablement aujourd’hui, eut lieu, de septembre 2013 à janvier 2014, Balthus : Cats and Girls – Paintings and Provocations. La traduction française du catalogue lui préféra un prudent Balthus. Jeunes filles aux chats. Quand on lui reprochait sa peinture dérangeante, ses extases d’adolescentes boudeuses, ses irruptions de culottes blanches, ses feux de cheminée allégoriques et ses chats concupiscents, Balthus affectait de n’en rien savoir. De ne rien voir. Mais sa correspondance lui oppose un sévère démenti. Volontaire était l’érotisme outré ou ouaté de ses tableaux, de même que les ronrons inquiétants dont l’âge indécis de ses modèles s’accompagnait le plus souvent. « Mort aux hypocrites ! », s’exclame-t-il, en 1937, au détour d’une lettre adressée à sa première épouse, la singulière Antoinette de Watteville. L’éveil de la libido et la sortie de la puberté étaient avant-guerre liés par une sorte de gène ou d’interdit, rattrapés depuis lors par les révélations atroces sur la pédophilie organisée. Or, Balthus n’innocente pas la sexualité de qui regarde et de qui on regarde, il peint une solidarité d’attentes, d’affects confus, ou d’émois impurs, sous la double lumière du désir et de la vulnérabilité, de la pulsion et de la souveraineté, double lumière qu’incarne très tôt l’ambivalence du chat.

C’est la perte de l’un d’entre eux, on le sait, qui fonde et justifie l’œuvre, avec la bénédiction du poète Rilke. Balthus a onze ans lorsqu’il fait son deuil de celui qui deviendra, pour l’éternité, Mitsou, après la publication, en 1921, de quarante dessins au graphisme faussement naïf, et au climat trompeusement candide. « Trouver un chat, c’est inouï », dit Rilke en préface. Le perdre, c’est l’horreur. De page en page se déploie le récit d’un petit garçon et du jeune chat qu’il a recueilli et finit par voir s’effacer. Précipitant rencontre heureuse et séparation traumatique, cette suite en noir et blanc se fait l’instrument d’une auto-analyse en images, comme si l’intelligence de soi était inapte encore aux mots. Mitsou annonce la multitude de chats promis à habiter et troubler la peinture de Balthus. Certains y lapent du lait avec une sensualité contagieuse, d’autres sèment l’effroi par leur sourire forcé, la plupart se réduisent à leur trouble présence, sentinelle ici, observateur là. Faisons aussi l’hypothèse de leur mémoire pluriséculaire, celle de Balthus lui-même, dernier des modernes à s’être glissé dans la fourrure du pictor doctus. Et plus encore que Giacometti, Francis Bacon ou Jean-Michel Basquiat, à s’être identifié à ces quadrupèdes inapprivoisables. (Lire la suite dans La Revue des deux mondes de mars 2024).
Stéphane Guégan

Triplés malruciens chez Baker Street / Fier d’être un des leurs, après avoir toujours vécu avec eux et les avoir si bien dessinés, André Malraux (1901-1976) connut la longévité des chats, 9 vies. La dernière n’a duré qu’un an et elle nous est joliment contée, la main sur le cœur, par Philippe Langémieux. Entre novembre 1975 et novembre 1976, il s’en est passé des choses à Verrières-le-Buisson, il en est passé des visiteurs et des visiteuses , malgré la maladie, malgré la mort qui chuchote désagréablement à ses oreilles. Malraux pensait l’avoir apprivoisée au fil des plus terribles deuils qui se puissent imaginer, il n’en est rien. Elle reste, d’ailleurs, l’un de ses moteurs, comme le mythe, voire la mythomanie. La crainte d’un départ précipité ne lui fait gaspiller aucune miette du temps. Les derniers grands livres se peaufinent, L’Homme précaire et la littérature, L’Intemporel ; la télévision, dont il est un spectateur gourmand, le sollicite ; on vient recueillir son témoignage (beau moment avec Dominique Desanti au sujet de Drieu, que le déclin de la France avait perdu et que Malraux continue à vénérer) ; la politique l’ennuie puisqu’elle n’est plus d’action, et que les « experts en impuissance » font passer les intérêts avant la patrie ; ses autres drogues ont changé, et même le whisky laisse souvent place au chocolat, mais rien n’égale un déjeuner, en tête-à-tête, avec une jolie femme, Victoire de Montesquiou et d’autres ; l’art, à haute dose, le maintient en selle entre deux opérations sérieuses ; autour de cet homme qui parle de Napoléon, Mao ou Picasso comme s’il venait de les quitter, il y a enfin le dernier carré, Sophie de Vilmorin, nièce de la défunte Louise, Michaël et François de Saint-Chéron, si fidèles jusqu’à aujourd’hui, et deux chats, qui veillent et devinent… Quand viendra l’heure, le gouvernement, face au vertige, ne trouvera pas les mots. Depuis la rue de Valois, où son ombre reste écrasante, Françoise Giroud, sans convaincre, joue l’agnostique contre le lecteur de Bossuet et de Baudelaire : « Il était l’homme du tragique, celui de la lucidité sans foi. » L’art serait-il vraiment la seule résurrection qui nous soit promise ? A propos, nous verrons en 2026 ce qu’il en est de la permanence de Malraux parmi nous. SG // Philippe Langénieux, Les derniers jours d’André Malraux, Baker Street, 20€ (amusante coquille : le ministre des arts du gouvernement Gambetta en 1881, ce n’est pas Adrien Proust, père de Marcel, mais Antonin Proust, l’ami de Manet) ; chez le même éditeur, Guillaume Villemot, André Malraux. L’homme qui osait ses rêves, 19€ et la nouvelle édition augmentée d’Alain Malraux, Au passage des grelots. Dans le cercle des Malraux, 21€. Le premier trousse à toute vitesse, et en toute empathie, comme dirait un ministre, une biographie de l’homme ivre de grandeur et de hauteur ; le second, portraitiste accompli et musicien inspiré, restitue les harmoniques d’un monde et d’un milieu dont notre nostalgie n’est pas prête de se guérir.

Lacan en images, entre Balthus et Masson / Bonne idée que d’allonger le célèbre psychanalyste de la rue de Lille sur le divan de l’histoire de l’art, et de nous remettre dans l’œil ces images qui ne sauraient montrer qu’en voilant, s’offrir à la vue qu’en la frustrant, ou dire qu’en le niant. Visible, au sens plein, jusqu’au 27 mai, l’exposition du Centre Pompidou-Metz n’a cure des taxinomies propres à l’exercice et son catalogue rose et bleu, avec oculus de rigueur, s’autorise ce que Mallarmé appelait des divagations. Dénué de la politesse des vrais écrivains envers leurs lecteurs, Lacan pouvait les décourager à force de jouer avec les mots ou de les dénaturer, de dépecer la syntaxe au gré des contorsions qui l’amusaient ou des glissements de l’oralité pour amphithéâtres ventrus. Quand on l’interrogeait à ce sujet, Lévi-Strauss ne se privait pas d’avouer qu’il n’y comprenait pas grand-chose, hormis, on l’imagine, ce que lui dictait une curiosité commune pour la symbolique sexuelle et la culture qu’on associe paresseusement aujourd’hui au surréalisme. Au fond, cet étourdisseur était classique de goût, de Courbet à Dalí, de Bellmer et Duchamp à son beau-frère André Masson (par la grâce des sœurs Maklès), le meilleur de la bande. L’heureux et facétieux propriétaire de L’Origine du monde n’eut pas nécessairement la patience des exégèses très élaborées. Parler de la fente de l’infante au sujet des Ménines est à peine digne d’un carabin des années 1920. On le suit mieux lorsque les inversions visuelles du chef-d’œuvre de Velázquez le conduisent à La Chambre de Balthus (1952-1954). Qui oserait aujourd’hui montrer un tel tableau, fiat lux ultra-érotique, en classe ? Lacan ou le monde d’hier. SG Chiara Parisi, Bernard Marcadé et Marie-Laure Bernadac (dir.), Lacan, l’exposition. Quand l’art rencontre la psychanalyse, Gallimard / Centre Pompidou-Metz, 39€.

Séparés, Malraux et Morand ne le furent pas sur tout et par tout. Une certaine conception du roman, Manet, Venise, les chats, le donjuanisme, entre autres ressemblances, les rapprochaient. Mais la guerre accusa la faille qui s’était creusée au temps où le Prix Goncourt 1933 s’était entiché du communisme, bête noire de Morand et illusoire bouclier à la barbarie de même couleur. En date du 19 octobre 1945, le Journal de guerre de l’ambassadeur déchu enregistre une volte-face de l’Histoire plutôt mortifiante : « Il y a vingt ans quand j’étais à l’hôpital de Saïgon, je vis arriver Malraux traqué, […] ayant fait de l’agitation révolutionnaire à Canton, et suspect au gouvernement général de l’Indochine. Et moi, fonctionnaire tranquille du Quai, je ne me doutais pas que, vingt ans plus tard, je serais le proscrit, le suspect alors que Malraux serait le conseiller intellectuel du régime. » Au sujet du tome II du Journal de guerre de Morand, édition de Bénédicte Vergez-Chaignon, Gallimard, 2023, 35 €, voir mon article « Les mémoires d’outre-tombe de Paul Morand », Commentaire, n°185, printemps 2024.