 L’effervescence artistique des années sombres a longtemps été ravalée, en bloc, au rang du collaborationnisme où se serait complue la France envahie… Il y a bien encore quelques plumes vengeresses, incapables de comprendre ce que furent Vichy, l’Occupation et la politique des alliés, pour crucifier les artistes et les écrivains qui décidèrent de rester actifs sous la botte et firent ainsi le bonheur des Françaises et des Français affamés de peinture, de littérature et de cinéma. Leur fringale légitime obéissait autant au patriotisme blessé qu’au besoin d’évasion qui les animait depuis le naufrage de juin 1940. Vital était de créer, vital était de soutenir et jouir des créations nationales. Il serait inconvenant, comme certains universitaires le prétendent encore, d’affirmer que cette forme de résistance revenait à faire le jeu des boches, en entretenant l’illusion de leur totale libéralité. Du reste, une certaine tolérance a bien prévalu en zone occupée et en zone libre durant cette paradoxale époque où même la littérature clandestine, bien connue des bureaux de censure, se fit un chemin jusqu’aux lecteurs. Ce sont eux et leurs goûts que Jacques Cantier a voulu étudier hors des préjugés usuels. L’illettrisme galopant de notre époque rend son préambule fort utile. Sous la IIIe République, en effet, la langue et la littérature passaient encore pour constitutifs du socle national et, par conséquent, du système éducatif. Montaigne, Corneille, Voltaire, Chateaubriand, Hugo, Michelet et Renan veillaient sur l’instruction des enfants de France. A la veille de la guerre, le tirage des journaux est faramineux et la crise de 1929, en écornant le marché du livre, n’en a pas atteint le cœur. En outre, la France occupée, malgré les pénuries, va renverser la tendance. On s’arrache les livres, L’Etranger comme le Journal de Gide, les prix montent et les éditeurs s’enrichissent malgré les titres « anti-allemands » qu’il a fallu retirer de leurs catalogues. Que le contexte ait favorisé les entreprises les plus folles, Maurice Girodias, l’inventeur du Chêne, le partenaire de Picasso en 1943, le reconnaîtra plus tard. Aucun des acteurs de la chaîne, de l’éditeur au lecteur, n’échappe à Cantier, qui s’intéresse même aux critiques littéraires, les plus brillants n’étant pas nécessairement ceux qu’on estime aujourd’hui s’être bien comportés, de Kléber Haedens à Claude Jamet. Ce dernier, grande plume des Nouveaux temps, n’a qu’ironie cinglante pour « l’offensive de vertu officielle » dont Vichy a lancé la croisade de façon anachronique et maladroite. Le double jeu se généralise et se diversifie, Aragon et Sartre en sont de bons exemples. Si le roman, en tous genres, exerce sa pleine puissance sur un lectorat friand d’aventures, la poésie connaît alors un triomphe et un renouveau. Péguy et Claudel réconfortent, galvanisent. Mais Cantier, bien que biographe de Drieu, a tort d’oublier la part qui revient à la N.R.F., prétendument nazifiée, dans la promotion des talents neufs, Audiberti en tête. Il n’est pas moins significatif de voir Genet, taulard génial, porté aux nues par de peu gaullistes voix.
L’effervescence artistique des années sombres a longtemps été ravalée, en bloc, au rang du collaborationnisme où se serait complue la France envahie… Il y a bien encore quelques plumes vengeresses, incapables de comprendre ce que furent Vichy, l’Occupation et la politique des alliés, pour crucifier les artistes et les écrivains qui décidèrent de rester actifs sous la botte et firent ainsi le bonheur des Françaises et des Français affamés de peinture, de littérature et de cinéma. Leur fringale légitime obéissait autant au patriotisme blessé qu’au besoin d’évasion qui les animait depuis le naufrage de juin 1940. Vital était de créer, vital était de soutenir et jouir des créations nationales. Il serait inconvenant, comme certains universitaires le prétendent encore, d’affirmer que cette forme de résistance revenait à faire le jeu des boches, en entretenant l’illusion de leur totale libéralité. Du reste, une certaine tolérance a bien prévalu en zone occupée et en zone libre durant cette paradoxale époque où même la littérature clandestine, bien connue des bureaux de censure, se fit un chemin jusqu’aux lecteurs. Ce sont eux et leurs goûts que Jacques Cantier a voulu étudier hors des préjugés usuels. L’illettrisme galopant de notre époque rend son préambule fort utile. Sous la IIIe République, en effet, la langue et la littérature passaient encore pour constitutifs du socle national et, par conséquent, du système éducatif. Montaigne, Corneille, Voltaire, Chateaubriand, Hugo, Michelet et Renan veillaient sur l’instruction des enfants de France. A la veille de la guerre, le tirage des journaux est faramineux et la crise de 1929, en écornant le marché du livre, n’en a pas atteint le cœur. En outre, la France occupée, malgré les pénuries, va renverser la tendance. On s’arrache les livres, L’Etranger comme le Journal de Gide, les prix montent et les éditeurs s’enrichissent malgré les titres « anti-allemands » qu’il a fallu retirer de leurs catalogues. Que le contexte ait favorisé les entreprises les plus folles, Maurice Girodias, l’inventeur du Chêne, le partenaire de Picasso en 1943, le reconnaîtra plus tard. Aucun des acteurs de la chaîne, de l’éditeur au lecteur, n’échappe à Cantier, qui s’intéresse même aux critiques littéraires, les plus brillants n’étant pas nécessairement ceux qu’on estime aujourd’hui s’être bien comportés, de Kléber Haedens à Claude Jamet. Ce dernier, grande plume des Nouveaux temps, n’a qu’ironie cinglante pour « l’offensive de vertu officielle » dont Vichy a lancé la croisade de façon anachronique et maladroite. Le double jeu se généralise et se diversifie, Aragon et Sartre en sont de bons exemples. Si le roman, en tous genres, exerce sa pleine puissance sur un lectorat friand d’aventures, la poésie connaît alors un triomphe et un renouveau. Péguy et Claudel réconfortent, galvanisent. Mais Cantier, bien que biographe de Drieu, a tort d’oublier la part qui revient à la N.R.F., prétendument nazifiée, dans la promotion des talents neufs, Audiberti en tête. Il n’est pas moins significatif de voir Genet, taulard génial, porté aux nues par de peu gaullistes voix.
 « Les affaires d’Adrienne Monnier sont prospères, on lit de plus en plus en France – peut-être pour essayer d’oublier la présence de l’ennemi. » Bien qu’éloignée par des milliers de kilomètres de son cher pays, Hélène Hoppenot observe comment on y survit. Le nouveau volume de son merveilleux Journal, aussi « exact » que « sincère », selon ses termes, fourmille de lumières sur les années sombres. Son mari, Henri, s’est vu écarter du Quai d’Orsay dès le 23 juin 1940, Vichy y place des hommes plus sûrs que lui, « trop à gauche », précise Hélène. Leur grand ami, Alexis Léger, alias Saint-John Perse, est déjà parti bouder aux Etats-Unis. Pétain, à contrecœur, le dénationalisera… Le limogeage d’Henri est moins rude, qui ne l’entraîne qu’en Uruguay ! Dans la ville de Lautréamont, Montevideo, l’ennui les attend. Hélène ne cache pas sa détresse aux autres exilés dont le Journal nous permet de connaître un peu mieux l’existence apatride. Les amoureux de Jouvet, Milhaud ou Gisèle Freund, « devenue la photographe de sa Majesté (Victoria Ocampo) » ne seront pas mécontents de les croiser au fil de ces pages si vivantes et informées. Au sujet de ceux qui sont restés et jouissent, sous la botte, d’un confort variable, Hélène peut se montrer moins renseignée ou plus dure. Ainsi imagine-t-elle Paulhan coulant des jours plus tranquilles depuis que la N.R.F. est passée aux mains de Drieu ! Le 6 mars 1941, elle se fait l’écho de Jeanne Bathori qui lui apprend, écrit-elle, que « Georges Auric a été victime d’un accident d’auto à Paris en compagnie de Marie-Laure de Noailles et d’un… officier allemand ! Une juive abjecte. » La même pourtant s’indigne des lois anti-Juifs de Vichy et loue Claudel de s’être ému publiquement du sort réservé aux israélites. Le camp d’Hélène et d’Henri, c’est celui de Londres, bien que la diariste stigmatise Mers el Kébir et les agissements des gaullistes en Amérique du Sud, dont elle compare les méthodes, à l’occasion, à celles des nazis. Des anglophiles, elle a compris, du reste, que Vichy en déborde très tôt. Le couple, hostile à la politique de Laval, s’étonne même que les Allemands «n’interviennent pas plus dans le flirt qui s’est établi entre la France et les Etats-Unis». Malgré Pearl Harbor et «l’horrible décret» du S.T.O., la démission d’Henri attendra le 25 octobre 1942. Saint-John Perse l’en félicite aussitôt. A peine réconciliés, les deux amis se déchirent sur De Gaulle dont le poète a ses raisons de se méfier. Puis viennent le premier débarquement des alliés et la volte-face de Darlan, que les Américains placent à la tête des forces d’Afrique du Nord. « Catastrophe », écrit Hélène, qui ne verse aucune larme sur l’assassinat de l’amiral. Cet acte lamentable, téléguidé par la France libre, mit Roosevelt hors de lui. Le président des Etats-Unis, admirateur de Pétain, aura tout fait pour écarter la solution gaulliste… Le Journal ne réagit pas au sabordage de Toulon mais le 22 novembre 1943, Hélène ne se prive pas de ce cri de joie : « La R.A.F.a fait tomber 2300 tonnes de bombes sur Berlin. Le châtiment va commencer. » Etrange ivresse, passagère, qui ne lui ressemble pas. Stéphane Guégan
« Les affaires d’Adrienne Monnier sont prospères, on lit de plus en plus en France – peut-être pour essayer d’oublier la présence de l’ennemi. » Bien qu’éloignée par des milliers de kilomètres de son cher pays, Hélène Hoppenot observe comment on y survit. Le nouveau volume de son merveilleux Journal, aussi « exact » que « sincère », selon ses termes, fourmille de lumières sur les années sombres. Son mari, Henri, s’est vu écarter du Quai d’Orsay dès le 23 juin 1940, Vichy y place des hommes plus sûrs que lui, « trop à gauche », précise Hélène. Leur grand ami, Alexis Léger, alias Saint-John Perse, est déjà parti bouder aux Etats-Unis. Pétain, à contrecœur, le dénationalisera… Le limogeage d’Henri est moins rude, qui ne l’entraîne qu’en Uruguay ! Dans la ville de Lautréamont, Montevideo, l’ennui les attend. Hélène ne cache pas sa détresse aux autres exilés dont le Journal nous permet de connaître un peu mieux l’existence apatride. Les amoureux de Jouvet, Milhaud ou Gisèle Freund, « devenue la photographe de sa Majesté (Victoria Ocampo) » ne seront pas mécontents de les croiser au fil de ces pages si vivantes et informées. Au sujet de ceux qui sont restés et jouissent, sous la botte, d’un confort variable, Hélène peut se montrer moins renseignée ou plus dure. Ainsi imagine-t-elle Paulhan coulant des jours plus tranquilles depuis que la N.R.F. est passée aux mains de Drieu ! Le 6 mars 1941, elle se fait l’écho de Jeanne Bathori qui lui apprend, écrit-elle, que « Georges Auric a été victime d’un accident d’auto à Paris en compagnie de Marie-Laure de Noailles et d’un… officier allemand ! Une juive abjecte. » La même pourtant s’indigne des lois anti-Juifs de Vichy et loue Claudel de s’être ému publiquement du sort réservé aux israélites. Le camp d’Hélène et d’Henri, c’est celui de Londres, bien que la diariste stigmatise Mers el Kébir et les agissements des gaullistes en Amérique du Sud, dont elle compare les méthodes, à l’occasion, à celles des nazis. Des anglophiles, elle a compris, du reste, que Vichy en déborde très tôt. Le couple, hostile à la politique de Laval, s’étonne même que les Allemands «n’interviennent pas plus dans le flirt qui s’est établi entre la France et les Etats-Unis». Malgré Pearl Harbor et «l’horrible décret» du S.T.O., la démission d’Henri attendra le 25 octobre 1942. Saint-John Perse l’en félicite aussitôt. A peine réconciliés, les deux amis se déchirent sur De Gaulle dont le poète a ses raisons de se méfier. Puis viennent le premier débarquement des alliés et la volte-face de Darlan, que les Américains placent à la tête des forces d’Afrique du Nord. « Catastrophe », écrit Hélène, qui ne verse aucune larme sur l’assassinat de l’amiral. Cet acte lamentable, téléguidé par la France libre, mit Roosevelt hors de lui. Le président des Etats-Unis, admirateur de Pétain, aura tout fait pour écarter la solution gaulliste… Le Journal ne réagit pas au sabordage de Toulon mais le 22 novembre 1943, Hélène ne se prive pas de ce cri de joie : « La R.A.F.a fait tomber 2300 tonnes de bombes sur Berlin. Le châtiment va commencer. » Etrange ivresse, passagère, qui ne lui ressemble pas. Stéphane Guégan
*Jacques Cantier, Lire sous l’Occupation, CNRS Editions, 25€ // Hélène Hoppenot, Journal 1940-1944, édition établie, introduite et annotée par Marie France Mousli, éditions Claire Paulhan, 35€.
D’autres guerres
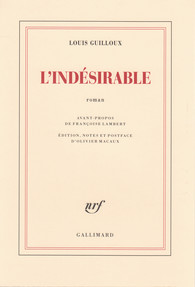 Une enfance pauvre, une jeunesse bretonne, la S.F.I.O. 1900, la guerre de 14, l’amitié de Malraux et Max Jacob, le choc de La Maison du peuple (1927) et du Sang noir (1935), le voyage déniaisant qui le mena en URSS avec Gide, Herbart et Dabit, Louis Guilloux avait fait du chemin et déjà brûlé quelques illusions lorsque la guerre de 1939-40 se referma, pas si drôle, par la pire des humiliations de notre histoire. Sous l’Occupation, Guilloux publie Le Pain des rêves, chez Gallimard, sous un titre inventé par Gaston. Ce roman qu’on ne lit plus guère, et qu’on lui reprocha plus tard, se voit couronner du Prix du roman populiste en 1942. Ceci explique cela… Blanchot dit aussitôt aimer parce qu’il y trouve, comme chez Marc Bernard, une aptitude à rendre « la vision de l’enfance sous cette lumière qui devrait l’obscurcir et qui n’en altère pas la pureté. » Guéhenno eût préféré que son ami Guilloux s’abstint de tout livre sous la botte, Louis lui répondit : « Tout bien pesé, je crois qu’il vaut mieux publier, qu’il vaut mieux être vivant que mort et qu’un ouvrage de cette nature et sur ce thème ne sert ni ne dessert personne. » Il est arrivé à Guilloux de renoncer à un manuscrit, acte d’autant plus vertueux qu’il a toujours tiré le diable par la queue. Roman de l’innocence méjugée et salie, L’Indésirable est donc resté dans ses tiroirs en 1923. Cet inédit est à lire tant la langue y est belle, simple, forte, le récit rapide, le propos d’une lucidité digne de Balzac et Vallès. D’entrée de jeu, Guilloux nous rappelle sa détestation de la guerre. C’est celle de 14 qui lui offre la trame, un camp de prisonniers étrangers où se trouve une vieille Alsacienne par erreur, trame où il tisse toutes les petitesses humaines, comme celles de jouir de la souffrance des autres ou de souffrir de leur bonheur. Quelques êtres d’exception. Tout Guilloux, que l’idéologie n’a jamais aveuglé, est là. SG/ Louis Guilloux, L’Indésirable, avant-propos de Françoise Lambert, édition, notes et postface d’Olivier Macaux, Gallimard, 18€.
Une enfance pauvre, une jeunesse bretonne, la S.F.I.O. 1900, la guerre de 14, l’amitié de Malraux et Max Jacob, le choc de La Maison du peuple (1927) et du Sang noir (1935), le voyage déniaisant qui le mena en URSS avec Gide, Herbart et Dabit, Louis Guilloux avait fait du chemin et déjà brûlé quelques illusions lorsque la guerre de 1939-40 se referma, pas si drôle, par la pire des humiliations de notre histoire. Sous l’Occupation, Guilloux publie Le Pain des rêves, chez Gallimard, sous un titre inventé par Gaston. Ce roman qu’on ne lit plus guère, et qu’on lui reprocha plus tard, se voit couronner du Prix du roman populiste en 1942. Ceci explique cela… Blanchot dit aussitôt aimer parce qu’il y trouve, comme chez Marc Bernard, une aptitude à rendre « la vision de l’enfance sous cette lumière qui devrait l’obscurcir et qui n’en altère pas la pureté. » Guéhenno eût préféré que son ami Guilloux s’abstint de tout livre sous la botte, Louis lui répondit : « Tout bien pesé, je crois qu’il vaut mieux publier, qu’il vaut mieux être vivant que mort et qu’un ouvrage de cette nature et sur ce thème ne sert ni ne dessert personne. » Il est arrivé à Guilloux de renoncer à un manuscrit, acte d’autant plus vertueux qu’il a toujours tiré le diable par la queue. Roman de l’innocence méjugée et salie, L’Indésirable est donc resté dans ses tiroirs en 1923. Cet inédit est à lire tant la langue y est belle, simple, forte, le récit rapide, le propos d’une lucidité digne de Balzac et Vallès. D’entrée de jeu, Guilloux nous rappelle sa détestation de la guerre. C’est celle de 14 qui lui offre la trame, un camp de prisonniers étrangers où se trouve une vieille Alsacienne par erreur, trame où il tisse toutes les petitesses humaines, comme celles de jouir de la souffrance des autres ou de souffrir de leur bonheur. Quelques êtres d’exception. Tout Guilloux, que l’idéologie n’a jamais aveuglé, est là. SG/ Louis Guilloux, L’Indésirable, avant-propos de Françoise Lambert, édition, notes et postface d’Olivier Macaux, Gallimard, 18€.
 La bande dessinée, ce film muet qui continue à opérer sa magie, sait se grandir, quand il le faut, à l’échelle des drames de l’histoire du XXe siècle. Futuropolis nous en a déjà administré la preuve avec La Déconfiture de Pascal Rabaté, récit bichrome de la débâcle de juin 40 (2020 sera l’occasion d’apprendre aux plus jeunes que cette débandade fut une vraie tuerie). A ces jeunes de France, il faudrait aussi rappeler que d’autres, à leur âge, furent incorporés, malgré eux, dans les bataillons d’Hitler à partir de 1942, Wehrmacht et Waffen SS. Ce fut notamment le cas des Alsaciens dont le statut, sous l’Occupation, valut aux habitants un traitement « spécial ». Le héros du Voyage de Marcel Grob rejoint ainsi la division Reichführer au lendemain du débarquement de Normandie. Pour lui et quelques-uns de ses camarades d’enfance, plus enthousiastes à l’idée de casser du rouge, la guerre continue, sérieusement même. Leur baptême du feu ne sera pourtant pas russe : à Marzabotto, en septembre 1944, il tourne au bain de sang. Grob y découvre la facilité de tuer et, chez un supérieur, ardent nazi, la capacité d’épargner. Les lignes se troublent parfois en cette agonie du Reich, les consciences, comme les souvenirs plus tard, en lutte contre les traumas de toutes sortes. Le passionnant album de Collin et Goethals rappelle, dès les premières planches, qu’il est des jours où l’on préférerait effacer le passé, disparaître dans un trou de sa mémoire. Leur livre fait remonter des nôtres le témoignage de Christian de La Mazière, l’un des moments les plus forts du Chagrin et la pitié, personnage étonnant sur lequel le beau livre de Vitoux, L’Ami de mon père, revint avec finesse. Mais La Mazière, à rebours de Grob, avait été FRW (freiwilligen), « engagé volontaire », et termina sa folle épopée sous l’uniforme de la Charlemagne. A lire et faire lire aux nouvelles générations. SG / Philippe Collin et Sébastien Goethals, Le Voyage de Marcel Grob, Futuropolis, 24€.
La bande dessinée, ce film muet qui continue à opérer sa magie, sait se grandir, quand il le faut, à l’échelle des drames de l’histoire du XXe siècle. Futuropolis nous en a déjà administré la preuve avec La Déconfiture de Pascal Rabaté, récit bichrome de la débâcle de juin 40 (2020 sera l’occasion d’apprendre aux plus jeunes que cette débandade fut une vraie tuerie). A ces jeunes de France, il faudrait aussi rappeler que d’autres, à leur âge, furent incorporés, malgré eux, dans les bataillons d’Hitler à partir de 1942, Wehrmacht et Waffen SS. Ce fut notamment le cas des Alsaciens dont le statut, sous l’Occupation, valut aux habitants un traitement « spécial ». Le héros du Voyage de Marcel Grob rejoint ainsi la division Reichführer au lendemain du débarquement de Normandie. Pour lui et quelques-uns de ses camarades d’enfance, plus enthousiastes à l’idée de casser du rouge, la guerre continue, sérieusement même. Leur baptême du feu ne sera pourtant pas russe : à Marzabotto, en septembre 1944, il tourne au bain de sang. Grob y découvre la facilité de tuer et, chez un supérieur, ardent nazi, la capacité d’épargner. Les lignes se troublent parfois en cette agonie du Reich, les consciences, comme les souvenirs plus tard, en lutte contre les traumas de toutes sortes. Le passionnant album de Collin et Goethals rappelle, dès les premières planches, qu’il est des jours où l’on préférerait effacer le passé, disparaître dans un trou de sa mémoire. Leur livre fait remonter des nôtres le témoignage de Christian de La Mazière, l’un des moments les plus forts du Chagrin et la pitié, personnage étonnant sur lequel le beau livre de Vitoux, L’Ami de mon père, revint avec finesse. Mais La Mazière, à rebours de Grob, avait été FRW (freiwilligen), « engagé volontaire », et termina sa folle épopée sous l’uniforme de la Charlemagne. A lire et faire lire aux nouvelles générations. SG / Philippe Collin et Sébastien Goethals, Le Voyage de Marcel Grob, Futuropolis, 24€.
 Elles sont belles ces jeunes coureuses, blondes et brunes, d’Alexandre Deïneka, la nature les enveloppe d’une lumière caressante, comme le peintre, sensible à leur fière allure, leurs seins qui pointent sous le maillot, les cuisses qui s’allongent dans l’effort dominé. Les ombres sont courtes, c’est l’été 1944, celui de la victoire déjà engagée de l’armée rouge sur les dernières divisions d’Hitler. Pleine liberté dit le titre… On aimerait y croire. Mais cet Hopper russe est aussi un Hopper stalinien. Une merveille trompeuse… Le dernier chapitre de Rouge, la fabuleuse exposition du Grand Palais en réserve plus d’une. Je sais que la tyrannie du goût voudrait que je fisse plutôt l’éloge des premières salles, que Nicolas Liucci-Goutnikov a dédiées aux fiançailles de cœur et de raison entre le bolchevisme et l’avant-garde, ivres de leur dureté abstraite commune. Mais les possibilités sont si rares à Paris de voir le meilleur du réalisme socialiste, «socialiste par son contenu et nationale dans sa forme», précise Staline, dès 1930. A quoi Jdanov, autre esthéticien de l’art d’action, ajouterait que le propre du tableau est moins de figer un état que de figurer « la réalité dans son développement révolutionnaire ». On comprend que, comme chez David, Géricault, Degas et Lautrec, le mouvement tienne ici du paradigme. Le très sensuel Deïneka, décidément le plus inspiré des figuratifs dès 1925, sut greffer à cette dynamo une robustesse digne de Courbet. Plus le totalitarisme déshumanise ses sujets, plus sa peinture, supposée son levier, réincarne, impose le corps, femmes et hommes, formes et sexes au-delà du bulletin de santé très officiel que ses tableaux dressent. Quelle leçon en ces temps néo-puritains! SG / Rouge. Art et utopie au pays des soviets, Grand Palais, jusqu’au 1er juillet, catalogue exemplaire (RMN, 45€), qui n’est pas sans rappeler, maquette et typographie, ceux des expositions Paris-Moscou et Les réalismes entre révolution et réaction. Nostalgie, nostalgie.
Elles sont belles ces jeunes coureuses, blondes et brunes, d’Alexandre Deïneka, la nature les enveloppe d’une lumière caressante, comme le peintre, sensible à leur fière allure, leurs seins qui pointent sous le maillot, les cuisses qui s’allongent dans l’effort dominé. Les ombres sont courtes, c’est l’été 1944, celui de la victoire déjà engagée de l’armée rouge sur les dernières divisions d’Hitler. Pleine liberté dit le titre… On aimerait y croire. Mais cet Hopper russe est aussi un Hopper stalinien. Une merveille trompeuse… Le dernier chapitre de Rouge, la fabuleuse exposition du Grand Palais en réserve plus d’une. Je sais que la tyrannie du goût voudrait que je fisse plutôt l’éloge des premières salles, que Nicolas Liucci-Goutnikov a dédiées aux fiançailles de cœur et de raison entre le bolchevisme et l’avant-garde, ivres de leur dureté abstraite commune. Mais les possibilités sont si rares à Paris de voir le meilleur du réalisme socialiste, «socialiste par son contenu et nationale dans sa forme», précise Staline, dès 1930. A quoi Jdanov, autre esthéticien de l’art d’action, ajouterait que le propre du tableau est moins de figer un état que de figurer « la réalité dans son développement révolutionnaire ». On comprend que, comme chez David, Géricault, Degas et Lautrec, le mouvement tienne ici du paradigme. Le très sensuel Deïneka, décidément le plus inspiré des figuratifs dès 1925, sut greffer à cette dynamo une robustesse digne de Courbet. Plus le totalitarisme déshumanise ses sujets, plus sa peinture, supposée son levier, réincarne, impose le corps, femmes et hommes, formes et sexes au-delà du bulletin de santé très officiel que ses tableaux dressent. Quelle leçon en ces temps néo-puritains! SG / Rouge. Art et utopie au pays des soviets, Grand Palais, jusqu’au 1er juillet, catalogue exemplaire (RMN, 45€), qui n’est pas sans rappeler, maquette et typographie, ceux des expositions Paris-Moscou et Les réalismes entre révolution et réaction. Nostalgie, nostalgie.
 Bonnard, si respectueux à «l’impression initiale» dans sa quête d’absolu mallarméenne, n’eût pas désapprouvé le dévoilement auquel procède cette belle publication. Vingt de ses agendas, s’étirant de 1927 à 1946, sont la propriété de la BNF depuis 1993. Leur publication in-extenso est à désirer, bien qu’ils soient connus des spécialistes. Mais la promenade est toujours à refaire dans ces feuillets où règne une double météo, la couleur du ciel s’y enregistre autant que le baromètre des désirs, y compris celui de peindre. Epousant ou contredisant le format japonais des agendas, Marthe et ses ablutions, jusqu’en janvier 1942, remplit la page de ses rondeurs et ses douceurs. Confirmant la nécessité de révéler « le non-vu de la vue » (Jean Clair), l’impudeur du couple ne connaît aucune limite, « les exigences de l’émotion » priment sur tout. Un pur enchantement court à travers ces agendas, malgré la guerre, le délitement du groupe nabi et la persécution des marchands juifs qui les font disparaître, en 1942, de ses bilans financiers annuels. Il reviendra aux fils de Josse Bernheim d’organiser la première exposition de l’après-guerre. Puis les Américains, le MoMA notamment, s’empareront de l’artiste faussement informel… SG / Céline Chicha-Castex, Alain Lévêque et Véronique Serrano, Pierre Bonnard. Au fil des jours. Agendas 1927-1946, L’atelier contemporain / Musée Bonnard, Le Cannet / BNF, 35€.
Bonnard, si respectueux à «l’impression initiale» dans sa quête d’absolu mallarméenne, n’eût pas désapprouvé le dévoilement auquel procède cette belle publication. Vingt de ses agendas, s’étirant de 1927 à 1946, sont la propriété de la BNF depuis 1993. Leur publication in-extenso est à désirer, bien qu’ils soient connus des spécialistes. Mais la promenade est toujours à refaire dans ces feuillets où règne une double météo, la couleur du ciel s’y enregistre autant que le baromètre des désirs, y compris celui de peindre. Epousant ou contredisant le format japonais des agendas, Marthe et ses ablutions, jusqu’en janvier 1942, remplit la page de ses rondeurs et ses douceurs. Confirmant la nécessité de révéler « le non-vu de la vue » (Jean Clair), l’impudeur du couple ne connaît aucune limite, « les exigences de l’émotion » priment sur tout. Un pur enchantement court à travers ces agendas, malgré la guerre, le délitement du groupe nabi et la persécution des marchands juifs qui les font disparaître, en 1942, de ses bilans financiers annuels. Il reviendra aux fils de Josse Bernheim d’organiser la première exposition de l’après-guerre. Puis les Américains, le MoMA notamment, s’empareront de l’artiste faussement informel… SG / Céline Chicha-Castex, Alain Lévêque et Véronique Serrano, Pierre Bonnard. Au fil des jours. Agendas 1927-1946, L’atelier contemporain / Musée Bonnard, Le Cannet / BNF, 35€.
 On ne peut pas dire que Roosevelt ait cru en De Gaulle et l’avenir de La France libre avant l’été 1943. Le respect qu’il vouait à Pétain, le soldat et le stratège de 14-18, souffrit moins de l’armistice de juin 1940 qu’on le pense ordinairement. Il y a tout lieu de croire, en outre, que l’idée d’un régime plus autoritaire, en France, au sortir des funestes années 1930, ne déplaisait pas davantage à l’homme du New Deal qu’aux Français qui suivirent d’abord le maréchal. Charles Zorgbibe, qui possède l’art du récit et domine une vaste documentation, prend manifestement plaisir à nous entraîner dans l’imbroglio dont l’Afrique du Nord fut le théâtre, comme il l’écrit, « surréaliste ». Mais son livre est d’une ambition plus grande et devrait s’imposer désormais comme l’un des plus utiles pour comprendre à la fois le régime de Vichy, l’attitude des Anglais à notre égard et la politique américaine, isolationniste, et longtemps sceptique envers ce que cuisinait Churchill. La tragédie de Mers el Kébir, qui tua 1300 marins français, montra « l’extrême-violence » dont Winston était capable envers son ancien allié. Après Dunkerque et le refus d’engager la R.A.F. dans les derniers moments de la drôle de guerre, ce fut la goutte de sang qui contribua à l’anglophobie d’une partie du personnel de Vichy. Relativement aux Etats-Unis, les proches de Pétain ou les plus « germanophiles », Laval en tête, le sentiment général était plus nuancé. Darlan lui-même en donnera la confirmation la plus éclatante lorsque le débarquement américain de novembre 1942, qu’il combat d’abord, le hisse, moins de deux mois, à la tête du Haut-Commissariat d’Afrique du Nord. Pétain n’en revient pas, De Gaulle non plus. Il faudra que Darlan soit assassiné par un jeune gaulliste et que Giraud manque de vision politique pour que s’opère un vrai changement. Charles Zorgbibe, que la singularité africaine fascine, y redonne une place à Weygand, très hostile aux concessions que Laval et Darlan ne surent pas refuser à Hitler. Puis la logique atlantique l’emporta sur l’Axe et soumit l’Europe à son leadership. SG / Charles Zorgbibe, L’Imbroglio. Roosevelt et Alger, Editions de Fallois, 24€.
On ne peut pas dire que Roosevelt ait cru en De Gaulle et l’avenir de La France libre avant l’été 1943. Le respect qu’il vouait à Pétain, le soldat et le stratège de 14-18, souffrit moins de l’armistice de juin 1940 qu’on le pense ordinairement. Il y a tout lieu de croire, en outre, que l’idée d’un régime plus autoritaire, en France, au sortir des funestes années 1930, ne déplaisait pas davantage à l’homme du New Deal qu’aux Français qui suivirent d’abord le maréchal. Charles Zorgbibe, qui possède l’art du récit et domine une vaste documentation, prend manifestement plaisir à nous entraîner dans l’imbroglio dont l’Afrique du Nord fut le théâtre, comme il l’écrit, « surréaliste ». Mais son livre est d’une ambition plus grande et devrait s’imposer désormais comme l’un des plus utiles pour comprendre à la fois le régime de Vichy, l’attitude des Anglais à notre égard et la politique américaine, isolationniste, et longtemps sceptique envers ce que cuisinait Churchill. La tragédie de Mers el Kébir, qui tua 1300 marins français, montra « l’extrême-violence » dont Winston était capable envers son ancien allié. Après Dunkerque et le refus d’engager la R.A.F. dans les derniers moments de la drôle de guerre, ce fut la goutte de sang qui contribua à l’anglophobie d’une partie du personnel de Vichy. Relativement aux Etats-Unis, les proches de Pétain ou les plus « germanophiles », Laval en tête, le sentiment général était plus nuancé. Darlan lui-même en donnera la confirmation la plus éclatante lorsque le débarquement américain de novembre 1942, qu’il combat d’abord, le hisse, moins de deux mois, à la tête du Haut-Commissariat d’Afrique du Nord. Pétain n’en revient pas, De Gaulle non plus. Il faudra que Darlan soit assassiné par un jeune gaulliste et que Giraud manque de vision politique pour que s’opère un vrai changement. Charles Zorgbibe, que la singularité africaine fascine, y redonne une place à Weygand, très hostile aux concessions que Laval et Darlan ne surent pas refuser à Hitler. Puis la logique atlantique l’emporta sur l’Axe et soumit l’Europe à son leadership. SG / Charles Zorgbibe, L’Imbroglio. Roosevelt et Alger, Editions de Fallois, 24€.
Il fut, au début des années 1930, l’homme politique le plus aimé des Français, il est aujourd’hui le symbole de toutes leurs détestations. Pierre Laval, aux yeux de la vulgate et du vulgaire, est le traître parfait, le symbole de la « germanophilie » de Vichy, le fils du peuple, le socialiste qui a mal tourné. Traître à soi, traître aux autres, traître irrécupérable. On ne saurait dire que Renaud Meltz le ménage dans sa biographie magistrale, écrite et documentée avec un brio constant. 1200 pages à charge, ou presque, ce n’est pas banal. A moins que Meltz ait suivi le conseil de Zweig qui préconisait aux biographes de prendre en grippe leur objet… Mais un homme qui annote la Vie de Jésus de Mauriac, avant d’être fusillé par des soldats étourdis de rhum, ne méritait-il pas plus d’égards ? Sa politique des années 1933-1935 plus de considération ? A-t-il manqué à ce point d’intelligence de terrain l’homme qui jouait Mussolini et même Staline contre Hitler ? Certes, Meltz souligne à juste titre le lien qui unit l’émule de Briand et la future politique d’entente avec l’Allemagne nazie. A l’inverse, il rappelle que, contre toute attente, et contrairement à Morand et Berl, Laval ne fut pas plus munichois que Drieu. L’ancien ministre des affaires étrangères n’avait pas toujours montré cette lucidité, voire la même fermeté, envers Hitler. De plus, en septembre 1938, Laval a perdu tout pouvoir, il ronge son frein. On connaît la suite, on plutôt on croit la connaître. Il est préférable de lire Meltz à cet égard. Laval et Vichy, c’est le paradoxe dans le paradoxe, puisque l’ancien maire d’Aubervilliers se dit républicain jusqu’au bout, ne croit pas à la révolution nationale du « vieux », trop archaïque, cléricale et maurassienne à son goût. Il n’adhère pas plus au paganisme néo-nietzschéen des géants blonds. Et, comme l’a souligné Léon Poliakoff, sa xénophobie d’état ne se paie d’aucun racisme biologique. Le chapitre que Meltz consacre à la persécution différentielle des Juifs rappelle son obsession d’épargner au maximum les sujets français aux dépens des « apatrides », que Laval savait destinés au pire entre les mains de Allemands. Chapitre riche, glaçant comme l’est la realpolitik, terrible, mais un peu embrouillé, au point de laisser croire par moments que Laval était informé de la « solution finale » et en aurait servi dès juillet 1942 les desseins monstrueux et inexpiables. SG / Renaud Meltz, Pierre Laval. Un mystère français, Perrin, 35€

















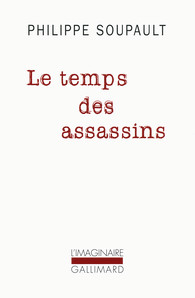





 Parmi les inédits déjà mentionnés, on lira un sonnet d’octobre 14, dont le titre résume à la fois l’esthétique et le paradoxe dont il tire sa beauté. Fusée fait du
Parmi les inédits déjà mentionnés, on lira un sonnet d’octobre 14, dont le titre résume à la fois l’esthétique et le paradoxe dont il tire sa beauté. Fusée fait du  En novembre 1913, la classe de Drieu est appelée pour un service militaire de trois ans. Le jeune incorporé est aussi un humilié précoce. L’échec aux examens de Sciences Po a été plus que cuisant et la blessure d’amour-propre s’aggrave de l’amère déception des siens. Il s’en ouvre dans ses lettres à sa fiancée, Colette Jéramec, une jeune fille intelligente. Sa future épouse se destine à la médecine et incarne l’ambition de la grande bourgeoisie juive, intégrée et convertie. Pour ne pas s’éloigner d’elle, de son frère André et du Paris qu’ils aiment tous les trois, Drieu renonce aux cuirassiers pour l’infanterie. La déclaration de guerre le trouve, en cet été étouffant, à la caserne de la Pépinière. Le 6 août 1914, accompagné d’André Jéramec, il part pour le front avec le grade de caporal. Le 23, c’est «la bataille de Charleroi» où Drieu dit avoir connu l’expérience la plus forte de son existence en sortant de soi. Une sorte d’éjaculation, dira-t-il plus tard avec quelque emphase: «Comme j’avais été brave et lâche ce jour-là, copain et lâcheur, dans et hors le sens commun, le sort commun.» Les pertes avaient été lourdes. André, dont il dira le courage et le patriotisme en 1934, fait partie des disparus. Drieu lui-même, blessé à la tête par un shrapnel, est évacué vers Deauville. Nommé sergent le 16 octobre 1914, il rejoignait son régiment le 20 en Champagne. Blessé au bras le 28 octobre, Drieu rejoint l’hôpital militaire de Toulouse pour trois mois. Au printemps 1915, il est volontaire pour la campagne des Dardanelles. Ce grand ratage le renvoie à ses pires obsessions, la maladie, la déchéance, la syphilis, la mort. Il a senti «l’Homme» mourir en lui, l’appel séduisant de l’abject… Lors de sa longue convalescence à Toulon, une infirmière à bec-de-lièvre, aussi pure qu’il se sent souillé, lui prête les Cinq grandes odes de Claudel. Choc durable… Colette, toujours elle, le fait rentrer à Paris avant la fin de l’année. Ce temps gagné sur la guerre, on l’a vu, il le consacre à l’écriture d’Interrogation. En janvier 1916, il intègre le 146e RI. Quand la bataille de Verdun éclate, son régiment est aux premières lignes. Le 26 février, toujours sergent, Drieu s’élance au milieu des bombes avec le sentiment de n’être plus qu’un petit tas de viande jeté «dans le néant». Sous la mitraille, lui et ses hommes rebroussent chemin. Un obus, en soirée, le terrasse, le blessant au bras gauche et lui crevant un tympan. On le renvoie à l’hôpital, avant les services auxiliaires. Gilles laissera entendre que Drieu décida de tourner la page et d’exploiter l’infirmité légère de son bras. Relations, accommodements, le voilà nommé auprès de l’État major, hôtel des Invalides! Parmi les amis de Colette surgit alors le jeune
En novembre 1913, la classe de Drieu est appelée pour un service militaire de trois ans. Le jeune incorporé est aussi un humilié précoce. L’échec aux examens de Sciences Po a été plus que cuisant et la blessure d’amour-propre s’aggrave de l’amère déception des siens. Il s’en ouvre dans ses lettres à sa fiancée, Colette Jéramec, une jeune fille intelligente. Sa future épouse se destine à la médecine et incarne l’ambition de la grande bourgeoisie juive, intégrée et convertie. Pour ne pas s’éloigner d’elle, de son frère André et du Paris qu’ils aiment tous les trois, Drieu renonce aux cuirassiers pour l’infanterie. La déclaration de guerre le trouve, en cet été étouffant, à la caserne de la Pépinière. Le 6 août 1914, accompagné d’André Jéramec, il part pour le front avec le grade de caporal. Le 23, c’est «la bataille de Charleroi» où Drieu dit avoir connu l’expérience la plus forte de son existence en sortant de soi. Une sorte d’éjaculation, dira-t-il plus tard avec quelque emphase: «Comme j’avais été brave et lâche ce jour-là, copain et lâcheur, dans et hors le sens commun, le sort commun.» Les pertes avaient été lourdes. André, dont il dira le courage et le patriotisme en 1934, fait partie des disparus. Drieu lui-même, blessé à la tête par un shrapnel, est évacué vers Deauville. Nommé sergent le 16 octobre 1914, il rejoignait son régiment le 20 en Champagne. Blessé au bras le 28 octobre, Drieu rejoint l’hôpital militaire de Toulouse pour trois mois. Au printemps 1915, il est volontaire pour la campagne des Dardanelles. Ce grand ratage le renvoie à ses pires obsessions, la maladie, la déchéance, la syphilis, la mort. Il a senti «l’Homme» mourir en lui, l’appel séduisant de l’abject… Lors de sa longue convalescence à Toulon, une infirmière à bec-de-lièvre, aussi pure qu’il se sent souillé, lui prête les Cinq grandes odes de Claudel. Choc durable… Colette, toujours elle, le fait rentrer à Paris avant la fin de l’année. Ce temps gagné sur la guerre, on l’a vu, il le consacre à l’écriture d’Interrogation. En janvier 1916, il intègre le 146e RI. Quand la bataille de Verdun éclate, son régiment est aux premières lignes. Le 26 février, toujours sergent, Drieu s’élance au milieu des bombes avec le sentiment de n’être plus qu’un petit tas de viande jeté «dans le néant». Sous la mitraille, lui et ses hommes rebroussent chemin. Un obus, en soirée, le terrasse, le blessant au bras gauche et lui crevant un tympan. On le renvoie à l’hôpital, avant les services auxiliaires. Gilles laissera entendre que Drieu décida de tourner la page et d’exploiter l’infirmité légère de son bras. Relations, accommodements, le voilà nommé auprès de l’État major, hôtel des Invalides! Parmi les amis de Colette surgit alors le jeune  Un an plus tard, Interrogation reçoit un accueil très favorable. Les comptes rendus s’égrènent au cours de l’année suivante à propos de ce «petit livre, dur, mystique, tout flamboyant, tout fumant encore de la bataille», qui rappelle à la fois Claudel, Whitman et Lamennais à Fernand Vandérem. Le grand Apollinaire lui concède aussi quelques lignes très positives. La recension la plus enflammée revient à Hyacinthe Philouze, sensible à «l’âme tout entière de la génération qui, au sortir de la tranchée, va façonner le monde nouveau!» Quant à la réaction de Paul Adam, c’est la reconnaissance du vieux professeur d’énergie, heureux de saluer en Drieu un émule de Rimbaud. En 1934, date anniversaire s’il en est, La Comédie de Charleroi forcera aussi l’admiration des contemporains. Selon
Un an plus tard, Interrogation reçoit un accueil très favorable. Les comptes rendus s’égrènent au cours de l’année suivante à propos de ce «petit livre, dur, mystique, tout flamboyant, tout fumant encore de la bataille», qui rappelle à la fois Claudel, Whitman et Lamennais à Fernand Vandérem. Le grand Apollinaire lui concède aussi quelques lignes très positives. La recension la plus enflammée revient à Hyacinthe Philouze, sensible à «l’âme tout entière de la génération qui, au sortir de la tranchée, va façonner le monde nouveau!» Quant à la réaction de Paul Adam, c’est la reconnaissance du vieux professeur d’énergie, heureux de saluer en Drieu un émule de Rimbaud. En 1934, date anniversaire s’il en est, La Comédie de Charleroi forcera aussi l’admiration des contemporains. Selon  – À lire aussi, Jean-Pierre Guéno et Gérard Lhéritier, Entre les lignes et les tranchées, Musée des lettres et manuscrits, Gallimard, 29€. Guerre poétique, 14-18 fut aussi une guerre épistolaire. Plus de quatre millions de lettres circulent chaque jour en France. L’originalité ici est de confronter la plume des inconnus et la voix de ceux que l’histoire a encensés, de Félix Vallotton et
– À lire aussi, Jean-Pierre Guéno et Gérard Lhéritier, Entre les lignes et les tranchées, Musée des lettres et manuscrits, Gallimard, 29€. Guerre poétique, 14-18 fut aussi une guerre épistolaire. Plus de quatre millions de lettres circulent chaque jour en France. L’originalité ici est de confronter la plume des inconnus et la voix de ceux que l’histoire a encensés, de Félix Vallotton et Qu’on se rassure, Jean Clair se porte bien. Les derniers jours qu’annonce son dernier livre ne sont pas les siens. Mais ils sont ceux du monde, très ancien, qu’il a vu disparaître et de la société, très actuelle, dont il scrute la décomposition avancée. D’un côté, la paysannerie dont il vient ; de l’autre, le cloaque où nous versons. À bien y réfléchir, cela n’a rien de rassurant. Dissipons d’emblée le contresens auquel l’ouvrage pourrait conduire de trop rapides lecteurs : s’il s’émeut, avec le recul de l’homme qui sillonne son enfance, de la fin des terroirs, s’il dénonce l’ersatz de ruralité qu’une Europe exsangue tente de maintenir en vie,
Qu’on se rassure, Jean Clair se porte bien. Les derniers jours qu’annonce son dernier livre ne sont pas les siens. Mais ils sont ceux du monde, très ancien, qu’il a vu disparaître et de la société, très actuelle, dont il scrute la décomposition avancée. D’un côté, la paysannerie dont il vient ; de l’autre, le cloaque où nous versons. À bien y réfléchir, cela n’a rien de rassurant. Dissipons d’emblée le contresens auquel l’ouvrage pourrait conduire de trop rapides lecteurs : s’il s’émeut, avec le recul de l’homme qui sillonne son enfance, de la fin des terroirs, s’il dénonce l’ersatz de ruralité qu’une Europe exsangue tente de maintenir en vie, 
 Lors de l’exposition qu’organisa la Galerie Pierre en 1934, sa célèbre Leçon de guitare confrontait le public au spectacle équivoque d’une initiation violente aux plaisirs de la chair. Ce grand tableau, comme quatre-vingt dix-neuf autres, est commenté dans notre Cent peintures qui font débat (Hazan, 39,90€, en collaboration avec Delphine Storelli).
Lors de l’exposition qu’organisa la Galerie Pierre en 1934, sa célèbre Leçon de guitare confrontait le public au spectacle équivoque d’une initiation violente aux plaisirs de la chair. Ce grand tableau, comme quatre-vingt dix-neuf autres, est commenté dans notre Cent peintures qui font débat (Hazan, 39,90€, en collaboration avec Delphine Storelli). Pour les avoir vécues en «homme libre», Emmanuel Berl a laissé un témoignage inestimable sur les toutes premières heures du régime de
Pour les avoir vécues en «homme libre», Emmanuel Berl a laissé un témoignage inestimable sur les toutes premières heures du régime de  La «révolution nationale», plus maurrassienne que fasciste, se fera sans lui. Pétain, Weygand, comme il le dira à Modiano en 1976, c’était le retour de Mac Mahon. Berl, fidèle à la République, quitta donc Vichy dès que l’Assemblée nationale eut voté sa liquidation. Des élus du Front populaire, hormis une petite centaine de récalcitrants, Pétain recueillit donc les pleins pouvoirs, supérieurs à ceux que Napoléon Ier s’était donnés ! En mai 1968, alors que le mythe du résistancialisme commençait à sérieusement prendre l’eau, Berl publiait un livre superbe sur la funeste journée du 10 juillet, celle qui avait congédié Marianne si brutalement et ouvert le temps de la collaboration. Il ressort aujourd’hui, accompagné d’un remarquable dossier réuni par
La «révolution nationale», plus maurrassienne que fasciste, se fera sans lui. Pétain, Weygand, comme il le dira à Modiano en 1976, c’était le retour de Mac Mahon. Berl, fidèle à la République, quitta donc Vichy dès que l’Assemblée nationale eut voté sa liquidation. Des élus du Front populaire, hormis une petite centaine de récalcitrants, Pétain recueillit donc les pleins pouvoirs, supérieurs à ceux que Napoléon Ier s’était donnés ! En mai 1968, alors que le mythe du résistancialisme commençait à sérieusement prendre l’eau, Berl publiait un livre superbe sur la funeste journée du 10 juillet, celle qui avait congédié Marianne si brutalement et ouvert le temps de la collaboration. Il ressort aujourd’hui, accompagné d’un remarquable dossier réuni par  En très grande majorité, il s’agissait de ces mêmes «juifs étrangers», qu’une partie des politiques, à gauche comme à droite, avaient commencé à juger «indésirables» dans les années 1930. Sans les oublier, sans oublier la responsabilité de Vichy dans la Shoah, mais sans confondre la «logique d’exclusion» des Français avec la «logique d’extermination» des nazis, le nouveau livre de Jacques Semelin s’intéresse à ceux qui survécurent à l’une et à l’autre. Des chiffres, encore : 75% des juifs, vivant alors en France, échappèrent à la mort. En Belgique, aux Pays-Bas, pour ne pas parler de la Pologne, les proportions s’inversent… Jacques Semelin ne bouleverse pas seulement son lecteur par son souci des destins individuels et sa façon de traduire en mot simples la puissance de vie des persécutés, cette somme exemplaire examine et détruit bien des idées reçues sur la politique ségrégationniste de Vichy, l’existence quotidienne des juifs et le comportement du reste de la population à leur égard. Au sujet de la première, il y a lieu en effet de parler de «schizophrénie administrative». D’un côté, discrimination, spoliation, arrestation et livraison aux Allemands ; de l’autre, mesures de protection, allocations sociales et soutiens aux organisations juives. Dans cette apparente incohérence, la nationalité française reste le facteur décisif. Les deux statuts relatifs aux juifs, visant à réduire leur «influence» en France, ne vont pas sans exemptions, statuts spéciaux, arrangements, mesures dérogatoires, voire hautes protections, comme celle dont a pu jouir Gertrude Stein, l’ami de Bernard Faÿ.
En très grande majorité, il s’agissait de ces mêmes «juifs étrangers», qu’une partie des politiques, à gauche comme à droite, avaient commencé à juger «indésirables» dans les années 1930. Sans les oublier, sans oublier la responsabilité de Vichy dans la Shoah, mais sans confondre la «logique d’exclusion» des Français avec la «logique d’extermination» des nazis, le nouveau livre de Jacques Semelin s’intéresse à ceux qui survécurent à l’une et à l’autre. Des chiffres, encore : 75% des juifs, vivant alors en France, échappèrent à la mort. En Belgique, aux Pays-Bas, pour ne pas parler de la Pologne, les proportions s’inversent… Jacques Semelin ne bouleverse pas seulement son lecteur par son souci des destins individuels et sa façon de traduire en mot simples la puissance de vie des persécutés, cette somme exemplaire examine et détruit bien des idées reçues sur la politique ségrégationniste de Vichy, l’existence quotidienne des juifs et le comportement du reste de la population à leur égard. Au sujet de la première, il y a lieu en effet de parler de «schizophrénie administrative». D’un côté, discrimination, spoliation, arrestation et livraison aux Allemands ; de l’autre, mesures de protection, allocations sociales et soutiens aux organisations juives. Dans cette apparente incohérence, la nationalité française reste le facteur décisif. Les deux statuts relatifs aux juifs, visant à réduire leur «influence» en France, ne vont pas sans exemptions, statuts spéciaux, arrangements, mesures dérogatoires, voire hautes protections, comme celle dont a pu jouir Gertrude Stein, l’ami de Bernard Faÿ.