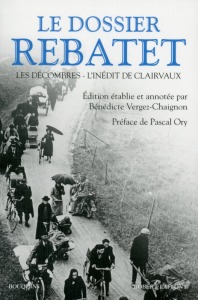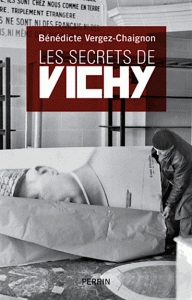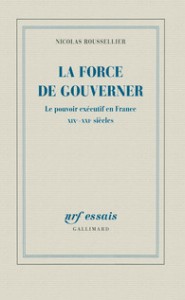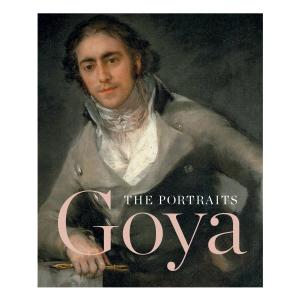Les chiens aboient, hurlent même, la science picassienne progresse et le musée de Barcelone y contribue vigoureusement. Au souvenir de Lola Ruiz Picasso (1884-1958), sœur cadette de Pablo, sont attachés quelques-uns de ses portraits les plus émouvants, ou les plus troublants lorsque, devenue une belle Andalouse de seize ans, son frère devine et saisit la femme, son magnétisme, derrière l’adolescente. Sabartés a confirmé le charme fou de Lola, de même que son tempérament de feu, qui la fera baptiser terremotica, le petit tremblement de terre, au regard des secousses que subit Malaga de temps à autre, et de celles qu’elle provoque autour d’elle. La mort tragique de leur sœur Conchita, où John Richardson nous a appris à lire le drame originel de l’artiste, avait posé sur l’enfance des deux survivants la griffe de la mort, et donc de son rejet. Mais l’exposition que le Museu Picasso vient de consacrer à Lola (1), en écho au cinquantenaire de la donation des œuvres de jeunesse de l’artiste – donation faite à la ville de Barcelone et non à l’Espagne de Franco -, éclaire un peu plus et le manque d’assiduité de Pablo aux impératifs familiaux (mariage de sa sœur, mort de leur mère, etc.) et la forte empreinte catholique de son milieu d’origine. Les photographies qui documentent les appartements où vécurent Lola et les siens ne trompent pas. Au milieu des œuvres du frère prodige et vite prodigue, la présence du Christ, sous l’espèce notamment d’ivoires baroques, en est le signe majeur. Le catalogue très utile de Malén Gual nous apprend enfin que la toute jeune Lola, entre 1888 et 1891, c’est-à-dire le départ de la tribu pour La Corogne où elle apprendra à peindre comme Pablo, fut confiée à l’école des Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux. Cette congrégation religieuse, fondée par Pierre-Bienvenu Noailles (1793-1861), a vu le jour sur les rives de la Garonne en 1820 et essaimé rapidement à travers l’Europe. En Espagne, elle croisa le destin des Picasso. On comprend que Pablo ait choisi de représenter sa sœur dans le chef-d’œuvre de ses 15 ans : en 1896, il signe sa Première communion, grave et sensuelle au-delà du naturalisme d’époque, qui rejoindra aussi le musée de Barcelone en 1970. «Esprit religieux sans austérité » : c’est ce que conclura Max Jacob, vers 1902, après examen des lignes de main de Picasso, alors inséparable de lui.

D’autres témoignages aussi sûrs, du sculpteur Fenosa à Marie-Thérèse Walter et Jacqueline Roque, laissent peu de doute quant à la profonde catholicité de Picasso, que toute une histoire de l’art a niée ou continue d’ignorer. Elle fait l’objet, à l’inverse, du chapitre le plus saisissant d’un livre roboratif, qui nous fait enfin entrer dans l’autre intimité de l’artiste, superstitions et croyances, rituels domestiques et prophylaxies, manies et magies. La vertu heuristique des regards croisés, quand l’analyse esthétique et l’anthropologie se rencontrent comme ici, n’est plus à démontrer. Il est palpable, à les lire, que Diana Picasso et Philippe Charlier ont pris plaisir à construire ensemble, au gré de chapitres nets, l’image d’un artiste aux obsessions révélatrices (2). Dieu et la mort n’en fixent que les limites extrêmes, peut-être les deux infinis, puisque Pascal fut très lu au Bateau-Lavoir, selon Apollinaire. Son ami Picasso est le contraire de l’individu moderne, positif et laïc, délié du monde et de l’au-delà. Les choses et la nature ne lui sont pas extérieures, de même que vie et mort définissent le grand balancier de sa création, de la peinture aux arts du feu. Des forces agissent derrière les objets ou déchets, bois, fer ou simple cordelette, que le hasard, dont il doute, sème sur sa route en permanence. Il en va ainsi des femmes et des hommes auxquels il a un besoin viscéral de se mêler, de se confronter ou de se heurter. Rien n’est plus significatif que son goût des assemblages hétéroclites, chez lui, à l’atelier, au sol. Les vitrines que Brassaï a photographiées à la demande de Picasso sont autant les reliquaires de l’homme que le dictionnaire de l’œuvre. Malraux, lui-même assez hanté, nous le fait sentir à maints endroits de La Tête d’obsidienne, livre capital, unique quant à la compréhension de l’animisme particulier de son héros : Picasso, qui s’était renommé, conservait cheveux et ongles, vêtements usés et tickets de corrida, n’aura pas demandé aux arts non occidentaux, à la statuaire africaine et océanienne, un simple supplément d’énergie primitive, mais un supplément d’âme, des corrélations cosmiques, de quoi croire et de quoi vaincre le néant.

Une étrange boule chamarrée, chef-d’œuvre de la production céramique de Vallauris, occupe, presque à elle seule, la salle introductive de Picasso. L’effervescence des formes, première exposition que Bordeaux ait dédiée à l’artiste depuis de lustres (3). Les cinq ans de la Cité du Vin se fêtent en rompant un trop long silence. Mais cet anniversaire eût été incomplet si le thème même de l’exposition n’avait pas permis d’approfondir ce que nous savions du rapport de l’artiste aux alcools, pour user du terme global qu’en 1913 Apollinaire associait à leur poétique commune. Le vin et tant de boissons, de la Suze au rhum, du porto au cher Anis del Mono, traversent la carrière de Picasso, comme autant de symboles de cette analogie, de cette ébriété subtile du visible et du verbe. La boule de 1948 et ses trois lettres bien lisibles le disent aussi, mais de manière à en souligner la portée cosmique. Entre fermentation et distillation, profane et sacré, le moderne, celui de Picasso et Apollinaire, touche au processus qu’il intègre à son vocabulaire. Poésie et peinture, sculpture et céramique sont désormais vouées à concentrer, en les illimitant, sensations physiques et associations imaginaires de toutes natures. L’univers des cafés, artistes ou populaires, à Barcelone et Paris, ouvre d’emblée la problématique à sa composante existentielle, sociale, politique : Picasso a l’ivresse partageuse et se nourrit dès avant 1900 des signes qu’émettent les lieux de boissons, verres, bouteilles, étiquettes, dés à jouer et journaux ou le présent vibre et se périme. Pendant près de trois ans, les tableaux bleus dramatisent les plaisirs ambigus de la boisson et de la prostitution. La tentation du verre de trop y prend alternativement le visage des jouisseurs fin-de-siècle et celui des douleurs différées. Le moment cubiste de l’œuvre fait triompher le verre et la bouteille parmi le lexique de ses objets les plus sollicités, car les plus aptes aux métamorphoses de forme, de sens et de matière auxquelles Picasso soumet son univers et son public. Le vin ne quittera plus l’œuvre. L’œcuménique Picasso exalte le breuvage du peuple et celui des dieux à égalité ! En 1933, année noire, ses Minotaures plébéiens brandissent aussi bien le glaive de Thésée que le verre de Bacchus. On observe alors une faveur accrue des figures mythologiques liées aux mystères sacrés et aux jouissances terrestres. A dire vrai, elles ont toujours été aussi présentes que le Christ. Ce qui l’aura constamment rapproché du miracle de la vigne ne pouvait que se nourrir, en profondeur, des résonances eucharistiques de la divine boisson, que l’artiste n’oublie pas de faire rayonner en émule avoué des frères Le Nain. Pour la première fois, une exposition se propose d’orchestrer l’ensemble des aspects et des valeurs que l’attachement picassien au vin a pris dans son œuvre et sa vie.

La mort de John Richardson, en 2019, avait plongé dans la plus profonde tristesse ceux qui eurent le privilège de connaitre ce concentré de vie, de charme, de malice et d’intelligence. Nous le savions cramponné à l’écriture du tome IV de sa biographie et inquiet de ne plus être, un jour, en force de l’achever. Qui a vu Richardson à sa table de travail, surmontant fatigue et vue écornée, sait ce que la discipline intérieure, aux portes de la mort, peut avoir d’admirable. Durant les ultimes semaines d’une existence qui refusa toute réclusion morose jusqu’au bout, son acharnement ne fléchit pas, de sorte que le livre que nous avons entre les mains, aujourd’hui, porte la marque de son auteur, style et esprit. Et ce n’est pas diminuer l’apport de Delphine Huisinga et de Ross Finocchio que de l’écrire. Sans eux, car ils furent bien plus que de simples assistants, nous serions privés des réflexions de Richardson sur l’une des périodes les plus clivantes du parcours picassien. Avec son sens inné de la synthèse, le meilleur biographe de l’artiste parle des Minotaure Years au sujet des années 1933-1943. La figure mi-animale, mi- humaine, surgie en 1928, attendait l’heure de sa pleine signification historique, poétique et intime. Grande et petite histoires peuvent désormais investir le mythe crétois, du labyrinthe orgiaque à la victoire de Thésée, de ce qui assombrit et électrise l’époque, comme des terreurs et désirs qui déchirent la vie amoureuse et familiale de Picasso. A se recharger ainsi, l’ambiguïté première du Minotaure n’est guère trahie, pas plus que la violence dont il est la fois le sujet et l’objet. Richardson connaissait bien les dangers de la lecture littérale, qui passe de l’œuvre à la vie, ou inversement, dans l’oubli de ce qui les sépare au-delà des interférences inévitables. La composante biographique de l’art picassien demande à être interprétée en fonction de l’imaginaire qui règle le rapport de Picasso au temps présent, affecte les turbulences de sa vie personnelle, travaille ses obsessions et fantasmes les plus ancrés. Donner aux ébats l’apparence du viol ne fait pas nécessairement de vous le parangon des violences domestiques et le sexiste barbare que les réseaux aiment à dénoncer en lui. Du reste, Richardson ne montra jamais le moindre angélisme au sujet de cet homme qu’il avait bien connu et dont il avait pu mesurer la part de cruauté, de narcissisme, de bluff comme d’altruisme ou de tendresse. De même, malgré sa ferme implication antifasciste, qui se traduisit en images et en dons d’argent, Picasso n’hésitera jamais à approcher des hommes et des femmes de l’autre camp. Ses fréquentations sous la botte, voire ses publications et achats, déjouent nos critères trop manichéens ou trop innocents. Ce tome IV, en nous les rendant si proches, fait défiler Olga et Paulo, Marie-Thérèse et Dora, Cocteau et les Eluard, Man Ray et Adrienne Fidelin, Vollard et Fabiani, Max Jacob et les fantômes de Conchita ou d’Apollinaire. Revit surtout un temps d’apocalypse qui nous vaut tant de portraits torturés et de natures mortes en manière d’ex-voto. Picasso disait vouloir dégager du spectacle de l’ordinaire de haute significations, parler comme le Christ, par paraboles.

Comme il existe un roman arthurien, où le Graal concentre la seule vérité, il existe un roman waltérien, brodé lui autour d’une absence, ou plutôt d’une absente. C’est la thèse de Laurence Madeline, experte du domaine picassien, et très réfractaire à la manière dont s’est constituée, voire perpétuée, l’image publique de Marie-Thérèse Walter (1909-1977) depuis plus d’un demi-siècle. La modélisation commence très tôt et se dispense longtemps du témoignage de l’intéressée, faute de quoi les premiers biographes de Picasso se montrent plus soucieux d’exalter les ardeurs de « l’amour fou », partagé avec un homme qui avait plus du double de son âge, que d’interroger l’amoureuse et les traces réelles de leur passion : prompt embrasement, liaison cachée, affection durable mais distance à partir de la Libération. Marie-Thérèse aborde la soixantaine quand Life la questionne enfin. De l’entretien de l’hiver 1968 qui dut être moins expéditif, la revue américaine, si friande en « gossips » quand il s’agit de l’une de ses stars préférées, retient des bribes, convenues et suggestives : « J’avais dix-sept ans et j’étais une gamine innocente. […] Picasso m’a attrapée par le bras et m’a dit » Je suis Picasso et nous allons faire de grandes choses ensemble » […] Nous faisions ce que les couples d’amoureux font, vous voyez ce que je veux dire. » Le canevas initial du mythe n’a guère besoin de plus, d’autant que le livre de Françoise Gilot a déjà fuselé la silhouette d’une adolescente sculpturale, peu regardante, mais très regardée, incarnation d’une vitalité sexuée, et bientôt maternelle, que l’œuvre allait traduire d’abondance, alternant le frénétique et la tendresse, l’éveil et le sommeil des sens, mais aussi l’actif et l’onirique. En dépit de cette iconographie contraire au simplisme de la « love affair » convertie en stimulant plastique et érotique, Marie-Thérèse, vue par Pierre Cabanne ou par Lydia Gasman, se voit réduite à jouer les Lolita dans les bras de Barbe-bleue, la « perversité » de ce dernier variant de force et de nature selon la rive de l’Atlantique d’où l’on parle… S’en trouve renforcée aussi l’habitude puérile de réduire les tableaux et les sculptures du Pygmalion moderne à la seule transcription de ses adultérines romances. Madeline multiplie les correctifs en matière de lectures brutales et d’identifications infondées : de même que Marie-Thérèse est reconnue sous chaque nu scabreux, Olga, la rivale, reste aujourd’hui très souvent condamnée à figurer la routine bourgeoise ou l’hystérie agressive. Ce récit binaire et banal, John Richardson, Diana et Olivier Picasso, Bernard Picasso, s’y sont heureusement attaqués, et ont contribué à nous en libérer. L’ambition déconstructive de Madeline fait souffrir la doxa elle aussi, elle fait surtout émerger maints documents oubliés, qui éclairent les origines familiales, le caractère volontaire de Marie-Thérèse, ses convictions religieuses, très peu mentionnées et glosées jusque-là, comme ses déceptions matrimoniales. Le dialogue de l’auteure avec son propre féminisme, retenu ici, moins là, n’est pas le moindre intérêt de son enquête.

Chose à peine croyable, la critique d’art de Jean Cocteau manquait à la librairie française. Encore le volume qui comble cette terrible lacune, 400 pages illustrées, ne procure-t-il qu’une sélection du corpus, large et annoté, il est vrai (5). David Gallentops en donne la raison : certains textes écartés répètent ceux qui ont été retenus ou sont de moindre valeur. La pression des circonstances ou les devoirs de l’amitié ont parfois pesé un peu sur l’observateur incontournable du moment moderne que fut Cocteau entre la guerre de 1914 et le début des années 1960. On se serait mieux rendu compte de cette réalité si le volume eût suivi, non l’ordre alphabétique, mais l’ordre chronologique, c’est-à-dire celui de la vie et de ses surprises. À cet égard, Gullentops aurait pu étoffer son introduction d’un survol du monde de l’art et de sa géographie mouvante où Cocteau tint un rôle plus qu’éminent. La biographie, non citée, de Claude Arnaud (Gallimard, 2003) l’avait saisi à la croisée de plusieurs cercles et de plusieurs esthétiques, qu’il ne croyait pas trahir en cheminant sans exclusive. Bérard et Coco Chanel, en somme, font bon ménage avec Braque, Derain et, évidement, Picasso. De lui, qui règne, Cocteau éloigne ceux qu’il nomme les Aristote du cubisme, peignant à l’abri de règles, ceux qui confondent discipline et crainte, tradition et conformisme de forme ou de sens. Picasso, peintre poète, se garde bien de faire de la peinture littéraire, il déforme et reconstruit sans rien perdre de la force objective de son motif. En outre, en peinture, il faut parler, dit-il à Cocteau, dégager de l’ordinaire tout ce qu’il peut suggérer d’essentiel. Qu’une bougie fichée sur une bouteille de vin, ou une ampoule criante de lumière, troue la nuit des hommes ou de l’Histoire d’une ardeur réconfortante, il n’en faut pas davantage. Même quand Cocteau parle des autres, ainsi du Greco en 1943, sa plume cabriolante reste aimantée à Picasso, peintre des deux infinis, lame de Tolède. Il faut croire que l’ode à Breker, un an plus tôt, ne l’avait pas brouillé avec Don Pablo, qui connaissait aussi la servitude des circonstances.

En 1943 et 1944, obéissant une fois encore aux devoirs de l’amitié, André Salmon saluait lui le génie d’Apollinaire, qu’il avait connu dès 1903 et avec lequel, si l’on y ajoute Picasso et Max Jacob, il forma la vraie bande du bateau-lavoir, perché dans ses planches branlantes au sommet de Montmartre. Atelier de peinture et de poésie, l’une rivalisant avec l’autre fraternellement, l’étrange vaisseau du 13 de la rue Ravignan en vit et en entendit de belles. Avec le livre de Fernande Olivier (Stock, 1933), dont Picasso a reconnu la valeur unique après avoir tenté d’interdire sa publication, Salmon et Apollinaire enregistrèrent l’ardeur de ces années où l’on pouvait boire « jusqu’à l’aurore », mêler « des vers purs à des chants obscènes », ou glorifier la jeune peinture comme on célèbre les apéritifs. Des verres au verbe, du verbe à l’image, vin et alcools coulent et enflamment la ferveur lyrique du quatuor. Le cubisme pictural et poétique, pour user d’un mot trop sec, perd une bonne partie de sa saveur et de son identité à oublier les « mondes élargis de nos sages ivresses ». La correspondance de Salmon et Apollinaire, longtemps attendue, nous ramène là où la vie des formes tire sa source. Nous la devons à Jacqueline Gojard, éditrice en 2009 des lettres qu’échangèrent Max Jacob et ce même Salmon, le moins favorisé par l’historiographie récente. Or, ce volume confirme doublement notre erreur, car à son versant épistolaire s’ajoutent les nombreux et si vivants hommages que Salmon rédigea en mémoire du père d’Alcools, dès le 11 novembre 1918. De la première partie, on retiendra la brièveté des missives, l’espèce de code qu’ils partagent et dont l’annotation devient indispensable pour le lecteur d’aujourd’hui. Ils pourront tout se dire, sous l’apparence du contraire, durant la guerre de 14 où ils s’engagent d’un même pas. Au front, les lettres s’allongent, puisque le feu à rendu impossibles les rencontres. À partir de 1916, les deux amis, qu’un peu de compétition mutuelle a toujours stimulés, contribuent au réveil du monde de l’art, le premier en exposant Les Demoiselles d’Avignon, le second en épaulant Derain et Paul Guillaume. Quant aux exercices d’admiration posthumes de Salmon, ils varient selon les supports : la NRF, en 1920, ce n’est pas Je suis partout, en 1943, ou Révolution nationale, la revue de Lucien Combelle cher à Drieu, Assouline et Gibault, en 1944. À l’heure où Picasso rêvait sur le visage de Mallarmé, Salmon redessinait inlassablement la figure de Guillaume, bien faite pour symboliser, face aux fridolins, l’âme indestructible du génie français. Stéphane Guégan
(1)Emmanuel Guigon, Malén Gual, Mariona Tió, Xavier Vilató, cat. expo. Lola Ruiz Picasso, édition bilingue, Fundació Museu Picasso de Barcelona, 20€ / (2) Diana Widmaier Riuz Picasso et Philippe Charlier, Picasso sorcier, Gallimard, Hors-Série Connaissance, 22€ / (3) Picasso. L’effervescence des formes, Bordeaux, Cité du Vin, jusqu’au 28 août 2022 (avec la participation exceptionnelle du musée national Picasso-Paris et du Museu Picasso de Barcelone) / (4) John Richardson (avec la collaboration de Ross Finocchio et de Delphine Huisingua), A life of Picasso. The Minotaure years 1933-1943, New York, Afred A. Knopf, 2021, 45€ / (5) Laurence Madeline, Marie-Thérèse Walter & Pablo Picasso. Biographie d’une relation, préface de Philippe Dagen, Nouvelles éditions Scala, 22€. Un autre ouvrage, d’après sa 4e de couverture, tente de « raconter Marie-Thérèse » et « d’éclairer la relation de Picasso avec les femmes ». Écrit dans un style volontiers journalistique (« Cette fille le rend dingue »), peu soucieux de l’hétérogénéité de ses sources (le témoignage tardif de Tzara n’est guère fiable), le livre de Brigitte Benkemoun (Sa vie pour Picasso. Marie-Thérèse Walter, Stock, 20,50€) s’intéresse presque autant aux sœurs de la mère de Maya, infantilise un peu cette dernière et entre souvent mal dans le jeu amoureux des années intenses (1927-1935) où, pour citer un confrère très inspiré, Pablo se serait conduit en cannibale déstabilisant. On regrette à le dire ainsi, car l’auteure se tient à distance des excès de la diabolisation actuelle et semble, tout d’abord, ne pas vouloir traiter Picasso en macho invétéré, thèse qui exige que Marie-Thérèse, sexuellement majeure à 13 ans, en ait été la victime sous emprise. Et, oui, par « violer », elle entendait « rapports violents » – je dirais plutôt « vigoureux », pour éviter toute équivoque. / (6) Jean Cocteau, Ecrits sur l’art, édition de David Gullentops, Gallimard, 26€ / (7) Guillaume Apollinaire et André Salmon, Correspondance 1903-1918 et Florilège 1918-1959, édition préfacée et annotée par Jacqueline Gojard, 39€, éditions Claire Paulhan.
PICASSO PEINTRE BALZACIEN

Il semble que ce soit bien Dora Maar qui ait conduit Picasso a louer, en 1937, le 7 rue des Grands Augustins afin d’y peindre son chef-d’œuvre inconnu. Dans sa perfection inaccessible aux béotiens, son apparent chaos d’où émergent quelques éclats de féminité douloureuse, Guernica ne fut guère mieux compris que la Belle noiseuse de Frenhofer. Bien que le nouvel atelier ait plutôt abrité Pourbus et ses tableaux lisses dans le récit balzacien, Picasso préférait se penser, comme il l’avoue à Brassaï, en avatar du génie incompris. Un siècle après la publication du Chef d’œuvre inconnu, il en avait donné sa version gravée, que Vollard destinait aux happy few. Assurément, d’autres affinités expliquent l’attirance du peintre pour l’écrivain, et leurs multiples traces. Le Cousin Pons, tel qu’Adrien Goetz propose de le lire, l’œil rivé sur le collectionnisme des années 1840 et la clôture nécessaire à la religion privée du beau, aurait pu ou dû inspirer à Picasso une suite d’illustrations. Elles eussent accusé toutes sortes de cousinages : Picasso partage la bricomanie de Balzac et de Sylvain Pons, Prix de Rome de musique au destin avorté, et que le bel art des autres console de ne pas en être l’élu. C’est aussi la façon de procéder du chineur, en accord avec la théorie balzacienne du magnétisme involontaire, Goetz y insiste, qui suscite la comparaison avec Picasso et sa conception, non de l’objet trouvé, mais de l’objet qui vous trouve. « Moi, proclame Pons, je crois à l’intelligence des objets d’art, ils connaissent les amateurs, ils les appellent, ils leur font : Chit! chit!… » Sans ce mystère de la rencontre imprévisible, et largement inexplicable, l’amour de l’art ne pourrait pas prétendre égaler d’autres voluptés ou les remplacer, il ne pourrait pas davantage toucher au sublime des cultes de substitution. Le juif Magus, marchand insatiable, passe souvent pour l’antithèse du collectionneur désintéressé dont il pénétrera le trésor avec la complicité de l’ignoble Mme Cibot. Mais la thèse de l’antisémitisme est un piège dans lequel ne tombe pas Goetz. Au contraire, en dépit de leur rivalité à posséder la crème des anciens maîtres, Pons et Magus sont frères par la folle passion des chefs-d’œuvre qui les réunit. Le goût de la monarchie de Juillet, et cette préface en relève la richesse comme Baudelaire le fait en 1845, élargie précisément les contours du panthéon pictural en y ramenant aussi bien la peinture des Le Nain que celle de Watteau, ainsi que le rappelle aussi l’exposition actuelle de la Cité du Vin. SG / Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, préface d’Adrien Goetz, annotation d’Isabelle Mimouni, post-face d’André Lorant, répertoire biographique des artistes par Rachel Boucobza, Gallimard, Folio classique, 8,70€.

A lire dans le numéro d’avril 2022 de la Revue des deux mondes : « Trois excentriques de haute époque » (autrement dit, Saint-Simon, Montalembert, Chateaubriand) et ma recension de l’indispensable volume où Christophe Carrère a réuni la Correspondance (1876-1900) d’Albert Samain (Classiques Garnier, 2021, 95€), grand poète et grand contributeur de la Revue des deux mondes, dont la réévaluation progresse. Voir enfin mon Entre Ruskin et Marx : Morris le magnifique dans le numéro inaugural de la revue Geste/s.