C’est le titre baudelairien que Marc Fumaroli a donné à son bel essai sur Vigée Le Brun, où l’éloge du féminin récuse tout anachronisme féministe. Des femmes, de la fièvre qu’elles embrasent et embrassent, il est question dans Fragonard amoureux. Un bonbon, disent les uns. Un bijou, disent les autres. L’exposition du Luxembourg est surtout un chef-d’œuvre. « Vouloir fuir l’Amour, c’est une entreprise inutile », pensaient les Anciens. Sagesse confirmée.
 Les frères Goncourt, ces réveilleurs du rococo à la suite de Gautier et Baudelaire, voyaient en Frago le « Chérubin de la peinture érotique ». Volage ne pouvait être que l’homme auquel on doit tant d’images lascives, plus suggestives pourtant que littérales… Volage et donc plus soucieux d’inspirer le désir sexuel que d’en explorer les variantes, les jeux, les limites et la troublante impureté, aux confins du plaisir et du sentiment, du corps et du cœur. Volage et donc moins porté sur les romans et les idées de son temps que sur les profits de sa petite entreprise. Nous n’en sommes plus là aujourd’hui. Le premier mérite de l’exposition de Guillaume Faroult, et de son époustouflant catalogue (chose rare, désormais), est de rendre Fragonard à lui-même, de nous le montrer parmi les artistes qui orientèrent ses choix et au plus près d’un milieu d’amateurs, écrivains et intellectuels que le mouvement des Lumières entraîne sans les enfermer dans une morale trop rigoureuse. Le sensualisme du temps les guide plus que l’obsession de durcir les mœurs. Il s’en faut que les amis de « la philosophie » aient tous souhaité la purger des bas instincts du libertinage aristocratique… Comme la Révolution, selon un mot célèbre, le XVIIIème siècle est un bloc, qui chercha longtemps un équilibre possible entre la libération des sens, les valeurs familiales et le ciment social à réinventer. Fragonard fut le peintre de cette heureuse ambiguïté, passant du tendre au scabreux, des caresses au viol, des soupirs aux pâmoisons, et même du libertinage le plus affiché aux bonheurs domestiques les plus innocents, avec un naturel confondant. « Quel homme ! », se dit-on à chaque étape de la merveilleuse démonstration du Luxembourg. Après 1789, David le fera nommer au Louvre. Il résumait donc son époque.
Les frères Goncourt, ces réveilleurs du rococo à la suite de Gautier et Baudelaire, voyaient en Frago le « Chérubin de la peinture érotique ». Volage ne pouvait être que l’homme auquel on doit tant d’images lascives, plus suggestives pourtant que littérales… Volage et donc plus soucieux d’inspirer le désir sexuel que d’en explorer les variantes, les jeux, les limites et la troublante impureté, aux confins du plaisir et du sentiment, du corps et du cœur. Volage et donc moins porté sur les romans et les idées de son temps que sur les profits de sa petite entreprise. Nous n’en sommes plus là aujourd’hui. Le premier mérite de l’exposition de Guillaume Faroult, et de son époustouflant catalogue (chose rare, désormais), est de rendre Fragonard à lui-même, de nous le montrer parmi les artistes qui orientèrent ses choix et au plus près d’un milieu d’amateurs, écrivains et intellectuels que le mouvement des Lumières entraîne sans les enfermer dans une morale trop rigoureuse. Le sensualisme du temps les guide plus que l’obsession de durcir les mœurs. Il s’en faut que les amis de « la philosophie » aient tous souhaité la purger des bas instincts du libertinage aristocratique… Comme la Révolution, selon un mot célèbre, le XVIIIème siècle est un bloc, qui chercha longtemps un équilibre possible entre la libération des sens, les valeurs familiales et le ciment social à réinventer. Fragonard fut le peintre de cette heureuse ambiguïté, passant du tendre au scabreux, des caresses au viol, des soupirs aux pâmoisons, et même du libertinage le plus affiché aux bonheurs domestiques les plus innocents, avec un naturel confondant. « Quel homme ! », se dit-on à chaque étape de la merveilleuse démonstration du Luxembourg. Après 1789, David le fera nommer au Louvre. Il résumait donc son époque.
 Bien qu’elle assiste au triomphe de l’imprimé et que Fragonard ait puisé à l’illustration des livres lestes, cette époque n’est pas que de papier, elle emprunte d’abord ses couleurs et ses ardeurs nouvelles à Watteau, Chardin, Boucher, Coypel et Van Loo. Notre peintre, avant de se frotter à l’Italie et notamment au grand souffle baroque, a vite appris, au point d’étonner ses maîtres et de nous étonner encore. Il est Prix de Rome à 20 ans. A moins de 30, peindre la Psyché de Londres, et son adorable poitrine, n’est pas donné à tous ces jeunes provinciaux (il vient de Grasse l’odorante) en quête d’une position capitale. L’Aurore triomphant de la Nuit (Boston) est à se damner… Avant 1756 et le départ pour Rome, toute une cohorte de bergères, d’allégories bien incarnées, et déjà d’amants en doux colloques, disent le bonheur d’une jeunesse un peu folle. La pâte est crémeuse, le coloris printanier, les seins palpitent, les accessoires parlent sotto voce. La liberté des cœurs faisant loi, l’ombre du saphisme rode ici et là, bien que la possibilité de l’inversion se borne souvent à offrir aux amants un fantasme de plus. Mais l’un des chefs-d’œuvre de cette période, le Céphale et Procris d’Angers souffle le désarroi sur le jardin des délices. Et Le Baiser gagné (Met), peint à Rome, confirme une aptitude à nous confronter à de complexes situations psychologiques.
Bien qu’elle assiste au triomphe de l’imprimé et que Fragonard ait puisé à l’illustration des livres lestes, cette époque n’est pas que de papier, elle emprunte d’abord ses couleurs et ses ardeurs nouvelles à Watteau, Chardin, Boucher, Coypel et Van Loo. Notre peintre, avant de se frotter à l’Italie et notamment au grand souffle baroque, a vite appris, au point d’étonner ses maîtres et de nous étonner encore. Il est Prix de Rome à 20 ans. A moins de 30, peindre la Psyché de Londres, et son adorable poitrine, n’est pas donné à tous ces jeunes provinciaux (il vient de Grasse l’odorante) en quête d’une position capitale. L’Aurore triomphant de la Nuit (Boston) est à se damner… Avant 1756 et le départ pour Rome, toute une cohorte de bergères, d’allégories bien incarnées, et déjà d’amants en doux colloques, disent le bonheur d’une jeunesse un peu folle. La pâte est crémeuse, le coloris printanier, les seins palpitent, les accessoires parlent sotto voce. La liberté des cœurs faisant loi, l’ombre du saphisme rode ici et là, bien que la possibilité de l’inversion se borne souvent à offrir aux amants un fantasme de plus. Mais l’un des chefs-d’œuvre de cette période, le Céphale et Procris d’Angers souffle le désarroi sur le jardin des délices. Et Le Baiser gagné (Met), peint à Rome, confirme une aptitude à nous confronter à de complexes situations psychologiques.
 La fadeur des béatitudes de convention ne l’a jamais effleuré, comme l’atteste l’œuvre du « retour », qu’il s’agisse de La Gimblette absente (la gravure de Charles Bertony n’aurait pas été de trop), du Lever Resnick très Picabia ou de la Chemise enlevée (qui nous rappelle qu’Olympia, si tributaire de Titien, doit sa literie blanche et froissée à Frago). Un artiste très oublié aujourd’hui, et dont Faroult restaure l’ascendant, pèse alors sur les destinées du genre érotique : Pierre-Antoine Baudouin, gendre de Boucher depuis 1758, s’empare de la scène au cours des années 1760 et fréquente Fragonard (leurs collections témoignent d’échanges peu glosés jusque-là). L’ère des gazes a cessé, Baudouin peint la chose. Giulio Romano et Agostino Carracci sont ses pères. Frago suit le mouvement et se fait moins allusif. L’Escarpolette de la Wallace collection et les panneaux de Louveciennes, deux sommets inamovibles du génie français, frondent moins le rousseauisme ambiant qu’ils n’annoncent la secrète gravité des Liaisons dangereuses. Plus bouleversant encore, Le Verrou se referme à la fois sur le boudoir des ébats brusqués et la pomme de l’interdit jamais levé. L’érotisme, lorsqu’il se libère de la faute, s’expose au facile voyeurisme. Et Fragonard, le sachant, ne réduit jamais la femme à un simple objet de consommation expéditive, au rebours de ce que peuvent en dire les tenantes du nouveau féminisme. Chacune de ses grandes inventions oblige le spectateur à s’exposer à la vérité de ses fantasmes et à quitter la position dominante qu’assigne le roman libertin à son lecteur. Fragonard était donc armé pour affronter le tournant « grec » des années 1770-80 (on vient, scoop, de retrouver son anthologie de la poésie amoureuse de l’antiquité, avec un « envoi » de Massard, le graveur de Greuze). Le Vœu à l’amour, La Fontaine d’amour et Le Sacrifice de la rose font le voyage de Corinthe dans une sorte de nuit rembranesque très électrique. A la veille de la Révolution, Fragonard n’accuse ni retard, ni regret.
La fadeur des béatitudes de convention ne l’a jamais effleuré, comme l’atteste l’œuvre du « retour », qu’il s’agisse de La Gimblette absente (la gravure de Charles Bertony n’aurait pas été de trop), du Lever Resnick très Picabia ou de la Chemise enlevée (qui nous rappelle qu’Olympia, si tributaire de Titien, doit sa literie blanche et froissée à Frago). Un artiste très oublié aujourd’hui, et dont Faroult restaure l’ascendant, pèse alors sur les destinées du genre érotique : Pierre-Antoine Baudouin, gendre de Boucher depuis 1758, s’empare de la scène au cours des années 1760 et fréquente Fragonard (leurs collections témoignent d’échanges peu glosés jusque-là). L’ère des gazes a cessé, Baudouin peint la chose. Giulio Romano et Agostino Carracci sont ses pères. Frago suit le mouvement et se fait moins allusif. L’Escarpolette de la Wallace collection et les panneaux de Louveciennes, deux sommets inamovibles du génie français, frondent moins le rousseauisme ambiant qu’ils n’annoncent la secrète gravité des Liaisons dangereuses. Plus bouleversant encore, Le Verrou se referme à la fois sur le boudoir des ébats brusqués et la pomme de l’interdit jamais levé. L’érotisme, lorsqu’il se libère de la faute, s’expose au facile voyeurisme. Et Fragonard, le sachant, ne réduit jamais la femme à un simple objet de consommation expéditive, au rebours de ce que peuvent en dire les tenantes du nouveau féminisme. Chacune de ses grandes inventions oblige le spectateur à s’exposer à la vérité de ses fantasmes et à quitter la position dominante qu’assigne le roman libertin à son lecteur. Fragonard était donc armé pour affronter le tournant « grec » des années 1770-80 (on vient, scoop, de retrouver son anthologie de la poésie amoureuse de l’antiquité, avec un « envoi » de Massard, le graveur de Greuze). Le Vœu à l’amour, La Fontaine d’amour et Le Sacrifice de la rose font le voyage de Corinthe dans une sorte de nuit rembranesque très électrique. A la veille de la Révolution, Fragonard n’accuse ni retard, ni regret.
Stéphane Guégan
*Fragonard amoureux. Galant et libertin, Musée du Luxembourg, jusqu’au 24 janvier 2016. Catalogue indispensable, tant il est « écrit » et informé, sous la direction de Guillaume Faroult avec les contributions de Pierre Rosenberg, de l’Académie française (on lui doit, entre autres choses, l’achat controversé du génialissime Verrou en 1974), Marie-Anne Dupuy-Vachey, Mary D. Sheriff, Michel Delon et Juliette Trey, RMN/ Musée du Luxembourg-Sénat, 39€.
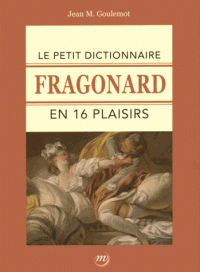 Le Petit Dictionnaire Fragonard en 16 plaisirs de Jean-Marie Goulemot nous ouvre les portes du libertinage visuel de l’artiste sans enfoncer celles de la banalité égrillarde ou de la moralisatrice théorie du genre. L’auteur de Ces livres qu’on ne lit que d’une main (1994), admirable analyse du roman pornographique du XVIIIe siècle, sait qu’il ne faut pas confondre sensualité et sexualité, implicite et explicite en matière d’image et d’incitation rétinienne. Il n’ignore pas, à l’inverse, ce que la peinture et la littérature des années 1750-1780 s’empruntent par besoin de mobiliser le corps et l’imaginaire de leur public, le roman multipliant les tableaux à voir, et la peinture les amorces de récit. Merveilleusement écrit, ce viatique de poche s’intéresse donc aux ruses fragonardiennes, à sa façon d’en dire plus qu’il n’en montre. Le peintre procède par ellipses, équivoques et ambiguïtés quand Baudoin exhibe des sexes en action, des mains qui se perdent, des cuisses qui s’ouvrent. Peu de nus chez Fragonard, mais combien de tableaux et de dessins emportés par le dévoilement, l’effraction, les fausses résistances ! L’acmé du plaisir l’intéresse moins que « la tension du désir ». SG
Le Petit Dictionnaire Fragonard en 16 plaisirs de Jean-Marie Goulemot nous ouvre les portes du libertinage visuel de l’artiste sans enfoncer celles de la banalité égrillarde ou de la moralisatrice théorie du genre. L’auteur de Ces livres qu’on ne lit que d’une main (1994), admirable analyse du roman pornographique du XVIIIe siècle, sait qu’il ne faut pas confondre sensualité et sexualité, implicite et explicite en matière d’image et d’incitation rétinienne. Il n’ignore pas, à l’inverse, ce que la peinture et la littérature des années 1750-1780 s’empruntent par besoin de mobiliser le corps et l’imaginaire de leur public, le roman multipliant les tableaux à voir, et la peinture les amorces de récit. Merveilleusement écrit, ce viatique de poche s’intéresse donc aux ruses fragonardiennes, à sa façon d’en dire plus qu’il n’en montre. Le peintre procède par ellipses, équivoques et ambiguïtés quand Baudoin exhibe des sexes en action, des mains qui se perdent, des cuisses qui s’ouvrent. Peu de nus chez Fragonard, mais combien de tableaux et de dessins emportés par le dévoilement, l’effraction, les fausses résistances ! L’acmé du plaisir l’intéresse moins que « la tension du désir ». SG
 En 1987, alors que Pierre Rosenberg fête Fragonard de manière inoubliable au Grand Palais, Philippe Sollers publie un court essai conforme en tout, Eros et verve, au virage qu’a marqué, quatre ans plus tôt, Femmes. Dès la première page, l’intuition que cette peinture pense, autant qu’elle dépense, éclate en une formule d’avenir : « Il est temps de faire de Fragonard un peintre profond. » Les récentes études lui ont donné raison, non sans avoir débaptisé les supposés portraits de Diderot et de La Guimard, sur lesquels s’appuyait Sollers. Si la référence des illustrations aurait pu en tenir compte, le texte n’en souffre pas. Sa musique, du Vivaldi, évidemment, traduit le lyrisme du peintre au bon tempo, et son ancrage littéraire. Fragonard, nous dit Sollers, s’autorise toutes les libertés à l’intérieur de sa science de grand conteur, à l’instar de Manet et Picasso, deux de ses héritiers directs et déférents. SG
En 1987, alors que Pierre Rosenberg fête Fragonard de manière inoubliable au Grand Palais, Philippe Sollers publie un court essai conforme en tout, Eros et verve, au virage qu’a marqué, quatre ans plus tôt, Femmes. Dès la première page, l’intuition que cette peinture pense, autant qu’elle dépense, éclate en une formule d’avenir : « Il est temps de faire de Fragonard un peintre profond. » Les récentes études lui ont donné raison, non sans avoir débaptisé les supposés portraits de Diderot et de La Guimard, sur lesquels s’appuyait Sollers. Si la référence des illustrations aurait pu en tenir compte, le texte n’en souffre pas. Sa musique, du Vivaldi, évidemment, traduit le lyrisme du peintre au bon tempo, et son ancrage littéraire. Fragonard, nous dit Sollers, s’autorise toutes les libertés à l’intérieur de sa science de grand conteur, à l’instar de Manet et Picasso, deux de ses héritiers directs et déférents. SG
Vigée fêtée // Une pluie de livres, mais une pluie d’or, est venue saluer l’exposition Vigée Le Brun, à laquelle je suis trop lié pour dire le bien qu’il faut en penser. La palme, de loin, revient à Marc Fumaroli, en qui le XVIIIe prérévolutionnaire a trouvé le meilleur des avocats, savant comme Caylus, vif comme Voltaire. A contre-courant des chantres du davidisme et de leur haine suspecte du génie rocaille, à rebours aussi d’un certain féminisme, qui ne comprend rien à la condition des femmes sous l’Ancien Régime et bannit toute stratégie de séduction au nom de la grandeur de leur sexe bafoué, cet amoureux de Watteau, de Boucher et de Fragonard n’hésite pas à les accrocher, sur les cimaises de son musée intime, aux côtés des merveilles de Madame Vigée Le Brun. En cela, il prolonge les habitudes du monde qu’il chérit. La « galerie française » d’un Vaudreuil, comme Colin Bailey l’a montré, réunissait ce que l’histoire de l’art des XIXe et XXe siècles devait séparer par ignorance du goût « d’avant l’orage » (Marc Fumaroli). Son Mundus muliebris, en moins de cent pages, contient et éclaire ce qu’il faut savoir de la carrière exceptionnelle d’une roturière, flanquée d’un mari utile bien qu’infidèle, et parvenue à subjuguer la haute société, Versailles comme Paris, par le seul charisme de ses pinceaux et de sa personne.
 On ne triomphe pas ainsi sans s’attirer la haine de ceux qui depuis Louis XV confondent le pouvoir des femmes et la féminité en art dans une même réprobation et une même idéalisation de Rome et de Sparte, ces sociétés parfaites où les hommes, confiants en leur saine et suffisante virilité, dominent les champs politique, moral et esthétique sans partage. Pour mesurer jusqu’où aura porté le rejet du frivole ou du charme supposé délétère, Marc Fumaroli donne la parole à Baudelaire et aux frères Goncourt, prophètes d’un monde, le nôtre, où le féminin ne semble plus avoir d’autres choix que la négation de soi (Beauvoirisme) et l’euphémisation (Sophia Coppola). Autre éminent connaisseur du XVIIIe siècle – son Dictionnaire libertin (Gallimard, L’Infini) est un must – Patrick Wald Lasowski a accepté de préfacer et d’annoter les trois tomes des Souvenirs de Vigée Le Brun, qui n’en ont font qu’un, superbement illustré (certaines images débordant l’habituel florilège) et restituant l’édition Fournier de 1835-1837 de façon, semble-t-il, plus scrupuleuse que certaines éditions modernes. Mais le meilleur est l’intelligence féline avec laquelle il approche, en introduction, l’esprit du portrait tel que Vigée en hérita et le haussa à la perfection d’un mimétisme où la ressemblance et l’éclat de « l’âge d’or » cessent de se contredire : « La peinture d’Elisabeth accueille le regard des spectateurs, comme elle-même accueille ses modèles. Une piété profane leur offre cet espace de repli, cette protection : chaque portrait est une assomption, chaque visage est un visage sauvé. Après quoi, le modèle souffre, vieillit, trahit son image, dont il n’est plus que le lointain souvenir. » Admirable… Différemment, Cécile Berly, qui a beaucoup et bien écrit sur Marie-Antoinette, demande aux Souvenirs de Vigée le secret de la puissance de leur auteur. En somme, Loulou – pour le dire comme Joseph Bailllio – a peint deux fois ses plus beaux portraits, la première dans l’élan de la vie, la seconde dans le plaisir de les raconter. Rousseau, cité en exergue des Souvenirs, et Casanova, doublant les « plaisirs » de son existence par les mots qui les fixe, sont ses frères de plume. SG
On ne triomphe pas ainsi sans s’attirer la haine de ceux qui depuis Louis XV confondent le pouvoir des femmes et la féminité en art dans une même réprobation et une même idéalisation de Rome et de Sparte, ces sociétés parfaites où les hommes, confiants en leur saine et suffisante virilité, dominent les champs politique, moral et esthétique sans partage. Pour mesurer jusqu’où aura porté le rejet du frivole ou du charme supposé délétère, Marc Fumaroli donne la parole à Baudelaire et aux frères Goncourt, prophètes d’un monde, le nôtre, où le féminin ne semble plus avoir d’autres choix que la négation de soi (Beauvoirisme) et l’euphémisation (Sophia Coppola). Autre éminent connaisseur du XVIIIe siècle – son Dictionnaire libertin (Gallimard, L’Infini) est un must – Patrick Wald Lasowski a accepté de préfacer et d’annoter les trois tomes des Souvenirs de Vigée Le Brun, qui n’en ont font qu’un, superbement illustré (certaines images débordant l’habituel florilège) et restituant l’édition Fournier de 1835-1837 de façon, semble-t-il, plus scrupuleuse que certaines éditions modernes. Mais le meilleur est l’intelligence féline avec laquelle il approche, en introduction, l’esprit du portrait tel que Vigée en hérita et le haussa à la perfection d’un mimétisme où la ressemblance et l’éclat de « l’âge d’or » cessent de se contredire : « La peinture d’Elisabeth accueille le regard des spectateurs, comme elle-même accueille ses modèles. Une piété profane leur offre cet espace de repli, cette protection : chaque portrait est une assomption, chaque visage est un visage sauvé. Après quoi, le modèle souffre, vieillit, trahit son image, dont il n’est plus que le lointain souvenir. » Admirable… Différemment, Cécile Berly, qui a beaucoup et bien écrit sur Marie-Antoinette, demande aux Souvenirs de Vigée le secret de la puissance de leur auteur. En somme, Loulou – pour le dire comme Joseph Bailllio – a peint deux fois ses plus beaux portraits, la première dans l’élan de la vie, la seconde dans le plaisir de les raconter. Rousseau, cité en exergue des Souvenirs, et Casanova, doublant les « plaisirs » de son existence par les mots qui les fixe, sont ses frères de plume. SG
 *Marc Fumaroli, de l’Académie française, «Mundus muliebris ». Elisabeth Vigée Le Brun, peintre de l’Ancien Régime féminin, Editions de Fallois, 12€
*Marc Fumaroli, de l’Académie française, «Mundus muliebris ». Elisabeth Vigée Le Brun, peintre de l’Ancien Régime féminin, Editions de Fallois, 12€
*Vigée Le Brun, Souvenirs, préface et notes de Patrick Wald Lasowski, Citadelles § Mazenod, 59 €
*Cécile Berly, Louise Elisabeth Vigée Le Brun. Peindre et écrire. Marie-Antoinette et son temps, Artlys, 25 €.




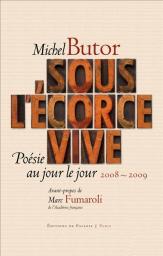

 Je mentirai en disant l’inverse d’El Lissitzky. L’expérience de la totalité, catalogue d’une exposition qui tourne, aujourd’hui à Malaga, demain à Barcelone… La France se serrera la ceinture! Demeure son catalogue qui préfère la minceur savante à l’obésité redondante. Maintes raisons justifient qu’on en parle après Arts and Architecture: la première est qu’
Je mentirai en disant l’inverse d’El Lissitzky. L’expérience de la totalité, catalogue d’une exposition qui tourne, aujourd’hui à Malaga, demain à Barcelone… La France se serrera la ceinture! Demeure son catalogue qui préfère la minceur savante à l’obésité redondante. Maintes raisons justifient qu’on en parle après Arts and Architecture: la première est qu’
 Marc Fumaroli n’a pas son pareil pour secouer les certitudes de l’histoire culturelle et rafraîchir notre vision de ce que l’on appelait encore, avant la réforme des programmes scolaires, l’âge classique. Son inutilité semble aujourd’hui une évidence à la plupart des enseignants. Au lieu de s’en attrister une fois de plus, on notera que le mépris des vieilles humanités, poussé à ce degré d’intolérance, rappelle les débats qui avaient agité le monde savant sous
Marc Fumaroli n’a pas son pareil pour secouer les certitudes de l’histoire culturelle et rafraîchir notre vision de ce que l’on appelait encore, avant la réforme des programmes scolaires, l’âge classique. Son inutilité semble aujourd’hui une évidence à la plupart des enseignants. Au lieu de s’en attrister une fois de plus, on notera que le mépris des vieilles humanités, poussé à ce degré d’intolérance, rappelle les débats qui avaient agité le monde savant sous  On ne pouvait pas mieux l’aborder qu’en partant du génial Gracián. L’Homme de cour est le titre fallacieux sous lequel parut, dans une traduction flottante, le grand livre épigrammatique du jésuite espagnol. Autour du roi soleil, les représentants de l’ordre ignacien jouissent alors d’une faveur certaine. C’est qu’ils ont poli leurs griffes avec le même opportunisme qu’Amelot le texte de Gracián, toilettage qui lui valut de devenir un best-seller et un bréviaire de stratégie laïque jusqu’à
On ne pouvait pas mieux l’aborder qu’en partant du génial Gracián. L’Homme de cour est le titre fallacieux sous lequel parut, dans une traduction flottante, le grand livre épigrammatique du jésuite espagnol. Autour du roi soleil, les représentants de l’ordre ignacien jouissent alors d’une faveur certaine. C’est qu’ils ont poli leurs griffes avec le même opportunisme qu’Amelot le texte de Gracián, toilettage qui lui valut de devenir un best-seller et un bréviaire de stratégie laïque jusqu’à  Il fut un temps où l’on n’écrivait guère par vocation sacrée ni obsession d’être publié. Écrire revenait à parler, à converser autrement, librement, à prolonger sa vie plus qu’à la grimer ou la flatter, sans égards pour les bienséances et la censure qu’imposait la chose imprimée. Pour s’être plus que d’autres méfié des servitudes et des risques du livre, Tallemant des Réaux (1619-1682) fut un auteur tardif. On parle bien de bombe à retardement… Il n’a rejoint le cercle des classiques confirmés, ou fréquentables, qu’en 1960, grâce aux bons soins d’Antoine Adam, sourd aux préventions esthétiques et morales qui s’étaient accumulées sur le manuscrit des Historiettes. Cet éminent professeur de la vieille Sorbonne, bon connaisseur du Fracasse de Gautier, cédait volontiers au magnétisme de la littérature Louis XIII. Verdeur de vue et style brutal, souci du détail et mépris de la composition, réalisme en un mot, Tallemant préfère regarder de près que juger de haut. Comme il se fiche de bien écrire, il excelle à brosser son époque telle qu’il l’a vécue. D’autres, dès avant Voltaire, peindront le Grand siècle avec les couleurs guindées d’un mythe toujours vivace. Le témoignage de Tallemant en sape par avance les fondations, la rhétorique, l’hypocrisie, la veulerie ancillaire et la fausse majesté. Dans son admirable préface, vrai morceau de littérature libertine, au sens que le premier XVIIe donnait à ce mot, Michel Jeanneret examine une à une les audaces de cette chronique déniaisée d’un temps qu’on découvre moins corseté, et moins fermé au mouvement brownien des sociétés modernes. Parce qu’elles en recueillent l’écume, récits, intrigues et confessions intimes, les Historiettes épousent le parti et la verve des élites lettrées où le talent l’emportait sur la naissance, le fait et l’effet sur les cachoteries assommantes. Mme de Rambouillet, Mme de Scudéry et Ninon de Lenclos furent les muses d’une fronde des esprits affranchis et des mœurs déliées. Imagine-t-on aujourd’hui une plume capable de s’amuser des plus hauts personnages de l’État comme Tallemant et ses amies le faisaient d’Henri IV, de Richelieu et de Louis XIII ? Verbe et parole découvrent les joies de l’escrime. C’est l’autre cour, celle qui mène à Rétif, aux romantiques et aux Hussards. Nimier assouplissait ses épées en lisant le cardinal de Retz, l’ami de Tallemant… Il fut enterré, belle sortie, non loin de
Il fut un temps où l’on n’écrivait guère par vocation sacrée ni obsession d’être publié. Écrire revenait à parler, à converser autrement, librement, à prolonger sa vie plus qu’à la grimer ou la flatter, sans égards pour les bienséances et la censure qu’imposait la chose imprimée. Pour s’être plus que d’autres méfié des servitudes et des risques du livre, Tallemant des Réaux (1619-1682) fut un auteur tardif. On parle bien de bombe à retardement… Il n’a rejoint le cercle des classiques confirmés, ou fréquentables, qu’en 1960, grâce aux bons soins d’Antoine Adam, sourd aux préventions esthétiques et morales qui s’étaient accumulées sur le manuscrit des Historiettes. Cet éminent professeur de la vieille Sorbonne, bon connaisseur du Fracasse de Gautier, cédait volontiers au magnétisme de la littérature Louis XIII. Verdeur de vue et style brutal, souci du détail et mépris de la composition, réalisme en un mot, Tallemant préfère regarder de près que juger de haut. Comme il se fiche de bien écrire, il excelle à brosser son époque telle qu’il l’a vécue. D’autres, dès avant Voltaire, peindront le Grand siècle avec les couleurs guindées d’un mythe toujours vivace. Le témoignage de Tallemant en sape par avance les fondations, la rhétorique, l’hypocrisie, la veulerie ancillaire et la fausse majesté. Dans son admirable préface, vrai morceau de littérature libertine, au sens que le premier XVIIe donnait à ce mot, Michel Jeanneret examine une à une les audaces de cette chronique déniaisée d’un temps qu’on découvre moins corseté, et moins fermé au mouvement brownien des sociétés modernes. Parce qu’elles en recueillent l’écume, récits, intrigues et confessions intimes, les Historiettes épousent le parti et la verve des élites lettrées où le talent l’emportait sur la naissance, le fait et l’effet sur les cachoteries assommantes. Mme de Rambouillet, Mme de Scudéry et Ninon de Lenclos furent les muses d’une fronde des esprits affranchis et des mœurs déliées. Imagine-t-on aujourd’hui une plume capable de s’amuser des plus hauts personnages de l’État comme Tallemant et ses amies le faisaient d’Henri IV, de Richelieu et de Louis XIII ? Verbe et parole découvrent les joies de l’escrime. C’est l’autre cour, celle qui mène à Rétif, aux romantiques et aux Hussards. Nimier assouplissait ses épées en lisant le cardinal de Retz, l’ami de Tallemant… Il fut enterré, belle sortie, non loin de