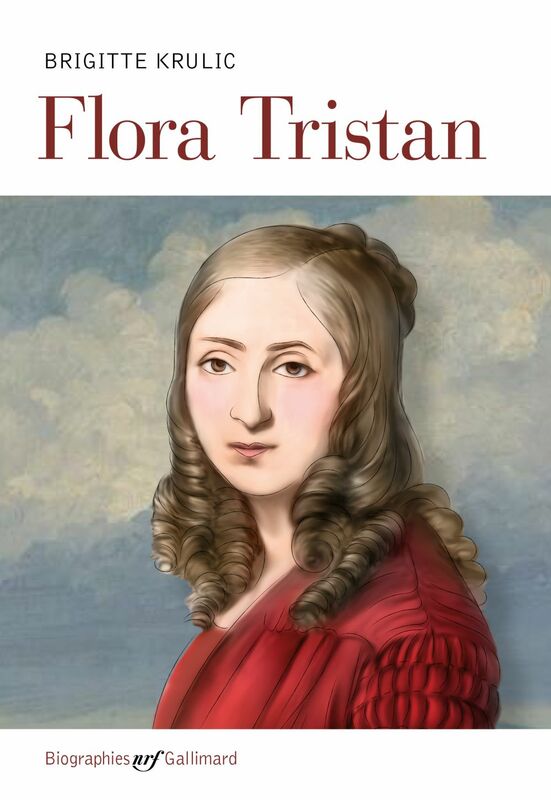L’Avenir de l’intelligence, en 1905, contient notamment une série d’articles publiés deux ans plus tôt sous le titre Le Romantisme féminin. Charles Maurras évalue en détails la panne que la poésie française lui semble avoir connue entre 1893 et 1903, consécutive, pense-t-il, à la lente agonie du Parnasse et du symbolisme, accrochés à un maniérisme stérile et à une liturgie de l’absolu désormais sans objet. Notons au passage que les spécialistes actuels d’Apollinaire partagent son constat d’une crise, non des vocations, mais des réalisations. Or, Maurras, s’il se montre sévère envers la muse masculine, s’avoue presque conquis par une poussée féminine autrement stimulante. Vers 1900, à le lire, « il s’est produit un phénomène singulier : subitement et presque simultanément, quatre poètes sont nés dont la chanson, bonne ou mauvaise, a réveillé les amateurs. Enfin, voilà donc des vivants ! » Ces vivants sont donc des vivantes, et elles se nomment Renée Vivien, Marie de Heredia, Lucie Delarue-Mardrus ou Anna de Noailles. Quelles que soient les réserves émises par Maurras en cours d’examen, et ses considérations sur la virilité ou la féminité en art, elles ne justifient pas la façon dont l’histoire littéraire et la parole féministe aiment à dénaturer la longue et scrupuleuse analyse qu’il accorde aux voix et aux audaces de ces « sirènes ». La seule possibilité que le fondateur de L’Action française ait vibré à cette poésie si souvent saphique fait horreur aux gardiens et gardiennes de la doxa. Il en découle des citations tronquées, des références erronées, des approximations sectaires. Et je ne parle pas, contagion oblige, de ce qui traîne sur les réseaux et autres blogs animés d’un militantisme ignare. On peut penser ce que l’on veut du monarchisme nationaliste de Maurras, et on doit condamner l’antisémitisme qui en découle, l’écrivain royaliste n’en aura pas moins apporté aux Sapho de la Belle Epoque un soutien inattendu, au mépris des multiples résistances que le nouveau siècle oppose à ces poétesses fières de leur sexe et de leur verbe. La position courante de la presse et du milieu littéraire oscillait entre la condescendance et le rejet : comparées aux innombrables imitateurs de Baudelaire, Verlaine et Mallarmé, nos aèdes en jupons subiraient davantage leurs limites physiologique et donc l’ascendant des maîtres.

Le premier des trois articles à ouvrir Le Romantisme féminin fait judicieusement de Renée Vivien (1877-1909) son étendard. Cette année-là, celle qui signait R. Vivien est devenue Renée Vivien en publiant sous son nom, ou plutôt sous un pseudonyme à résonnance féminine, ses traductions de Sapho, assorties de nouveaux vers. Les précédents recueils, Etudes et préludes, et surtout Cendres et poussières, avaient déjà eu pour éditeur Alphonse Lemerre, le complice des Parnassiens depuis le Second Empire. Mais l’habit ne fait pas le moine, et Maurras ramène plutôt la prêtresse de Sapho sur les rivages du Verlaine de Parallèlement et des pièces condamnées de Baudelaire. Le premier dit la couleur lesbienne des vers de Vivien, non moins qu’une maîtrise de l’idiome de son pays d’adoption : « Le français dont elle use est, en prose et en vers, d’une fluidité remarquable. Ni impropriété dans les mots ni méprises dans l’euphonie. Elle connaît que le e muet fait le charme de notre langue. » Maurras ne cède à aucune xénophobie, contrairement à ce qu’on lit ici et là, en insistant sur les origines étrangères de René, née à Londres d’un père britannique et d’une mère américaine. A 24 ans, Pauline Mary Tarn change d’identité et demande à la poésie, d’inspiration aussi antique que chrétienne, d’y contribuer. Maurras s’intéresse à cette dualité nourrie très tôt de la lecture fascinée de Baudelaire. Il n’est pas d’écrivain, selon lui, qui ait autant pénétré la jeune femme à l’heure où elle a commencé à traduire ses secrètes langueurs. Mais quand d’autres commentateurs accusent Vivien de singer son modèle, en outrant ses effets, Maurras l’innocente du mimétisme des suiveurs : « Imitations, sans doute, mais imitations trop ardentes, trop passionnées, trop près des choses pour n’être pas reconnues tout aussi original que n’importe quoi. » C’est de réincarnation qu’il préfère parler tant la langue frémissante de Renée Vivien s’écrit avec les sens. Lesbos, et ses nuits chaudes, précède Femmes damnées, et leurs « caresses puissantes », dans l’édition de 1857 des Fleurs du Mal, avant que la justice de Napoléon III ne les marque au fer rouge. Ils restaient inscrits en Renée et vibraient d’une irrévérence jumelle, cela n’a pas échappé à Maurras. La « conscience religieuse » de notre affranchie, qui croit au mal moral, lui paraît aussi irréfutable. Il estime la transfuge plus chaleureuse que Baudelaire, et plus soucieuse du plaisir. Le billet inédit que Renée adressa à Maurras en 1905, et que la librairie du Feu follet a exhumé, ne contient pas le plus petit reproche : « Monsieur, En feuilletant votre si intéressant volume : De l’Avenir de l’Intelligence [sic], j’ai relu, avec un plaisir ému, les pages – trop indulgentes vraiment ! – que vous avez consacrées à mes ouvrages. Merci infiniment. Et veuillez agréer mes très reconnaissants sentiments de confraternité littéraire. Renée Vivien. » Plus d’un siècle s’est écoulé… Les amazones 1900, surnom d’époque qui convient mieux à Liane de Pougy et Natalie Barney, n’ont pas quitté les feux de l’actualité, et l’on se réjouit que les éditeurs, Bartillat en premier lieu, fassent pleuvoir inédits et correspondances. Stéphane Guégan

*La suite est à retrouver dans « Les Sapho 1900 », Revue des deux mondes, décembre-janvier 2024-2025 / A lire : Liane de Pougy, Dix ans de fête. Mémoires d’une demi-mondaine, Bartillat, 2022 ; Je suis tienne irrévocablement. Lettres de Renée Vivien à Natalie Barney, Bartillat, 2023 ; Natalie Clifford Barney, Lettres à une connue. Roman de notre temps, Bartillat, 2024 / Le même éditeur remet en librairie L’Inconstante de Marie de Régnier, avec une bonne préface de Marie de Laubier, 23€. Ce roman rapide, intrépide de 1903, que Rachilde plébiscita, superpose les triangles amoureux et divise les amants dévoilés, malgré ou à cause de l’anonymat (Pierre Louÿs, Jean de Tinan) ; la langue est aussi décorsetée que les situations, d’un libertinage déjà 1920 / On lira aussi La Passion selon Renée Vivien, la biographie romancée de Maria-Mercè Marçal, traduction, préface et notes de Nicole G. Albert, éminente spécialiste de Vivien et du saphisme 1900, ErosOnyx éditions, 2024, 25€. Etrange livre que celui de Marçal où l’écrivaine, transfert aidant, s’efface si peu devant son objet qu’elle éclaire davantage les années 1980 (jusque dans son identité catalane réaffirmée) que le moment 1900 ! Je ne m’appesantis pas sur les parallélismes entre patriarcat et franquisme, et ne réagis pas aux oppositions entre « l’ordre hétérosexuel », qui serait propre au récit linéaire, et l’écriture féminine/féministe, favorable elle à « l’éclatement » narratif.
Encres féminines

Le motif de l’exil, très porté par la bienpensance transfrontalière, a toujours stimulé la littérature et la peinture. Ovide l’expulsé, merveilleux exemple, a fait rêver jusqu’aux pinceaux et crayons de Delacroix et Degas. Plus tard, le monde chrétien, en se déchirant, a connu ses migrations et ses martyrs. Germaine de Staël, protestante de foi, janséniste de cœur, n’ignorait rien des éloignements forcés dont elle fut un brillant avatar, et ajouta au tableau d’honneur la proscription politique. Son père y avait goûté, elle fit mieux encore après avoir échoué à séduire Bonaparte entre Directoire et Consulat. Un rendez-vous manqué, selon la formule d’Annie Jourdan. N’y voyons pas seulement agir la répugnance du général corse envers les femmes de tête. Certes les idées et le génie littéraire ne manquaient pas à la fille de l’ex-ministre de Louis XVI. L’inconvénient, c’est que ces idées et ce génie, pour s’être vite affranchis du jacobinisme invétéré des Français, restaient trop marqués de libéralisme. Bonaparte, impatienté par Benjamin Constant – l’amant de la dame, n’était plus d’humeur à tolérer la moindre résistance à sa réorganisation institutionnelle du régime. A gauche et à droite, à mots plus ou moins mouchetés, on s’émeut de l’inflexion autoritaire, voire anti-démocratique, en cours. Le bannissement doré de notre Clorinde intervient en 1802, il durera dix ans, selon des modalités diverses. Il semble que Germaine y ait mis du sien et participé à la conspiration de Moreau et Bernadotte. Du reste, il suffisait qu’elle en fût soupçonnée pour devenir persona non grata. La proscrite a laissé un superbe récit, à froid, des années qui suivirent, et la virent parcourir l’Europe. La conquérir aussi. Philippe Roger tire avec superbe les leçons du texte, publié après la mort de l’auteure, mais où revit un moment d’histoire. Ce posthume confirme la théorie de Chateaubriand, frondeur monarchiste : la nouvelle littérature, la sienne, comme celle de Constant, Bonald, Népomucène Lemercier (auquel on revient) et « madame de Staël » a été la langue de l’opposition et du nouveau magistère de l’écrivain, quel qu’en soit le sexe. SG / Germaine de Staël, Dix années d’exil, édition de Philippe Roger, Folio Classique, 9,90€. Edition que Roger dédie à la mémoire du regretté Jean-Claude Berchet, éminent spécialiste de Chateaubriand, disparu en juillet dernier.

Le duel a disparu des mœurs littéraires, et il faut regretter qu’on n’échange plus plomb ou fer en défense d’un livre, de son auteur ou de son autrice, comme ce fut le cas, en 1833, quand Lélia déchaîna les passions et fit se battre Jean-Gabriel Capo de Feuillide, « nature chaude » (Charles Monselet), et Gustave Planche, peu imaginable en bretteur. Du reste, le pistolet fut préféré à l’épée et le sang ne coula pas… Proche de George Sand, qui signe de ce pseudonyme vaguement hermaphrodite le roman à scandale, Planche ne jure que par l’idéalisme dont Lélia serait le triomphe. Entendons un livre où l’action et les sentiments céderaient le pas au symbolisme philosophique, le grossier au céleste. L’argument ne convainc pas Capo de Feuillide et le « renoncement » de l’héroïne ne trompe pas sa perspicacité. Après avoir subi la brutalité d’un premier amant, Lélia sème le malheur, non par vengeance, mais par impuissance d’aimer les hommes, avant de tenter de se racheter. Trop tard, Sténio, son amant frustré et même trompé, a déjà rendu l’âme. C’est le grand mot du livre, livre qui dénonce avec fermeté l’athéisme moderne. Mais ce mot, la critique d’alors et d’aujourd’hui, le comprend mal et le défigure en lui opposant le corps et ses démons. Sand est réputée très réceptive aux appels de la chair et aux félicités de l’amour. Leur accord, voilà son bel idéal. On a pu écrire que le roman de 1833, plus que la version chaste de 1839, était celui de la frigidité ou du lesbianisme, autant de notions faciles à colorer désormais de féminisme américain. Le vent qui souffle des Etats-Unis a tendance à tout vivifier et « la dissatisfaction sexuelle », franglais répandu aussi, ne saurait s’expliquer que par l’affirmation d’une sexualité proprement et fièrement féminine. Théorie intéressante, mais insuffisante au regard du texte même, assez labyrinthique, fascinant par ses détours moins vraisemblables que chargés de symptômes ou de symboles à éclaircir. Un certain scabreux, voire un scabreux certain, ne l’oublions pas, lui est reproché en 1833. Musset le trouvait « plus hardi et plus viril », c’est que Sand l’a plié aux mouvances et aux caprices de sa libido. Le personnage de la sœur courtisane, double plus que repoussoir, ne permet pas d’en douter. L’édition savante d’Isabelle Hoog Naginski nous confronte donc aux lectures du moment et aux prolongements iconographiques du personnage, Delacroix (pastel bien connu), Courbet (la toile fiévreuse d’Erevan, fort belle a priori, se confond-elle avec le « mauvais tableau » que Théophile Silvestre dit avoir été peint « après la lecture » de Lélia ?) et Clésinger. En mars 1846, plus d’un an avant de devenir son gendre, celui-ci écrivait à la romancière afin de lui faire savoir qu’il exposait une sculpture inspirée de son personnage, mixte féminin d’Oberman et de René. Au sujet de cette Mélancolie, aujourd’hui à l’Ermitage (dessin préparatoire à Orsay), qu’on me permette d’ajouter que l’œuvre fut mentionnée et prisée par Gautier au Salon, cette année-là, avant qu’il ne la retrouve en Russie. Clésinger, sur le point d’immortaliser la Présidente en 1847, avait su ne pas trop refroidir sa propre Lélia. SG / George Sand, Œuvres complètes, sous la direction de Béatrice Didier, Lélia, 1833, suivi de l’édition de 1839, édition critique par Isabelle Hoog Naginski, deux volumes, Honoré Champion, 190€.
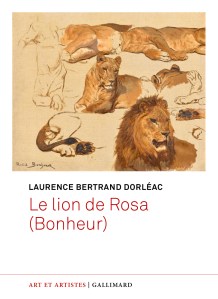
Devenue un cas d’école en raison du succès grandissant des expositions qui lui sont consacrées, et des combats qu’elle incarne, Rosa Bonheur (1822-1899) s’est acquis une audience très supérieure à la valeur intrinsèque de son œuvre peint, plus appliqué qu’inventif, théâtral que réaliste. Les tableaux de Salon, à cet égard, n’ont pas la fraîcheur des études, exécutées d’une main plus légère, dans une visée moins rhétorique. Saturée de lions et de lionnes, têtes et corps, l’une de ces pochades séduisantes (couverture) pourrait être signée de Delacroix ou de Barye, familiers des fauves du jardin des plantes sous la Restauration. La beauté des animaux les fascinait, comme ce qui les rapprochait de l’humain dans leur différence. Les dissections au cours des deux siècles précédents avaient renouvelé l’approche d’un problème proprement philosophique, car impliquant le privilège du cogito ; les peintres du XIXe siècle ne l’ignoraient pas, initiés qu’ils étaient aux sciences de la nature. La correspondance de Rosa Bonheur la montre ainsi très curieuse de la chose animale, et très soucieuse de la cause animale. La SPA est née sous la monarchie de Juillet et notre peintre en fut ; elle a vécu, d’ailleurs, entourée de toute une ménagerie, qui faisait sa part au sauvage au sein du domestique et du rustique. Laurence Bertrand Dorléac l’étudie comme un miroir de l’œuvre, sujet aux évolutions anthropologiques et historiques. Après 1870, et la statue de Bartholdi le confirme, la majesté du lion se veut le reflet inversé d’un patriotisme blessé. Le cœur de Rosa saigne aussi. On parle généralement moins de cet amour-là que de son amour des dames. Bertrand Dorléac, quant à elle, refuse de dissocier les identités et les secrets dont Rosa était faite. C’est là que nous retrouvons l’étude féline autour de laquelle s’enroule ce livre, et l’étrange présence d’une forme, en haut, à gauche, anatomiquement ambiguë. Le lecteur découvrira lui-même ce que Bertrand Dorléac tire de cette anamorphose digne de Charles Le Brun et, pour revenir à lui, de Delacroix, deux peintres que Baudelaire aimait à rapprocher. Ô surprise, la quatrième de couverture stigmatise ce siècle de fer, celui de Rosa, « qui ne donne presque aucune chance à une femme d’exister », oubliant que rugissement de lion n’est pas nécessairement raison. SG / Laurence Bertrand Dorléac, Le Lion de Rosa (Bonheur), Gallimard, 23 €.
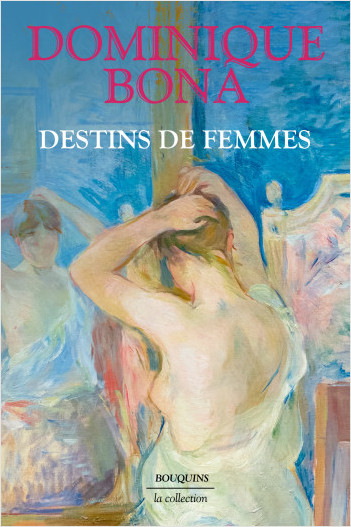
C’est en réunissant cinq de ses biographies, où le beau sexe a le beau rôle, que Dominique Bona en a perçu la profonde unité : « Il y a une chaîne entre toutes ces femmes. Elles se parlent et se répondent d’un livre à l’autre. » N’allez pas croire que cette chaîne pèse sur les écrivaines et les peintres élues comme les fers du patriarcat dont le XIXe siècle et le premier XXe siècles auraient été les gardiens intangibles… Pas plus qu’elle n’emploie le ton victimaire de rigueur, Dominique Bona ne leste le destin de ses héroïnes d’un « message », ou d’une « morale » distincte de leur pente à créer et aimer. Si les sœurs Lerolle n’ont pas été aussi heureuses en amour que les sœurs Heredia, si Berthe Morisot a noué, par et dans la peinture, une relation avec Edouard Manet plus intense que le couple qu’elle forma avec son frère Eugène, Colette et Jeanne Voilier, la terrible maîtresse de Paul Valéry, ont mieux additionné ferveur artistique et Eros vécu, à l’instar de Marie de Régnier. Mais un même « fil rouge », celui de la passion, les dote d’une complicité fertile aux yeux de la romancière. Car Dominique Bona documente et narre ces « vies », comme le disaient Vasari et Félibien, d’une même verve littéraire. Pour que nos existences ressemblent à un roman, mieux vaut demander à une vraie plume d’en tracer le dessin, de creuser, dit la biographe, un chemin de vérité parmi « les pistes buissonnières de l’imagination ». Il arrive que les forts volumes de la collection Bouquins prennent l’apparence d’une famille recomposée, d’un réseau fraternel ou sororal, c’est le cas ici, et le lecteur, pris à son tour au jeu des correspondances, n’est pas mécontent d’y contribuer. SG / Dominique Bona, de l’Académie française, Destins de femmes, Bouquins, 32€.

Une nouvelle occasion nous est donnée de saluer, en même temps que ses éditeurs, l’acuité et la valeur littéraire du Journal d’Hélène Hoppenot, indispensable à qui veut connaître l’avant-guerre et les années de l’Occupation. Photographe dans l’âme, proche de Gisèle Freund au demeurant, « l’épouse de l’ambassadeur » serre la réalité, enregistre les conversations de table ou de vernissage, cisèle sa langue d’historienne du présent. Quand les boches quittent Paris, elle se trouve toujours à New York, en sympathie avec le milieu gaulliste et avec la nébuleuse surréaliste, Marcel Duchamp, Mary Reynolds, Jacqueline Breton… Qui peut alors se prévaloir de toucher à ces extrêmes sans se brûler les ailes ? Des ailes, justement, elle en use le 7 mars 1945 afin de de rentrer au pays. Elle note au passage l’inquiétude de ceux qui se sont exilés (Alexis Leger), même quand ils y étaient forcés (Henry Bernstein), tous redoutent les reproches de ceux qui étaient restés. Le spectacle, à son arrivée, lui soulève le cœur, l’épuration souvent expéditive ne saurait apaiser les attentes d’une femme d’expérience, prête à punir qui le mérite, mais pas n’importe comment. 17 mars 1945 : « Drieu la Rochelle a réussi à se suicider après avoir reçu l’ordre de comparaître devant la Commission d’enquête. […] Tant d’autres qui ont été pire […] vont s’en tirer à meilleur compte… » Les « hommes du jour » sont finement croqués, Picasso, qui « vieillit bien », Aragon, qui triomphe comme si la place rouge s’était installée à la Concorde. Hoppenot ne le loupe pas fin août : « Il a grisonné et conservé cet air hypocrite de chat qui s’apprête à laper de la crème en surveillant les alentours. Grande amabilité cachant un grand fanatisme. » Même regard percutant chez la fille d’Hélène, au sujet du médiocre roman d’Elsa Triolet, Les Amants d’Avignon : « Ce n’était pas l’atmosphère de la Résistance : elle n’a pas dû en être. » Jusqu’en 1951 ainsi, sur fond de déconfiture, on croise le ban et l’arrière-ban de l’après-guerre, lettres et beaux-arts – pas seulement donc Sartre et ses sbires, entre Paris et Berne, où Hoppenot est muté, au poste que Paul Morand, l’homme pressé, n’avait pas eu le temps d’occuper. SG / Hélène Hoppenot, Journal 1945-1951, éditions Claire Paulhan, édition établie et annotée par la regrettée Marie France Mousli, 36€.

Remuer la mémoire familiale ne va pas sans risques, chacun en fait, un jour ou l’autre, l’expérience. Les mauvaises rencontres, à ce petit jeu, sont souvent plus nombreuses que les heureuses découvertes. Récidiviste vivifiante, Marie Nimier pensait avoir épuisé la figure du père, l’insaisissable et noir Roger, avec La Reine du silence, magnifique portrait de celui qu’elle a si peu connu, mais qui la poursuit comme une énigme pugnace. A la lecture du livre, son amie Juliette Gréco, pour qui elle a ciselé quelques chansons, l’enjoint à lui donner un pendant. Après les dérobades paternelles – et la mort à toute vitesse en fut une à maints égards, vient donc le clair-obscur de la mère et, à travers cette femme forte, les hommes qu’elle fit entrer en abondance dans sa vie, à défaut de pouvoir ou de vouloir toujours les retenir. Si l’âge a cruellement altéré sa beauté de blonde rayonnante quand le livre débute, le tempérament reste de feu. Marie Nimier ne compte plus les brûlures que lui a values une relation filiale plutôt compliquée, hantée par le fantôme d’un père qui ne se donnait même pas la peine d’y ressembler. La vieillesse n’est pas toujours tendre envers sa propre progéniture, elle peut, à l’occasion, se rendre détestable lorsque les enfants acculent leurs parents à leurs échecs ou leurs secrets. Marie Nimier a le don de mettre son lecteur dans la confidence avec une émouvante franchise et, s’il le faut, une saine impudeur. Et je ne parle pas, legs familial, de son humour unique. Une fois ouverte, la malle aux souvenirs, que réveillent une indiscrétion ici, un parfum là, ne peut plus se refermer, ou se taire, comme cette correspondance longtemps enfouie de la grand-mère de l’autrice, Renée Vautier, une des passions du faunesque Paul Valéry (dont elle a laissé un buste aux yeux éteints). Du reste, l’épistolaire joue un rôle quasi hitchcockien dans le cas présent, autant que certains objets arrachés à l’oubli et porteurs d’aveux troubles. Un livre poignant donc, digne en tout des exigences de la collection où il prend place et fait entendre une musique qui eût enchanté le hussard foudroyé, quelque part, sur l’autoroute de l’Ouest, un jour de septembre 1962. SG / Marie Nimier, Le côté obscur de la Reine, Mercure de France, collection Traits et Portraits, 22,50€.
Meilleurs vœux aux lectrices et lecteurs de ce blog dont l’audience a quadruplé depuis 2020.