 Jean Paulhan nous manque terriblement. Son ironie de sage, ses perles de fausse huître, son sens infaillible de la justesse et de la justice, en firent une manière de Voltaire au pays des fous et des tueurs de salon. Avec sa constance de Nîmois et son espièglerie de toujours, il fut l’ami et presque l’amant d’une littérature sans cesse traînée devant les Tribunaux. Toute son œuvre, qui eut l’élégance de ne jamais souligner combien elle importait et portait, est résistance… Un exemple, pour commencer. Déjà inquiété par l’affaire d’Histoire d’O, qu’il avait préfacé en champion des corps ardents et de l’esclavage (consenti) des sens, Paulhan comparaît, le 15 décembre 1956, devant la XVIIe chambre correctionnelle. L’accusé, c’est toujours l’éditeur Jean-Jacques Pauvert ! Mais l’objet du délit a changé, c’est Sade. Pauvert et son avocat, l’étonnant Maurice Garçon, ne sauraient rejouer le procès des Fleurs du mal, un siècle après, sans l’appui de Paulhan et son aisance à contourner les pièges d’un Président qui, lui aussi, a lu Baudelaire… Puisque l’outrage aux mœurs est retenu, puisque le divin marquis est menacé de ne pouvoir quitter sa prison posthume, il en va de la défense de l’écriture imprescriptible et de son privilège à fouiller équitablement le clair-obscur des âmes et des sociétés. À la joute oratoire qu’est tout procès Paulhan apporte, ce jour-là, les ressources de sa brillante conversation et de ses innocentes mystifications. Voulant donner un poids décisif à ses premiers mots, il ne trouve rien de mieux que de s’attribuer une thèse sur Sade, jadis soutenue en Sorbonne, thèse où il aurait montré que la littérature moderne, en son entier, descendait du pornographe embastillé. Suprême ruse, Paulhan cite à la barre jusqu’au jeune Lamartine, qui ne fut pas que soupirs et suspensions. Très en verve, le patron de la NRF, sadien de la première heure, poursuit son inventaire, convoque aussi bien Baudelaire que Nietzsche et Freud, autant de plumes trempées dans le mal. Trempées, non noyées. S’il est juste, souligne Paulhan, d’attribuer à Sade le rejet d’«une philosophie un peu molle qui admettait sans réserve que l’homme était bon et qu’il suffisait de le rendre à sa nature pour que tout se passe bien», un correctif s’impose, une distinction s’affirme, où se fonde la liberté des modernes à rejeter la prédication du sens fermé. Ainsi le texte sadien échappe-t-il au sadisme sous lequel on l’écrase et l’annule. Quelles que fussent les mauvaises mœurs et pensées de Sade, le très inflammable aristocrate, ses récits endiablés, chant d’outrance et d’humour noir, rappellent qu’«il n’a jamais demandé à être suivi comme exemple».
Jean Paulhan nous manque terriblement. Son ironie de sage, ses perles de fausse huître, son sens infaillible de la justesse et de la justice, en firent une manière de Voltaire au pays des fous et des tueurs de salon. Avec sa constance de Nîmois et son espièglerie de toujours, il fut l’ami et presque l’amant d’une littérature sans cesse traînée devant les Tribunaux. Toute son œuvre, qui eut l’élégance de ne jamais souligner combien elle importait et portait, est résistance… Un exemple, pour commencer. Déjà inquiété par l’affaire d’Histoire d’O, qu’il avait préfacé en champion des corps ardents et de l’esclavage (consenti) des sens, Paulhan comparaît, le 15 décembre 1956, devant la XVIIe chambre correctionnelle. L’accusé, c’est toujours l’éditeur Jean-Jacques Pauvert ! Mais l’objet du délit a changé, c’est Sade. Pauvert et son avocat, l’étonnant Maurice Garçon, ne sauraient rejouer le procès des Fleurs du mal, un siècle après, sans l’appui de Paulhan et son aisance à contourner les pièges d’un Président qui, lui aussi, a lu Baudelaire… Puisque l’outrage aux mœurs est retenu, puisque le divin marquis est menacé de ne pouvoir quitter sa prison posthume, il en va de la défense de l’écriture imprescriptible et de son privilège à fouiller équitablement le clair-obscur des âmes et des sociétés. À la joute oratoire qu’est tout procès Paulhan apporte, ce jour-là, les ressources de sa brillante conversation et de ses innocentes mystifications. Voulant donner un poids décisif à ses premiers mots, il ne trouve rien de mieux que de s’attribuer une thèse sur Sade, jadis soutenue en Sorbonne, thèse où il aurait montré que la littérature moderne, en son entier, descendait du pornographe embastillé. Suprême ruse, Paulhan cite à la barre jusqu’au jeune Lamartine, qui ne fut pas que soupirs et suspensions. Très en verve, le patron de la NRF, sadien de la première heure, poursuit son inventaire, convoque aussi bien Baudelaire que Nietzsche et Freud, autant de plumes trempées dans le mal. Trempées, non noyées. S’il est juste, souligne Paulhan, d’attribuer à Sade le rejet d’«une philosophie un peu molle qui admettait sans réserve que l’homme était bon et qu’il suffisait de le rendre à sa nature pour que tout se passe bien», un correctif s’impose, une distinction s’affirme, où se fonde la liberté des modernes à rejeter la prédication du sens fermé. Ainsi le texte sadien échappe-t-il au sadisme sous lequel on l’écrase et l’annule. Quelles que fussent les mauvaises mœurs et pensées de Sade, le très inflammable aristocrate, ses récits endiablés, chant d’outrance et d’humour noir, rappellent qu’«il n’a jamais demandé à être suivi comme exemple».
 La profession de foi de Paulhan, en ce terrible hiver 1956, excusait le mensonge qu’il s’était autorisé habilement. De thèse sur Sade, en effet, il n’avait jamais été question… Mais cette petite entorse à la vérité portait la marque d’une longue hésitation. Avant que la guerre de 14 ne les diffère, les ambitions universitaires de Paulhan, trente ans déjà, étaient bien réelles, comme s’y penche le livre piquant de Charles Coustille. À l’instar de Mallarmé, Péguy, Céline et Barthes, que son essai rassemble, l’ancien élève de Louis-le-Grand eut donc la velléité de s’inscrire dans le champ du savoir institutionnel. Plus que les motifs de Paulhan, tradition paternelle, goût de l’analyse, prestige de la Sorbonne d’avant-guerre et besoins alimentaires d’enseigner, l’échec de ses visées académiques intéresse Coustille. L’ensemble des cas qu’il étudie confirme d’abord une vieille querelle, une très ancienne difficulté, puisque Le Testament de Villon s’en fait l’écho. Inconciliables semblent déjà les deux écritures, celle du savant et celle du créateur. Là où l’une se plie à des objectifs desséchants, selon une certaine vulgate, l’autre se déplie joyeusement, dirait Paulhan, en pleine conscience de ses libertés propres. Elles diffèreraient par essence, disent Segalen et Valéry en substance. Pour être le fruit des siècles et d’une mythologie croissante, la situation se complique autour de 1900, ainsi que le montrent les difficultés que Péguy et Paulhan rencontrent sur le chemin de leurs thèses, elles tiennent aux réticences du corps professoral à admettre les aspirations de la jeunesse nietzchéenne ou catholique, en qui savoir, métaphysique et subjectivité se tissent autrement. A quoi s’ajoute l’ethnographie… Féru de Madagascar, où il a enseigné les lettres en 1908-1910, Paulhan a décidé de mieux comprendre la culture native, après s’y être immergé autant qu’il se pouvait. Il lui a été notamment permis de saisir les liens entre le mode de vie des indigènes et les différents registres de leur parole. La thèse que Paulhan tentera de mener sur les proverbes, les fameux hain-teny, devait le harceler jusqu’à la fin des années 1930, causant moments d’enthousiasme et de découragement. Mais il en tira plus que l’article de Commerce, paru en 1925, alors que Gaston Gallimard, Jacques Rivière tragiquement disparu, lui a déjà confié la NRF.
La profession de foi de Paulhan, en ce terrible hiver 1956, excusait le mensonge qu’il s’était autorisé habilement. De thèse sur Sade, en effet, il n’avait jamais été question… Mais cette petite entorse à la vérité portait la marque d’une longue hésitation. Avant que la guerre de 14 ne les diffère, les ambitions universitaires de Paulhan, trente ans déjà, étaient bien réelles, comme s’y penche le livre piquant de Charles Coustille. À l’instar de Mallarmé, Péguy, Céline et Barthes, que son essai rassemble, l’ancien élève de Louis-le-Grand eut donc la velléité de s’inscrire dans le champ du savoir institutionnel. Plus que les motifs de Paulhan, tradition paternelle, goût de l’analyse, prestige de la Sorbonne d’avant-guerre et besoins alimentaires d’enseigner, l’échec de ses visées académiques intéresse Coustille. L’ensemble des cas qu’il étudie confirme d’abord une vieille querelle, une très ancienne difficulté, puisque Le Testament de Villon s’en fait l’écho. Inconciliables semblent déjà les deux écritures, celle du savant et celle du créateur. Là où l’une se plie à des objectifs desséchants, selon une certaine vulgate, l’autre se déplie joyeusement, dirait Paulhan, en pleine conscience de ses libertés propres. Elles diffèreraient par essence, disent Segalen et Valéry en substance. Pour être le fruit des siècles et d’une mythologie croissante, la situation se complique autour de 1900, ainsi que le montrent les difficultés que Péguy et Paulhan rencontrent sur le chemin de leurs thèses, elles tiennent aux réticences du corps professoral à admettre les aspirations de la jeunesse nietzchéenne ou catholique, en qui savoir, métaphysique et subjectivité se tissent autrement. A quoi s’ajoute l’ethnographie… Féru de Madagascar, où il a enseigné les lettres en 1908-1910, Paulhan a décidé de mieux comprendre la culture native, après s’y être immergé autant qu’il se pouvait. Il lui a été notamment permis de saisir les liens entre le mode de vie des indigènes et les différents registres de leur parole. La thèse que Paulhan tentera de mener sur les proverbes, les fameux hain-teny, devait le harceler jusqu’à la fin des années 1930, causant moments d’enthousiasme et de découragement. Mais il en tira plus que l’article de Commerce, paru en 1925, alors que Gaston Gallimard, Jacques Rivière tragiquement disparu, lui a déjà confié la NRF.
 La parenthèse malgache, au fond, ne s’est jamais refermée. Expérience coloniale, elle se devine derrière l’opposition future de Paulhan en matière de décolonisation. Expérience linguistique, elle ne quittera plus jamais l’attention permanente de Paulhan aux mécanismes poétiques du langage, à la dimension du sacré non confessionnel qu’ils manifestent et au pouvoir des mots, musique et sens, dans la relation interindividuelle. En somme, cette thèse fatalement inaboutie lui révéla l’écrivain et le grand critique qu’il serait bientôt. Grâce aux deux nouveaux volumes des Œuvres complètes de Paulhan, admirablement conduites par Bernard Baillaud, c’est le grand arbitre de la République des lettres qui est enfin rendu à lui-même dans le respect de sa méthode, toute d’écoute à la singularité des œuvres, et dans la fidélité à son esprit, quintessence de celui de la NRF. On en rappelle le principe libertaire : en dehors des préventions envers la littérature sagement mondaine ou bêtement militante, il n’est aucune règle qui ne puisse être prise en défaut, aucune doctrine qui n’ait ses exceptions et ses ridicules. Paulhan se garde bien de s’en donner, des règles, veux-je dire. L’ordre alphabétique que suit Baillaud accuse cet éclectisme raisonné sans le trahir, l’abeille de sa curiosité se plaisait à voler de fleur en fleur, peu importait la teneur du pollen. Le ton professoral donnait des aigreurs, on le sait, à l’ami de Ponge, Grenier et Jouhandeau. Ces volumes le prouvent, s’agissant du premier Barthes, marxiste camouflé en mythologue du quotidien, ou des Temps modernes, trop contents d’occuper la place laisse vacante par la NRF épurée dès 1944. Avant de se porter au secours des autres excommuniés de la Libération, Paulhan interrogea les exclus du sérail littéraire, les oubliés, les recalés, Duranty, Vallés et Jules Renard parmi de moins illustres. Pourquoi le Panthéon national se montrait-il si exclusif ? Son cher Fénéon aimait Seurat et Gauguin du même cœur, avant de faire venir les futuristes à Paris. Enfant de sa génération plus que son père, Paulhan se moquait des antinomies scolaires et tenait presque les premiers poètes de l’esprit nouveau, des géniaux Apollinaire et Cendrars à Max Jacob, Reverdy et Salmon dont il parlait si bien, pour supérieurs aux surréalistes, dont il dénonça les préciosités sentencieuses, la moralité clanique, le courage physique à éclipses et le tournant communiste. Dès 1927, dans le sillage de la récente rupture de Drieu et en accord avec Artaud, qui épinglait cette année-là le «bluff surréaliste», Paulhan, note Baillaud, eut un avant-goût des débats de l’épuration. Le terrorisme qu’exerceraient les écrivains gagnés à la police politique moscovite n’avait plus besoin que des impulsions d’un conflit clivant.
La parenthèse malgache, au fond, ne s’est jamais refermée. Expérience coloniale, elle se devine derrière l’opposition future de Paulhan en matière de décolonisation. Expérience linguistique, elle ne quittera plus jamais l’attention permanente de Paulhan aux mécanismes poétiques du langage, à la dimension du sacré non confessionnel qu’ils manifestent et au pouvoir des mots, musique et sens, dans la relation interindividuelle. En somme, cette thèse fatalement inaboutie lui révéla l’écrivain et le grand critique qu’il serait bientôt. Grâce aux deux nouveaux volumes des Œuvres complètes de Paulhan, admirablement conduites par Bernard Baillaud, c’est le grand arbitre de la République des lettres qui est enfin rendu à lui-même dans le respect de sa méthode, toute d’écoute à la singularité des œuvres, et dans la fidélité à son esprit, quintessence de celui de la NRF. On en rappelle le principe libertaire : en dehors des préventions envers la littérature sagement mondaine ou bêtement militante, il n’est aucune règle qui ne puisse être prise en défaut, aucune doctrine qui n’ait ses exceptions et ses ridicules. Paulhan se garde bien de s’en donner, des règles, veux-je dire. L’ordre alphabétique que suit Baillaud accuse cet éclectisme raisonné sans le trahir, l’abeille de sa curiosité se plaisait à voler de fleur en fleur, peu importait la teneur du pollen. Le ton professoral donnait des aigreurs, on le sait, à l’ami de Ponge, Grenier et Jouhandeau. Ces volumes le prouvent, s’agissant du premier Barthes, marxiste camouflé en mythologue du quotidien, ou des Temps modernes, trop contents d’occuper la place laisse vacante par la NRF épurée dès 1944. Avant de se porter au secours des autres excommuniés de la Libération, Paulhan interrogea les exclus du sérail littéraire, les oubliés, les recalés, Duranty, Vallés et Jules Renard parmi de moins illustres. Pourquoi le Panthéon national se montrait-il si exclusif ? Son cher Fénéon aimait Seurat et Gauguin du même cœur, avant de faire venir les futuristes à Paris. Enfant de sa génération plus que son père, Paulhan se moquait des antinomies scolaires et tenait presque les premiers poètes de l’esprit nouveau, des géniaux Apollinaire et Cendrars à Max Jacob, Reverdy et Salmon dont il parlait si bien, pour supérieurs aux surréalistes, dont il dénonça les préciosités sentencieuses, la moralité clanique, le courage physique à éclipses et le tournant communiste. Dès 1927, dans le sillage de la récente rupture de Drieu et en accord avec Artaud, qui épinglait cette année-là le «bluff surréaliste», Paulhan, note Baillaud, eut un avant-goût des débats de l’épuration. Le terrorisme qu’exerceraient les écrivains gagnés à la police politique moscovite n’avait plus besoin que des impulsions d’un conflit clivant.
 Sous l’Occupation, l’attitude de Paulhan fut exemplaire en ceci qu’il joua sur deux tableaux sans jamais excuser l’un par l’autre : les Lettres françaises clandestines et le Comité National des Écrivains, d’un côté; la participation active à la vie littéraire, éditoriale et artistique, de l’autre. Y eut-il patriote mieux à même d’évaluer l’attitude des écrivains, de la presse, de leur éventuel ralliement à la Révolution nationale ou au parti de l’Allemagne ? De leur degré de culpabilité au-delà des circonstances ? Réfractaire à la pensée globale, fléau de notre triste époque et de sa relation malade au passé, Paulhan s’insurge, dès la fin 1944, contre ce qu’il appelle, en avril 1948, « la fâcheuse tendance de quelques écrivains contemporains à se transformer en policiers supplémentaires » (De la paille et du grain, Gallimard). Ces écrivains, ces « purs » qui avaient pour beaucoup participé du trouble des années noires, il les nomme dans l’extraordinaire Lettre aux Directeurs de la Résistance (Éditions de Minuit, 1952), ce sont Vercors, Aragon, Eluard et Sartre, qu’il n’aime décidément pas. Que la Libération ait trop souvent tourné à la « Revanche » et confondu les responsabilités individuelles si difficiles à établir dans une criminalisation généralisée, Jacques Boncompain en a donné de nouvelles preuves, en 2016, avec son étonnant Dictionnaire de l’épuration. Enfin sont documentées les enquêtes et radiations auxquelles se livra la Société des Gens de Lettres qui, en marge du CNL sous obédience communiste, entendait « laver son linge sale en famille » et se dota d’un comité distinct. La richesse de l’ouvrage, plus paulhanien que gaulliste, est inouïe et devrait faire son chemin parmi les recherches à venir. La masse étourdissante des témoignages de première main inexploités jette maints éclairages sur les conditions d’exercice de la littérature et de la presse après juin 1940. Si certains, tel André Thérive, répondent de leurs écrits en invoquant l’impératif de montrer une France «aucunement abattue par la défaite, au point de vue artistique et intellectuel», si un Cocteau se souvient des avanies que lui valurent son homosexualité et son usage soutenu des stupéfiants en ces temps de vertu retrouvée, la réponse de Chardonne, le 8 mars 1945, sidère malgré les précautions d’usage qui s’imposent au lecteur d’aujourd’hui. Le voyageur de Weimar ne s’attarde pas sur ses sympathies sincères pour l’Allemagne victorieuse et l’Europe anticapitaliste qu’elle promettait, on le comprend. Il énumère, en revanche, ses protections et son souci de les étendre aux écrivains qui ne pensaient pas nécessairement comme lui, en usant de l’Institut allemand et de Karl Epting pour neutraliser la Gestapo. Ainsi Chardonne dit s’être interposé deux fois en faveur de Duhamel, trois fois en faveur de Mauriac : « Deux fois je suis intervenu pour Marcel Arland et, d’une manière presque continuelle pour Paulhan, qui dirigeait un journal clandestin, ce que nul n’ignorait. » Sans parler de Max Jacob, délaissé par Picasso, et du mari de Colette qu’il fit libérer, chose documentée, il aurait aussi protégé Malraux et Aragon… La réécriture des années sombres, en ses ramifications inattendues, n’est pas achevée. Stéphane Guégan
Sous l’Occupation, l’attitude de Paulhan fut exemplaire en ceci qu’il joua sur deux tableaux sans jamais excuser l’un par l’autre : les Lettres françaises clandestines et le Comité National des Écrivains, d’un côté; la participation active à la vie littéraire, éditoriale et artistique, de l’autre. Y eut-il patriote mieux à même d’évaluer l’attitude des écrivains, de la presse, de leur éventuel ralliement à la Révolution nationale ou au parti de l’Allemagne ? De leur degré de culpabilité au-delà des circonstances ? Réfractaire à la pensée globale, fléau de notre triste époque et de sa relation malade au passé, Paulhan s’insurge, dès la fin 1944, contre ce qu’il appelle, en avril 1948, « la fâcheuse tendance de quelques écrivains contemporains à se transformer en policiers supplémentaires » (De la paille et du grain, Gallimard). Ces écrivains, ces « purs » qui avaient pour beaucoup participé du trouble des années noires, il les nomme dans l’extraordinaire Lettre aux Directeurs de la Résistance (Éditions de Minuit, 1952), ce sont Vercors, Aragon, Eluard et Sartre, qu’il n’aime décidément pas. Que la Libération ait trop souvent tourné à la « Revanche » et confondu les responsabilités individuelles si difficiles à établir dans une criminalisation généralisée, Jacques Boncompain en a donné de nouvelles preuves, en 2016, avec son étonnant Dictionnaire de l’épuration. Enfin sont documentées les enquêtes et radiations auxquelles se livra la Société des Gens de Lettres qui, en marge du CNL sous obédience communiste, entendait « laver son linge sale en famille » et se dota d’un comité distinct. La richesse de l’ouvrage, plus paulhanien que gaulliste, est inouïe et devrait faire son chemin parmi les recherches à venir. La masse étourdissante des témoignages de première main inexploités jette maints éclairages sur les conditions d’exercice de la littérature et de la presse après juin 1940. Si certains, tel André Thérive, répondent de leurs écrits en invoquant l’impératif de montrer une France «aucunement abattue par la défaite, au point de vue artistique et intellectuel», si un Cocteau se souvient des avanies que lui valurent son homosexualité et son usage soutenu des stupéfiants en ces temps de vertu retrouvée, la réponse de Chardonne, le 8 mars 1945, sidère malgré les précautions d’usage qui s’imposent au lecteur d’aujourd’hui. Le voyageur de Weimar ne s’attarde pas sur ses sympathies sincères pour l’Allemagne victorieuse et l’Europe anticapitaliste qu’elle promettait, on le comprend. Il énumère, en revanche, ses protections et son souci de les étendre aux écrivains qui ne pensaient pas nécessairement comme lui, en usant de l’Institut allemand et de Karl Epting pour neutraliser la Gestapo. Ainsi Chardonne dit s’être interposé deux fois en faveur de Duhamel, trois fois en faveur de Mauriac : « Deux fois je suis intervenu pour Marcel Arland et, d’une manière presque continuelle pour Paulhan, qui dirigeait un journal clandestin, ce que nul n’ignorait. » Sans parler de Max Jacob, délaissé par Picasso, et du mari de Colette qu’il fit libérer, chose documentée, il aurait aussi protégé Malraux et Aragon… La réécriture des années sombres, en ses ramifications inattendues, n’est pas achevée. Stéphane Guégan
Verbatim
« Je pense que la littérature apprend toujours à celui qui la fait à se voir lui-même et à voir le monde d’une façon plus précise et plus complète qu’il ne le faisait jusque-là. » (1965)
« Pour le reste, l’on a pu faire à Brasillach plus d’une critique. Il faut avouer qu’il a gardé un sens admirable de la formule, et du raccourci. Anarchique et scolaire, pouvait-on mieux dire ? C’est à la fois l’extrême indépendance, l’extrême discipline ; la hardiesse, mais la modération ; la liberté, mais l’obéissance. Si la NRF n’est pas encore digne d’un tel éloge, elle s’efforcera de le mériter. »‘ (1938)
Sur Drieu, Paulhan et leur correspondance (Claire Paulhan, 2017), voire Stéphane Guégan, « À Drieu ne plaise », Revue des deux mondes, avril 2108
*Charles Coustille, Antithèses. Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes, Gallimard, Bibliothèque des Idées, 24€.
*Jean Paulhan, Œuvres complètes IV, Critique littéraire, I et II, édition de Bernard Baillaud, Gallimard, 39,50€ et 39,50€. On y relira, entre mille autres, les pages consacrées à Roger Martin du Gard (1881-1958), homme de deux conflits aux blessures profondes (voir ses admirables Écritures de guerre, Gallimard, 2014), héritier de Duranty en pleine modernité, humble et délicat serviteur du roman comme acceptation stoïcienne de la vie. Peu importe qu’il écrive bien ou mal, dit Paulhan, ses personnages existent, persistent dans la mémoire. C’est que le pessimisme absolu de sa comédie humaine se tempère d’une bonté intangible, si préférable aux douteuses morales du siècle. Presque oublié depuis 1928, car non réuni aux Œuvres complètes de La Pléiade, Noizemont-Les-Vierges situe sur  cette ligne l’évocation mordorée de souvenirs d’enfance. Dernier été de la vie heureuse, les années 1890, avant la fin des grandes vacances, avant le nouveau siècle, ses menaces et son horreur… À la demande pressante d’un drôle d’éditeur belge, le romancier de Jean Barois met en musique des notes intimes, rédigées sous l’uniforme alors que s’éternisent la guerre de 14 et les lendemains de l’armistice, ce cap générationnel. La marche réglée des vieilles provinces, la tendresse voilée des aïeux, la grand-mère aveugle aux mille bibelots et photos, les jeux, les effrois et les sensations antérieurs à l’adolescence, tout y est exprimé en maître. Noizemont, c’est-à-dire Clermont-de-l’Oise du côté d’Amiens et de Beauvais, ce fut sa maison du Temps, son Combray. Du reste, le sourire aux lèvres, Roger Martin du Gard lance p. 79 un clin d’œil crypté à Proust, devenu l’étalon des fantômes chéris et des paradis perdus. Il fait aussi allusion, plus troublant, à la gravure qu’on avait accrochée au dessus de son petit lit, on y voyait « un beau jeune homme à demi-nu » happé par un énorme requin, « semblable aux sangsues du bassin ». Les amateurs auront reconnu la reproduction d’une toile fameuse de l’Américain Copley. Le monde des adultes se faisait les dents. SG / Roger Martin du Gard, Noizemont-Les-Vierges, édition établie, annotée et introduite par Thierry Gillyboeuf, Éditions Claire Paulhan, 16€
cette ligne l’évocation mordorée de souvenirs d’enfance. Dernier été de la vie heureuse, les années 1890, avant la fin des grandes vacances, avant le nouveau siècle, ses menaces et son horreur… À la demande pressante d’un drôle d’éditeur belge, le romancier de Jean Barois met en musique des notes intimes, rédigées sous l’uniforme alors que s’éternisent la guerre de 14 et les lendemains de l’armistice, ce cap générationnel. La marche réglée des vieilles provinces, la tendresse voilée des aïeux, la grand-mère aveugle aux mille bibelots et photos, les jeux, les effrois et les sensations antérieurs à l’adolescence, tout y est exprimé en maître. Noizemont, c’est-à-dire Clermont-de-l’Oise du côté d’Amiens et de Beauvais, ce fut sa maison du Temps, son Combray. Du reste, le sourire aux lèvres, Roger Martin du Gard lance p. 79 un clin d’œil crypté à Proust, devenu l’étalon des fantômes chéris et des paradis perdus. Il fait aussi allusion, plus troublant, à la gravure qu’on avait accrochée au dessus de son petit lit, on y voyait « un beau jeune homme à demi-nu » happé par un énorme requin, « semblable aux sangsues du bassin ». Les amateurs auront reconnu la reproduction d’une toile fameuse de l’Américain Copley. Le monde des adultes se faisait les dents. SG / Roger Martin du Gard, Noizemont-Les-Vierges, édition établie, annotée et introduite par Thierry Gillyboeuf, Éditions Claire Paulhan, 16€
*Jacques Boncompain, Dictionnaire de l’épuration des gens de lettres 1939-1949 « Mort aux confrères ! », préface de Henri-Christian Giraud, Honoré Champion Éditeur, 2016, 70€. Signalons enfin le vaste et très utile travail de synthèse de deux historiens français, partisans d’une histoire « genrée » et sensibles (trop ?) à l’historiographie anglo-saxonne, François Rouquet et Fabrice Virgili, Les Françaises, les Français et  l’Épuration. De 1940 à nos jours (Folio Histoire, Gallimard, 11,90€), non pour les couacs de la chronologie finale : nulle mention de Brasillach fusillé le 6 février 1945, nulle mention des deux livres de Paulhan en réaction à la répression excessive des écrivains, etc. On rappellera aussi que Drieu ne s’est pas auto-épuré, le 15 mars 1945, « en prison » ! Reconnaissant que les premiers moments de la Libération donnèrent souvent carrière à toute sortes d’excès et de fureurs inacceptables, déni de justice paradoxal dont les femmes tondues et mises à nu par centaines restent le symbole glorieux, ils apportent surtout du neuf au sujet des premiers pas de la grande Epuration, qui eut notamment pour théâtre les terres libérées d’un empire d’Afrique qu’on souhaitait, de De Gaulle aux communistes, maintenir dans le giron français. Excellentes, du reste, sont les pages sur le procès et la liquidation de Pierre Pucheu, vitrines et même générales médiatisées des grands châtiments à venir. SG
l’Épuration. De 1940 à nos jours (Folio Histoire, Gallimard, 11,90€), non pour les couacs de la chronologie finale : nulle mention de Brasillach fusillé le 6 février 1945, nulle mention des deux livres de Paulhan en réaction à la répression excessive des écrivains, etc. On rappellera aussi que Drieu ne s’est pas auto-épuré, le 15 mars 1945, « en prison » ! Reconnaissant que les premiers moments de la Libération donnèrent souvent carrière à toute sortes d’excès et de fureurs inacceptables, déni de justice paradoxal dont les femmes tondues et mises à nu par centaines restent le symbole glorieux, ils apportent surtout du neuf au sujet des premiers pas de la grande Epuration, qui eut notamment pour théâtre les terres libérées d’un empire d’Afrique qu’on souhaitait, de De Gaulle aux communistes, maintenir dans le giron français. Excellentes, du reste, sont les pages sur le procès et la liquidation de Pierre Pucheu, vitrines et même générales médiatisées des grands châtiments à venir. SG




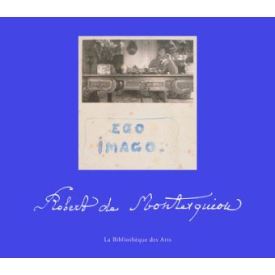
















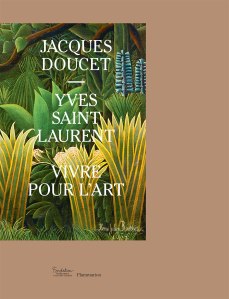




 Jordaens est entré dans le cœur des Français dès la fin du XVIIe siècle pour ne jamais plus en sortir. On s’étonne donc qu’il ait fallu attendre plus de 300 ans la sublime rétrospective du Petit Palais. Dans l’intervalle, évidemment, la perception de l’artiste s’est transformée du tout au tout. En 1699, alors que la «querelle du coloris» fait rage, Roger de Piles reconnaît à Jordaens une «manière» de son invention, une manière qu’il qualifie de «forte, de vraie et de suave» et qui appelle le souffle des «grands tableaux». Cette puissance de pinceau et d’effet, érotique et dramatique selon les sujets qu’elle fait vibrer sur la toile, résulterait de deux sources d’inspiration fondues par le génie flamand, la Venise de Véronèse dialoguant vigoureusement avec le réalisme du
Jordaens est entré dans le cœur des Français dès la fin du XVIIe siècle pour ne jamais plus en sortir. On s’étonne donc qu’il ait fallu attendre plus de 300 ans la sublime rétrospective du Petit Palais. Dans l’intervalle, évidemment, la perception de l’artiste s’est transformée du tout au tout. En 1699, alors que la «querelle du coloris» fait rage, Roger de Piles reconnaît à Jordaens une «manière» de son invention, une manière qu’il qualifie de «forte, de vraie et de suave» et qui appelle le souffle des «grands tableaux». Cette puissance de pinceau et d’effet, érotique et dramatique selon les sujets qu’elle fait vibrer sur la toile, résulterait de deux sources d’inspiration fondues par le génie flamand, la Venise de Véronèse dialoguant vigoureusement avec le réalisme du  Difficile de quitter les rives de
Difficile de quitter les rives de  Que la part du lion y revienne à Masson ne fait que souligner une vérité bonne à redire : des peintres qui eurent à se féliciter et à souffrir tour à tour du magistère de Breton, il est sans doute le peintre lettré par excellence. C’est en février 1924 que se rencontrent les deux hommes. La carrière commerciale de
Que la part du lion y revienne à Masson ne fait que souligner une vérité bonne à redire : des peintres qui eurent à se féliciter et à souffrir tour à tour du magistère de Breton, il est sans doute le peintre lettré par excellence. C’est en février 1924 que se rencontrent les deux hommes. La carrière commerciale de  Autre Juif allemand au destin incroyable, Erwin Blumenfeld, dont le Jeu de Paume évoque chaque métamorphose, pour la première fois, sur un pied d’égalité. N’y voyons pas facile provocation. Dès les années 1920, dans l’effervescence et les nouvelles menaces de l’après-guerre, le jeune Blumenfeld, exilé à Amsterdam puis à Paris, laisse ses dessins volontairement enfantins faire émerger les thèmes qu’il ne quitterait plus, l’Eros bestial, l’antisémitisme, la pratique du collage sans filet et une certaine fascination pour l’humour dévastateur de Chaplin. Qu’un dadaïste de la première heure ait pu se révéler un photographe de mode dès la fin des années 1930, qu’un fanatique du noir et blanc arty ait autant utilisé la couleur dans les années 1950-1960, voilà au moins deux raisons de se pencher sur son cas. À mi-distance de l’iconoclasme
Autre Juif allemand au destin incroyable, Erwin Blumenfeld, dont le Jeu de Paume évoque chaque métamorphose, pour la première fois, sur un pied d’égalité. N’y voyons pas facile provocation. Dès les années 1920, dans l’effervescence et les nouvelles menaces de l’après-guerre, le jeune Blumenfeld, exilé à Amsterdam puis à Paris, laisse ses dessins volontairement enfantins faire émerger les thèmes qu’il ne quitterait plus, l’Eros bestial, l’antisémitisme, la pratique du collage sans filet et une certaine fascination pour l’humour dévastateur de Chaplin. Qu’un dadaïste de la première heure ait pu se révéler un photographe de mode dès la fin des années 1930, qu’un fanatique du noir et blanc arty ait autant utilisé la couleur dans les années 1950-1960, voilà au moins deux raisons de se pencher sur son cas. À mi-distance de l’iconoclasme  Les anniversaires en ce début d’année nous bousculent. Après Le Sacre et ses tempi affolés, Alcools et son ivresse indémodable. Stravinsky, Apollinaire, 1913… Il ne manque que la réouverture du
Les anniversaires en ce début d’année nous bousculent. Après Le Sacre et ses tempi affolés, Alcools et son ivresse indémodable. Stravinsky, Apollinaire, 1913… Il ne manque que la réouverture du  Le livre de Campa, énorme et léger, érudit et vif, maîtrise une information confondante sans y noyer son lecteur. Nombreux et périlleux étaient pourtant les obstacles à surmonter. La Belle époque ne bute-t-elle pas sur la méconnaissance, de plus en en plus répandue, de notre histoire politique? La poésie, elle, n’attire guère les foules, encore moins celle d’une période que l’on présente habituellement comme intermédiaire entre le symbolisme et le surréalisme. Et que dire du milieu pictural, si ouvert et cosmopolite, dont Apollinaire fut l’un des acteurs et des témoins essentiels ! Comment aborder enfin le nationalisme particulier de ce «Russe», né en Italie de père inconnu, et fier de défendre l’art français avant de se jeter dans la guerre de 14 par anti-germanisme ? Or la biographie de Campa ne se laisse jamais déborder par l’ampleur qu’elle s’assigne et la qualité d’écriture qu’elle s’impose. On ne saurait oublier la difficulté majeure de l’entreprise, Apollinaire lui-même et sa méfiance instinctive, nietzschéenne, des catégories auxquelles la librairie française obéissait servilement. Ce n’était pas son moindre charme aux yeux de Picasso. Pour avoir refusé la pensée unique et la tyrannie de l’éphémère, ces dieux du XXe siècle, l’écrivain et le critique d’art restent donc difficiles à saisir. Nos codes s’affolent à sa lecture. Il faut pourtant l’accepter en bloc. On aimerait tant qu’il ait prêché le modernisme sans retenue, au mépris de ce que l’art du jour mettait justement en péril, dans une adhésion totale à chacune des nouveautés dont se réclamaient ses contemporains. Entre 1898 et 1918, de la mort de Mallarmé à la sienne, il fut pourtant tout autre chose que le chantre abusé des avant-gardes européennes.
Le livre de Campa, énorme et léger, érudit et vif, maîtrise une information confondante sans y noyer son lecteur. Nombreux et périlleux étaient pourtant les obstacles à surmonter. La Belle époque ne bute-t-elle pas sur la méconnaissance, de plus en en plus répandue, de notre histoire politique? La poésie, elle, n’attire guère les foules, encore moins celle d’une période que l’on présente habituellement comme intermédiaire entre le symbolisme et le surréalisme. Et que dire du milieu pictural, si ouvert et cosmopolite, dont Apollinaire fut l’un des acteurs et des témoins essentiels ! Comment aborder enfin le nationalisme particulier de ce «Russe», né en Italie de père inconnu, et fier de défendre l’art français avant de se jeter dans la guerre de 14 par anti-germanisme ? Or la biographie de Campa ne se laisse jamais déborder par l’ampleur qu’elle s’assigne et la qualité d’écriture qu’elle s’impose. On ne saurait oublier la difficulté majeure de l’entreprise, Apollinaire lui-même et sa méfiance instinctive, nietzschéenne, des catégories auxquelles la librairie française obéissait servilement. Ce n’était pas son moindre charme aux yeux de Picasso. Pour avoir refusé la pensée unique et la tyrannie de l’éphémère, ces dieux du XXe siècle, l’écrivain et le critique d’art restent donc difficiles à saisir. Nos codes s’affolent à sa lecture. Il faut pourtant l’accepter en bloc. On aimerait tant qu’il ait prêché le modernisme sans retenue, au mépris de ce que l’art du jour mettait justement en péril, dans une adhésion totale à chacune des nouveautés dont se réclamaient ses contemporains. Entre 1898 et 1918, de la mort de Mallarmé à la sienne, il fut pourtant tout autre chose que le chantre abusé des avant-gardes européennes. Fils d’une aventurière, une de ces Polonaises en perpétuel exil qui vivaient de leur charme et de leur intelligence sur la Riviera, Wilhelm de Kostrowitzky a fait de brillantes études avant de convertir son goût des livres en puissance littéraire. D’un lycée à l’autre, au gré des finances aléatoires de sa jolie maman, il s’acoquine à quelques adolescents grandis aussi vite que lui. Certains devaient croiser ses pas plus tard, et se faire un nom à Paris. Sur le moment, on partage déjà tout, les livres interdits,
Fils d’une aventurière, une de ces Polonaises en perpétuel exil qui vivaient de leur charme et de leur intelligence sur la Riviera, Wilhelm de Kostrowitzky a fait de brillantes études avant de convertir son goût des livres en puissance littéraire. D’un lycée à l’autre, au gré des finances aléatoires de sa jolie maman, il s’acoquine à quelques adolescents grandis aussi vite que lui. Certains devaient croiser ses pas plus tard, et se faire un nom à Paris. Sur le moment, on partage déjà tout, les livres interdits,
 Mais le piège des Italiens ne se refermera pas sur Apollinaire, qui reconnaît les vertus roboratives du futurisme. Ainsi son enthousiasme pour Delaunay et la peinture simultanée doit-il s’évaluer à l’aune des tensions du milieu de l’art parisien, gagné par la surchauffe patriotique de l’avant-guerre. En mars 1913, lors du Salon des Indépendants,
Mais le piège des Italiens ne se refermera pas sur Apollinaire, qui reconnaît les vertus roboratives du futurisme. Ainsi son enthousiasme pour Delaunay et la peinture simultanée doit-il s’évaluer à l’aune des tensions du milieu de l’art parisien, gagné par la surchauffe patriotique de l’avant-guerre. En mars 1913, lors du Salon des Indépendants,  De cette guerre, tellement moderne par son alliance de haute technologie et de bas instincts, de mélancolie et d’énergie, de peur et de surpassement de soi, Apollinaire va traduire les tristesses et les beautés. Il en fut l’Ovide et l’Homère. Aux poèmes de l’absence et de l’attente répond l’éclat paradoxal, explosif, de certains calligrammes, qui ont tant fait pour rejeter leur auteur parmi les suppôts d’un «patriotisme niais» ou d’une virilité risible. Il faut croire que notre génération, celle de Laurence Campa, n’a plus de telles préventions à l’égard du poète en uniforme ! Lequel, comme Campa le montre aussi, n’oublie pas le front des arts jusqu’en 1918 (il meurt un jour avant l’armistice !). Ajournés pour cause de conflit, Les Trois Don Juan paraissent en 1915. Là où Apollinaire voyait ou affectait de voir un expédient alimentaire, le lecteur d’aujourd’hui découvre avec bonheur une des plus heureuses divagations, drôles et érotiques à la fois, sur ce grand d’Espagne, obsédé de femmes et repoussant la mort et l’impossible à travers elles. Cette fantaisie admirable, qui absorbe Molière comme Byron sans le moindre scrupule, respire, au plus fort du conflit, l’immoralisme des Onze mille verges… Après son retour du front, le trépané va accumuler les aventures les plus audacieuses, signer des préfaces, seconder les galeries qui se lancent ou se réveillent. Adulé par la nouvelle génération, du Nord/Sud de Reverdy à
De cette guerre, tellement moderne par son alliance de haute technologie et de bas instincts, de mélancolie et d’énergie, de peur et de surpassement de soi, Apollinaire va traduire les tristesses et les beautés. Il en fut l’Ovide et l’Homère. Aux poèmes de l’absence et de l’attente répond l’éclat paradoxal, explosif, de certains calligrammes, qui ont tant fait pour rejeter leur auteur parmi les suppôts d’un «patriotisme niais» ou d’une virilité risible. Il faut croire que notre génération, celle de Laurence Campa, n’a plus de telles préventions à l’égard du poète en uniforme ! Lequel, comme Campa le montre aussi, n’oublie pas le front des arts jusqu’en 1918 (il meurt un jour avant l’armistice !). Ajournés pour cause de conflit, Les Trois Don Juan paraissent en 1915. Là où Apollinaire voyait ou affectait de voir un expédient alimentaire, le lecteur d’aujourd’hui découvre avec bonheur une des plus heureuses divagations, drôles et érotiques à la fois, sur ce grand d’Espagne, obsédé de femmes et repoussant la mort et l’impossible à travers elles. Cette fantaisie admirable, qui absorbe Molière comme Byron sans le moindre scrupule, respire, au plus fort du conflit, l’immoralisme des Onze mille verges… Après son retour du front, le trépané va accumuler les aventures les plus audacieuses, signer des préfaces, seconder les galeries qui se lancent ou se réveillent. Adulé par la nouvelle génération, du Nord/Sud de Reverdy à  8 avril 1973, il y a 40 ans à cette minute précise, mort de Picasso. Personne ne pouvait y croire, nul ne voulait y croire. Il occupait la scène, de sa présence écrasante, depuis si longtemps. C’était comme voir mourir le XXe siècle trop tôt. Sa disparition surprit d’autant plus que Pablo mourait debout, en lion, après avoir secoué la vieille crinière gothique de la chapelle du palais des Papes. Les plus jeunes ont sans doute oublié le vacarme provoqué par ses dernières œuvres en mai 1970, explosion incontrôlable de toreros outrageusement enfantins, d’Arlequins farcesques et de nus sexués ad libitum. On aurait dit que l’Eros picassien déchirait son lit éternel, débordait, emportait tout, le sujet et les formes dans sa folie. Sénile, dira la vieille garde. Juvénile, répondront les aficionados. L’Humanité, le 8 mai 1970, titre «Pablo Picasso, cet indomptable». Jeannine Warnod, côté Figaro, parle d’«action-painting» sans confondre frénésie et hasard. Picasso voulait-il en découdre avec les Américains et l’idée que la modernité était devenue leur domaine réservé en trente ans ? Sans doute. À quoi, du reste, comparer cette lave que la chapelle d’Avignon ne pouvait contenir ?
8 avril 1973, il y a 40 ans à cette minute précise, mort de Picasso. Personne ne pouvait y croire, nul ne voulait y croire. Il occupait la scène, de sa présence écrasante, depuis si longtemps. C’était comme voir mourir le XXe siècle trop tôt. Sa disparition surprit d’autant plus que Pablo mourait debout, en lion, après avoir secoué la vieille crinière gothique de la chapelle du palais des Papes. Les plus jeunes ont sans doute oublié le vacarme provoqué par ses dernières œuvres en mai 1970, explosion incontrôlable de toreros outrageusement enfantins, d’Arlequins farcesques et de nus sexués ad libitum. On aurait dit que l’Eros picassien déchirait son lit éternel, débordait, emportait tout, le sujet et les formes dans sa folie. Sénile, dira la vieille garde. Juvénile, répondront les aficionados. L’Humanité, le 8 mai 1970, titre «Pablo Picasso, cet indomptable». Jeannine Warnod, côté Figaro, parle d’«action-painting» sans confondre frénésie et hasard. Picasso voulait-il en découdre avec les Américains et l’idée que la modernité était devenue leur domaine réservé en trente ans ? Sans doute. À quoi, du reste, comparer cette lave que la chapelle d’Avignon ne pouvait contenir ?  D’un bilan l’autre. Passons à l’intrigante exposition du Kunstmuseum de Bâle, dont le titre prometteur ne réserve aucune désillusion. Il est donc vrai que les collections bâloises peuvent raisonnablement s’enorgueillir de chefs-d’œuvre du peintre. Ce n’est que justice. Les musées suisses au cours des années 1930 se sont montrés d’une rare audace à son endroit. L’événement le plus symbolique reste la rétrospective organisée par le Kunsthaus de Zurich fin 1932, alors que la crise affecte lourdement les valeurs sûres du marché de l’art. Et Picasso en est une. Bâle va très vite occuper un rôle de premier plan dans ce processus, qui se double de l’intérêt que lui témoignaient les meilleurs collectionneurs depuis les années 1920. Raoul La Roche, dont le nom est indissociable du Kunstmuseum de Bâle, accumula les toiles cubistes entre 1921 et 1928 ; en pleine guerre de 14, l’entrepreneur Rudolf Staechelin étoffa ses murs des Deux frères, sommet de la période rose, avant d’acquérir, auprès de Paul Rosenberg, une autre perle, l’Arlequin assis de 1923. La même année, son ami Im Obersteg, achetait au marchand parisien son propre Arlequin. Dans le catalogue de l’exposition, Anita Haldemann et Nina Zimmer ont mille autres anecdotes et informations à nous raconter. À l’évidence, à partir du milieu des années 1950, alors que l’œuvre de Picasso prenait à nouveau un tour déconcertant, Ernst Beyeler donna un second souffle à cette passion bâloise. Deux des tableaux essentiels de l’exposition viennent de la fondation qui porte son nom, Chat et homard, variation hallucinée sur La Raie de Chardin, et Le Nu couché jouant avec un chat, clin d’œil décomplexé à Olympia. Oui, The Picassos are here, comme le dit l’affiche de Bâle !
D’un bilan l’autre. Passons à l’intrigante exposition du Kunstmuseum de Bâle, dont le titre prometteur ne réserve aucune désillusion. Il est donc vrai que les collections bâloises peuvent raisonnablement s’enorgueillir de chefs-d’œuvre du peintre. Ce n’est que justice. Les musées suisses au cours des années 1930 se sont montrés d’une rare audace à son endroit. L’événement le plus symbolique reste la rétrospective organisée par le Kunsthaus de Zurich fin 1932, alors que la crise affecte lourdement les valeurs sûres du marché de l’art. Et Picasso en est une. Bâle va très vite occuper un rôle de premier plan dans ce processus, qui se double de l’intérêt que lui témoignaient les meilleurs collectionneurs depuis les années 1920. Raoul La Roche, dont le nom est indissociable du Kunstmuseum de Bâle, accumula les toiles cubistes entre 1921 et 1928 ; en pleine guerre de 14, l’entrepreneur Rudolf Staechelin étoffa ses murs des Deux frères, sommet de la période rose, avant d’acquérir, auprès de Paul Rosenberg, une autre perle, l’Arlequin assis de 1923. La même année, son ami Im Obersteg, achetait au marchand parisien son propre Arlequin. Dans le catalogue de l’exposition, Anita Haldemann et Nina Zimmer ont mille autres anecdotes et informations à nous raconter. À l’évidence, à partir du milieu des années 1950, alors que l’œuvre de Picasso prenait à nouveau un tour déconcertant, Ernst Beyeler donna un second souffle à cette passion bâloise. Deux des tableaux essentiels de l’exposition viennent de la fondation qui porte son nom, Chat et homard, variation hallucinée sur La Raie de Chardin, et Le Nu couché jouant avec un chat, clin d’œil décomplexé à Olympia. Oui, The Picassos are here, comme le dit l’affiche de Bâle ! On aurait tort de sourire des résistances que suscita le dernier Picasso. Elles furent aussi le fait des plus éminents esprits du siècle passé, comme le rappelle l’ambitieuse synthèse de Serge Linarès sur les écrivains qui contribuèrent largement à façonner la statue du commandeur. Il est heureux qu’un éditeur, Citadelles en l’occurrence, ait confié à un spécialiste de Cocteau, éditeur de La Pléiade, la tâche de documenter et d’éclairer pareil sujet. Pour le dire d’un mot, Picasso fut aux écrivains de son temps ce que seul Manet, au XIXe siècle, fut aux siens. Linarès, dès son introduction, extrait cette phrase du livre que Gertrude Stein, consacrait en 1938 au peintre qu’elle avait commencé à collectionner trente ans plus tôt : «Ses amis, il les choisit bien plus parmi les écrivains que parmi les peintres.» Les écrivains français, aurait-elle pu préciser si ses origines américaines n’avaient pas vaincu ici sa passion pour leur pays d’adoption. Car Picasso,
On aurait tort de sourire des résistances que suscita le dernier Picasso. Elles furent aussi le fait des plus éminents esprits du siècle passé, comme le rappelle l’ambitieuse synthèse de Serge Linarès sur les écrivains qui contribuèrent largement à façonner la statue du commandeur. Il est heureux qu’un éditeur, Citadelles en l’occurrence, ait confié à un spécialiste de Cocteau, éditeur de La Pléiade, la tâche de documenter et d’éclairer pareil sujet. Pour le dire d’un mot, Picasso fut aux écrivains de son temps ce que seul Manet, au XIXe siècle, fut aux siens. Linarès, dès son introduction, extrait cette phrase du livre que Gertrude Stein, consacrait en 1938 au peintre qu’elle avait commencé à collectionner trente ans plus tôt : «Ses amis, il les choisit bien plus parmi les écrivains que parmi les peintres.» Les écrivains français, aurait-elle pu préciser si ses origines américaines n’avaient pas vaincu ici sa passion pour leur pays d’adoption. Car Picasso,  Linarès y reconnaît «un fait de société» récurrent depuis le romantisme, «la constitution d’une collectivité artistique mêlant les artisans du verbe et de l’image». D’où le ballet incessant des écrivains et poètes autour de Picasso, au moins jusqu’à la fin des années 1960. À tous ce livre fait une place en dissociant, non sans mal, les purs créateurs des plumes gagnées à la critique d’art professionnelle, de Salmon et Reverdy à
Linarès y reconnaît «un fait de société» récurrent depuis le romantisme, «la constitution d’une collectivité artistique mêlant les artisans du verbe et de l’image». D’où le ballet incessant des écrivains et poètes autour de Picasso, au moins jusqu’à la fin des années 1960. À tous ce livre fait une place en dissociant, non sans mal, les purs créateurs des plumes gagnées à la critique d’art professionnelle, de Salmon et Reverdy à