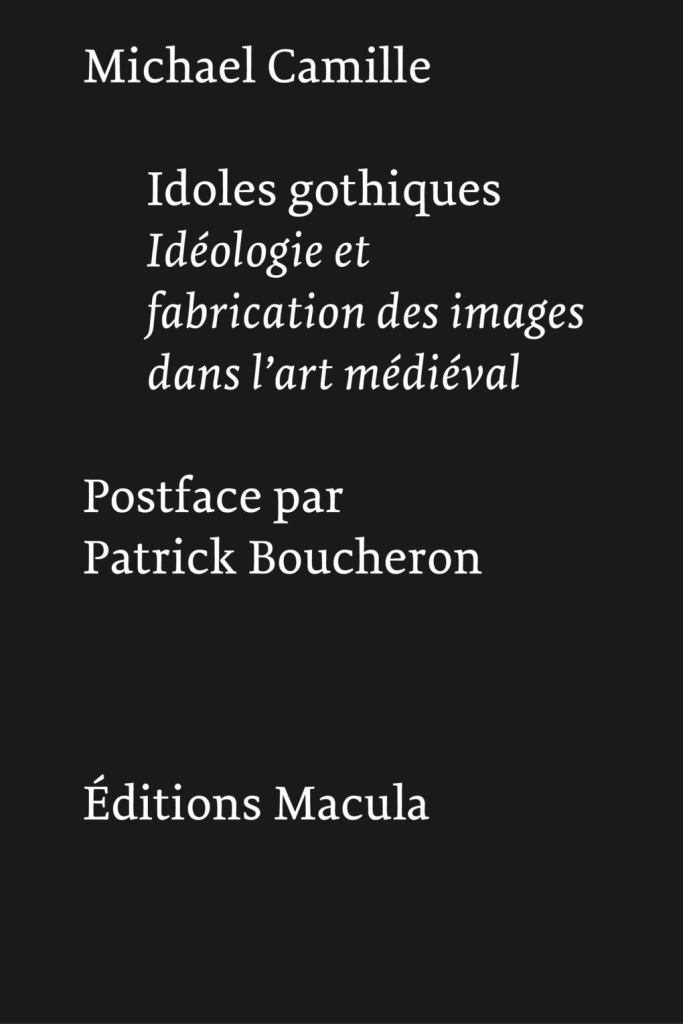Le Moyen Âge de la poésie amoureuse et du divin à hauteur de cœur, vécu dans l’intimité des mots, des sons et des images, ne s’est jamais mieux porté, à lire les contributeurs de ce beau volume, merveilleusement illustré et conforme à son objet. Ut musica poesis : une certaine pratique de la poésie, sous l’Antiquité déjà, vise moins à la dire qu’à la chanter, la danser, voire la montrer. Du XIIe siècle des Troubadours au début de ce que l’on nomme la Renaissance, l’aspiration lyrique rime avec l’aspiration, sensible dans les manuscrits et livres pré-gutemberguiens, à donner un corps, un espace et parfois une couleur aux lettres qui débordent souvent les limites de la lecture instrumentale. Il arrive que certains livres, indifféremment profane ou sacré, épousent la forme de cet organe à qui nous devons la vie et où l’imaginaire occidental loge le foyer des sentiments. Bien avant Apollinaire et ses calligrammes, on peint avec les mots, et l’art d’aujourd’hui, revendiquant d’autres filiations loin du modernisme idiot, redistribue l’alliance du verbe, de l’ouïe et du voir, et de l’émouvoir, de mille façons. Stéphane Guégan / Nathalie Koble et Amandine Mussou (dir.), Ut musica poesis. Poésie visuelle et sonore au Moyen Âge et aujourd’hui, Editions Macula, 42€.

Ah que les princes, les rois et leurs avatars récents ont l’oreille fine ! Comme ils savent s’entourer des musiciens que la postérité les félicitera d’avoir protégés et pensionnés ! Et ne croyez pas que la fin de l’Ancien régime ait mis fin à cette association du sceptre et des enfants d’Euterpe. Etymologiquement, la muse de la musique, en Grèce ancienne, renvoyait à la faculté de plaire. Le danger de confondre plaisir et complaisance ne date donc pas d’hier, de même que la tendance à indifférencier flagornerie et narcissisme. Maryvonne de Saint Pulgent, avec la clarté incisive qu’elle imprime à tous ses livres, s’intéresse et parfois s’attaque à la courtisanerie des musiciens officiels, de Lully à Boulez. Sacrilège, dira-t-on depuis les espaces sonores de l’art assisté. Saint Boulez repeint en nouveau Lully, la perruque en moins, voilà qui indigne (pour faire écho à un pamphlet de désagréable mémoire). Encore la comparaison conserve-t-elle une part de flatterie, en laissant penser que les deux compositeurs étaient d’égale valeur, ce que le catalogue de Boulez ne permet de penser qu’à ses afficionados. Malraux n’en était pas, lui qui croyait pourtant au dirigisme étatique en matière de culture. Outre sa dilection pour les arcanes du régalien, Maryvonne de Saint Pulgent connaît si bien la musique qu’elle résume en 400 pages alertes ses épousailles avec le pouvoir. Il est, certes, des époques moins portées à la régulation verticale. Par exemple, le règne de Louis-Philippe, au grand dam de Berlioz, ne couronne aucun compositeur, laissant juges les amateurs. Jusqu’au XXe siècle, l’argent public à travers les vecteurs institutionnels constitue l’essentielle contribution d’en haut. Si le mécénat d’Etat ultérieur, en temps de crise économique ou politique, se montre plus interventionniste à l’occasion, peu d’exemples de comportements dictatoriaux, en dehors de Boulez, seront à dénombrer. Afin de conclure, l’auteur cite Pascal Ory, bien placé en raison de sa connaissance du Front populaire et de son intervention dans l’affaire Karol Beffa, qui actait, en 2014, la fin d’un monopole du goût et des Verdurin de « la contemporaine ». Le regretté Benoît Duteurtre, cauchemar du Monde et de la bienpensance, en croisant le fer, aura aiguisé sa verve. SG / Maryvonne de Saint Pulgent, Les Musiciens et le pouvoir en France. De Lully à Boulez, Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 35€.

Ennemi juré de Berlioz, Paul Scudo lui porta le coup de grâce lors de son entrée, en 1856, à l’Académie des Beaux-Arts. La plume de la Revue des deux mondes prit ainsi un plaisir certain à féliciter l’Institut d’accueillir sous son toit un nouvel écrivain, à défaut d’un musicien digne du nom. Pour être très excessif, notre Vénitien francisé soulignait cruellement une évidence, la République des lettres avait mille raisons de tenir pour sien le polygraphe chevelu. Qui a lu Berlioz connaît son aisance à raconter ses malheurs, peindre ses impressions de voyage, louer et souvent étriller ses confrères, dès avant le Second Empire. Il faut le compter parmi les plus éminents critiques musicaux de son temps (6000 pages), et un épistolier de première grandeur (7 volumes épais). Ce vaste corpus étant désormais réuni, annoté et commenté des deux côtés de la Manche (l’Angleterre, qu’il a chérie, l’adore et le joue plus que nous), une étude d’ensemble s’avérait tentante. Le grand gautiériste François Brunet, fin musicologue à ses heures (Théophile Gautier et la musique, Honoré Champion, 2006), n’a pas résisté à l’envoutement, que Pierre Citron, l’homme de Balzac et Giono, avait subi avant lui. Mais son livre garde la tête froide et, après une étude précieuse de la rhétorique berliozienne, aborde successivement les genres propres à l’activité scripturale, inlassable, souvent orageuse ou dépitée, du musicien « malheureux ». Elève de Lesueur (chouchou de Napoléon Ier), celui que Gautier présentait comme le Delacroix de son art professait de classiques convictions, il resta gluckiste en pleine révolution wagnérienne (Baudelaire le lui reproche). Pourtant Berlioz aime aussi les longues phrases, et pas seulement quand il mélodise avec génie (Les Nuits d’été, once more, sur des poèmes de Gautier). Brunet s’intéresse moins au parcours politique, qu’analyse Maryvonne de Saint Pulgent dans un chapitre aigre-doux de son livre. Notre homme débuta aux côtés de la presse ultra, avant 1830, oublia ensuite son légitimisme, fit la moue en 1848, se félicita du coup d’Etat en décembre 1850, mais souffrit sous l’Empire de sa réputation d’orléaniste. L’éternel ballotté, l’incurable déçu, assez mal en cour par ses maladresses, ne fut pas le Boulez du romantisme. On peut s’en réjouir. SG / François Brunet, Hector Berlioz, épistolier, journaliste, librettiste et mémorialiste, Honoré Champion, 88€.

J’ai toujours pensé que Manet avait lu et conservé en mémoire l’époustouflante recension de la première du Hamlet d’Ambroise Thomas dont le Moniteur universel donna lecture le 16 mars 1867. Bien entendu, c’est Gautier qui tient la plume, note les diminuendos surnaturels de la scène inaugurale du spectre, met à sa place ce musicien plus grave que frénétique, comme pour mieux souligner la fièvre de l’immense baryton Jean-Baptiste Faure, l’égal de l’acteur shakespearien Rouvière quant à l’énergie noire. Passer de celui-ci à celui-là, c’est passer d’un tableau de Manet (notre illustration) à un autre, et rendre le peintre à sa culture scénique et romantique. En cette fin du Second Empire, la chronique théâtrale de Gautier, dont nous avons parlé à maintes reprises, embrasse l’actualité musicale. Le poète cher à Ezra Pound profite ainsi d’une reprise partielle du Roméo et Juliette de Berlioz pour le qualifier, lui, de « shakespearien ». La mort allant vite, Théo devait signer la nécrologie de celui qui, né sous une étoile enragée, n’avait jamais vraiment conquis le grand public, à l’exception du succès de L’Enfance du Christ (son chef-d’œuvre, il est vrai, avec les Nuits d’été). On sent ailleurs le poète plus conquis. Ainsi accueille-t-il avec chaleur un inconnu, qui ne le restera pas longtemps, en janvier 1868. La Jolie fille de Perth vient d’être donné au Théâtre-Lyrique, rival de l’Opéra : « M. Bizet appartient à la nouvelle école musicale et a rompu avec les airs de facture, les strette, les cabalette et toutes les vieilles formules. Il poursuit la mélopée d’un bout à l’autre de la situation et ne coupe pas en petits motifs faciles à chantonner en sortant du théâtre. Richard Wagner doit être son maître favori, et nous l’en félicitons. » Encouragé par sa fille Judith et par Baudelaire, Théophile aura secondé le wagnérisme français, électrochoc et pathologie, mais sans sacrifier au culte encombrant la musique française et la nouveauté verdienne, très présente dans le tome XIX de ses admirables pages de journalisme dramatique. SG / Théophile Gautier, Œuvres complètes. Critique théâtrale, tome XIX, juin 1867-mai 1869, texte établi, présenté et annoté par Patrick Berthier, Honoré Champion, 125€.
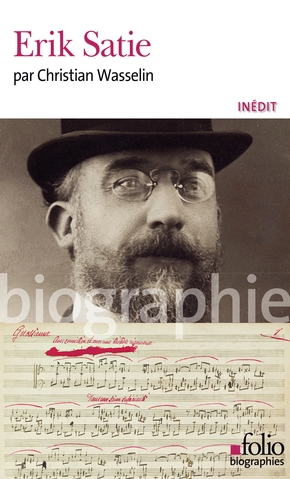
Les incompatibilités d’antan n’ont plus force de loi au XXIe siècle. Prenez Christian Wasselin, éminent connaisseur de la chose musicale. Tout berliozien et mahlérien qu’il soit, il nous donne une vie de Satie, mort il y a cent ans, qui confirme son aptitude à la biographie malicieuse et son peu d’aversion pour la ligne claire. Le natif d’Honfleur (ville bénie, on le sait), l’exilé de la rue Cortot (où il logea ses amours avec Suzanne Valadon), le faux ermite d’Arcueil personnifie, à côté de Chabrier, Debussy et Satie, ce qui est arrivé de mieux à notre musique depuis l’indépassable Rameau. Lui-même préférait, on le comprend, Chopin à Wagner, sans rester étanche aux sirènes de Bayreuth. Peu de musiciens ont été portraiturés autant que lui, selon les pointillés par Antoine La Rochefoucauld, en héritier de Verlaine par la colonie des Espagnols de Paris, ou en pianiste du Chat noir. Le secret de son génie tient en partie aux correspondances qu’il affectionnait, lui le grand lecteur, lui l’iconophile, pareil en cela à Debussy, qui fit tant pour lui. Et puis, évidemment, il y eut le choc de Parade. C’est Cocteau qui le pousse, rêve longtemps caressé, de coudre ensemble la Sparte des Gymnopédies et le forain de Toulouse-Lautrec, Morand l’a bien compris Né en dehors de l’Ecole, Satie en remontrait toutefois aux élèves trop sages. Il avait, d’ailleurs, quelques années de conservatoire dans les doigts. Comment faut-il le jouer, se demande Wasselin après nous avoir donné l’envie, s’il était nécessaire, de revenir aux enregistrements inégalés d’Aldo Ciccolini (né en 1925 !). De façon inexpressive, répond le pianiste Jean-Marc Luisada, et en pensant à Magritte, ajoute-t-il. Hum ! Ne vaut-il pas mieux interpréter Satie, comme le dessina le Picasso qu’on dit néoclassique, d’un trait vibrant, en somme, sans négliger la pédale ? Sobre, pas sec. « Portez cela plus loin », aurait conclu Satie lui-même. SG / Christian Wasselin, Erik Satie, Gallimard/Folio biographies, 10,50€. A lire aussi Patrick Roegiers, Satie, Grasset, 22€, plus un récit biographique qu’un roman, à rebours de ce que dit la couverture. Comme Jankélévitch, Roegiers prend l’humour du musicien au sérieux, sans traiter ses drames à la légère.

« Tout art tend constamment aux modalités de la musique », écrit Walter Pater en 1877 à propos du Concert champêtre (Louvre) cher à Manet. Depuis dix ans, un Whistler baptisait de titres musicaux ses tableaux, à mesure qu’ils se vidaient de tout référent extérieur pleinement identifiable, et que le peintre de Londres, d’abord baudelairien, puis mallarméen, cherchait à faire primer le suggestif sur l’iconique. L’époque sera bientôt au wagnérisme, à la quête des expériences totales, des synesthésies, seules capable de rendre l’individu et le monde à leur unité perdue. Jean-David Jumeau-Lafond et Pierre Pinchon ont consacré à l’Ut musica pictura (et inversement) un chapitre du panorama très ambitieux qu’ils viennent de consacrer au symbolisme en lui associant d’autres experts de ce que la fin-de-siècle, en référence à la tradition de l’idea, appelait avec hauteur la peinture d’imagination. Était-il si naturel de penser l’image comme l’équivalent d’une composition sonore, et non d’un texte préexistant, et l’œil comme l’analogue de l’ouïe ? Disons que le modèle musical, sans détrôner le modèle poétique, aura permis de repousser les limites du pictural loin des rivages du réalisme. Car on ne saurait définir le symbolisme qu’à partir de son supposé contraire. La force du présent bilan réside aussi dans l’extension du domaine traditionnellement imparti à son sujet. Outre que l’iconographie réserve bien des surprises captivantes, et que tous les médiums sont concernés, les auteurs suivent la vague du symbolisme, phénomène sans frontières, en ses recoins les plus variés. Socialisme, nationalisme, christianisme et néopaganisme sont quelques-uns des ismes que la nouvelle esthétique seconde et leste, soit de platonisme (l’essence des choses), soit de relativisme (le mystère comme signe d’une réalité en partie inaccessible à la raison). L’enquête s’arrête aux portes de la peinture abstraite, elle aurait pu pousser celles du surréalisme, friand des visions de Moreau et des noirs de Redon, de l’exotisme de Gauguin et du mysticisme de Filiger. SG / Jean-David Jumeau-Lafond et Pierre Pinchon (dir.), avec la collaboration de Rossella Froissart, Laurent Houssais et Adriana Sotropa, Le Symbolisme, Citadelles § Mazenod, 199€. A paraître, Stéphane Guégan, Gustave Moreau. L’Apparition, BNF/Orsay.
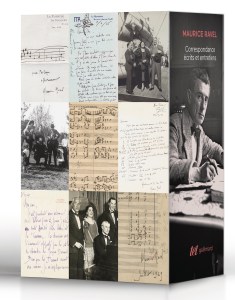
Le 31 décembre 1937, à quelques mois de l’Anschluss, le Wiener Philharmoniker adressait à Jean Zay ses sincères condoléances au sujet de Ravel, mort trois jours plus tôt. Le ministre de l’éducation nationale et des Beaux-Arts répondit aux Viennois, très touché de la part qu’ils prenaient à « la perte cruelle qu’éprouve la musique française en [sa] personne ». Parfait reflet du sacre tardif de Ravel, cette lettre est la 2756e du monument que Manuel Cornejo a élevé à son musicien préféré. A chaque édition de la correspondance de Ravel, elle prend du poids et gagne en annotations. Si ces lettres manquaient d’esprit et d’informations, on aurait moins de raisons d’applaudir à l’effort renouvelé des chercheurs. Cornejo, dernier en date, a fait gravir à l’exhumation des documents un stade impressionnant. Aux lettres se sont réunis articles et entretiens de Ravel, autant d’indices de sa difficulté à sortir de sa nature pudique ailleurs que la plume en main ou dans le tête-à-tête de l’interview. Autant que les destinataires, de Colette à Ida Rubinstein, de Fauré à Poulenc, les goûts littéraires (Poe, Mallarmé) et les cercles se redessinent sous nos yeux, à commencer par la nébuleuse de Misia ex-Natanson. Ravel était son musicien préféré et le présenta à Bonnard, chez qui passe parfois le souvenir des partitions du premier (Shéhérazade). La courte missive que Ravel adresse au peintre en septembre 1908, goguenarde de ton, scelle aussi leur amour commun des « gosses » et des « bêtes ». Bonnard, peintre préféré de Zay, tout se tient. Ce simple exemple en dit long sur les profits immenses que la connaissance va nécessairement tirer de ces 3000 pages de bonheur. SG / Maurice Ravel, Correspondance, écrits et entretiens, Tome I et II, Tel, Gallimard, 32€.

Fin 1941, en Russie, où se ruent les panzers d’Adolf… Prokoviev, rentré de Paris depuis près de six ans, devise avec son secrétaire, complice de toujours. Quelle raison l’a persuadé à « rentrer », à quitter le Paris des avant-gardes pour Moscou et le knout du nouveau tsar ? Guerre et Paix, sur le métier, a changé d’ampleur et de ton à l’approche des nouveaux chevaliers teutoniques. Il faut, proclame Sergueï, que ma musique parle au cœur du plus grand nombre, qu’elle s’ouvre sans déchoir, reste au niveau des pièces motoriques de ma jeunesse, alliages uniques de lyrisme, d’ironie et de martellement mesmérien. Le choix impossible, qui donne son titre au nouveau roman de Dominique Fernandez, c’est cette sortie, par le haut, de la réception élitaire. Et Prokofiev, dans la même scène, de chanter les louanges d’un Ravel accessible à tous, et taxé d’académisme par contrecoup : « Telle est l’accusation qu’on porte en France contre tout effort de mettre la musique à la portée du public. Moi, j’adore le Boléro ! Je voudrais l’avoir écrit ! Voilà l’exemple, le plus réussi à ce jour, de la réforme nécessaire. » L’amour que Fernandez porte à la Russie, égal à son stendhalisme italien, n’est un mystère pour personne, bien que sa flamme pour le roman soviétique en ait surpris plus d’un en 2023. Autre passion, la musique de Prokofiev, dans son refus de l’élégiaque, du bavardage, une musique qui percute, selon le mot de Drieu en 1917 ; elle nous tient, dit le romancier, sous sa poigne, de bout en bout. Une manière de terrorisme ou d’exorcisme. La sombre (et sublime) déflagration qui ouvre Roméo et Juliette en 1936 n’a aucun équivalent. Y verra-t-on une autre réponse au « choix impossible » ? Quoi qu’il en soit, le roman aux tempi vifs de Fernandez, roman puisque la fiction s’installe dans les silences de l’histoire, débute par une polyphonie acide et drôle, conforme à son héros : morts le même jour de 1953, à quelques minutes près, Staline et Prokofiev dominent les conversations parmi les musiciens d’Etat, médiocres pisseurs de partitions sans âme. Le choix du possible, telle est la règle chez les cafards. « Celui qui se borne à suivre un autre ne le dépassera jamais », disait Michel-Ange. Prokofiev, à qui on doit quelques-unes des plus belles musiques de film, ne laisse jamais à d’autres le soin d’écrire la bande-son de sa folie. A vos casques ! SG / Dominique Fernandez, de l’Académie française, Un choix impossible, Grasset, 25€.