 Je suis, nous sommes ramenés, par l’actualité de plusieurs débats, aux liens complexes entre patrimoine et politique. Parmi les précédents qui peuvent nous éclairer et maintenir l’analyse hors de toute récrimination anachronique, le trésor du marquis Campana, au mitan du XIXe siècle, offre un destin exemplaire. Depuis deux générations, sa famille régnait sur le Mont-de-Piété des Etats pontificaux et en tirait des revenus qu’elle convertissait, pour partie, en achats d’œuvres d’art. La passion et la situation dont hérite Giampietro lui permirent de réunir une douzaine de milliers d’œuvres, des monnaies antiques aux plus grands maîtres de la peinture italienne. Dans le sillage des collections papales, sous l’impulsion aussi de ce que Napoléon Ier avait mis en œuvre au-delà des Alpes, notre banquier prospère entend constituer une sorte de musée privé du génie national. L’antiquité s’y assure facilement la part du lion. Mais Campana s’offre aussi, entre autres « vieux tableaux », une grande Crucifixion de Giotto, La Bataille de San Romano de Paolo Uccello et le décor peint du studiolo de Frédéric de Montefeltre, pour ne pas parler de peintures qu’il croyait aussi prestigieuses que celles-ci et que l’avenir allait déclasser. A la suite de l’incarcération du beau marquis, en délicatesse avec la tutelle papale à partir de 1857, la collection sera vendue. Le moment était mal choisi… En mars 1861, l’heure du Risorgimento a sonné et le Vatican, hors de l’unité encore, se voit sévèrement critiqué d’avoir laissé partir en Russie et en France un morceau de la jeune Italie. Pour l’équilibriste qu’est Napoléon III, un pied chez les patriotes locaux, l’autre chez le successeur de saint Pierre, cet achat le hisse au rang des puissants du monde occidental. Exposition d’une ampleur et d’un effet exceptionnels, Un Rêve d’Italie s’est doté d’un catalogue aux dimensions de la folie qu’elle ausculte et interroge à la lumière des préoccupations d’aujourd’hui. L’histoire est un tissu serré qu’il importe de respecter et de partager. Tous les rêves n’y trouvent pas nécessairement de quoi s’habiller.
Je suis, nous sommes ramenés, par l’actualité de plusieurs débats, aux liens complexes entre patrimoine et politique. Parmi les précédents qui peuvent nous éclairer et maintenir l’analyse hors de toute récrimination anachronique, le trésor du marquis Campana, au mitan du XIXe siècle, offre un destin exemplaire. Depuis deux générations, sa famille régnait sur le Mont-de-Piété des Etats pontificaux et en tirait des revenus qu’elle convertissait, pour partie, en achats d’œuvres d’art. La passion et la situation dont hérite Giampietro lui permirent de réunir une douzaine de milliers d’œuvres, des monnaies antiques aux plus grands maîtres de la peinture italienne. Dans le sillage des collections papales, sous l’impulsion aussi de ce que Napoléon Ier avait mis en œuvre au-delà des Alpes, notre banquier prospère entend constituer une sorte de musée privé du génie national. L’antiquité s’y assure facilement la part du lion. Mais Campana s’offre aussi, entre autres « vieux tableaux », une grande Crucifixion de Giotto, La Bataille de San Romano de Paolo Uccello et le décor peint du studiolo de Frédéric de Montefeltre, pour ne pas parler de peintures qu’il croyait aussi prestigieuses que celles-ci et que l’avenir allait déclasser. A la suite de l’incarcération du beau marquis, en délicatesse avec la tutelle papale à partir de 1857, la collection sera vendue. Le moment était mal choisi… En mars 1861, l’heure du Risorgimento a sonné et le Vatican, hors de l’unité encore, se voit sévèrement critiqué d’avoir laissé partir en Russie et en France un morceau de la jeune Italie. Pour l’équilibriste qu’est Napoléon III, un pied chez les patriotes locaux, l’autre chez le successeur de saint Pierre, cet achat le hisse au rang des puissants du monde occidental. Exposition d’une ampleur et d’un effet exceptionnels, Un Rêve d’Italie s’est doté d’un catalogue aux dimensions de la folie qu’elle ausculte et interroge à la lumière des préoccupations d’aujourd’hui. L’histoire est un tissu serré qu’il importe de respecter et de partager. Tous les rêves n’y trouvent pas nécessairement de quoi s’habiller.
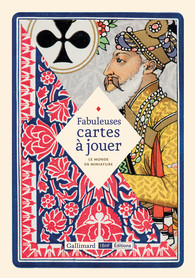 On les croyait plutôt récentes, elles sont très anciennes. On les imaginait stables comme l’antique, elles sont mobiles comme l’air. Les cartes à jouer se jouent de nous, en changeant de symbolique plus que de format, signe de leur magie éternelle, tant il est vrai que les jeux de hasard, si habile soit-on à en user, désignent une part du merveilleux, de l’idéal autour de quoi les sociétés, même les plus incroyantes, s’organisent, se soudent, dirait Marcel Mauss. Quand le cadre collectif n’était pas aussi miné que le nôtre, bercé par les réseaux liberticides et la violence dégondée, l’autorité religieuse et le pouvoir politique se préoccupaient de ces cartes si populaires, sans les interdire : c’est l’équilibre des civilisations évoluées et durables. Le temps long s’impose donc aux historiens du domaine : « Originaires d’Extrême-Orient, sans doute de Chine où elles pourraient être nées au XIIe siècle, les cartes à jouer font leur apparition en Europe dans la seconde moitié du XIVe siècle. On en trouve les premières traces en Italie du Nord et en Catalogne, dans les années 1370 », écrit Jude Talbot en prélude – le jeu, toujours ! – au superbe livre qu’elle vient de consacrer au sujet, plus exactement à ce qui en relève parmi les collections de la BNF. Dès les premiers achats de la Couronne, en 1667 et 1715, actes fondateurs de la grande maison, les cartes à jouer et les tarots entrent en nombre avec les estampes. Leur valeur historique est équivalente, leur beauté aussi. En 7 siècles, elles forment un sismographe du goût, du politique, de l’érotique. Jeux de main, jeux de… Si carte et territoire sont voués à ne jamais s’épouser, le territoire des cartes embrasse largement, de l’artisan obscur à David et Célestin Nanteuil, de Masson et Dali à Dubuffet et quelques autres. Savante ou galante, la donne se relie aux plus vieux mystères.
On les croyait plutôt récentes, elles sont très anciennes. On les imaginait stables comme l’antique, elles sont mobiles comme l’air. Les cartes à jouer se jouent de nous, en changeant de symbolique plus que de format, signe de leur magie éternelle, tant il est vrai que les jeux de hasard, si habile soit-on à en user, désignent une part du merveilleux, de l’idéal autour de quoi les sociétés, même les plus incroyantes, s’organisent, se soudent, dirait Marcel Mauss. Quand le cadre collectif n’était pas aussi miné que le nôtre, bercé par les réseaux liberticides et la violence dégondée, l’autorité religieuse et le pouvoir politique se préoccupaient de ces cartes si populaires, sans les interdire : c’est l’équilibre des civilisations évoluées et durables. Le temps long s’impose donc aux historiens du domaine : « Originaires d’Extrême-Orient, sans doute de Chine où elles pourraient être nées au XIIe siècle, les cartes à jouer font leur apparition en Europe dans la seconde moitié du XIVe siècle. On en trouve les premières traces en Italie du Nord et en Catalogne, dans les années 1370 », écrit Jude Talbot en prélude – le jeu, toujours ! – au superbe livre qu’elle vient de consacrer au sujet, plus exactement à ce qui en relève parmi les collections de la BNF. Dès les premiers achats de la Couronne, en 1667 et 1715, actes fondateurs de la grande maison, les cartes à jouer et les tarots entrent en nombre avec les estampes. Leur valeur historique est équivalente, leur beauté aussi. En 7 siècles, elles forment un sismographe du goût, du politique, de l’érotique. Jeux de main, jeux de… Si carte et territoire sont voués à ne jamais s’épouser, le territoire des cartes embrasse largement, de l’artisan obscur à David et Célestin Nanteuil, de Masson et Dali à Dubuffet et quelques autres. Savante ou galante, la donne se relie aux plus vieux mystères.
 Y voit-on plus clair depuis que la carte du caravagisme s’est précisée et diversifiée ? La géographie, en la matière, reste de dangereux emploi. Car cette extension se double souvent d’une approche satellitaire. On aime trop encore se représenter l’ancienne peinture française, ou plutôt la peinture de France antérieure à Louis XIV, comme le produit des nouveautés romaines, et certains artistes comme de simples porteurs de valise. Dans le cas des vieilles provinces du royaume, la logique migratoire se leste de la condescendance qu’inspirent nos représentants de « l’art régional ». Certains ne s’en sont pas relevés, contrairement à Guy François (1578-1650) qui remobilisa, il y a moins d’un siècle, l’attention des historiens de l’art, sous l’étiquette d’abord des « peintres de la réalité » (1934), puis des suiveurs de Saraceni. Cet émule vénitien et gracieux du Caravage ne possède ni la force inventive, ni le don de surprendre, du grand initiateur. On peut même lui préférer l’âpreté de François et l’émotion décapée qui nous guide vers ses tableaux religieux où le corps christique offert à la méditation intime est un marqueur d’époque, loin des tavernes de Valentin. La Rome de Clément VIII, ouverte au souffle tridentin et à tous les vents du génie, concentre vers 1600 une richesse d’expériences stylistiques sans équivalent. En plus de renseigner à nouveaux frais la vie et la carrière brillante d’un homme qui essaima des centaines de tableaux entre sa ville natale (Le-Puy-en-Velay), l’Auvergne et la région de Toulouse ou de Cahors, Bruno Saunier dégage Guy François des simples disputes d’attribution. Le péché de l’éclectisme n’a pas lieu d’être retenu contre son peintre tant il maîtrise ses alliages. Si la merveilleuse Madeleine pénitente du Louvre, grand achat de Pierre Rosenberg et Jean-Pierre Cuzin, est aussi caressante que les madones de Raphaël dont elle dérive en partie, L’Annonciation de 1610 toise Saraceni à travers une composition de Titien qui frappa alors ce Van Loon qu’expose en ce moment Bruxelles. Au-delà des emprunts, il reste la saveur propre, souvent rude, d’une personnalité marquée par sa région et le destin du pays. Il faut croire que notre XVIIe siècle pratiquait l’identitaire sans l’essentialiser, autre leçon de ce livre roboratif.
Y voit-on plus clair depuis que la carte du caravagisme s’est précisée et diversifiée ? La géographie, en la matière, reste de dangereux emploi. Car cette extension se double souvent d’une approche satellitaire. On aime trop encore se représenter l’ancienne peinture française, ou plutôt la peinture de France antérieure à Louis XIV, comme le produit des nouveautés romaines, et certains artistes comme de simples porteurs de valise. Dans le cas des vieilles provinces du royaume, la logique migratoire se leste de la condescendance qu’inspirent nos représentants de « l’art régional ». Certains ne s’en sont pas relevés, contrairement à Guy François (1578-1650) qui remobilisa, il y a moins d’un siècle, l’attention des historiens de l’art, sous l’étiquette d’abord des « peintres de la réalité » (1934), puis des suiveurs de Saraceni. Cet émule vénitien et gracieux du Caravage ne possède ni la force inventive, ni le don de surprendre, du grand initiateur. On peut même lui préférer l’âpreté de François et l’émotion décapée qui nous guide vers ses tableaux religieux où le corps christique offert à la méditation intime est un marqueur d’époque, loin des tavernes de Valentin. La Rome de Clément VIII, ouverte au souffle tridentin et à tous les vents du génie, concentre vers 1600 une richesse d’expériences stylistiques sans équivalent. En plus de renseigner à nouveaux frais la vie et la carrière brillante d’un homme qui essaima des centaines de tableaux entre sa ville natale (Le-Puy-en-Velay), l’Auvergne et la région de Toulouse ou de Cahors, Bruno Saunier dégage Guy François des simples disputes d’attribution. Le péché de l’éclectisme n’a pas lieu d’être retenu contre son peintre tant il maîtrise ses alliages. Si la merveilleuse Madeleine pénitente du Louvre, grand achat de Pierre Rosenberg et Jean-Pierre Cuzin, est aussi caressante que les madones de Raphaël dont elle dérive en partie, L’Annonciation de 1610 toise Saraceni à travers une composition de Titien qui frappa alors ce Van Loon qu’expose en ce moment Bruxelles. Au-delà des emprunts, il reste la saveur propre, souvent rude, d’une personnalité marquée par sa région et le destin du pays. Il faut croire que notre XVIIe siècle pratiquait l’identitaire sans l’essentialiser, autre leçon de ce livre roboratif.
 Enfin, Guérin vint… Dire que ce livre était aussi attendu que le Vincent de Jean-Pierre Cuzin, ce n’est pas mentir. Pour des raisons qui ne sont pas complètement différentes, tel le poids du davidisme sur l’analyse convenue des années 1770-1820, ces deux peintres ont souffert d’une durable condescendance, voire d’une longue proscription, de la part des historiens de l’art. Il y a 50 ans, on les tenait volontiers pour très secondaires au regard de la voie royale qui mène de David à Delacroix. Plus que Vincent encore, contemporain malheureux de David, Guérin (1774-1833), leur cadet, semblait condamné à son déclassement précoce. Il est vrai que l’artiste y avait mis du sien. Les triomphes de sa jeune maturité, Marcus Sextus en 1799, Phèdre en 1802, deux tableaux où Stendhal vit le dépassement de David par une expression plus forte et plus trouble, ne se renouvelèrent jamais. Qui, en dehors de quelques irréductibles, acceptent son Aurore et Céphale (1810) ou son Portrait d’Henri de La Rochejacquelein (1817) pour les chefs-d’œuvre qu’ils sont ? Avant même de s’éteindre à Rome, victime d’une longue maladie, sous l’œil attendri de Chateaubriand dont il avait fait le portrait et partagé un centrisme politique de bon aloi, Guérin vit son magistère combattu par l’historiographie romantique. Curieux et cruel paradoxe : sous l’Empire, et plus encore après Waterloo, la jeune peinture, de Géricault à Delacroix, était venue se former auprès de lui, s’assimiler son goût souvent noir de l’émotion forte et des narrations ramassées. Assez vite pourtant, la filiation fut oubliée, niée, au profit du bon vieux récit œdipien : le romantisme ne lui devait strictement rien. N’était-il pas libéral en art et en politique quand Guérin, contempteur de la Terreur sous le Directoire, fêté et fait baron par la Restauration, directeur autoritaire d’une Ville Médicis confronté aux frondeurs, incarnait le parti du conservatisme et de la régression ? Cette caricature d’approche historique, née autour de 1830, ne cessera de se durcir, au point de décourager toute réévaluation. La relecture ne débutera pas avant le début des années 1970. Les admirables travaux de Mehdi Korchane en sont l’aboutissement. Il n’est pas un poncif enchaîné à la mémoire de Guérin, à son parcours politique et esthétique, qu’il n’ait renversé preuves en mains. Son livre, précédé par de multiples articles, ajoute à la justesse des analyses une couverture photographique exemplaire. L’image peu connue, inédite, vient ici et là épauler une étude qui s’offre le luxe, à maints égards, de contester le souverainisme bienpensant de l’historiographie américaine.
Enfin, Guérin vint… Dire que ce livre était aussi attendu que le Vincent de Jean-Pierre Cuzin, ce n’est pas mentir. Pour des raisons qui ne sont pas complètement différentes, tel le poids du davidisme sur l’analyse convenue des années 1770-1820, ces deux peintres ont souffert d’une durable condescendance, voire d’une longue proscription, de la part des historiens de l’art. Il y a 50 ans, on les tenait volontiers pour très secondaires au regard de la voie royale qui mène de David à Delacroix. Plus que Vincent encore, contemporain malheureux de David, Guérin (1774-1833), leur cadet, semblait condamné à son déclassement précoce. Il est vrai que l’artiste y avait mis du sien. Les triomphes de sa jeune maturité, Marcus Sextus en 1799, Phèdre en 1802, deux tableaux où Stendhal vit le dépassement de David par une expression plus forte et plus trouble, ne se renouvelèrent jamais. Qui, en dehors de quelques irréductibles, acceptent son Aurore et Céphale (1810) ou son Portrait d’Henri de La Rochejacquelein (1817) pour les chefs-d’œuvre qu’ils sont ? Avant même de s’éteindre à Rome, victime d’une longue maladie, sous l’œil attendri de Chateaubriand dont il avait fait le portrait et partagé un centrisme politique de bon aloi, Guérin vit son magistère combattu par l’historiographie romantique. Curieux et cruel paradoxe : sous l’Empire, et plus encore après Waterloo, la jeune peinture, de Géricault à Delacroix, était venue se former auprès de lui, s’assimiler son goût souvent noir de l’émotion forte et des narrations ramassées. Assez vite pourtant, la filiation fut oubliée, niée, au profit du bon vieux récit œdipien : le romantisme ne lui devait strictement rien. N’était-il pas libéral en art et en politique quand Guérin, contempteur de la Terreur sous le Directoire, fêté et fait baron par la Restauration, directeur autoritaire d’une Ville Médicis confronté aux frondeurs, incarnait le parti du conservatisme et de la régression ? Cette caricature d’approche historique, née autour de 1830, ne cessera de se durcir, au point de décourager toute réévaluation. La relecture ne débutera pas avant le début des années 1970. Les admirables travaux de Mehdi Korchane en sont l’aboutissement. Il n’est pas un poncif enchaîné à la mémoire de Guérin, à son parcours politique et esthétique, qu’il n’ait renversé preuves en mains. Son livre, précédé par de multiples articles, ajoute à la justesse des analyses une couverture photographique exemplaire. L’image peu connue, inédite, vient ici et là épauler une étude qui s’offre le luxe, à maints égards, de contester le souverainisme bienpensant de l’historiographie américaine.
 Un cycle vient de se clore au musée Delacroix. Appelée à de nouvelles fonctions, Dominique de Font-Réaulx le quitte pour le Louvre. Mais elle laisse derrière elle un riche bilan, espaces rénovés, éclairage amélioré, jardin ragaillardi, achats, expositions et, depuis quelques jours, un livre aussi abondant que son amour pour l’artiste. Il y a, du reste, cohérence entre son apport à l’institution et son rapport à l’artiste : la vocation littéraire du jeune Delacroix, sur laquelle elle a ramené l’attention par ses livres précédents, a pareillement déterminé sa politique et l’ample synthèse qu’elle signe en cette fin d’année. Ce livre semble s’être écrit, à l’image du Journal, par développements presque autonomes, sans que le récit d’ensemble, plus proche d’abord du fil biographique, n’en souffre. L’auteur le dit elle-même, en pensant peut-être aux lecteurs d’aujourd’hui, chaque chapitre peut être lu séparément du reste. Le Journal n’a pas seulement offert une structure au présent livre, il s’y fait entendre partout, car tout y converge, confessions, frissons, théorie de la peinture, carrière, sociabilité. Le Journal, c’est l’autre moi, avec ce que ce dialogue avec soi comporte de fictionnel, de réparateur et de disciplinaire. Dominique de Font-Réaulx sait de quels meurtrissures, doutes et fermeté stoïcienne ce lecteur de Montaigne et de Voltaire a nourri ce surmoi que composent ensemble l’écriture diariste et la peinture d’imagination. C’est là que nous retrouvons la littérature, modèle et contre-modèle du langage propre aux arts visuels, thème récurrent chez lui. Le miracle delacrucien, que seul Manet renouvellera à ce degré, est d’avoir mis de la vie en tout, quoique sa peinture fût restée résolument irréductible au simple « spectacle de la nature ». L’alternance de l’intime et de la sphère publique, autre trait du Journal, gouverne enfin l’iconographie de ce livre où elle se révèle aussi généreuse que propice aux surprises.
Un cycle vient de se clore au musée Delacroix. Appelée à de nouvelles fonctions, Dominique de Font-Réaulx le quitte pour le Louvre. Mais elle laisse derrière elle un riche bilan, espaces rénovés, éclairage amélioré, jardin ragaillardi, achats, expositions et, depuis quelques jours, un livre aussi abondant que son amour pour l’artiste. Il y a, du reste, cohérence entre son apport à l’institution et son rapport à l’artiste : la vocation littéraire du jeune Delacroix, sur laquelle elle a ramené l’attention par ses livres précédents, a pareillement déterminé sa politique et l’ample synthèse qu’elle signe en cette fin d’année. Ce livre semble s’être écrit, à l’image du Journal, par développements presque autonomes, sans que le récit d’ensemble, plus proche d’abord du fil biographique, n’en souffre. L’auteur le dit elle-même, en pensant peut-être aux lecteurs d’aujourd’hui, chaque chapitre peut être lu séparément du reste. Le Journal n’a pas seulement offert une structure au présent livre, il s’y fait entendre partout, car tout y converge, confessions, frissons, théorie de la peinture, carrière, sociabilité. Le Journal, c’est l’autre moi, avec ce que ce dialogue avec soi comporte de fictionnel, de réparateur et de disciplinaire. Dominique de Font-Réaulx sait de quels meurtrissures, doutes et fermeté stoïcienne ce lecteur de Montaigne et de Voltaire a nourri ce surmoi que composent ensemble l’écriture diariste et la peinture d’imagination. C’est là que nous retrouvons la littérature, modèle et contre-modèle du langage propre aux arts visuels, thème récurrent chez lui. Le miracle delacrucien, que seul Manet renouvellera à ce degré, est d’avoir mis de la vie en tout, quoique sa peinture fût restée résolument irréductible au simple « spectacle de la nature ». L’alternance de l’intime et de la sphère publique, autre trait du Journal, gouverne enfin l’iconographie de ce livre où elle se révèle aussi généreuse que propice aux surprises.
 X…. C’est la lettre qui désigna longtemps l’interdit ou le visionnage sous condition… Itō Jakuchū (1716-1800) est resté hors de portée des Français jusqu’à la récente exposition du Petit Palais. Pour ceux qui, comme moi, ont commis l’imprudence de ne pas s’y précipiter immédiatement avant d’être découragé par la foule des ultimes jours, il reste un superbe catalogue pour noyer son chagrin. Le Royaume Coloré des Êtres Vivants, exécuté dans les années 1750, se compose de 30 panneaux de soie peinte, où se résume joyeusement la vie terrestre et aquatique; ils encadrent un bouddha et deux bodhisattvas, car le propos d’ensemble est évidemment religieux, rituel même. Membre de cette classe de marchands urbains, qui s’enrichit dans le Kyoto d’alors et qu’on voit précisément se promener dans l’ukiyo-e nippone, Jakuchū vient assez tard à la peinture. Moins soumis, dit-on, aux codes académiques que les professionnels du pinceau, il traduit sa foi bouddhique, et le vivant donc, avec une objectivité nouvelle, un dynamisme étonnant et un humour qui avoue la subjectivité de l’ensemble. La cosmologie qu’il fait sienne également impose le respect de tout être en qui s’incarne l’esprit du bouddha. En ce sens, rappelle le texte passionnant de Jean-Noël Robert, l’artiste peint les phénomènes dans les deux sens du terme, il les représente et il les crée, la main communique avec le divin, ce que, du romantisme à Masson, l’Occident postulera aussi.
X…. C’est la lettre qui désigna longtemps l’interdit ou le visionnage sous condition… Itō Jakuchū (1716-1800) est resté hors de portée des Français jusqu’à la récente exposition du Petit Palais. Pour ceux qui, comme moi, ont commis l’imprudence de ne pas s’y précipiter immédiatement avant d’être découragé par la foule des ultimes jours, il reste un superbe catalogue pour noyer son chagrin. Le Royaume Coloré des Êtres Vivants, exécuté dans les années 1750, se compose de 30 panneaux de soie peinte, où se résume joyeusement la vie terrestre et aquatique; ils encadrent un bouddha et deux bodhisattvas, car le propos d’ensemble est évidemment religieux, rituel même. Membre de cette classe de marchands urbains, qui s’enrichit dans le Kyoto d’alors et qu’on voit précisément se promener dans l’ukiyo-e nippone, Jakuchū vient assez tard à la peinture. Moins soumis, dit-on, aux codes académiques que les professionnels du pinceau, il traduit sa foi bouddhique, et le vivant donc, avec une objectivité nouvelle, un dynamisme étonnant et un humour qui avoue la subjectivité de l’ensemble. La cosmologie qu’il fait sienne également impose le respect de tout être en qui s’incarne l’esprit du bouddha. En ce sens, rappelle le texte passionnant de Jean-Noël Robert, l’artiste peint les phénomènes dans les deux sens du terme, il les représente et il les crée, la main communique avec le divin, ce que, du romantisme à Masson, l’Occident postulera aussi.
 Que restait-il à découvrir de Debussy (1862-1918), notre musicien majeur, très japoniste à ses heures, se demande Rémy Campos ? Son livre, une merveille d’ingéniosité et d’alacrité, est la réponse à cette question de bon sens. Car la littérature, musicologique et autre, sourit énormément à Claude de France et semble avoir tout fouillé avec fanatisme. Est-ce pour cela qu’elle donne souvent l’impression de trahir son objet en l’embaumant ? Comment retrouver la justesse du cocktail qui définit l’homme et le créateur, ce mélange de vie primesautière et de salutaire misanthropie, de facétie et d’attachement aux valeurs fondamentales, de mépris du matériel et d’appartenance aux élites ? Sous des dehors innocents, Debussy à la plage rejoint l’essentiel d’une personnalité qui se délectait de rester aussi insalissable que son art. Sur l’analyse photographique, mais poussée jusqu’à l’enquête policière, Campos appuie le portrait multi-facette du musicien au seuil de sa maturité douloureuse. Août 1911… D’un côté, la gloire internationale, Le Faune, Pelléas, Children’s Corner, les éditeurs qui le pressent, les claviers et les concerts qui font voyager sa musique, le maestro qui se transporte lui-même loin des frontières… De l’autre, le cancer qu’on vient de diagnostiquer, les besoins d’argent incessants, la difficile reconstruction de sa vie familiale avec Emma et Chouchou, après le suicide raté de la première épouse… En cet été 1911, la Belle époque et le beau monde, dont Debussy suit les transhumances normandes, pavanent à Houlgate. Plages, digue, opulents hôtels et casino servent de scène variée au flux continu de toilettes et de chapeaux. On se baigne peu ou pas, on regarde la mer, l’infini salé et ceux qui l’affrontent. Voir, se voir, se voir vu, tout est là. Donc il faut éterniser ces moments de haute sociabilité : c’est la rage du kodak et des albums sans lesquels la finitude humaine serait accablante. Debussy photographie ou prend la pose avec l’humour de ceux qui se demandent ce qu’ils font là. La mer, il la préfère en musique. Quant aux importuns qui gâchent les beautés du littoral et son silence ! Les clichés de cet été-là ne sont pas tous aussi célèbres que celui de la couverture dans son équilibre parfait entre monumentalité et désinvolture. La photographie nous fait croire qu’elle dit tout de son motif. Campos, moins naïf, passe la moisson de 1911 au crible de ce qu’elle laisse hors de son champ ou dévoile à ses marges. De ces angles morts, de ces arrière-plans négligés, il exhume des trésors d’information qui n’éclairent pas seulement les bienséances et les petits vices d’une humanité libre de s’adonner à tous les commerces loisibles. Debussy, ses lectures, sa musique, son attention aux siens, en forme l’écume.
Que restait-il à découvrir de Debussy (1862-1918), notre musicien majeur, très japoniste à ses heures, se demande Rémy Campos ? Son livre, une merveille d’ingéniosité et d’alacrité, est la réponse à cette question de bon sens. Car la littérature, musicologique et autre, sourit énormément à Claude de France et semble avoir tout fouillé avec fanatisme. Est-ce pour cela qu’elle donne souvent l’impression de trahir son objet en l’embaumant ? Comment retrouver la justesse du cocktail qui définit l’homme et le créateur, ce mélange de vie primesautière et de salutaire misanthropie, de facétie et d’attachement aux valeurs fondamentales, de mépris du matériel et d’appartenance aux élites ? Sous des dehors innocents, Debussy à la plage rejoint l’essentiel d’une personnalité qui se délectait de rester aussi insalissable que son art. Sur l’analyse photographique, mais poussée jusqu’à l’enquête policière, Campos appuie le portrait multi-facette du musicien au seuil de sa maturité douloureuse. Août 1911… D’un côté, la gloire internationale, Le Faune, Pelléas, Children’s Corner, les éditeurs qui le pressent, les claviers et les concerts qui font voyager sa musique, le maestro qui se transporte lui-même loin des frontières… De l’autre, le cancer qu’on vient de diagnostiquer, les besoins d’argent incessants, la difficile reconstruction de sa vie familiale avec Emma et Chouchou, après le suicide raté de la première épouse… En cet été 1911, la Belle époque et le beau monde, dont Debussy suit les transhumances normandes, pavanent à Houlgate. Plages, digue, opulents hôtels et casino servent de scène variée au flux continu de toilettes et de chapeaux. On se baigne peu ou pas, on regarde la mer, l’infini salé et ceux qui l’affrontent. Voir, se voir, se voir vu, tout est là. Donc il faut éterniser ces moments de haute sociabilité : c’est la rage du kodak et des albums sans lesquels la finitude humaine serait accablante. Debussy photographie ou prend la pose avec l’humour de ceux qui se demandent ce qu’ils font là. La mer, il la préfère en musique. Quant aux importuns qui gâchent les beautés du littoral et son silence ! Les clichés de cet été-là ne sont pas tous aussi célèbres que celui de la couverture dans son équilibre parfait entre monumentalité et désinvolture. La photographie nous fait croire qu’elle dit tout de son motif. Campos, moins naïf, passe la moisson de 1911 au crible de ce qu’elle laisse hors de son champ ou dévoile à ses marges. De ces angles morts, de ces arrière-plans négligés, il exhume des trésors d’information qui n’éclairent pas seulement les bienséances et les petits vices d’une humanité libre de s’adonner à tous les commerces loisibles. Debussy, ses lectures, sa musique, son attention aux siens, en forme l’écume.
 Un vent de renouveau souffle sur Ferdinand Hodler (1853-1918) dont la connaissance se réinvente par l’exploration de ses archives, décidément plus riches que prévu. Né dans la pauvreté, mais décédé dans l’opulence sur les bordes de Léman, il fut de ces peintres qui accumulent les traces de leur destin et de leur « travail », pour user d’un mot qui convient à sa personnalité opiniâtre et terrienne. Sans doute ne pouvait-il soupçonner que ce trésor serait un jour étudié dans sa moindre composante afin d’en éclairer l’homme et le corpus, à double face chacun. Jura Brüschweiler (1927-2013) le savait bien, lui qui nous a révélé la place que tint l’érotisme le plus cru dans la vie et l’inspiration d’Hodler, chez qui vibrait un Courbet secret. Ce libre chercheur a consacré à l’artiste, Genevois par choix précoce, plus d’un demi-siècle de sa vie, rassemblant une vaste documentation, aujourd’hui abritée par un centre de recherches qui porte son nom ; elle fait l’objet, jusqu’en mars prochain, d’une exposition et d’une publication aussi remarquables que tous les livres et catalogues auxquels Niklaus Manuel Güdel a attaché son nom. Le directeur des Archives Jura Brüschweiler, sans jamais se départir d’une rigueur philologique toute bâloise, a proprement dévoilé le versant théorique et littéraire du peintre ; ses écrits esthétiques, édités en collaboration avec Diana Blome (Editions Notari, 2017), constituent désormais le préalable à toute lecture de l’œuvre qu’il convient d’arracher aux derniers avatars du formalisme. Il est absurde, mais courant, de voir en Hodler un des avant-courriers de l’abstraction, au prétexte que sa peinture tendrait à une concision croissante et donc prémonitoire… L’étude de ses sources, de sa formation, ingresque par ricochet, invalide ce genre d’analyse expéditive. Et son goût pour la photographie et le cinéma, que la Fondation Bodmer rend particulièrement sensible, conforte ce que l’exposition Ferdinand Hodler et le Léman (Musée d’art de Pully, 2017) avait établi : l’expérience du réel, bientôt élargi par les techniques de reproduction modernes et l’usage insatiable du train, conditionna même les paysages les plus décantés. La restitution publique d’une archive privée, dans le respect du défunt, relève des missions essentielles de la communauté savante. Elle est souvent le meilleur moyen de ramener un artiste dans la curiosité d’un nouveau public. C’est le cas ici, il faut s’en féliciter.
Un vent de renouveau souffle sur Ferdinand Hodler (1853-1918) dont la connaissance se réinvente par l’exploration de ses archives, décidément plus riches que prévu. Né dans la pauvreté, mais décédé dans l’opulence sur les bordes de Léman, il fut de ces peintres qui accumulent les traces de leur destin et de leur « travail », pour user d’un mot qui convient à sa personnalité opiniâtre et terrienne. Sans doute ne pouvait-il soupçonner que ce trésor serait un jour étudié dans sa moindre composante afin d’en éclairer l’homme et le corpus, à double face chacun. Jura Brüschweiler (1927-2013) le savait bien, lui qui nous a révélé la place que tint l’érotisme le plus cru dans la vie et l’inspiration d’Hodler, chez qui vibrait un Courbet secret. Ce libre chercheur a consacré à l’artiste, Genevois par choix précoce, plus d’un demi-siècle de sa vie, rassemblant une vaste documentation, aujourd’hui abritée par un centre de recherches qui porte son nom ; elle fait l’objet, jusqu’en mars prochain, d’une exposition et d’une publication aussi remarquables que tous les livres et catalogues auxquels Niklaus Manuel Güdel a attaché son nom. Le directeur des Archives Jura Brüschweiler, sans jamais se départir d’une rigueur philologique toute bâloise, a proprement dévoilé le versant théorique et littéraire du peintre ; ses écrits esthétiques, édités en collaboration avec Diana Blome (Editions Notari, 2017), constituent désormais le préalable à toute lecture de l’œuvre qu’il convient d’arracher aux derniers avatars du formalisme. Il est absurde, mais courant, de voir en Hodler un des avant-courriers de l’abstraction, au prétexte que sa peinture tendrait à une concision croissante et donc prémonitoire… L’étude de ses sources, de sa formation, ingresque par ricochet, invalide ce genre d’analyse expéditive. Et son goût pour la photographie et le cinéma, que la Fondation Bodmer rend particulièrement sensible, conforte ce que l’exposition Ferdinand Hodler et le Léman (Musée d’art de Pully, 2017) avait établi : l’expérience du réel, bientôt élargi par les techniques de reproduction modernes et l’usage insatiable du train, conditionna même les paysages les plus décantés. La restitution publique d’une archive privée, dans le respect du défunt, relève des missions essentielles de la communauté savante. Elle est souvent le meilleur moyen de ramener un artiste dans la curiosité d’un nouveau public. C’est le cas ici, il faut s’en féliciter.
 Ourdie durant l’hiver 1946, la naissance de Dior fait événement au printemps suivant. Saison idoine : les jupes s’arrondissent en coroles avenantes, les tailles se font guêpes, les poitrines reprennent du dessin, la silhouette générale du ressort. Ce Dior qui triomphe n’est plus une jeunesse, mais il la revit, c’est la Libération continuée. On oublie les femmes tondues sous le luxe retrouvé. Retrouvé, retrouvé… Sous la botte, face à Berlin qui cherche à la cannibaliser, la mode française a tenu, grâce à des hommes que Dior a alors connus et auprès de qui il s’est fait la main, à commencer par Lucien Lelong cher à Patrick Mauriès. Dans l’ombre de Robert Piguet auparavant, le jeune Christian a appris beaucoup et trop patienté. C’est qu’un autre homme bouillonne en lui, l’architecte d’intérieur qu’il a rêvé d’abord de devenir en restaurant un certain art de vivre qu’il estime typiquement français. Deux guerres mondiales n’y sont pas pour rien. Son goût s’apparente au chic dont se réclament deux de ses complices de sauteries mondaines, Georges Geffroy et Victor Grandpierre. A eux trois, ils forment le sujet du livre très plaisant de Maureen Footer, qui braque ses jumelles gris et roses sur un aspect peu connu du seigneur de l’avenue Montaigne, sa passion du huis-clos racé et saturé de liens au grand goût d’Ancien régime. Le New look est au fond très vieille France. Comme la musique de Poulenc, le Louis XV ou le Louis XVI y prend, à toute petites touches, un aspect un peu canaille. Il est vrai qu’à vingt ans, au mitan des années folles, Dior fait le bœuf sur les toits du Tout-Paris, et fait bande avec des personnages qui attendent encore leur historien, Christian Bérard et Henri Sauguet, pour ne pas parler de Pierre Gaxotte, chantre d’un XVIIIe siècle peu soluble dans sa vulgate actuelle. En nous invitant chez Dior à l’heure du thé ou du champagne, Maureen Footer nous emmène bien au-delà, c’est le propre des bons livres.
Ourdie durant l’hiver 1946, la naissance de Dior fait événement au printemps suivant. Saison idoine : les jupes s’arrondissent en coroles avenantes, les tailles se font guêpes, les poitrines reprennent du dessin, la silhouette générale du ressort. Ce Dior qui triomphe n’est plus une jeunesse, mais il la revit, c’est la Libération continuée. On oublie les femmes tondues sous le luxe retrouvé. Retrouvé, retrouvé… Sous la botte, face à Berlin qui cherche à la cannibaliser, la mode française a tenu, grâce à des hommes que Dior a alors connus et auprès de qui il s’est fait la main, à commencer par Lucien Lelong cher à Patrick Mauriès. Dans l’ombre de Robert Piguet auparavant, le jeune Christian a appris beaucoup et trop patienté. C’est qu’un autre homme bouillonne en lui, l’architecte d’intérieur qu’il a rêvé d’abord de devenir en restaurant un certain art de vivre qu’il estime typiquement français. Deux guerres mondiales n’y sont pas pour rien. Son goût s’apparente au chic dont se réclament deux de ses complices de sauteries mondaines, Georges Geffroy et Victor Grandpierre. A eux trois, ils forment le sujet du livre très plaisant de Maureen Footer, qui braque ses jumelles gris et roses sur un aspect peu connu du seigneur de l’avenue Montaigne, sa passion du huis-clos racé et saturé de liens au grand goût d’Ancien régime. Le New look est au fond très vieille France. Comme la musique de Poulenc, le Louis XV ou le Louis XVI y prend, à toute petites touches, un aspect un peu canaille. Il est vrai qu’à vingt ans, au mitan des années folles, Dior fait le bœuf sur les toits du Tout-Paris, et fait bande avec des personnages qui attendent encore leur historien, Christian Bérard et Henri Sauguet, pour ne pas parler de Pierre Gaxotte, chantre d’un XVIIIe siècle peu soluble dans sa vulgate actuelle. En nous invitant chez Dior à l’heure du thé ou du champagne, Maureen Footer nous emmène bien au-delà, c’est le propre des bons livres.
 Incontournable… Un autre protégé de ce Sauguet, remarquable musicien bordelais, passe-murailles de terrain, y compris celui des années sombres durant lesquelles il composa pour le ballet, l’opérette et le cinéma, ce fut Cassandre. De lui et de son graphisme, on croyait tout savoir. Ce serait oublier le talent d’Alain Weill, éternel dandy, à s’écarter des sentiers battus et à planer au-dessus des lourdeurs thésardes. Sa monographie, la plus belle maquette de l’année 2018, parvient ainsi à dérouler sans les perdre tous les fils d’une carrière irréductible au génie de l’affichiste. Notons au passage qu’il eut pour professeur, à l’École des Beaux-Arts, après l’armistice de 1918, ce Cormon qui révéla Lautrec à lui-même. Son Bucheron de 1924, qui n’est pas sans faire penser à celui d’Hodler – Hodler dont nous aurons à examiner prochainement la grande actualité – lui vaut l’attention des contemporains, bien ou mal (Le Corbusier) intentionnés. En rejoignant l’UAM, il fera taire le camp moderniste dont il inquiète les intérêts (Léger, Delaunay). A dire vrai, on est plus tenté de le rapprocher du futurisme tardif que de nos fanatiques de la surface souveraine. Cassandre perce le mur, et même le mur du son. Moderne Lautrec, il bouscule l’espace-temps en vendant des chapeaux ou des cigarettes, des bateaux et des avions. Deux hommes pressés, ailés, n’auront qu’à se féliciter de son coup de crayon, Morand et Saint-Ex. Évidemment, très vite, le photomontage, en vogue après 1930, n’a plus de secret pour lui. Mon chapitre préféré est celui que Weill consacre à la peinture de Cassandre, sa grande ambition depuis le milieu des années 1930 et sa rencontre de Balthus. A la faveur des Réalismes de Jean Clair, le formidable portait de Coco Chanel était réapparu en 1980, presque 40 ans après son exposition aux murs de la galerie Drouin. On y voyait, en 1942, peintures et projets décoratifs. Car Cassandre, imagination spéciale et spatiale, fut un des enchanteurs de l’Opéra de Pris sous les Fritz. Weill, là encore, nous en apprend beaucoup sur ces collaborations oubliées avec Gaupert, Sauguet et Lifar. Les archives privées, merci, sont mises à contribution. De sa lecture de L’Homme à cheval de Drieu, au printemps 1943, Cassandre retint cette phrase qui le résume : « Le neuf naît de l’ancien, de l’ancien qui fut si jeune. » Un bain de jouvence, tel est aussi le sens de ce livre magnifiquement emboité.
Incontournable… Un autre protégé de ce Sauguet, remarquable musicien bordelais, passe-murailles de terrain, y compris celui des années sombres durant lesquelles il composa pour le ballet, l’opérette et le cinéma, ce fut Cassandre. De lui et de son graphisme, on croyait tout savoir. Ce serait oublier le talent d’Alain Weill, éternel dandy, à s’écarter des sentiers battus et à planer au-dessus des lourdeurs thésardes. Sa monographie, la plus belle maquette de l’année 2018, parvient ainsi à dérouler sans les perdre tous les fils d’une carrière irréductible au génie de l’affichiste. Notons au passage qu’il eut pour professeur, à l’École des Beaux-Arts, après l’armistice de 1918, ce Cormon qui révéla Lautrec à lui-même. Son Bucheron de 1924, qui n’est pas sans faire penser à celui d’Hodler – Hodler dont nous aurons à examiner prochainement la grande actualité – lui vaut l’attention des contemporains, bien ou mal (Le Corbusier) intentionnés. En rejoignant l’UAM, il fera taire le camp moderniste dont il inquiète les intérêts (Léger, Delaunay). A dire vrai, on est plus tenté de le rapprocher du futurisme tardif que de nos fanatiques de la surface souveraine. Cassandre perce le mur, et même le mur du son. Moderne Lautrec, il bouscule l’espace-temps en vendant des chapeaux ou des cigarettes, des bateaux et des avions. Deux hommes pressés, ailés, n’auront qu’à se féliciter de son coup de crayon, Morand et Saint-Ex. Évidemment, très vite, le photomontage, en vogue après 1930, n’a plus de secret pour lui. Mon chapitre préféré est celui que Weill consacre à la peinture de Cassandre, sa grande ambition depuis le milieu des années 1930 et sa rencontre de Balthus. A la faveur des Réalismes de Jean Clair, le formidable portait de Coco Chanel était réapparu en 1980, presque 40 ans après son exposition aux murs de la galerie Drouin. On y voyait, en 1942, peintures et projets décoratifs. Car Cassandre, imagination spéciale et spatiale, fut un des enchanteurs de l’Opéra de Pris sous les Fritz. Weill, là encore, nous en apprend beaucoup sur ces collaborations oubliées avec Gaupert, Sauguet et Lifar. Les archives privées, merci, sont mises à contribution. De sa lecture de L’Homme à cheval de Drieu, au printemps 1943, Cassandre retint cette phrase qui le résume : « Le neuf naît de l’ancien, de l’ancien qui fut si jeune. » Un bain de jouvence, tel est aussi le sens de ce livre magnifiquement emboité.
 ? … Willy Ronis par Willy Ronis, titre d’un majestueux catalogue de 600 pages, voilà qui justifie ce point d’interrogation final. Le grand photographe aurait-il théorisé sa pratique ou décrit son parcours politique plus que nous le pensions ? Un journal intime serait-il remonté à la surface de l’immense donation, photographies et archives, dont l’État français a bénéficié en 1983 et 1989, au temps de Jack Lang ? La réalité, pour n’être pas étrangère à cet heureux transfert de propriété, est un peu différente. Convaincu qu’il était plus sage de confier son œuvre aux institutions, Ronis constitua lui-même plusieurs albums à partir des clichés qui lui semblaient pouvoir résumer plus d’un demi-siècle de créations. Il se décida même à commenter chacun de ses choix dans une langue admirablement précise et évocatrice des prises de vue. Ronis, hostile au bavardage et au sentimentalisme, parle de tout avec la même netteté, de ses images engagées comme de ses images dégagées, du front populaire et des grèves comme des femmes revêtues de leur seule nudité éblouissante, des prolos comme des modèles d’une mode qui le nourrit aussi, des inconnus happés au hasard comme des divas de l’ère de la célébrité dont son appareil flexible accompagna le triomphe médiatique, Picasso, Sartre, Vian, Eluard, Aragon en transe devant les micros… La photographie dite humaniste n’est jamais aussi bonne que lorsqu’elle met en danger sa réputation de probité, d’humilité et d’attention aux petites gens. Ronis a pleinement vécu, ses mots le disent, la tension qui traverse son œuvre entre la mise en scène du réel, le théâtre du faux instantané, et l’abandon aux grâces du hasard, de l’intuition, de l’enregistrement sur le vif. Cela ne signifie pas qu’il faille délaisser ou dénigrer les clichés les plus contrôlés, Ronis savait y conserver la coulée de lumière, l’amorce ou la force du mouvement, le sens des gestes et des regards, l’énergie ou la fatigue des corps. Une image, entre toutes, montre clairement sa façon de métaphoriser le processus dont il fut l’un des maîtres. On y voit Jacques Prévert, en 1941, à Nice, sur le tournage probable de Lumières d’été de Grémillon, soulever l’écran, rideau ou bâche, qui le sépare de l’objectif tapi dans l’ombre. La photographie, en un clic, fixe le miracle de son invention. Stéphane Guégan
? … Willy Ronis par Willy Ronis, titre d’un majestueux catalogue de 600 pages, voilà qui justifie ce point d’interrogation final. Le grand photographe aurait-il théorisé sa pratique ou décrit son parcours politique plus que nous le pensions ? Un journal intime serait-il remonté à la surface de l’immense donation, photographies et archives, dont l’État français a bénéficié en 1983 et 1989, au temps de Jack Lang ? La réalité, pour n’être pas étrangère à cet heureux transfert de propriété, est un peu différente. Convaincu qu’il était plus sage de confier son œuvre aux institutions, Ronis constitua lui-même plusieurs albums à partir des clichés qui lui semblaient pouvoir résumer plus d’un demi-siècle de créations. Il se décida même à commenter chacun de ses choix dans une langue admirablement précise et évocatrice des prises de vue. Ronis, hostile au bavardage et au sentimentalisme, parle de tout avec la même netteté, de ses images engagées comme de ses images dégagées, du front populaire et des grèves comme des femmes revêtues de leur seule nudité éblouissante, des prolos comme des modèles d’une mode qui le nourrit aussi, des inconnus happés au hasard comme des divas de l’ère de la célébrité dont son appareil flexible accompagna le triomphe médiatique, Picasso, Sartre, Vian, Eluard, Aragon en transe devant les micros… La photographie dite humaniste n’est jamais aussi bonne que lorsqu’elle met en danger sa réputation de probité, d’humilité et d’attention aux petites gens. Ronis a pleinement vécu, ses mots le disent, la tension qui traverse son œuvre entre la mise en scène du réel, le théâtre du faux instantané, et l’abandon aux grâces du hasard, de l’intuition, de l’enregistrement sur le vif. Cela ne signifie pas qu’il faille délaisser ou dénigrer les clichés les plus contrôlés, Ronis savait y conserver la coulée de lumière, l’amorce ou la force du mouvement, le sens des gestes et des regards, l’énergie ou la fatigue des corps. Une image, entre toutes, montre clairement sa façon de métaphoriser le processus dont il fut l’un des maîtres. On y voit Jacques Prévert, en 1941, à Nice, sur le tournage probable de Lumières d’été de Grémillon, soulever l’écran, rideau ou bâche, qui le sépare de l’objectif tapi dans l’ombre. La photographie, en un clic, fixe le miracle de son invention. Stéphane Guégan
 Françoise Gaultier, Laurent Haumesser et Anna Trofimova, Un rêve d’Italie : la collection du marquis Campana, Louvre éditions / Liénart, 49€. Le même tandem éditorial a été l’artisan de la remarquable publication qui accompagne la non moins remarquable exposition Gravure en clair-obscur. Cranach, Raphaël, Rubens (sous la direction de Séverine Lepape, 29€). Le médium, c’est le message, disait qui on sait. Le désir de couleur qui habite l’estampe après 1500 oblige à s’intéresser au véhicule et aux traducteurs des grands maîtres des XVIe et XVIIe siècles, une part de l’invention se logeant dans la technique qui la diffuse. Qui ne voit ce que gagne un Raphaël, un Titien ou un Parmesan à changer de bichromie ? Les cangianti maniériste chantent à un meilleur diapason qu’en noir et blanc, ce qui explique la beauté de la séquence dédiée au siennois Beccafumi. Chaque planche du livre se veut le plus fidèle témoignage des feuilles réunies, qui nous rappellent que la photographie est une manière de gravure parvenue à son dernier stade mimétique.
Françoise Gaultier, Laurent Haumesser et Anna Trofimova, Un rêve d’Italie : la collection du marquis Campana, Louvre éditions / Liénart, 49€. Le même tandem éditorial a été l’artisan de la remarquable publication qui accompagne la non moins remarquable exposition Gravure en clair-obscur. Cranach, Raphaël, Rubens (sous la direction de Séverine Lepape, 29€). Le médium, c’est le message, disait qui on sait. Le désir de couleur qui habite l’estampe après 1500 oblige à s’intéresser au véhicule et aux traducteurs des grands maîtres des XVIe et XVIIe siècles, une part de l’invention se logeant dans la technique qui la diffuse. Qui ne voit ce que gagne un Raphaël, un Titien ou un Parmesan à changer de bichromie ? Les cangianti maniériste chantent à un meilleur diapason qu’en noir et blanc, ce qui explique la beauté de la séquence dédiée au siennois Beccafumi. Chaque planche du livre se veut le plus fidèle témoignage des feuilles réunies, qui nous rappellent que la photographie est une manière de gravure parvenue à son dernier stade mimétique.
Jude Talbot (sous la dir.), Fabuleuses cartes à jouer. Le monde en miniature, Galimard/Bibliothèque nationale, 39€.
Bruno Saunier, assisté d’Oriane Lavit, Guy François (vers 1578-1650). Peintre caravagesque du Puy-en-Velay, ARTHENA, 86€.
Mehdi Korchane, Pierre Guérin (1774-1833), Mare § Martin, 65€.
 Dominique de Font-Réault, Delacroix. La liberté d’être soi, Cohen et Cohen, 95€. L’auteur, en compagnie de Sébastien Allard et de Stéphane Guégan (Delacroix. Peindre contre l’oubli, Flammarion, 2018), participera à une table-ronde consacrée aux nouvelles interprétations de l’œuvre delacrucien, Musée du Louvre, Auditorium, jeudi 10 janvier 2019.
Dominique de Font-Réault, Delacroix. La liberté d’être soi, Cohen et Cohen, 95€. L’auteur, en compagnie de Sébastien Allard et de Stéphane Guégan (Delacroix. Peindre contre l’oubli, Flammarion, 2018), participera à une table-ronde consacrée aux nouvelles interprétations de l’œuvre delacrucien, Musée du Louvre, Auditorium, jeudi 10 janvier 2019.
Aya Öta et Manuela Moscatiello (sous la dir.), Jakuchu (1716-1800). Le royaume coloré des êtres vivants, Paris Musées, 29,90€.
Rémy Campos, Debussy à la plage, préface de Jean-Yves Tadié, Gallimard, 35€
Niklaus Manuel Güdel (sous la dir.), Ferdinand Hodler. Documents inédits. Fleurons des archives Jura Brüschweiler, Éditions Notari, 49€.
Maureen Footer, Dior et ses décorateurs, Citadelles § Mazenod, 69€




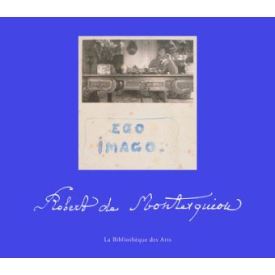










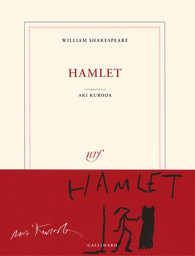









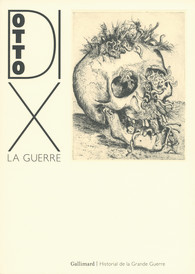
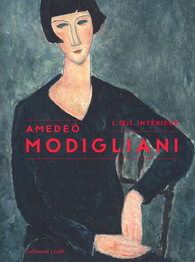

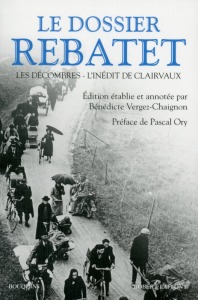
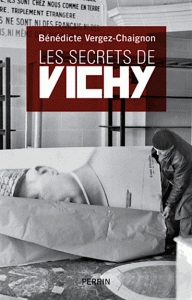


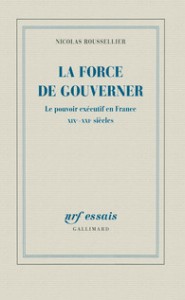

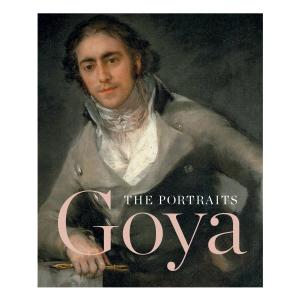








 Vous cherchiez en vain un moyen de tester vos amis ou vos collègues de bureau, de démasquer les tièdes… Ce moyen idoine, imparable, c’est la correspondance Morand-Chardonne. À la vue de ces mille pages dûment annotées, certains frissonneront d’horreur. Les gros livres, vous plaisantez ou quoi? Une petite injection de littérature, pour meubler les temps morts, cela suffit amplement. Et encore de la prose utile, responsable, partageable. Pas dérangeante. D’abord, qui c’est Chardonne? Les plus savants ou les plus âgés, si vous avez un peu chance, se souviendront vaguement que le très esthète
Vous cherchiez en vain un moyen de tester vos amis ou vos collègues de bureau, de démasquer les tièdes… Ce moyen idoine, imparable, c’est la correspondance Morand-Chardonne. À la vue de ces mille pages dûment annotées, certains frissonneront d’horreur. Les gros livres, vous plaisantez ou quoi? Une petite injection de littérature, pour meubler les temps morts, cela suffit amplement. Et encore de la prose utile, responsable, partageable. Pas dérangeante. D’abord, qui c’est Chardonne? Les plus savants ou les plus âgés, si vous avez un peu chance, se souviendront vaguement que le très esthète  En date du 16 décembre 1916, dans son Journal d’un attaché d’ambassade,
En date du 16 décembre 1916, dans son Journal d’un attaché d’ambassade,  On sait que la Première Guerre mondiale a favorisé l’introduction de cette musique en Europe et l’installation de musiciens noirs, sensibles aux conditions de vie moins discriminatoires qu’aux USA. Avant la crise de 29, son foyer le plus créatif reste New York, comme le fait comprendre le livre passionnant de Robert Nippoldt. En quelques pages bien frappées, l’auteur caractérise la personnalité musicale des plus grands jazzmen des «années folles», la vie de nuit, les clubs, le business du disque et la géographie raciale de Manhattan au temps de la prohibition et du piano stride. S’affrontent alors Jimmy Johnson, Fats Waller, Willie the Lion Smith et tant d’autres jeunes diables, certains riches d’une formation classique. La mise en scène est capitale, le cérémonial étudié: on dépose sa canne sur le pupitre, on pose son manteau plié, doublure à l’extérieur, sur le pupitre, on ôte son chapeau «face au public» et on entame une conversation informelle avec une voisine tout en jouant les premières notes d’un ragtime. La musique monte en puissance jusqu’à ce que le morceau atteigne son tempo. Les Big Bands franchissent le mur du son dès que s’en mêle Louis Armstrong, la star de Chicago, lequel stimule celui qui restera l’inventeur du sax ténor, Coleman Hawkins. À partir de 1927, Duke Ellington enflamme le Cotton Club avec sa jungle music, «résurgence du vieux sud profond». Comme nombre de lieux chauds, le Cotton Club appartenait à un gangster, Owney Madden. Pour débaucher le Duke, il fit à son ancien employeur une proposition qu’il ne pouvait refuser. Avec la crise, la pauvreté s’installe à Harlem, les clubs ferment… Armstrong, Ellington et Hawkins quittent New York pour l’Europe, eux qui, avec l’aide de quelques écrivains et journalistes, avaient fait de Harlem «un Paris noir».
On sait que la Première Guerre mondiale a favorisé l’introduction de cette musique en Europe et l’installation de musiciens noirs, sensibles aux conditions de vie moins discriminatoires qu’aux USA. Avant la crise de 29, son foyer le plus créatif reste New York, comme le fait comprendre le livre passionnant de Robert Nippoldt. En quelques pages bien frappées, l’auteur caractérise la personnalité musicale des plus grands jazzmen des «années folles», la vie de nuit, les clubs, le business du disque et la géographie raciale de Manhattan au temps de la prohibition et du piano stride. S’affrontent alors Jimmy Johnson, Fats Waller, Willie the Lion Smith et tant d’autres jeunes diables, certains riches d’une formation classique. La mise en scène est capitale, le cérémonial étudié: on dépose sa canne sur le pupitre, on pose son manteau plié, doublure à l’extérieur, sur le pupitre, on ôte son chapeau «face au public» et on entame une conversation informelle avec une voisine tout en jouant les premières notes d’un ragtime. La musique monte en puissance jusqu’à ce que le morceau atteigne son tempo. Les Big Bands franchissent le mur du son dès que s’en mêle Louis Armstrong, la star de Chicago, lequel stimule celui qui restera l’inventeur du sax ténor, Coleman Hawkins. À partir de 1927, Duke Ellington enflamme le Cotton Club avec sa jungle music, «résurgence du vieux sud profond». Comme nombre de lieux chauds, le Cotton Club appartenait à un gangster, Owney Madden. Pour débaucher le Duke, il fit à son ancien employeur une proposition qu’il ne pouvait refuser. Avec la crise, la pauvreté s’installe à Harlem, les clubs ferment… Armstrong, Ellington et Hawkins quittent New York pour l’Europe, eux qui, avec l’aide de quelques écrivains et journalistes, avaient fait de Harlem «un Paris noir».