 S’agissant de Cocteau et de ses turbulentes, mais fécondes, relations avec Picasso, les spécialistes du peintre ont été d’une rare malveillance et d’une sévère cécité, hormis André Fermigier et, bien sûr, John Richardson, le meilleur d’entre eux. Ce dernier m’a avoué que le peintre starisé, au début des années 1950, ne manquait aucune occasion de se montrer cruel envers l’écrivain et le taquinait, sans légèreté particulière, sur les amitiés allemandes qu’il avait entretenues durant l’Occupation, comme si sa propre attitude avait été indemne de l’ambiguïté des temps, comme s’il s’était autant démené que Cocteau pour arracher Max Jacob à Drancy… Mais la cruauté de Picasso, ses souffre-douleur l’ont dit et redit, était marque d’amitié et philtre d’amour. Il ne couvrait de miel que ceux, hommes et femmes, pour lesquels il n’avait qu’indifférence ou mépris. L’attention, l’affection de Don Pablo se payait au prix fort. Cocteau, vitalisme plus que masochisme, accepta d’endurer, entre Parade et son épée d’académicien, un demi-siècle de caprices et d’avanies… Leur correspondance, décisive et enfin disponible, nous jette dans la complexité passionnelle d’une association, ou d’une corrida, trop souvent caricaturée par la vulgate, stalinienne ou pas, des aficionados. Aucun des grands récits de la geste picassienne ne manque, en effet, d’égratigner « le bouffon de la cour », voir « l’enfant gâté d’une chapelle pédérastico-mondaine », pour le dire comme d’aucuns, qui s’empressent d’ajouter, avec autant de finesse, que Picasso reprochait à Cocteau « ses faiblesses envers l’Occupant ». Un dernier grief, après les ballets russes et les fritz, qui fait le bonheur des experts, c’est le fameux « rappel à l’ordre » des années 1920, dont Cocteau, auteur du livre qui fixa la formule, aurait inoculé le poison à ce moderniste inoxydable qu’était Picasso ! Ces trois chefs d’accusation, il faut les avoir en tête si l’on veut faire une lecture complète, fertile, de la correspondance des deux hommes.
S’agissant de Cocteau et de ses turbulentes, mais fécondes, relations avec Picasso, les spécialistes du peintre ont été d’une rare malveillance et d’une sévère cécité, hormis André Fermigier et, bien sûr, John Richardson, le meilleur d’entre eux. Ce dernier m’a avoué que le peintre starisé, au début des années 1950, ne manquait aucune occasion de se montrer cruel envers l’écrivain et le taquinait, sans légèreté particulière, sur les amitiés allemandes qu’il avait entretenues durant l’Occupation, comme si sa propre attitude avait été indemne de l’ambiguïté des temps, comme s’il s’était autant démené que Cocteau pour arracher Max Jacob à Drancy… Mais la cruauté de Picasso, ses souffre-douleur l’ont dit et redit, était marque d’amitié et philtre d’amour. Il ne couvrait de miel que ceux, hommes et femmes, pour lesquels il n’avait qu’indifférence ou mépris. L’attention, l’affection de Don Pablo se payait au prix fort. Cocteau, vitalisme plus que masochisme, accepta d’endurer, entre Parade et son épée d’académicien, un demi-siècle de caprices et d’avanies… Leur correspondance, décisive et enfin disponible, nous jette dans la complexité passionnelle d’une association, ou d’une corrida, trop souvent caricaturée par la vulgate, stalinienne ou pas, des aficionados. Aucun des grands récits de la geste picassienne ne manque, en effet, d’égratigner « le bouffon de la cour », voir « l’enfant gâté d’une chapelle pédérastico-mondaine », pour le dire comme d’aucuns, qui s’empressent d’ajouter, avec autant de finesse, que Picasso reprochait à Cocteau « ses faiblesses envers l’Occupant ». Un dernier grief, après les ballets russes et les fritz, qui fait le bonheur des experts, c’est le fameux « rappel à l’ordre » des années 1920, dont Cocteau, auteur du livre qui fixa la formule, aurait inoculé le poison à ce moderniste inoxydable qu’était Picasso ! Ces trois chefs d’accusation, il faut les avoir en tête si l’on veut faire une lecture complète, fertile, de la correspondance des deux hommes.
Elle accroît, tout d’abord, notre connaissance des débuts de leur amitié, que le jeune Cocteau, proche de Stravinsky et d’Apollinaire en 1913-1914, précipite dès l’été suivant. Le patriotisme français n’étant pas le fort du peintre, le jeune poète, gagnant lui le front en 1915, abandonne vite l’illusion d’amener Picasso à agir. A défaut de lui faire signer « le manifeste des peintres espagnols de France », il encourage la mutation stylistique en cours. Double, elle tire le cubisme picassien vers la fantaisie, la couleur, les nouveaux thèmes dont il avait besoin, ou explore les voies d’un ingrisme repensé. Contrairement à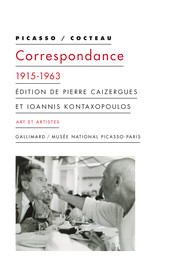 Lhote et d’autres, que Cocteau s’amuse à voir brûler ce qu’ils avaient adoré, Picasso ne renie rien. Avec Cocteau à ses côtés, il se donne les chances d’un regain d’invention. Parade, dont une exposition récente du Capodimonte de Naples a révélé des sources et clefs oubliées, leur fut un nouveau Sacre du printemps, Satie apportant à ses complices la haine des rutilances inutiles et une manière de cocasserie foraine. La scène, jusqu’au Train bleu, offre à leur fantaisie commune un espace de rêve. Parallèlement, les textes de Cocteau se multiplient, prose et poésie, qui clament la supériorité de Picasso sur Matisse, Derain ou Bonnard. Ceux qui douteraient de l’intérêt qu’y prête le peintre couronné n’ont qu’à lire la correspondance. En 1926, elle confirme la conduite « unfair » de Picasso lorsque paraît la fausse interview de L’Intransigeant, suite de propos calomnieux, forgés par les surréalistes dont Cocteau est la « bête noire ». Le poète pouvait admettre de Picabia et de Breton certaines bassesses, il digéra moins bien les silences de Picasso. Les lettres vont carrément s’espacer entre l’incident de 1926 et la guerre. De temps à autre, Cocteau s’attaque à ceux qui s’interposent entre Picasso et lui, tels les « amis du Minotaure ». Sous l’Occupation, les deux hommes renouent pour ainsi dire, ce qu’il faudrait davantage gloser. En présence de Dora Maar, Eluard, Jean Marais et même Léonce Rosenberg, ils se voient, ils s’écrivent aussi, reprise qui nous vaut des compléments d’information au regard du précieux Journal de Cocteau. L’Ode à Breker, fruit d’une amitié d’avant-guerre et d’une stratégie qui profita aux proches du poète, a trop longtemps servi d’arbre expiatoire, un de ceux qui nous masquent la forêt des réalités oubliées.
Lhote et d’autres, que Cocteau s’amuse à voir brûler ce qu’ils avaient adoré, Picasso ne renie rien. Avec Cocteau à ses côtés, il se donne les chances d’un regain d’invention. Parade, dont une exposition récente du Capodimonte de Naples a révélé des sources et clefs oubliées, leur fut un nouveau Sacre du printemps, Satie apportant à ses complices la haine des rutilances inutiles et une manière de cocasserie foraine. La scène, jusqu’au Train bleu, offre à leur fantaisie commune un espace de rêve. Parallèlement, les textes de Cocteau se multiplient, prose et poésie, qui clament la supériorité de Picasso sur Matisse, Derain ou Bonnard. Ceux qui douteraient de l’intérêt qu’y prête le peintre couronné n’ont qu’à lire la correspondance. En 1926, elle confirme la conduite « unfair » de Picasso lorsque paraît la fausse interview de L’Intransigeant, suite de propos calomnieux, forgés par les surréalistes dont Cocteau est la « bête noire ». Le poète pouvait admettre de Picabia et de Breton certaines bassesses, il digéra moins bien les silences de Picasso. Les lettres vont carrément s’espacer entre l’incident de 1926 et la guerre. De temps à autre, Cocteau s’attaque à ceux qui s’interposent entre Picasso et lui, tels les « amis du Minotaure ». Sous l’Occupation, les deux hommes renouent pour ainsi dire, ce qu’il faudrait davantage gloser. En présence de Dora Maar, Eluard, Jean Marais et même Léonce Rosenberg, ils se voient, ils s’écrivent aussi, reprise qui nous vaut des compléments d’information au regard du précieux Journal de Cocteau. L’Ode à Breker, fruit d’une amitié d’avant-guerre et d’une stratégie qui profita aux proches du poète, a trop longtemps servi d’arbre expiatoire, un de ceux qui nous masquent la forêt des réalités oubliées.
Stéphane Guégan
Picasso/Cocteau, Correspondance 1915-1963, Pierre Caizergues et Ioannis Kontaxopoulos (éd.), Gallimard/Musée national Picasso-Paris, 2018, 35€
7 télégrammes de Picasso !!!
La cuisine chez Picasso, la cuisine de Picasso : c’est tout un, nous dit Emmanuel Guigon, le patron très actif du musée Picasso de Barcelone, où se voit une délicieuse exposition, délicieuse au nez et à l’œil, sur les rapports nourrissants du culinaire et de l’image en ces processus de digestion et de transformation du réel. Neuf salles nous emmènent par la main jusqu’à l’imaginaire du déjeuner sur l’herbe, Manet ayant mordu à la vie, comme Picasso, de toutes les dents d’un appétit féroce. Les réunions de café et la communion auratique du restaurant ouvrent la marche. Els Quatre Gats, lieu inaugural, déborde son mythe. Picasso, exilé en France, n’aura de cesse d’en retrouver l’ambiance, la nourriture plus inventive qu’abondante, le théâtre des sens ; il y parviendra sous l’Occupation, au  bien nommé Catalan, que tient un homme du cru. C’est là qu’il déjeunera avec Eluard ou Prévert, Dora, puis Françoise… Entretemps, du vin aura coulé dans les verres. Du vin et de l’absinthe, comme le rappelle la salle cubiste, où la chose réelle sert parfois à se représenter elle-même dans l’écart qu’est toute poésie. Les ustensiles, et l’air d’éternité qui se loge au creux des casseroles et de la vieille céramique, ce fut l’une des grandes affaires de Picasso. A l’identique, il est des légumes, des viandes et des fruits de mer, qui le peignent à leur tour. Picasso, homme et œuvre, appelle l’artichaut, la tête de mouton et les poulpes balançant, plus ou moins gonflés, entre Éros et Thanatos. Les notes de boucherie, poissonnerie et primeurs, qu’il a conservées religieusement, méritaient d’être exposées, elles sont les traces d’une foi qu’il décida de transmettre. SG / La Cuisine de Picasso, Musée Picasso, Barcelone, jusqu’au 30 septembre, catalogue sous la dir. d’Emmanuel Guigon, La Fábrica, 39€.
bien nommé Catalan, que tient un homme du cru. C’est là qu’il déjeunera avec Eluard ou Prévert, Dora, puis Françoise… Entretemps, du vin aura coulé dans les verres. Du vin et de l’absinthe, comme le rappelle la salle cubiste, où la chose réelle sert parfois à se représenter elle-même dans l’écart qu’est toute poésie. Les ustensiles, et l’air d’éternité qui se loge au creux des casseroles et de la vieille céramique, ce fut l’une des grandes affaires de Picasso. A l’identique, il est des légumes, des viandes et des fruits de mer, qui le peignent à leur tour. Picasso, homme et œuvre, appelle l’artichaut, la tête de mouton et les poulpes balançant, plus ou moins gonflés, entre Éros et Thanatos. Les notes de boucherie, poissonnerie et primeurs, qu’il a conservées religieusement, méritaient d’être exposées, elles sont les traces d’une foi qu’il décida de transmettre. SG / La Cuisine de Picasso, Musée Picasso, Barcelone, jusqu’au 30 septembre, catalogue sous la dir. d’Emmanuel Guigon, La Fábrica, 39€.
**Pour la première exposition du musée qu’elle dirige désormais, Claudine Grammont réussit à étonner avec un sujet qui semblait impropre à le faire. Est-il terrain plus labouré, plus convenu, que ce que Picasso et Matisse se doivent sans toujours l’avoir avoué (Picasso surtout) ? Deux expositions, il y a une quinzaine d’années, avaient fait, en apparence, le tour de la « question », pour user d’un mot aujourd’hui atrocement répandu. Il restait beaucoup à dire pourtant, à dire et à délier. Toute lecture croisée dessine des frontières là où la porosité devrait régner. En les ramenant dans l’espace physique, mental et sexué de l’atelier, Claudine Grammont rend les deux peintres à leur passion irremplaçable, implacable, du modèle féminin ; et l’exposition niçoise, brassant les médiums et bravant les poncifs, se dote d’une dramaturgie proche des tensions et des tentations de « la  séance de pose ». Une vraie flamme parcourt les salles, entretenue par le trouble qu’elles mettent en scène, soutenue par les sortilèges du motif, aux prises avec le pinceau prédateur. Le rapport faunesque aux femmes serait apanage picassien ! Niaiserie, évidemment. A rebours d’une tendance lourde de l’historiographie matissienne, il est ici fait justice du mythe d’un peintre aux seuls signes attaché. Un peintre plus mallarméen que baudelairien (voir notre réédition des Fleurs du Mal illustré par Matisse sous l’Occupation, Hazan, 2017). La vie s’exalte, exulte même, aux détours multipliés des corps qui s’abandonnent ou convulsent, regards, chevelures et courbures dans le souvenir affiché de la Vénus callipyge et de toutes ces poitrines qui se laissèrent peindre. L’odalisque moderne est promesse d’étreinte, comme l’art, en son versant solaire, reste promesse de bonheur. SG / Matisse et Picasso. La Comédie du modèle, Musée Matisse, Nice, jusqu’au 29 septembre. Catalogue sous la direction de Claudine Grammont, LIENART, 34€.
séance de pose ». Une vraie flamme parcourt les salles, entretenue par le trouble qu’elles mettent en scène, soutenue par les sortilèges du motif, aux prises avec le pinceau prédateur. Le rapport faunesque aux femmes serait apanage picassien ! Niaiserie, évidemment. A rebours d’une tendance lourde de l’historiographie matissienne, il est ici fait justice du mythe d’un peintre aux seuls signes attaché. Un peintre plus mallarméen que baudelairien (voir notre réédition des Fleurs du Mal illustré par Matisse sous l’Occupation, Hazan, 2017). La vie s’exalte, exulte même, aux détours multipliés des corps qui s’abandonnent ou convulsent, regards, chevelures et courbures dans le souvenir affiché de la Vénus callipyge et de toutes ces poitrines qui se laissèrent peindre. L’odalisque moderne est promesse d’étreinte, comme l’art, en son versant solaire, reste promesse de bonheur. SG / Matisse et Picasso. La Comédie du modèle, Musée Matisse, Nice, jusqu’au 29 septembre. Catalogue sous la direction de Claudine Grammont, LIENART, 34€.
***André Breton rencontre Picasso et Picabia presque simultanément. Tout se noue entre novembre 1918 et décembre 1919. Entretemps, Au Sans pareil fait paraître son Mont de piété, riche de ses sages sonnets et de deux dessins de Derain. Sainte trinité… Mais c’est à Picabia, le plus Dada, le futur complice de Littérature, que Breton et Soupault demandent les portraits destinés à orner leurs Champs magnétiques en juin 1920. Livre génial, il est bien là, sous vitrine, au musée Granet, et l’on y verra la clef de l’éblouissante exposition Picasso / Picabia que Bruno Ely et Aurélie Verdier ont déployée sur deux étages. Il fallait bien cela pour débrouiller l’histoire de ce tandem et des attractions mutuelles dont il fut tissé. Parce que Picabia, art et idéologie, est supposé s’être très mal conduit dès la fin des années 1920 et s’être compromis sous l’Occupation, l’idée d’une telle comparaison semblait à jamais frappée d’impossibilité. Merci donc à Aix et au programme Picasso – Méditerranée de Laurent Le Bon d’avoir repoussé les bornes du licite. On saura gré, de plus, aux commissaires de pas avoir organisé leur propos autour de la compétition que certains  s’attendent peut-être à voir s’agiter et s’aiguiser dans les salles. Que nous importe de savoir qui, de ces deux peintres quasi contemporains et presque espagnols à égalité, fut le plus « radical », le plus « moderne » ou le plus apte à ironiser sur les propres mécanismes de son art et les attentes de son public. Au contraire, l’accrochage, fidèle au magnétisme que l’on a dit, distribue images et documents selon des convergences esthétiques et biographiques oubliées, du ludisme iconoclaste et agressif aux mondanités de la côte d’azur des années folles, depuis les espagnolades ingrisantes aux baisers voraces que l’on sait (deux moments du parcours à couper le souffle). En chemin, le visiteur se réapproprie les autres termes du dialogue, fait de leur même amour pour le mauvais goût, les matières clinquantes, la carte postale sentimentale recyclée et les désirs inapaisables. Les années de l’Occupation auraient pu être prudemment écartées, c’est mal connaître l’audace des commissaires. Une leçon. SG / Picasso/Picabia. La peinture au défi, Musée Granet, Aix, jusqu’au 23 septembre, catalogue sous la direction d’Aurélie Verdier, Somogy, 35€.
s’attendent peut-être à voir s’agiter et s’aiguiser dans les salles. Que nous importe de savoir qui, de ces deux peintres quasi contemporains et presque espagnols à égalité, fut le plus « radical », le plus « moderne » ou le plus apte à ironiser sur les propres mécanismes de son art et les attentes de son public. Au contraire, l’accrochage, fidèle au magnétisme que l’on a dit, distribue images et documents selon des convergences esthétiques et biographiques oubliées, du ludisme iconoclaste et agressif aux mondanités de la côte d’azur des années folles, depuis les espagnolades ingrisantes aux baisers voraces que l’on sait (deux moments du parcours à couper le souffle). En chemin, le visiteur se réapproprie les autres termes du dialogue, fait de leur même amour pour le mauvais goût, les matières clinquantes, la carte postale sentimentale recyclée et les désirs inapaisables. Les années de l’Occupation auraient pu être prudemment écartées, c’est mal connaître l’audace des commissaires. Une leçon. SG / Picasso/Picabia. La peinture au défi, Musée Granet, Aix, jusqu’au 23 septembre, catalogue sous la direction d’Aurélie Verdier, Somogy, 35€.
****En d’autres mains que celles d’Olivier Le Bihan, l’exposition Picasso. L’atelier du minotaure se serait sans doute contentée de feuilleter et célébrer la revue bien connue de Tériade et Skira (13 livraisons entre 1933 et 1939), chant du cygne d’un certain surréalisme. On sait que Picasso, avec la complicité de Breton et des siens, se fit attribuer la couverture du numéro inaugural, à la barbe de Masson et Bataille, les inventeurs pourtant d’un titre supposé traduire la valeur oraculaire des vieux mythes dans un présent menacé… Mais, à Evian, nulle exclusive. Le Masson de Sacrifices et Picasso cohabitent dans les espaces agréablement labyrinthiques de la scénographie. Les deux artistes, férus d’art « ancien », se savaient les débiteurs d’une tradition venue des Grecs et  de Pompéi. Le Bihan pousse plus loin la collecte des sources. La modernité, signe du vide autour duquel elle se constitua, a toujours joué les archéologues, c’est vrai de Canova, de l’étonnant Peytavin, davidien hors-norme, comme de Gustave Moreau. Au XXe siècle, le monstre à tête de taureau, fruit des ébats contre-nature de l’épouse de Minos, hante le théâtre et l’opéra, comme au bon temps du roi soleil. Mais la victoire des forces de la nuit se fait désormais plus impérieuse. Picasso fait courir son hybride priapique au milieu d’une obscure concurrence qui rêve, comme lui, des surmâles de Jarry et d’Apollinaire. Dans le genre, la plus belle surprise reste la tapisserie de Marc Saint-Sens, tissée en 1942-1943, où l’excès phallique sert l’allégorie patriotique. Thésée s’y jette sur le minotaure et lui plonge, en pleine encolure, le glaive de la future Libération. En écho aux violences crues de Picasso et Masson des années 1930, voilà qui fait réfléchir à leur sous-texte politique, comme au temps de David. SG / Picasso. L’atelier du minotaure, Evian, Palais Lumière, jusqu’au 7 octobre, catalogue sous la dir. d’Olivier Le Bihan, Somogy, 35€.
de Pompéi. Le Bihan pousse plus loin la collecte des sources. La modernité, signe du vide autour duquel elle se constitua, a toujours joué les archéologues, c’est vrai de Canova, de l’étonnant Peytavin, davidien hors-norme, comme de Gustave Moreau. Au XXe siècle, le monstre à tête de taureau, fruit des ébats contre-nature de l’épouse de Minos, hante le théâtre et l’opéra, comme au bon temps du roi soleil. Mais la victoire des forces de la nuit se fait désormais plus impérieuse. Picasso fait courir son hybride priapique au milieu d’une obscure concurrence qui rêve, comme lui, des surmâles de Jarry et d’Apollinaire. Dans le genre, la plus belle surprise reste la tapisserie de Marc Saint-Sens, tissée en 1942-1943, où l’excès phallique sert l’allégorie patriotique. Thésée s’y jette sur le minotaure et lui plonge, en pleine encolure, le glaive de la future Libération. En écho aux violences crues de Picasso et Masson des années 1930, voilà qui fait réfléchir à leur sous-texte politique, comme au temps de David. SG / Picasso. L’atelier du minotaure, Evian, Palais Lumière, jusqu’au 7 octobre, catalogue sous la dir. d’Olivier Le Bihan, Somogy, 35€.
*****La ville de Vallauris s’est mise en quatre afin de fêter, elle aussi, le méditerranéen Picasso. N’en est-il pas citoyen d’honneur depuis 1956 ? Tiens, c’est l’année de la boucherie de Prague. On sait que le camarade Pablo broncha à peine quand les tanks soviétiques nettoyèrent la ville de ses séditieux. Leur écrasement, surtout, n’allait-il pas profiter aux ennemis de Moscou ? Chacun sa conception de la liberté, n’est-ce-pas ? Le catalogue de cette exposition nous dit que Picasso trouva la sienne, fin 1944, au sein du PCF. Étrange façon de voir ce ralliement stratégique, ce n’est pas la mienne. Quoi qu’il en soit, cette modeste ville de potiers et d’ouvriers italiens convenait mieux que le château d’Antibes, où il avait réalisé en 1946 sa matissienne et païenne Joie de vivre, pour accréditer la thèse d’un peintre acquis à la cause des  prolétaires et au grand dessein stalinien. Le prix de ce compagnonnage, nous le connaissons, et cette exposition, en choisissant d’occuper quatre lieux différents, le met très bien en évidence. Comment ignorer le transitoire, mais fâcheux, fléchissement de la peinture picassienne, écartelée trop souvent qu’elle est alors entre la mièvrerie familiale et les images à message, des terrifiants Massacres de Corée à la chapelle de la Pax sovietica (merci à Mirò et Matisse quant au vocabulaire plastique !) ? Il y a le reste, par chance. Moins soumises aux pressions du parti et aux pannes d’inspiration, sculpture et céramique profitent encore de sa sève créatrice et sa faculté de faire feu de tout objet. Le vrai « terrain d’expérimentations », pour le dire avec Diana Picasso, s’ouvre au-delà de l’assujettissement idéologique, au plus près du réel et de la fantaisie royale de Don Pablo. SG / Picasso. Les années Vallauris (1948-1955), Vallauris, 4 lieux, jusqu’au 22 octobre, catalogue sous la direction d’Anne Dopfer et de Johanne Lindskog, RMN éditions, 39€.
prolétaires et au grand dessein stalinien. Le prix de ce compagnonnage, nous le connaissons, et cette exposition, en choisissant d’occuper quatre lieux différents, le met très bien en évidence. Comment ignorer le transitoire, mais fâcheux, fléchissement de la peinture picassienne, écartelée trop souvent qu’elle est alors entre la mièvrerie familiale et les images à message, des terrifiants Massacres de Corée à la chapelle de la Pax sovietica (merci à Mirò et Matisse quant au vocabulaire plastique !) ? Il y a le reste, par chance. Moins soumises aux pressions du parti et aux pannes d’inspiration, sculpture et céramique profitent encore de sa sève créatrice et sa faculté de faire feu de tout objet. Le vrai « terrain d’expérimentations », pour le dire avec Diana Picasso, s’ouvre au-delà de l’assujettissement idéologique, au plus près du réel et de la fantaisie royale de Don Pablo. SG / Picasso. Les années Vallauris (1948-1955), Vallauris, 4 lieux, jusqu’au 22 octobre, catalogue sous la direction d’Anne Dopfer et de Johanne Lindskog, RMN éditions, 39€.
******Le deuxième livre de Romy Golan, mais le premier à être traduit, est largement préférable au trop manichéen Modernity and Nostalgia (1995). Il en reproduit pourtant, à maints endroits, la tendance à catégoriser les situations et les artistes d’un mot, bien sûr, tranchant. Sont ainsi qualifiés de « réactionnaires » un certain nombre d’acteurs, sans que le lecteur sache si la régression est d’ordre esthétique ou politique. Quand l’ire de l’auteur s’abat sur Louis Hautecœur, qui fut directeur des Beaux-Arts sous Vichy, et Waldemar George, critique d’art juif qui s’enflamma pour le fascisme italien avant que Mussolini ne s’aligne sur le racisme d’état d’Hitler, on réalise que Golan pratique un certain amalgame. Disons rapidement qu’on doit à Hautecœur la  modernisation du musée du Luxembourg dans les années 1920, que le musée d’art moderne des années sombres montrait Tanguy, Picabia et Léger, ou que Waldemar George enfin fut l’un des critiques les plus géniaux de Miró après 1930. La lecture de Muralnomad (titre emprunté au néologisme par lequel Le Corbusier désignait la tapisserie) n’en est pas moins fort instructive quant à la relance du décor mural dans les années 1930, en Italie (très bien étudiée par l’auteur) et France, en Allemagne et Russie. Concernant ces deux derniers totalitarismes, Golan analyse finement l’emploi massif que la propagande fait alors du photomontage, qui devait dominer certains des pavillons de l’Exposition Universelle de 1937. Mais on ne la suivra pas dans son analyse de Guernica, qui serait tributaire de ces fresques photographiques à fragmentation et focalisation spectaculaires. Ne vaudrait-il pas mieux appliquer à la tragédie basque de Picasso ce que Golan dit de Lurçat ? En d’autres termes, Guernica, au-delà du gris des médias d’actualité, nous semble redevable des scènes médiévales d’apocalypse, voire de la tradition murale catalane, si chère à Miro, l’ami de Picasso. SG // Romy Golan, Muralnomad. Le paradoxe de l’image murale en Europe (1927-1957), Macula, 44€.
modernisation du musée du Luxembourg dans les années 1920, que le musée d’art moderne des années sombres montrait Tanguy, Picabia et Léger, ou que Waldemar George enfin fut l’un des critiques les plus géniaux de Miró après 1930. La lecture de Muralnomad (titre emprunté au néologisme par lequel Le Corbusier désignait la tapisserie) n’en est pas moins fort instructive quant à la relance du décor mural dans les années 1930, en Italie (très bien étudiée par l’auteur) et France, en Allemagne et Russie. Concernant ces deux derniers totalitarismes, Golan analyse finement l’emploi massif que la propagande fait alors du photomontage, qui devait dominer certains des pavillons de l’Exposition Universelle de 1937. Mais on ne la suivra pas dans son analyse de Guernica, qui serait tributaire de ces fresques photographiques à fragmentation et focalisation spectaculaires. Ne vaudrait-il pas mieux appliquer à la tragédie basque de Picasso ce que Golan dit de Lurçat ? En d’autres termes, Guernica, au-delà du gris des médias d’actualité, nous semble redevable des scènes médiévales d’apocalypse, voire de la tradition murale catalane, si chère à Miro, l’ami de Picasso. SG // Romy Golan, Muralnomad. Le paradoxe de l’image murale en Europe (1927-1957), Macula, 44€.
*******Roland Dumas, qu’aucune audace n’inquiète, a déjà parlé. En 2014, il m’avait reçu et confié quelques éléments sur la « restitution » de Guernica à l’Espagne post-franquiste (on comprendra, plus loin, la raison des guillemets). Au micro de Thierry Savatier, grand expert de la Présidente (oui, la « très chère » de Baudelaire) et de Courbet, venu le questionner sur L’Origine du monde, Lacan et le cache génial de Masson, il s’est bien davantage ouvert. Un livre entier est né de cette rencontre. Tout n’y est pas neuf, en raison, notamment, des publications antérieures de Roland Dumas. Mais le temps que s’accordent les auteurs est propice aux nuances et aux hésitations. L’ancien avocat de Pablo et de Jacqueline, entré dans leur intimité après les révélations de Françoise Gilot, n’hésite pas se dire partagé, ou à le faire comprendre en virtuose des silences éloquents, quant aux choix de son ancien client en matière familiale ou politique. On l’aimerait plus  disert au sujet des calamiteuses années communistes, sur lesquelles on lira Gertje Utley plutôt que Pierre Daix. Pourquoi ignorer, par exemple, que le décor de Vallauris, en sa composante nord-coréenne, relève de la pire propagande anti-américaine (et de la pire peinture) ? La guerre d’Algérie, qui plaça le PCF devant ses contradictions, le FLN et la défense de Diego Masson, le fils d’André, nous valent, de sa part, des remarques autrement plus nettes. Savatier sait l’écouter, il sait aussi relancer et rappeler que les faits sont têtus. Du soin que le chercheur prit à le préparer vient la cohérence du livre. Se vérifie enfin son sens critique du document. La preuve la plus éclatante en est fournie par l’annexe et la discussion serrée des « papiers » du dossier Guernica. Se pourrait-il que la République espagnole n’eût aucun droit de propriété sur le tableau qui n’aurait pas été « commandé » au peintre, ni payé ? Se pourrait-il que l’Espagne, après la mort de Franco (1975), eût forgé les preuves du contraire ? Garant de la volonté de Picasso, Roland Dumas ne parle pas de « restitution », mais de « transfert ». Et donc de don. Comme Savatier l’écrit, après avoir peut-être levé un sacré lièvre, à suivre… SG / Roland Dumas et Thierry Savatier, Picasso. Ce volcan jamais éteint, Bartillat, 20€.
disert au sujet des calamiteuses années communistes, sur lesquelles on lira Gertje Utley plutôt que Pierre Daix. Pourquoi ignorer, par exemple, que le décor de Vallauris, en sa composante nord-coréenne, relève de la pire propagande anti-américaine (et de la pire peinture) ? La guerre d’Algérie, qui plaça le PCF devant ses contradictions, le FLN et la défense de Diego Masson, le fils d’André, nous valent, de sa part, des remarques autrement plus nettes. Savatier sait l’écouter, il sait aussi relancer et rappeler que les faits sont têtus. Du soin que le chercheur prit à le préparer vient la cohérence du livre. Se vérifie enfin son sens critique du document. La preuve la plus éclatante en est fournie par l’annexe et la discussion serrée des « papiers » du dossier Guernica. Se pourrait-il que la République espagnole n’eût aucun droit de propriété sur le tableau qui n’aurait pas été « commandé » au peintre, ni payé ? Se pourrait-il que l’Espagne, après la mort de Franco (1975), eût forgé les preuves du contraire ? Garant de la volonté de Picasso, Roland Dumas ne parle pas de « restitution », mais de « transfert ». Et donc de don. Comme Savatier l’écrit, après avoir peut-être levé un sacré lièvre, à suivre… SG / Roland Dumas et Thierry Savatier, Picasso. Ce volcan jamais éteint, Bartillat, 20€.






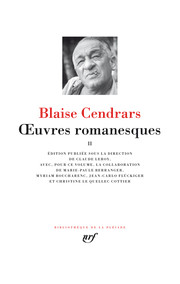





















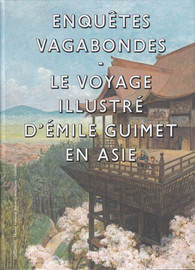

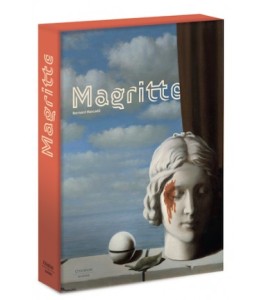










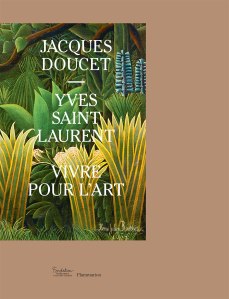






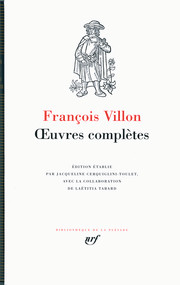



 – Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),
– Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),  *Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’
*Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’ *Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de
*Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de