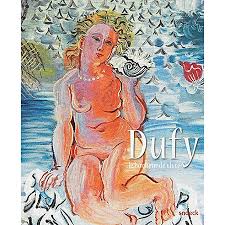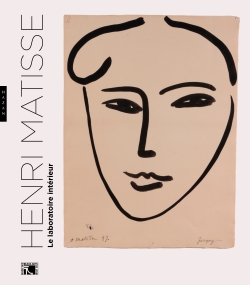A seize ans, Drieu est déjà lui-même, mais il l’ignore, se questionne, s’observe sous toutes les coutures, à commencer par celles de ses pantalons et gilets. Le dandysme, comme le génie, n’attend pas les années…. Contre l’éphémère, et contre une timidité dont il lui est urgent de se défaire, Drieu met des mots sur ses doutes et ses désirs, prend des notes, développe ou non, dialogue avec soi, se construit plume en main. Dès les premières pages de ses agendas et carnets intimes enfin disponibles, lesquels relient son adolescence aux années noires, le futile et le grave, la littérature et la politique, et bientôt le sexe et l’écriture, crus l’un et l’autre, composent le meilleur des portraits chinois. Au commencement, nous sommes en 1909, le lycéen passe de Molière à Horace, du latin à l’allemand, de Montesquieu et Saint-Just à Paul Adam. Les angoisses où on aime à l’enfermer aujourd’hui s’indiquent ici et là, mais sa fierté d’Athénien moderne résiste. Dans sa tête de jeune nanti roulent des idées contraires à son milieu, aux carrières faciles, aux existences casées, aux destins carrés. Ferme d’âme, mot qu’il affectionne en pascalien, Pierre ne juge pas de haut, mais il évalue avec sûreté les marottes d’un moment qui hésite entre Barrès, Nietzsche et la poésie cubiste. L’évolutionnisme glisse au mysticisme, le psychologisme à l’obscur, l’art à l’ésotérisme, le socialisme à l’utopie ouvrière… De quoi les jeunes bourgeois, ceux que tenaillent le manque d’action et la peur du plat, peuvent-ils rêver encore ? Nécessité intérieure faisant loi, Drieu se frotte aux idéologies de l’heure, à l’exclusion du monarchisme maurrassien. Julien Hervier, à qui l’on doit l’édition serrée de ces inédits peu commodes à déchiffrer, rappelle qu’on a longtemps tenu Drieu, à raison, pour un homme de gauche. Beaucoup de ses semblables, sans tout à fait renier leurs idées, devaient se laisser séduire comme lui par la droite dure, il les retrouverait au moment de la relance heureuse de la NRF, fin 1940, éclairée à neuf ici, et jusqu’où nous conduit cette publication indispensable aux rochelliens et à ceux qui, aujourd’hui, en pleine crise des démocraties et en plein essor des communautarismes, se demandent comment « refaire la France ».

L’expression, la sienne en 1939, désigne aussi bien l’attitude de Malraux en Espagne que le rêve de Drieu d’une Europe dressée contre les blocs qui la menaçaient, et où se seraient harmonisés hégémonie et fédéralisme, patrie et hygiène du groupe. Qu’il se soit trompé de méthode sous l’Occupation en déçu du briandisme genevois, Drieu l’a reconnu lui-même, dès le tournant 1942-43. Son pacte franco-germanique tourne court, il y avait illusoirement vu se conjuguer deux ambitions de sa jeunesse impatiente, celle de l’unité nationale reconquise à partir d’une révolution sociale, celle d’une alliance possible entre républicanisme romain et élitisme aristocratique. Balzac et Hugo, souvent cités par les carnets, l’ont nourri à cet égard. Car le beau, le luxe, la liberté de créer, la liberté de mœurs, la foi personnelle ne lui semblent en aucun cas devoir être sacrifiés à l’autorité de l’Etat, si respectable soit-elle. On le voit très tôt méditer l’envolée et l’échec de 1792-94, imaginer un christianisme reconcilié avec la vie ou demander aux arts autre chose qu’une distraction amollissante. Que Rodin soit alors préféré aux préraphaélites anglais, découverts à Londres même, c’est dans l’ordre, de même que son goût des moralistes du Grand siècle et, autre passion qui ne devait jamais s’éteindre, sa lecture catholique, politique, de Baudelaire, le poète des saines contradictions de l’homo duplex : « Certes je sortirai quant à moi satisfait / D’un monde où l’action n’est pas la sœur du rêve », recopie-t-il en 1911, écornant à peine la ponctuation de ce qu’il désigne d’un mot révélateur : « Révolte ». De Nietzsche, autre choix qui signe, il a appris que le Christ avait moins racheté les hommes par sa mort qu’il ne leur avait appris comment vivre par son enseignement. Pas d’antichristianisme laïcard chez notre républicain en mal de vraie République, car il a reconnu en lui la force multiséculaire de « l’inconscient héréditaire religieux ». Mais sa foi refuse toute « retraite », tient le « regret » pour le « fardeau des faibles », et exige un libre-arbitre actif, dans le mouvement de l’événement, à rebours de la pauvreté d’âme… Dans le carnet des Dardanelles, sa campagne de 1915, on lit : « Le sentiment de soulagement au début de la guerre. Enfin l’histoire remarche. Cette attente qui est toujours au fond des cœurs. » Le bellicisme des futuristes ne l’a pas plus contaminé pourtant que celui, plus tard, des nazis. Charleroi était passé par là. En 1939, soucieux comme jamais de trouver un remède à l’atomisme du corps national, il prêche de plus belle la restauration du corps, non l’apologie de la guerre, qui est l’apologie de la mort. « Jouer Dantzig sur un match de football » : sa formule tient de l’humeur, non de l’humour. « A partir du moment où le corps reparaît, un nouveau type d’homme est remis en honneur », conclut-il. Ses agendas touchent donc à l’essentiel, certains brefs aveux aussi. En 1913-1914, il en va ainsi de cette notation, qui n’est pas orpheline : « Deux êtres que je passerai ma vie à découvrir : la femme, le juif. » Sans exclusive fut pourtant sa sociabilité de l’entre-deux-guerres, comme le volume la renseigne à vif. Il s’achève par d’autres interrogations. Le dilemme. Notes sur le nationalisme, en 1942, opère ainsi des rapprochements qui saisissent : « Goethe a vécu dans la défaite de sa patrie. Mais avant et après lui il y a eu une Allemagne libre ». Protégé par sa première épouse, qui était juive, l’attachante et brillante Colette Jéramec, Drieu s’est tué au lendemain de la Libération. Avait-il deviné qu’elle ne ressemblerait pas à la France « refaite » dont Malraux et lui s’étaient donné le mot ?
Stéphane Guégan
*Pierre Drieu la Rochelle, Jouer Dantzig sur un match de football, Carnets intimes 1909-1942, édition et avant-propos de Julien Hervier, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 19€.
BAUDELAIRIANA

A 16 ans, Baudelaire était déjà lui-même et il le savait. Les lettres adressées alors à sa mère étincellent de brio, de vie et d’appels insatiables. Ce sensible rentré s’y met à nu, en tout, avant tous. Le lycéen préfère les études au collège et aux collégiens, les livres aux professeurs qui ont pourtant détecté une perle rare, difficile à polir toutefois. La poésie l’a déjà empoigné, plus que la hâte de publier. Bientôt les jupons et sa première chaude-pisse, confiée sotto voce à son demi-frère en 1839. Un rare témoignage antérieur, destiné au même, nous le dépeint avide de lectures fortes : « J’aime assez le romantique », lui avouait-il à 11 ans, en 1832, alors que Gautier et Pétrus Borel se débarrassaient, frénétisme obligeait, du sentimental 1820. Charles les lira et, plus important, leur restera fidèle mêlant cette inspiration ténébreuse et rieuse à son baroquisme chrétien propre. Il y a peu, ces lettres et tant d’autres trésors, peintures, estampes comme photographies et manuscrits, ont été livrés, gracieusement, aux mordus de Baudelaire, sur lequel les hommages de la nation et de la presse ne pleuvent pas, comme l’écrit Jean-Claude Vrain, l’instigateur de l’exposition décisive qui vient de se refermer à la mairie du Vie arrondissement. Remercions-en aussi le maire, Jean-Pierre Lecoq. D’autres que lui auraient probablement abdiqué devant le wokisme proliférant, peu tendre avec ce poète qui parlait si mal, dit-on, des femmes, de la démocratisation délirante et du progrès, ce satanisme déguisé en bien, comme le rappelle André Guyaux en tête du catalogue. Car, si la fête dura peu, comme les meilleures agapes de l’esprit et du vrai goût, il reste une publication, presque un livre par la somme d’informations, souvent inédites, qu’il abrite. Sa « vie avec Baudelaire », Vrain pouvait seul la raconter avec force et émotion, notamment lorsqu’il évoque la figure de Claude Pichois. D’une telle richesse, d’une telle patience à traquer la pièce exceptionnelle, on éprouve quelque honte à parler si brièvement. Si la manifestation se présentait dans le plus simple appareil (au diable les scénographies quand il en va du plus grand génie français !), l’ouvrage déploie un luxe de reproductions et de commentaires aiguisés, de sorte que le lecteur s’y promène, pantois, et y retrouve décuplés les frissons de sa visite. Au titre de ces curiosités aptes à combler plus d’un collectionneur, il faudrait s’arrêter sur tel tirage de Nadar, telle épreuve unique de la dernière photographie de Baudelaire à l’été 1866 (notre illustration), tel document, tel tableau, comme la copie par Legros du portrait de Baudelaire par Courbet. On vibre aussi devant le beau visage de Poulet-Malassis charbonné par Carolus-Duran, feuille qui a appartenu au poète comme ce bel exemplaire de l’eau-forte de Manet représentant Lola de Valence, posant au-dessus du quatrain que l’on sait. Un des deux manuscrits d’Un voyage à Cythère porte dédicace à Nerval, et donc à l’Eros navré, mais toujours renaissant, de son modèle, adepte du rococo et des voyages amers. Parmi les exemplaires de l’édition originale des Fleurs du Mal, série inouïe, se trouvait celui sur Hollande d’Asselineau, indissociable Pollux des Salons de Baudelaire, qui n’ont pas été oubliés. On y croisait encore une épreuve corrigée du Reniement de saint Pierre, le poème qui obséda Drieu sa vie durant. Sous nos yeux, « tristes blasphèmes » se mue en « affreux blasphèmes », qui sent son Bossuet lu et relu. De lettres en envois, de livres en livres, un monde se recompose avec ses contemporains majeurs. Que Jean-Claude Vrain ait rangé parmi eux Théophile Gautier, omniprésent dans le catalogue, prouve sa fine connaissance des choses de l’esprit, dont la bibliophilie fut autant le levier qu’un coup de foudre, dans l’ennui des casernes, pour ces fleurs qui n’étaient plus de rhétorique. SG // Charles Baudelaire (1821-2021) Exposition du bicentenaire, Librairie Jean-Claude Vrain, 30€. Quant à l’exposition de la BnF, Baudelaire. La modernité mélancolique, voir ma recension à paraître dans Grande Galerie.

Dans son dernier livre en date, fruit de la dernière série de cours qu’il prononça au Collège de France, Antoine Compagnon choisit de s’intéresser aux ultima verba, dernières œuvres, dernières images ou dernières paroles. Triplicité fascinante, un livre de Chateaubriand en concentre le prestige. La Vie de Rancé, que certains d’entre nous tiennent pour l’un des plus éminents de son auteur et de toute la littérature française, souleva l’incompréhension de Sainte-Beuve, à sa sortie, en 1844. Trop calotin, trop discontinu, trop désinvolte… On connaît la musique des sourds et des secs. Sainte-Beuve n’a pas mieux compris, ni défendu, Baudelaire, Stendhal et même Gautier, quand on y regarde de près. Proust lui règlera son compte en connaissance de cause. Or, Rancé, écrit justement Compagnon, « préfigure la poésie de la mémoire de Baudelaire à Proust ». Barthes doutait un peu des fins, l’édification de ses lecteurs, le pardon de ses péchés, que l’enchanteur annonçait vouloir servir, en accord avec son confesseur. Il doutait aussi que les modernes puissent encore le lire ainsi. Double erreur. L’autre reviendrait à donner raison à Maurice Blanchot, le faux écrivain par excellence, persuadé que la littérature ne visait que sa propre disparition, n’aspirait qu’au silence dont elle serait indûment sortie et que la décision de ne plus écrire confirmait ce que devait être l’œuvre conséquente, une mise à mort, par les mots, de tout ce qui débordait l’espace autonome de son énonciation. La vie, quand bien même la littérature n’en capterait qu’une intensité inférieure à son modèle, semblait un but plus légitime à Chateaubriand, ce que confirme l’ultime bouquet de son Rancé. S’il relève d’une tradition hagiographique bien établie, René la colore de sa sensualité et de son catholicisme noblement didactique. Du reste, la finalité édifiante du texte sort renforcée des multiples échappées autobiographiques qui rappellent l’écriture chorale des Mémoires d’outre-tombe. Quitte à digresser, Chateaubriand, semblable en cela à Baudelaire et Drieu, n’oublie pas les tableaux. « Peindre est l’acte le plus chaud d’acceptation de la vie », écrivait ce dernier en mai 1940. Après avoir si bien parlé du vieux Guérin, peignant son dernier tableau à Rome, la très racinienne Prise de Troie, Chateaubriand introduit Poussin, deux fois, parmi les méandres de son Rancé. La première occurrence rejoint un mythe que scrute Compagnon en détails, le chant du cygne chez les génies, ou l’imperfection voulue comme élection : « On remarque des traits indécis dans le tableau du Déluge, dernier travail du Poussin : ces défauts du temps embellissent le chef-d’œuvre. » La seconde référence à Poussin, qui a inspiré son plus beau livre à Gaëtan Picon, ramène le lecteur au Déluge par une voie plus moderne, c’est-à-dire plus propre au XIXe siècle et à son art, obsédés d’historicité fuyante et de temporalité vécue : « Ce tableau rappelle quelque chose de l’âge délaissé et de la main du vieillard : admirable tremblement du temps ! Souvent les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d’œuvre : c’est leur âme qui s’envole. » Le tableau, pour Baudelaire et Manet, devra témoigner du temps de son exécution et de la décision de son inachèvement. Au terme de ce livre où Rancé sert de « conducteur » et conduit Compagnon à réfléchir sur le « dernier livre » ou le « dernier style », nous retrouvons Proust, Baudelaire et le thème du dernier portrait, celui en qui tout se résumerait, sachant que chaque poète, pour Marcel, résumait la poésie à soi seul. De la dernière séance à laquelle Carjat soumit le poète des Epaves, deux images nous restent. Proust aura connu, par la reproduction, la « plus dure », la « plus misérable » des deux (notre ill.), écrit Compagnon, celle où Baudelaire semble, menton bas, regard dément, de l’autre côté du miroir. Au « J’allais mourir » du Rêve d’un curieux semble s’être substitué un terrible « Je vais mourir ». Proust ne sera pas le dernier, face à l’ultime lucarne, à avoir « envie de pleurer ». Le beau livre de Compagnon, plein de son sujet, permet d’accrocher d’autres profondeurs à cette photographie mythique et à tout ce qu’elle suggère d’infini et de réfléchi. SG / Antoine Compagnon, La Vie derrière soi. Fins de la littérature, Editions des Equateurs, 2021, 23€.