 La mère de Baudelaire se rongeait les sangs, son fils, qu’elle savait génial, mais incorrigible, remettait ça. Non content d’avoir goûté aux tribunaux pour Les Fleurs du Mal, de préférer les « filles » au ménage bourgeois et de tirer le diable par la queue, Charles s’était jeté dans un projet plus inquiétant encore. Par horreur de Rousseau et de ses modernes prosélytes, et afin de réfuter l’idée absurde que l’homme naissait bon, l’intrépide avait décidé d’écrire ses propres Confessions et d’y entasser toutes ses « colères » et ses « rancunes ». Au début d’avril 1861, Baudelaire l’annonce à celle qui reste, malgré la mort du général, Mme Aupick, la sentinelle d’Honfleur, la mère aimée et haïe… Le poète aura quarante ans sous peu mais il en paraît beaucoup plus. La vie de plaisirs, la maladie et ses graves ennuis d’argent ont ruiné ses ardeurs de jeunesse et accru en lui l’impression d’un désordre profond, d’un mécontentement de soi, qui le ronge autant que la syphilis. Ce qu’il appelle sa « vérole », et dont il observe les « retours », change de tour en janvier 1862, alors qu’il brigue le fauteuil académique du défunt Lacordaire, « prêtre romantique » dont il s’estime l’héritier à juste droit. Le fragment du 23 janvier 1862 est célèbre : « j’ai senti passer sur moi le vent de l’aile de l’imbécillité ». Des vagues torpeurs en commotions alarmantes, les crises vont s’accuser et l’acculer à toutes sortes d’expédients… Baudelaire ne sait plus trop si le suicide mettrait fin à ses malheurs ou confirmerait la faiblesse qu’il se reproche. La meilleure des « hygiènes », son mot, c’est travailler. Demeure donc un solide désir de publier, avant de disparaître, « mes œuvres critiques, si je renonçais aux drames […], aux romans, et enfin un grand livre auquel je rêve depuis deux ans : Mon Cœur mis à nu ».
La mère de Baudelaire se rongeait les sangs, son fils, qu’elle savait génial, mais incorrigible, remettait ça. Non content d’avoir goûté aux tribunaux pour Les Fleurs du Mal, de préférer les « filles » au ménage bourgeois et de tirer le diable par la queue, Charles s’était jeté dans un projet plus inquiétant encore. Par horreur de Rousseau et de ses modernes prosélytes, et afin de réfuter l’idée absurde que l’homme naissait bon, l’intrépide avait décidé d’écrire ses propres Confessions et d’y entasser toutes ses « colères » et ses « rancunes ». Au début d’avril 1861, Baudelaire l’annonce à celle qui reste, malgré la mort du général, Mme Aupick, la sentinelle d’Honfleur, la mère aimée et haïe… Le poète aura quarante ans sous peu mais il en paraît beaucoup plus. La vie de plaisirs, la maladie et ses graves ennuis d’argent ont ruiné ses ardeurs de jeunesse et accru en lui l’impression d’un désordre profond, d’un mécontentement de soi, qui le ronge autant que la syphilis. Ce qu’il appelle sa « vérole », et dont il observe les « retours », change de tour en janvier 1862, alors qu’il brigue le fauteuil académique du défunt Lacordaire, « prêtre romantique » dont il s’estime l’héritier à juste droit. Le fragment du 23 janvier 1862 est célèbre : « j’ai senti passer sur moi le vent de l’aile de l’imbécillité ». Des vagues torpeurs en commotions alarmantes, les crises vont s’accuser et l’acculer à toutes sortes d’expédients… Baudelaire ne sait plus trop si le suicide mettrait fin à ses malheurs ou confirmerait la faiblesse qu’il se reproche. La meilleure des « hygiènes », son mot, c’est travailler. Demeure donc un solide désir de publier, avant de disparaître, « mes œuvres critiques, si je renonçais aux drames […], aux romans, et enfin un grand livre auquel je rêve depuis deux ans : Mon Cœur mis à nu ».
 Beau titre, « titre pétard », il était emprunté à Edgar Poe, comme l’idée d’un florilège d’aphorismes, et il laissait présager un double déshabillage. L’époque et ses vices, différents de ceux du poète, appartenaient au programme. Hélas, Mon Cœur mis à nu subit la loi des livres « trop rêvés », écrit André Guyaux, le meilleur éditeur de ces notes cruciales qui reviennent en librairie, plus riches de commentaires et d’annexes, sous une couverture explosive (si volcanique qu’elle inverse involontairement l’autoportrait qui lui sert d’illustration). On doit tenir ces « pointes » pour autant de « fusées », autre projet mis en chantier alors, et d’aveux sur la relation équivoque, désir et dégoût liés, que l’écrivain entretient avec le « contemporain » en ce moment de bascule du Second Empire. Dans son Baudelaire. L’irréductible (Flammarion, 2014), Antoine Compagnon s’est justement évertué à déjouer les pièges d’une lecture globalisante et négative des « dernières années » du poète, que ses aigreurs et son état auraient condamné à l’échec littéraire et aux pires dérives idéologiques. De 1859 à 1866, de la plaquette sur Gautier aux Épaves, il n’a guère molli. La seconde édition des Fleurs et ses traductions de Poe, autant que la publication des premiers poèmes en prose du Spleen de Paris ou ses articles sur Manet et Constantin Guys, l’ont définitivement installé, même aux yeux de l’administration impériale et d’un critique aussi écouté et retors que Sainte-Beuve, parmi les valeurs sûres de la République des Lettres. Certes, l’homme demeure imprévisible, insituable, craint… Il faut donc lire Mon Cœur mis à nu, avec André Guyaux, comme le laboratoire parallèle d’un ultime combat contre les hérésies d’un temps contradictoire, exaltant à certains égards, mais livré au culte du progrès en ses deux faces, l’ivresse technologique et l’angélisme fraternitaire.
Beau titre, « titre pétard », il était emprunté à Edgar Poe, comme l’idée d’un florilège d’aphorismes, et il laissait présager un double déshabillage. L’époque et ses vices, différents de ceux du poète, appartenaient au programme. Hélas, Mon Cœur mis à nu subit la loi des livres « trop rêvés », écrit André Guyaux, le meilleur éditeur de ces notes cruciales qui reviennent en librairie, plus riches de commentaires et d’annexes, sous une couverture explosive (si volcanique qu’elle inverse involontairement l’autoportrait qui lui sert d’illustration). On doit tenir ces « pointes » pour autant de « fusées », autre projet mis en chantier alors, et d’aveux sur la relation équivoque, désir et dégoût liés, que l’écrivain entretient avec le « contemporain » en ce moment de bascule du Second Empire. Dans son Baudelaire. L’irréductible (Flammarion, 2014), Antoine Compagnon s’est justement évertué à déjouer les pièges d’une lecture globalisante et négative des « dernières années » du poète, que ses aigreurs et son état auraient condamné à l’échec littéraire et aux pires dérives idéologiques. De 1859 à 1866, de la plaquette sur Gautier aux Épaves, il n’a guère molli. La seconde édition des Fleurs et ses traductions de Poe, autant que la publication des premiers poèmes en prose du Spleen de Paris ou ses articles sur Manet et Constantin Guys, l’ont définitivement installé, même aux yeux de l’administration impériale et d’un critique aussi écouté et retors que Sainte-Beuve, parmi les valeurs sûres de la République des Lettres. Certes, l’homme demeure imprévisible, insituable, craint… Il faut donc lire Mon Cœur mis à nu, avec André Guyaux, comme le laboratoire parallèle d’un ultime combat contre les hérésies d’un temps contradictoire, exaltant à certains égards, mais livré au culte du progrès en ses deux faces, l’ivresse technologique et l’angélisme fraternitaire.
 Si différentes que fussent ces deux passions, elles postulaient souvent une foi laïque aussi fragile qu’oublieuse du dogme autour duquel s’étaient construites la pensée et l’esthétique de Baudelaire, celui de la déchéance originelle de l’humanité. Nul sartrisme avant l’heure : le mal est antérieur au social, l’essence précède l’existence. On pense à l’une de ses fusées les plus vertigineuses : « Quand même Dieu n’existerait pas, la Religion serait encore Sainte et Divine. » Mon Cœur mis à nu, bilan comparable à L’Atelier de Courbet où le poète figure en bonne place, revient sur « l’ivresse » vite dissipée de 1848 pour mieux dénoncer ce goût de « la destruction » chevillé aux hommes, et dont les journaux font leur pâture, tout en proclamant la société actuelle en progrès… Il est remarquable que deux esprits d’élite, mais de camps opposés, Drieu et Georges Blin aient interrogé et revalorisé, à peu près au même moment, le catholicisme de Baudelaire, où l’université républicaine voyait le credo superflu d’un dandy hors de l’histoire en marche ! « Toute littérature dérive du péché », écrivait-il à Poulet-Malassis, à la fin d’août 1860. L’ambivalence, faut-il comprendre, n’est pas un vice de pensée, mais la pensée même, elle se confond avec l’exigence, la morale « désagréable », qui anime le poète et le critique dans ses réflexions alors fréquentes sur le moderne. La dernière livraison de L’Année Baudelaire, livraison double et ouverte à toutes les approches, les meilleures comme les plus contestables, explore le devoir d’inventaire que l’écrivain aura imposé à ce qui constituait la modernité du début des années 1860, de Courbet à Manet, de la photographie à la presse à gros tirage, de la solitude haussmannienne à « cette excitation bizarre qui a besoin de spectacles, de foules, de musique, de réverbères même », excitation sans laquelle la vie urbaine serait un enfer et le Spleen de Paris un simple bréviaire de mélancolie. Quelle attitude, dès lors, adopter à l’égard des réserves que Baudelaire formule à l’endroit de la nouvelle peinture et des nouveaux médiums ? Faut-il parler de cécité avec Jean-Christophe Bailly, et confirmer la thèse d’un jugement esthétique devenu inapte à adhérer aux vraies forces du présent ? Doit-on, au contraire, avec Compagnon, Guyaux, Jean-Luc Steinmetz, Jérôme Thélot et Patrick Labarthe reconnaître la légitimité des critères d’évaluation et des jugements du « dernier Baudelaire » ? Le lecteur jugera. Les réticences et les colères baudelairiennes ont assurément leur vérité. L’Année Baudelaire nous aide à la dégager. Stéphane Guégan
Si différentes que fussent ces deux passions, elles postulaient souvent une foi laïque aussi fragile qu’oublieuse du dogme autour duquel s’étaient construites la pensée et l’esthétique de Baudelaire, celui de la déchéance originelle de l’humanité. Nul sartrisme avant l’heure : le mal est antérieur au social, l’essence précède l’existence. On pense à l’une de ses fusées les plus vertigineuses : « Quand même Dieu n’existerait pas, la Religion serait encore Sainte et Divine. » Mon Cœur mis à nu, bilan comparable à L’Atelier de Courbet où le poète figure en bonne place, revient sur « l’ivresse » vite dissipée de 1848 pour mieux dénoncer ce goût de « la destruction » chevillé aux hommes, et dont les journaux font leur pâture, tout en proclamant la société actuelle en progrès… Il est remarquable que deux esprits d’élite, mais de camps opposés, Drieu et Georges Blin aient interrogé et revalorisé, à peu près au même moment, le catholicisme de Baudelaire, où l’université républicaine voyait le credo superflu d’un dandy hors de l’histoire en marche ! « Toute littérature dérive du péché », écrivait-il à Poulet-Malassis, à la fin d’août 1860. L’ambivalence, faut-il comprendre, n’est pas un vice de pensée, mais la pensée même, elle se confond avec l’exigence, la morale « désagréable », qui anime le poète et le critique dans ses réflexions alors fréquentes sur le moderne. La dernière livraison de L’Année Baudelaire, livraison double et ouverte à toutes les approches, les meilleures comme les plus contestables, explore le devoir d’inventaire que l’écrivain aura imposé à ce qui constituait la modernité du début des années 1860, de Courbet à Manet, de la photographie à la presse à gros tirage, de la solitude haussmannienne à « cette excitation bizarre qui a besoin de spectacles, de foules, de musique, de réverbères même », excitation sans laquelle la vie urbaine serait un enfer et le Spleen de Paris un simple bréviaire de mélancolie. Quelle attitude, dès lors, adopter à l’égard des réserves que Baudelaire formule à l’endroit de la nouvelle peinture et des nouveaux médiums ? Faut-il parler de cécité avec Jean-Christophe Bailly, et confirmer la thèse d’un jugement esthétique devenu inapte à adhérer aux vraies forces du présent ? Doit-on, au contraire, avec Compagnon, Guyaux, Jean-Luc Steinmetz, Jérôme Thélot et Patrick Labarthe reconnaître la légitimité des critères d’évaluation et des jugements du « dernier Baudelaire » ? Le lecteur jugera. Les réticences et les colères baudelairiennes ont assurément leur vérité. L’Année Baudelaire nous aide à la dégager. Stéphane Guégan
*Baudelaire, Fusées. Mon Cœur mis à nu. Et autres fragments posthumes, nouvelle édition d’André Guyaux, Gallimard, Folio classique, 8,20€
**Antoine Compagnon (dir.), L’Année Baudelaire, n°18-19 (Baudelaire anti-moderne), Honoré Champion éditeur, 65€. Rappelons qu’en 2011, à l’initiative de Robert Kopp, le Baudelaire de Georges Blin (Gallimard, 1939) a été réédité, diminué de la belle préface de Jacques Crépet mais accru du résumé des cours du Collège de France (1965-1977), et que son autre livre décisif, anti-sartrien, Le Sadisme de Baudelaire (Corti, 1948) attend de l’être. Cette livraison de L’Année Baudelaire lui est dédiée. Ajoutons, avec André Guyaux, que Baudelaire est surtout à rapprocher du Laclos des Liaisons.
 ***J’ai toujours pensé que certains tableaux n’auraient pas dû, ou ne devraient pas, être montrés dans les musées. Ces œuvres-là, antérieures ou extérieures à la sphère publique propre à l’âge moderne, n’ont pas été faites pour être livrées au premier regard, et exposées à la violence incontrôlable de tous. Faut-il souligner que les menaces ont eu tendance à s’accroitre et se perfectionner dernièrement ? Ainsi ceux qui continuent à invoquer la nécessaire démocratisation ou circulation des biens culturels, sans toujours en mesurer les conséquences, ne pensent-ils pas assez au danger qu’ils font courir aux chefs-d’œuvre du génie humain les moins préparés à souffrir ce bel œcuménisme, je veux parler des œuvres érotiques… Manet, Picasso ou Velázquez… Le livre très instructif et documenté de Bruno Nassim Aboudrar, professeur d’esthétique à Paris 3 et plume alerte, en apporte la saisissante confirmation. Saviez-vous que la Vénus au miroir, l’un des tableaux les plus sensuels et réfléchis de l’histoire de la peinture européenne, avait été proprement agressé, le 9 mars 1914, par une suffragette délirante qui répondait au doux nom de Mary Richardson ? Elle n’avait rien trouvé de mieux, pauvre illuminée, pour faire disparaître de la vue de tous, et toutes, cette chute de reins et cette paire de fesses doublement royales (Philippe IV, aux mœurs moins relâchées qu’on ne l’a dit au XVIIème siècle par propagande, se montra plus tolérant). Ce livre vous apprendra aussi bien des choses utiles et croustillantes sur l’histoire du tableau, sa réception et le débat qui avait entouré la mise en cause de son authenticité, en 1906, lors de son acquisition par la National Gallery de Londres (le plus beau fonds de peinture espagnole, hors du Prado : merci la République de 48, dirait Baudelaire !). Il s’achève dans le sillage des travaux de David Freedberg sur le potentiel des images à voir se retourner contre elles leur charge sensuelle et leur puissance scopique (Bruno Nassim Aboudrar, Qui veut la peau de Vénus ? Le destin scandaleux d’un chef-d’œuvre de Velázquez, Flammarion, 20€). SG
***J’ai toujours pensé que certains tableaux n’auraient pas dû, ou ne devraient pas, être montrés dans les musées. Ces œuvres-là, antérieures ou extérieures à la sphère publique propre à l’âge moderne, n’ont pas été faites pour être livrées au premier regard, et exposées à la violence incontrôlable de tous. Faut-il souligner que les menaces ont eu tendance à s’accroitre et se perfectionner dernièrement ? Ainsi ceux qui continuent à invoquer la nécessaire démocratisation ou circulation des biens culturels, sans toujours en mesurer les conséquences, ne pensent-ils pas assez au danger qu’ils font courir aux chefs-d’œuvre du génie humain les moins préparés à souffrir ce bel œcuménisme, je veux parler des œuvres érotiques… Manet, Picasso ou Velázquez… Le livre très instructif et documenté de Bruno Nassim Aboudrar, professeur d’esthétique à Paris 3 et plume alerte, en apporte la saisissante confirmation. Saviez-vous que la Vénus au miroir, l’un des tableaux les plus sensuels et réfléchis de l’histoire de la peinture européenne, avait été proprement agressé, le 9 mars 1914, par une suffragette délirante qui répondait au doux nom de Mary Richardson ? Elle n’avait rien trouvé de mieux, pauvre illuminée, pour faire disparaître de la vue de tous, et toutes, cette chute de reins et cette paire de fesses doublement royales (Philippe IV, aux mœurs moins relâchées qu’on ne l’a dit au XVIIème siècle par propagande, se montra plus tolérant). Ce livre vous apprendra aussi bien des choses utiles et croustillantes sur l’histoire du tableau, sa réception et le débat qui avait entouré la mise en cause de son authenticité, en 1906, lors de son acquisition par la National Gallery de Londres (le plus beau fonds de peinture espagnole, hors du Prado : merci la République de 48, dirait Baudelaire !). Il s’achève dans le sillage des travaux de David Freedberg sur le potentiel des images à voir se retourner contre elles leur charge sensuelle et leur puissance scopique (Bruno Nassim Aboudrar, Qui veut la peau de Vénus ? Le destin scandaleux d’un chef-d’œuvre de Velázquez, Flammarion, 20€). SG
 ****La liberté de refaire l’histoire étant un droit démocratique, on se plaît à rêver au scénario suivant. En 1862, l’Académie française assit Baudelaire au fauteuil 18, en remplacement de Lacordaire, lequel avait succédé au comte Alexis de Tocqueville (1805-1859), et la coupole du quai Conti réaffirme ainsi le sens de sa silhouette romaine… Quelle trinité cela eût fait ! Du discours que Lacordaire prononça au sujet de l’auteur de De la démocratie en Amérique, en janvier 1860, Brigitte Krulic a raison de retenir les phrases suivantes. Elles disent tout, sur le ton d’un Chateaubriand, lointain parent de l’écrivain politique et du ministre de la IIe République, et, comme lui, accoucheur d’un monde où l’aristocratie ne pourrait plus être que de cœur et d’esprit : « Tocqueville cherchait dans ce qui était vivant le successeur de ce qui était mort, et l’illusion d’une immutabilité chevaleresque ne pouvait lui cacher le devoir de semer dans le sillon qui restait ouvert. Il eût aimé les serments qui ne s’oublient jamais ; il aimait mieux l’action qui espère toujours, ne sauvât-elle qu’une fois. » Ce petit homme bouillonnant, très porté sur les femmes, les idées et les voyages, d’une rare fermeté au moment du coup d’État du futur Napoléon III, n’est pas encore à sa place. Sans doute son scepticisme, proche de celui de Baudelaire, en fait-il un moderne du doute. Le combat qu’il aura mené, livres et ministères, tient en une équation impopulaire : l’héritage de 1789 contre l’esprit révolutionnaire. A cheval sur deux mondes, comme son périple américain en dessine la carte et le symbole, Tocqueville pense la modernité comme une évolution et un mal nécessaires. On comprend aussi qu’il ait été, tout ensemble, comme Chassériau, son génial portraitiste, partisan de la colonisation algérienne et son critique le plus acerbe. Le livre de Brigitte Krulic, nerveux et précis, sert son sujet à la perfection (Brigitte Krulic, Tocqueville, Folio Biographies, Gallimard, 9,20€). SG
****La liberté de refaire l’histoire étant un droit démocratique, on se plaît à rêver au scénario suivant. En 1862, l’Académie française assit Baudelaire au fauteuil 18, en remplacement de Lacordaire, lequel avait succédé au comte Alexis de Tocqueville (1805-1859), et la coupole du quai Conti réaffirme ainsi le sens de sa silhouette romaine… Quelle trinité cela eût fait ! Du discours que Lacordaire prononça au sujet de l’auteur de De la démocratie en Amérique, en janvier 1860, Brigitte Krulic a raison de retenir les phrases suivantes. Elles disent tout, sur le ton d’un Chateaubriand, lointain parent de l’écrivain politique et du ministre de la IIe République, et, comme lui, accoucheur d’un monde où l’aristocratie ne pourrait plus être que de cœur et d’esprit : « Tocqueville cherchait dans ce qui était vivant le successeur de ce qui était mort, et l’illusion d’une immutabilité chevaleresque ne pouvait lui cacher le devoir de semer dans le sillon qui restait ouvert. Il eût aimé les serments qui ne s’oublient jamais ; il aimait mieux l’action qui espère toujours, ne sauvât-elle qu’une fois. » Ce petit homme bouillonnant, très porté sur les femmes, les idées et les voyages, d’une rare fermeté au moment du coup d’État du futur Napoléon III, n’est pas encore à sa place. Sans doute son scepticisme, proche de celui de Baudelaire, en fait-il un moderne du doute. Le combat qu’il aura mené, livres et ministères, tient en une équation impopulaire : l’héritage de 1789 contre l’esprit révolutionnaire. A cheval sur deux mondes, comme son périple américain en dessine la carte et le symbole, Tocqueville pense la modernité comme une évolution et un mal nécessaires. On comprend aussi qu’il ait été, tout ensemble, comme Chassériau, son génial portraitiste, partisan de la colonisation algérienne et son critique le plus acerbe. Le livre de Brigitte Krulic, nerveux et précis, sert son sujet à la perfection (Brigitte Krulic, Tocqueville, Folio Biographies, Gallimard, 9,20€). SG




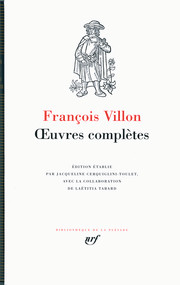
 Claude Arnaud a fait d’un livre deux coups. Ça tombe bien, on fête cette année le centenaire du Swann de Proust et le cinquantenaire de la mort de Cocteau, qu’il connaît mieux que personne. Entre ces deux immortels, qui furent si proches jusqu’à la rupture sanglante, son cœur ne balance pas. Il est tout acquis à Cocteau, aux éclairs brefs de son écriture, à son choix de vivre par tous les bouts, à ses allures de caméléon essoufflé, voire à l’incomplétude de son génie, si préférable, nous dit
Claude Arnaud a fait d’un livre deux coups. Ça tombe bien, on fête cette année le centenaire du Swann de Proust et le cinquantenaire de la mort de Cocteau, qu’il connaît mieux que personne. Entre ces deux immortels, qui furent si proches jusqu’à la rupture sanglante, son cœur ne balance pas. Il est tout acquis à Cocteau, aux éclairs brefs de son écriture, à son choix de vivre par tous les bouts, à ses allures de caméléon essoufflé, voire à l’incomplétude de son génie, si préférable, nous dit  «Cocteau manœuvre durant toute l’année 1913 pour trouver à Proust un éditeur acceptant de publier intégralement l’ouvrage», rappelle Claude Arnaud. Au terme de multiples démarches infructueuses, Bernard Grasset publie, mais à compte d’auteur, Du côté de chez Swann. Le terrible manuscrit avait été notamment repoussé par Gide. Ne pouvant encore adhérer au long processus de dévoilement qu’inaugurait le premier volume de La Recherche, éditeurs et
«Cocteau manœuvre durant toute l’année 1913 pour trouver à Proust un éditeur acceptant de publier intégralement l’ouvrage», rappelle Claude Arnaud. Au terme de multiples démarches infructueuses, Bernard Grasset publie, mais à compte d’auteur, Du côté de chez Swann. Le terrible manuscrit avait été notamment repoussé par Gide. Ne pouvant encore adhérer au long processus de dévoilement qu’inaugurait le premier volume de La Recherche, éditeurs et  Pour Robert Kopp, auteur d’une synthèse récente sur le Prix, l’année 1919 marque un tournant : «la fin de la littérature de guerre et le passage de la littérature engagée à la littérature dégagée, telle que la définissait Rivière dans La NRF qui venait de reparaître en juin.» Proust était bien du bâtiment… Depuis leur heureuse réunion, la maison Gallimard n’a cessé de travailler au monument national qu’est devenu Proust. Elle le prouve à nouveau en cette année de centenaire : deux éditions de poche de Swann en Folio, l’une pédagogique, l’autre luxueuse, remarquables l’une et l’autre, ont paru depuis l’été. Elles posent différemment la question de l’illustration possible de La Recherche. De tous ceux qui s’y sont essayés, Pierre Alechinsky, le dernier en date, est sans doute le plus convaincu et assurément le plus convaincant. La matière narrative d’Un amour de Swann, partie centrale du volume de 1913, concentre les affres de l’envie, de l’amour jaloux aux assassinats mondains. Sachant être allusive sans être élusive, l’intervention d’
Pour Robert Kopp, auteur d’une synthèse récente sur le Prix, l’année 1919 marque un tournant : «la fin de la littérature de guerre et le passage de la littérature engagée à la littérature dégagée, telle que la définissait Rivière dans La NRF qui venait de reparaître en juin.» Proust était bien du bâtiment… Depuis leur heureuse réunion, la maison Gallimard n’a cessé de travailler au monument national qu’est devenu Proust. Elle le prouve à nouveau en cette année de centenaire : deux éditions de poche de Swann en Folio, l’une pédagogique, l’autre luxueuse, remarquables l’une et l’autre, ont paru depuis l’été. Elles posent différemment la question de l’illustration possible de La Recherche. De tous ceux qui s’y sont essayés, Pierre Alechinsky, le dernier en date, est sans doute le plus convaincu et assurément le plus convaincant. La matière narrative d’Un amour de Swann, partie centrale du volume de 1913, concentre les affres de l’envie, de l’amour jaloux aux assassinats mondains. Sachant être allusive sans être élusive, l’intervention d’
 On ne parle pas assez des romans de
On ne parle pas assez des romans de  Au fond, les deux gamins de Polaire sont des «égarés», pour leur appliquer le mot qu’utilise Claire Paulhan au seuil de l’anthologie d’Eric Dussert, grand manitou du programme Gallica de la BNF. Autant dire qu’il brasse du papier avant de le dématérialiser pour le bonheur des utilisateurs de sa bibliothèque numérique. Mais à remuer la poussière des âges, à fréquenter les fantômes de l’histoire littéraire, on se noircit fatalement les doigts. L’entreprise de Dussert, salissante mais salutaire, n’est pas nouvelle. Il se place lui-même sous l’étoile du bon Charles Monselet, célèbre fouilleur de tombes des années 1850. Avant cet auteur très
Au fond, les deux gamins de Polaire sont des «égarés», pour leur appliquer le mot qu’utilise Claire Paulhan au seuil de l’anthologie d’Eric Dussert, grand manitou du programme Gallica de la BNF. Autant dire qu’il brasse du papier avant de le dématérialiser pour le bonheur des utilisateurs de sa bibliothèque numérique. Mais à remuer la poussière des âges, à fréquenter les fantômes de l’histoire littéraire, on se noircit fatalement les doigts. L’entreprise de Dussert, salissante mais salutaire, n’est pas nouvelle. Il se place lui-même sous l’étoile du bon Charles Monselet, célèbre fouilleur de tombes des années 1850. Avant cet auteur très 
 On savait que le courant était très bien passé entre Ezra Pound et
On savait que le courant était très bien passé entre Ezra Pound et  L’Italie, Venise notamment, devait s’offrir bientôt comme l’autre trait d’union qui mène de Gautier à Pound ? C’est à Rapallo que l’Américain devait rédiger son précis ironique de littérature, How to read, en 1927-1928. Les éditions
L’Italie, Venise notamment, devait s’offrir bientôt comme l’autre trait d’union qui mène de Gautier à Pound ? C’est à Rapallo que l’Américain devait rédiger son précis ironique de littérature, How to read, en 1927-1928. Les éditions 