 C’était en 1979 et le Centre Pompidou avait deux ans, pour paraphraser qui vous savez… Une rétrospective Magritte s’y organise, la chose n’est pas banale alors, et ses commissaires encore moins, Jean Clair et David Sylvester. Pour son retour en France, le peintre du caché-montré, trouble-fête aux images trompeusement lisses, s’offrait des avocats de choc. La mort de Magritte, douze ans plus tôt, avait ouvert l’ère des bilans. Le leur tenait compte du vif intérêt que les générations successives, celles du Pop, de la Bad Painting et de l’art conceptuel, avaient porté au maître du surréalisme. On n’en avait pas fini avec lui et ses turpitudes plus ou moins glacées (toucher au fonctionnement des signes, n’est-ce pas toujours les salir un peu ?) Comme le facteur sonne toujours deux fois, pour paraphraser cette fois-ci le James M. Cain qui mit Camus sur le chemin de son style (voir plus bas), Magritte revient au Centre, quarante plus tard. Si Clair et Sylvester avaient salué l’émule de Giorgio De Chirico, ce que Magritte fut autant que le délicieux Pierre Roy (la critique intelligente les associait encore sous l’Occupation), Didier Ottinger exalte le doctus pictor, figure bien connue depuis Alberti, et que le XXe siècle n’a pas rayée de ses feuilles de présence (contrairement à ce que le sot formalisme nous demande de croire). Le fait est que cette peinture pense autant qu’elle se dépense, joue les mystérieuses autant qu’elle revient constamment à ce que Magritte appelait L’Évidence éternelle, l’Éros qui mène le monde et fissure le regard. Nul besoin d’être Michel Foucault, aficionado du Belge érectile, pour deviner ce qui s’avoue derrière les pipes ou les nez dilatés du maître ! À l’inverse, sans la science exégétique d’Ottinger et des auteurs de son catalogue, une bonne part des intentions de Magritte et de ses références aux mythes fondateurs du logos occidental serait restée lettre morte. Intentions, logos et même méthode, ce sont des mots qu’on ne prononce pas souvent à son sujet. Or c’est tout le propos de cette exposition, promise au succès, que de nous rappeler que le surréalisme, inassimilable à la mystique des derviches tourneurs, aura visé les mécanismes secrets, mais concrets et donc analysables, de la pensée, du rêve ou du langage derrière l’arbitraire, l’automatisme et la gratuité irrationnelle dont il se réclamait. Clarté de l’obscur…
C’était en 1979 et le Centre Pompidou avait deux ans, pour paraphraser qui vous savez… Une rétrospective Magritte s’y organise, la chose n’est pas banale alors, et ses commissaires encore moins, Jean Clair et David Sylvester. Pour son retour en France, le peintre du caché-montré, trouble-fête aux images trompeusement lisses, s’offrait des avocats de choc. La mort de Magritte, douze ans plus tôt, avait ouvert l’ère des bilans. Le leur tenait compte du vif intérêt que les générations successives, celles du Pop, de la Bad Painting et de l’art conceptuel, avaient porté au maître du surréalisme. On n’en avait pas fini avec lui et ses turpitudes plus ou moins glacées (toucher au fonctionnement des signes, n’est-ce pas toujours les salir un peu ?) Comme le facteur sonne toujours deux fois, pour paraphraser cette fois-ci le James M. Cain qui mit Camus sur le chemin de son style (voir plus bas), Magritte revient au Centre, quarante plus tard. Si Clair et Sylvester avaient salué l’émule de Giorgio De Chirico, ce que Magritte fut autant que le délicieux Pierre Roy (la critique intelligente les associait encore sous l’Occupation), Didier Ottinger exalte le doctus pictor, figure bien connue depuis Alberti, et que le XXe siècle n’a pas rayée de ses feuilles de présence (contrairement à ce que le sot formalisme nous demande de croire). Le fait est que cette peinture pense autant qu’elle se dépense, joue les mystérieuses autant qu’elle revient constamment à ce que Magritte appelait L’Évidence éternelle, l’Éros qui mène le monde et fissure le regard. Nul besoin d’être Michel Foucault, aficionado du Belge érectile, pour deviner ce qui s’avoue derrière les pipes ou les nez dilatés du maître ! À l’inverse, sans la science exégétique d’Ottinger et des auteurs de son catalogue, une bonne part des intentions de Magritte et de ses références aux mythes fondateurs du logos occidental serait restée lettre morte. Intentions, logos et même méthode, ce sont des mots qu’on ne prononce pas souvent à son sujet. Or c’est tout le propos de cette exposition, promise au succès, que de nous rappeler que le surréalisme, inassimilable à la mystique des derviches tourneurs, aura visé les mécanismes secrets, mais concrets et donc analysables, de la pensée, du rêve ou du langage derrière l’arbitraire, l’automatisme et la gratuité irrationnelle dont il se réclamait. Clarté de l’obscur…
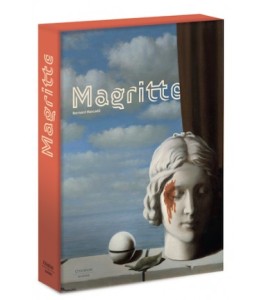 Duchamp, Picabia, Magritte… Les passions de Bernard Marcadé, docteur es-mauvais esprit, sont aussi connues que légitimes. L’art véritable lui a toujours paru jeter le doute sur « l’ordre des choses », miroir aux alouettes dont Magritte s’emploie très tôt à déchirer les illusoires reflets. Que de vitres cassées chez lui, de fenêtres ouvertes sur l’intérieur, d’ombres parlantes, d’air liquide, de forêts démontables, de corps pétrifiés ou, a contrario, de statues vivantes ! Dans le format renouvelé, plus vertical et plus riche en images, des grandes monographies de Citadelles § Mazenod, il suit ainsi pas à pas les étapes d’un artiste en froid avec bien des dogmes de la modernité. La peinture, c’est beaucoup plus que la peinture, aurait pu dire Magritte s’il avait lu Chardonne. René attribuait justement à Chirico l’audace d’avoir sorti leur discipline de sa vaine quête d’une autonomie étouffante et d’un cheminement linéaire. On comprend que Magritte ait pu, dès 1946, encenser les tableaux que Picabia avait peints sous l’Occupation, nus hyperréalistes aux charmes sûrs, à propos desquels une poignée de malheureux parleraient d’art fasciste en 1976… La rengaine moderniste et le ronron du bon goût furent donc autant d’objets d’agacement. Magritte s’affranchit très tôt des attentes de l’avant-garde, futuriste ou puriste, Marcadé y insiste, de même qu’il signale l’importance des nus féminins du début des années 20. Mais le « choc émotionnel » que le jeune peintre dit alors rechercher s’écarte de la brutalité des sens : son lyrisme, sa violence parfois, celle d’un lecteur de Sade, Lautréamont, Nietzsche et Bataille, menace le spectateur, le déboussole sans l’enflammer tout à fait : nous demeurons au bord du gouffre, au seuil du cauchemar ou à la lisière du rêve érotique. La retenue mène au fragment, le silence à la stridence, jamais à l’enveloppement. Freud, dont Marcadé minimise à tort l’emprise sur Magritte, parlerait à bon droit de « retour du refoulé » au sujet de la période vache (les tableaux lâchés de 1947, mes préférés).
Duchamp, Picabia, Magritte… Les passions de Bernard Marcadé, docteur es-mauvais esprit, sont aussi connues que légitimes. L’art véritable lui a toujours paru jeter le doute sur « l’ordre des choses », miroir aux alouettes dont Magritte s’emploie très tôt à déchirer les illusoires reflets. Que de vitres cassées chez lui, de fenêtres ouvertes sur l’intérieur, d’ombres parlantes, d’air liquide, de forêts démontables, de corps pétrifiés ou, a contrario, de statues vivantes ! Dans le format renouvelé, plus vertical et plus riche en images, des grandes monographies de Citadelles § Mazenod, il suit ainsi pas à pas les étapes d’un artiste en froid avec bien des dogmes de la modernité. La peinture, c’est beaucoup plus que la peinture, aurait pu dire Magritte s’il avait lu Chardonne. René attribuait justement à Chirico l’audace d’avoir sorti leur discipline de sa vaine quête d’une autonomie étouffante et d’un cheminement linéaire. On comprend que Magritte ait pu, dès 1946, encenser les tableaux que Picabia avait peints sous l’Occupation, nus hyperréalistes aux charmes sûrs, à propos desquels une poignée de malheureux parleraient d’art fasciste en 1976… La rengaine moderniste et le ronron du bon goût furent donc autant d’objets d’agacement. Magritte s’affranchit très tôt des attentes de l’avant-garde, futuriste ou puriste, Marcadé y insiste, de même qu’il signale l’importance des nus féminins du début des années 20. Mais le « choc émotionnel » que le jeune peintre dit alors rechercher s’écarte de la brutalité des sens : son lyrisme, sa violence parfois, celle d’un lecteur de Sade, Lautréamont, Nietzsche et Bataille, menace le spectateur, le déboussole sans l’enflammer tout à fait : nous demeurons au bord du gouffre, au seuil du cauchemar ou à la lisière du rêve érotique. La retenue mène au fragment, le silence à la stridence, jamais à l’enveloppement. Freud, dont Marcadé minimise à tort l’emprise sur Magritte, parlerait à bon droit de « retour du refoulé » au sujet de la période vache (les tableaux lâchés de 1947, mes préférés).
 Si Marcadé durcit trop également l’opposition à/de Breton (la couverture reproduite de Qu’est-ce que le surréalisme ? – 1934 – appelait une autre approche sur ce point), il fait le meilleur usage de son propre « mauvais goût » (excellentes pages sur les périodes Renoir et vache) et de la philosophie que convoque l’œuvre entier. Oui, en 1958, les impayables Vacances de Hegel disent la répugnance du peintre envers toute résolution dialectique. Deux ans après la saignée hongroise, ajouterais-je, Magritte donnait définitivement congé à ses tocades communistes vaguement hégéliennes… Tenu de bout en bout, ce livre parle politique et esthétique avec la souplesse qu’exige la plasticité du peintre, avant et après la seconde guerre mondiale. Marcadé s’intéresse enfin aux sources de ce peintre très dissimulateur, note les convergences d’époque (Max Ernst, Dali, le Picasso des corps disloqués), piste les traces de la peinture ancienne et commente l’apport des nouveaux médiums. Les Jours gigantesques, en couverture du collectif consacré à Voir double (Hazan), plonge directement sa spirale mobile et son sadisme étrangement fusionnel dans la fascination du moment pour le cinéma (Paul Nougé, le gourou de Magritte, l’enregistre immédiatement en 1928). Les films, à cette date, ne parlent pas encore, mais ils usent ou mésusent des mots, opèrent des disjonctions, comme le symbolisme loufoque avant eux. En dehors du génial Satie, souvent et dûment évoqué, il me semble qu’on néglige beaucoup ce que Magritte prolonge de la culture visuelle propre à la la fin du XIXe siècle. Sa peinture, pour le dire comme Marcadé, emploie la mimesis contre elle-même, elle n’est pas la première à le faire, ainsi que le rappelle précisément la brillante réflexion d’ensemble que propose l’ouvrage d’Hazan sur l’ambiguïté visuelle. Frapper d’incertitude notre rapport au monde et notre foi dans la langue commune ne fut pas l’apanage des surréalistes, pas plus que le brouillage des codes à travers lesquels nous pensons stabiliser le réel. Ni Magritte, ni Dalí, autre expert de l’énigme visuelle, n’en monopolise le prestige. André Breton, tout en se prévalant d’une rupture radicale, n’a cessé de rappeler que l’entreprise de sape intellectuelle dont il fut le prophète s’amarrait à une très ancienne tradition. Aux marges de la normalité esthétique, il reconnaissait la permanence d’un « art magique » traversant les âges et les cultures.
Si Marcadé durcit trop également l’opposition à/de Breton (la couverture reproduite de Qu’est-ce que le surréalisme ? – 1934 – appelait une autre approche sur ce point), il fait le meilleur usage de son propre « mauvais goût » (excellentes pages sur les périodes Renoir et vache) et de la philosophie que convoque l’œuvre entier. Oui, en 1958, les impayables Vacances de Hegel disent la répugnance du peintre envers toute résolution dialectique. Deux ans après la saignée hongroise, ajouterais-je, Magritte donnait définitivement congé à ses tocades communistes vaguement hégéliennes… Tenu de bout en bout, ce livre parle politique et esthétique avec la souplesse qu’exige la plasticité du peintre, avant et après la seconde guerre mondiale. Marcadé s’intéresse enfin aux sources de ce peintre très dissimulateur, note les convergences d’époque (Max Ernst, Dali, le Picasso des corps disloqués), piste les traces de la peinture ancienne et commente l’apport des nouveaux médiums. Les Jours gigantesques, en couverture du collectif consacré à Voir double (Hazan), plonge directement sa spirale mobile et son sadisme étrangement fusionnel dans la fascination du moment pour le cinéma (Paul Nougé, le gourou de Magritte, l’enregistre immédiatement en 1928). Les films, à cette date, ne parlent pas encore, mais ils usent ou mésusent des mots, opèrent des disjonctions, comme le symbolisme loufoque avant eux. En dehors du génial Satie, souvent et dûment évoqué, il me semble qu’on néglige beaucoup ce que Magritte prolonge de la culture visuelle propre à la la fin du XIXe siècle. Sa peinture, pour le dire comme Marcadé, emploie la mimesis contre elle-même, elle n’est pas la première à le faire, ainsi que le rappelle précisément la brillante réflexion d’ensemble que propose l’ouvrage d’Hazan sur l’ambiguïté visuelle. Frapper d’incertitude notre rapport au monde et notre foi dans la langue commune ne fut pas l’apanage des surréalistes, pas plus que le brouillage des codes à travers lesquels nous pensons stabiliser le réel. Ni Magritte, ni Dalí, autre expert de l’énigme visuelle, n’en monopolise le prestige. André Breton, tout en se prévalant d’une rupture radicale, n’a cessé de rappeler que l’entreprise de sape intellectuelle dont il fut le prophète s’amarrait à une très ancienne tradition. Aux marges de la normalité esthétique, il reconnaissait la permanence d’un « art magique » traversant les âges et les cultures.
Stéphane Guégan
*Magritte. La trahison des images. Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, jusqu’au 23 janvier 2017. Le catalogue, sous la direction de Didier Ottinger (39,90€), se présente comme une suite d’essais (voir notamment celui, très juste, de Jacqueline Lichtenstein sur les liens entre la théorie ancienne du beau et Éros).
**Bernard Marcadé, Magritte, Citadelles § Mazenod, 235€.
***Michel Weemans (dir.), Voir double. Pièges et révélations du visible, Hazan, 75€.
THE STRANGER IS BACK
 Parmi les questions qui obsèdent les campus américains depuis un certain temps, il en est une qui touche L’Étranger de Camus : pourquoi ce jeune Français d’Algérie, 26 ans au moment où paraît son premier roman, n’a-t-il pas nommé la victime de Meursault ? Malgré les quatre coups de révolver qui l’abattent dans la lumière d’un été aveuglant, pourquoi « l’Arabe » mord-il la poussière sans dévoiler son patronyme ? Il faut ne rien comprendre à L’Étranger, récit d’une dépersonnalisation contagieuse, à la littérature (française, s’entend) et à la situation historique d’alors pour s’en étonner et, pire, en faire grief à Camus. Au moins, Alice Kaplan, qui a écrit sur le procès bâclé de Brasillach un livre important, épargne-t-elle de telles tracasseries à notre Albert national. En quête de l’Étranger (Gallimard, 22 €) est indemne de tout soupçon anachronique envers ce beau et bref roman de 1942, dont elle retrace le difficile accouchement et la réception aussi délicate. Elle dit bien en quoi la lecture du Facteur sonne toujours deux fois de James M. Cain libéra Camus de ses pannes. Pour nous faire éprouver la « vie livrée à l’absurde » de Meursault, meurtrier sans raison ou presque, l’écriture de Camus s’astreint à un principe continu de fragmentation, de dissociation et de stagnation, qui doit au roman américain et à la volonté un peu insistante de fixer un type. Son personnage meurt de ne pas savoir mentir avant de faire de sa condamnation à mort la voie d’un salut intérieur. La passion de la vérité prend finalement des accents christiques qui déplurent, avec raison, à Jean Paulhan, bien qu’il poussât Gaston à publier ce roman de « grande classe ». Une partie de la critique n’y vit toutefois que compassion pour un « déchet moral », étranger au redressement national. Blanchot, lui, s’enthousiasma pour cette image de la « nature humaine » dépouillée de « toutes les fausses explications subjectives ». La génétique réussit mieux à Kaplan que l’étude de la réception. Elle en donne un aperçu partiel et partial. Qualifiant brutalement Drieu d’« intellectuel pronazi », elle néglige le rôle qu’il joua dans la publication de L’Étranger et son accueil. La correspondance entre Camus et Malraux, qui appuya lui aussi le benjamin, le met pourtant en évidence. Or Kaplan cite cette correspondance, qui vient de paraître (Gallimard, 18,50€). De même, omet-elle de parler en détail de l’article que Drieu fit écrire dans la NRF qu’il dirige à la demande des Allemands, mais en veillant aux intérêts de la maison et de la vraie littérature. Cet article, signé Fieschi, a bien saisi la part du matricide et du mal social dans l’apparente atonie de Meursault. Camus dut lui-même reconnaître que la critique avait été médiocre en zone libre et « excellente à Paris ». Pourquoi dès lors ne mentionner qu’en note la carte postale bien connue que Gaston, toujours lui, adressa à son poulain si prometteur ? Il n’avait pas échappé au patron que la presse avait été « absurde » envers Camus, hors Marcel Arland et… Fieschi. Il aurait pu ajouter Blanchot. L’histoire de la littérature sous la botte est bien à réécrire. SG (sur la correspondance Camus/Malraux, voir mon « Malraux avec nous », La Revue des deux mondes, octobre 2016, 15 €)
Parmi les questions qui obsèdent les campus américains depuis un certain temps, il en est une qui touche L’Étranger de Camus : pourquoi ce jeune Français d’Algérie, 26 ans au moment où paraît son premier roman, n’a-t-il pas nommé la victime de Meursault ? Malgré les quatre coups de révolver qui l’abattent dans la lumière d’un été aveuglant, pourquoi « l’Arabe » mord-il la poussière sans dévoiler son patronyme ? Il faut ne rien comprendre à L’Étranger, récit d’une dépersonnalisation contagieuse, à la littérature (française, s’entend) et à la situation historique d’alors pour s’en étonner et, pire, en faire grief à Camus. Au moins, Alice Kaplan, qui a écrit sur le procès bâclé de Brasillach un livre important, épargne-t-elle de telles tracasseries à notre Albert national. En quête de l’Étranger (Gallimard, 22 €) est indemne de tout soupçon anachronique envers ce beau et bref roman de 1942, dont elle retrace le difficile accouchement et la réception aussi délicate. Elle dit bien en quoi la lecture du Facteur sonne toujours deux fois de James M. Cain libéra Camus de ses pannes. Pour nous faire éprouver la « vie livrée à l’absurde » de Meursault, meurtrier sans raison ou presque, l’écriture de Camus s’astreint à un principe continu de fragmentation, de dissociation et de stagnation, qui doit au roman américain et à la volonté un peu insistante de fixer un type. Son personnage meurt de ne pas savoir mentir avant de faire de sa condamnation à mort la voie d’un salut intérieur. La passion de la vérité prend finalement des accents christiques qui déplurent, avec raison, à Jean Paulhan, bien qu’il poussât Gaston à publier ce roman de « grande classe ». Une partie de la critique n’y vit toutefois que compassion pour un « déchet moral », étranger au redressement national. Blanchot, lui, s’enthousiasma pour cette image de la « nature humaine » dépouillée de « toutes les fausses explications subjectives ». La génétique réussit mieux à Kaplan que l’étude de la réception. Elle en donne un aperçu partiel et partial. Qualifiant brutalement Drieu d’« intellectuel pronazi », elle néglige le rôle qu’il joua dans la publication de L’Étranger et son accueil. La correspondance entre Camus et Malraux, qui appuya lui aussi le benjamin, le met pourtant en évidence. Or Kaplan cite cette correspondance, qui vient de paraître (Gallimard, 18,50€). De même, omet-elle de parler en détail de l’article que Drieu fit écrire dans la NRF qu’il dirige à la demande des Allemands, mais en veillant aux intérêts de la maison et de la vraie littérature. Cet article, signé Fieschi, a bien saisi la part du matricide et du mal social dans l’apparente atonie de Meursault. Camus dut lui-même reconnaître que la critique avait été médiocre en zone libre et « excellente à Paris ». Pourquoi dès lors ne mentionner qu’en note la carte postale bien connue que Gaston, toujours lui, adressa à son poulain si prometteur ? Il n’avait pas échappé au patron que la presse avait été « absurde » envers Camus, hors Marcel Arland et… Fieschi. Il aurait pu ajouter Blanchot. L’histoire de la littérature sous la botte est bien à réécrire. SG (sur la correspondance Camus/Malraux, voir mon « Malraux avec nous », La Revue des deux mondes, octobre 2016, 15 €)









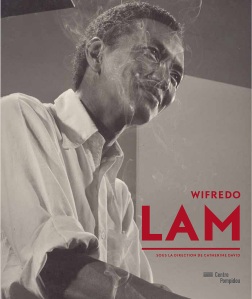








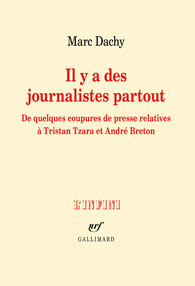






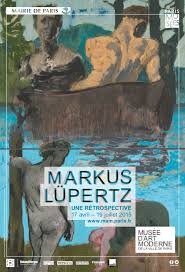



 – Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),
– Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),  *Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’
*Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’ *Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de
*Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de  Vous le pensiez froid comme la mort ou l’ennui, glacé comme ses pinceaux, agaçant comme une énigme sans fin, Magritte est tout le contraire. Le portrait qu’en brosse Michel Draguet inverse la donne. Plus son objet fuit et se refuse à la lecture, à l’instar des tableaux à tiroirs infinis dont le peintre partageait le goût avec Dalí, plus Draguet le poursuit dans ses retranchements, ses non-dits, ses mensonges et les recoins d’une vie qui, parce que pleine et pas toujours très nette, veut d’emblée rester secrète. On ne saurait trouver meilleure justification à la biographie, enquête policière sans jugement dernier. «Magritte est un maître du paraître. Un Œdipe qui, pour berner le Sphinx, aurait échafaudé une incroyable fiction: celle d’un peintre sans vie et sans passion, se partageant entre sa femme Georgette, les échecs et quelques menues distractions et qui, derrière la façade de son conformisme bourgeois, aurait alimenté un imaginaire poétique méthodiquement mis en scène dans des tableaux propres et des gouaches précises.» Il refusait de parler de son passé, du suicide de sa mère, jetait un voile de pudeur et d’oubli sur son père, un affairiste libertaire, et sa jeunesse hautement dissolue.
Vous le pensiez froid comme la mort ou l’ennui, glacé comme ses pinceaux, agaçant comme une énigme sans fin, Magritte est tout le contraire. Le portrait qu’en brosse Michel Draguet inverse la donne. Plus son objet fuit et se refuse à la lecture, à l’instar des tableaux à tiroirs infinis dont le peintre partageait le goût avec Dalí, plus Draguet le poursuit dans ses retranchements, ses non-dits, ses mensonges et les recoins d’une vie qui, parce que pleine et pas toujours très nette, veut d’emblée rester secrète. On ne saurait trouver meilleure justification à la biographie, enquête policière sans jugement dernier. «Magritte est un maître du paraître. Un Œdipe qui, pour berner le Sphinx, aurait échafaudé une incroyable fiction: celle d’un peintre sans vie et sans passion, se partageant entre sa femme Georgette, les échecs et quelques menues distractions et qui, derrière la façade de son conformisme bourgeois, aurait alimenté un imaginaire poétique méthodiquement mis en scène dans des tableaux propres et des gouaches précises.» Il refusait de parler de son passé, du suicide de sa mère, jetait un voile de pudeur et d’oubli sur son père, un affairiste libertaire, et sa jeunesse hautement dissolue.  Surmontant son horreur sans cesse réaffirmée du littéral, du transparent, de l’évidence (sauf quand elle est éternelle), Magritte a pratiqué le portrait. Son entourage direct, de l’intraitable Nougé à la famille Spaak, lui a fourni quelques modèles et l’occasion, chaque fois, de détourner les lois du genre. La face éludée, flambée de l’excentrique
Surmontant son horreur sans cesse réaffirmée du littéral, du transparent, de l’évidence (sauf quand elle est éternelle), Magritte a pratiqué le portrait. Son entourage direct, de l’intraitable Nougé à la famille Spaak, lui a fourni quelques modèles et l’occasion, chaque fois, de détourner les lois du genre. La face éludée, flambée de l’excentrique 
 Sans qu’ils le sachent encore, Bernard et
Sans qu’ils le sachent encore, Bernard et  La vie de Bernard bascule dès sa démobilisation. Le 25 juillet 1940, il épouse Else Reichman, une superbe Juive autrichienne qu’il a abordée au Louvre alors qu’elle tournait autour de la Vénus de Milo (il s’était mis lui-même à tourner autour des deux beautés avant d’aborder la seule qui pût partager son existence précaire). Le 26, il expédie à Paulhan sa profession de foi collaborationniste. Cette concomitance surprend moins quand on réalise que Bernard ne confond pas la
La vie de Bernard bascule dès sa démobilisation. Le 25 juillet 1940, il épouse Else Reichman, une superbe Juive autrichienne qu’il a abordée au Louvre alors qu’elle tournait autour de la Vénus de Milo (il s’était mis lui-même à tourner autour des deux beautés avant d’aborder la seule qui pût partager son existence précaire). Le 26, il expédie à Paulhan sa profession de foi collaborationniste. Cette concomitance surprend moins quand on réalise que Bernard ne confond pas la  Puisque Ulysse revient en Folio Classique (Gallimard, 12,80€) dans l’édition que Jacques Aubert avait dirigée pour La Pléiade, rappelons l’impact de cette grandiose satire homérique sur la génération de Marc Bernard. La traduction de
Puisque Ulysse revient en Folio Classique (Gallimard, 12,80€) dans l’édition que Jacques Aubert avait dirigée pour La Pléiade, rappelons l’impact de cette grandiose satire homérique sur la génération de Marc Bernard. La traduction de  Les anniversaires en ce début d’année nous bousculent. Après Le Sacre et ses tempi affolés, Alcools et son ivresse indémodable. Stravinsky, Apollinaire, 1913… Il ne manque que la réouverture du
Les anniversaires en ce début d’année nous bousculent. Après Le Sacre et ses tempi affolés, Alcools et son ivresse indémodable. Stravinsky, Apollinaire, 1913… Il ne manque que la réouverture du  Le livre de Campa, énorme et léger, érudit et vif, maîtrise une information confondante sans y noyer son lecteur. Nombreux et périlleux étaient pourtant les obstacles à surmonter. La Belle époque ne bute-t-elle pas sur la méconnaissance, de plus en en plus répandue, de notre histoire politique? La poésie, elle, n’attire guère les foules, encore moins celle d’une période que l’on présente habituellement comme intermédiaire entre le symbolisme et le surréalisme. Et que dire du milieu pictural, si ouvert et cosmopolite, dont Apollinaire fut l’un des acteurs et des témoins essentiels ! Comment aborder enfin le nationalisme particulier de ce «Russe», né en Italie de père inconnu, et fier de défendre l’art français avant de se jeter dans la guerre de 14 par anti-germanisme ? Or la biographie de Campa ne se laisse jamais déborder par l’ampleur qu’elle s’assigne et la qualité d’écriture qu’elle s’impose. On ne saurait oublier la difficulté majeure de l’entreprise, Apollinaire lui-même et sa méfiance instinctive, nietzschéenne, des catégories auxquelles la librairie française obéissait servilement. Ce n’était pas son moindre charme aux yeux de Picasso. Pour avoir refusé la pensée unique et la tyrannie de l’éphémère, ces dieux du XXe siècle, l’écrivain et le critique d’art restent donc difficiles à saisir. Nos codes s’affolent à sa lecture. Il faut pourtant l’accepter en bloc. On aimerait tant qu’il ait prêché le modernisme sans retenue, au mépris de ce que l’art du jour mettait justement en péril, dans une adhésion totale à chacune des nouveautés dont se réclamaient ses contemporains. Entre 1898 et 1918, de la mort de Mallarmé à la sienne, il fut pourtant tout autre chose que le chantre abusé des avant-gardes européennes.
Le livre de Campa, énorme et léger, érudit et vif, maîtrise une information confondante sans y noyer son lecteur. Nombreux et périlleux étaient pourtant les obstacles à surmonter. La Belle époque ne bute-t-elle pas sur la méconnaissance, de plus en en plus répandue, de notre histoire politique? La poésie, elle, n’attire guère les foules, encore moins celle d’une période que l’on présente habituellement comme intermédiaire entre le symbolisme et le surréalisme. Et que dire du milieu pictural, si ouvert et cosmopolite, dont Apollinaire fut l’un des acteurs et des témoins essentiels ! Comment aborder enfin le nationalisme particulier de ce «Russe», né en Italie de père inconnu, et fier de défendre l’art français avant de se jeter dans la guerre de 14 par anti-germanisme ? Or la biographie de Campa ne se laisse jamais déborder par l’ampleur qu’elle s’assigne et la qualité d’écriture qu’elle s’impose. On ne saurait oublier la difficulté majeure de l’entreprise, Apollinaire lui-même et sa méfiance instinctive, nietzschéenne, des catégories auxquelles la librairie française obéissait servilement. Ce n’était pas son moindre charme aux yeux de Picasso. Pour avoir refusé la pensée unique et la tyrannie de l’éphémère, ces dieux du XXe siècle, l’écrivain et le critique d’art restent donc difficiles à saisir. Nos codes s’affolent à sa lecture. Il faut pourtant l’accepter en bloc. On aimerait tant qu’il ait prêché le modernisme sans retenue, au mépris de ce que l’art du jour mettait justement en péril, dans une adhésion totale à chacune des nouveautés dont se réclamaient ses contemporains. Entre 1898 et 1918, de la mort de Mallarmé à la sienne, il fut pourtant tout autre chose que le chantre abusé des avant-gardes européennes. Fils d’une aventurière, une de ces Polonaises en perpétuel exil qui vivaient de leur charme et de leur intelligence sur la Riviera, Wilhelm de Kostrowitzky a fait de brillantes études avant de convertir son goût des livres en puissance littéraire. D’un lycée à l’autre, au gré des finances aléatoires de sa jolie maman, il s’acoquine à quelques adolescents grandis aussi vite que lui. Certains devaient croiser ses pas plus tard, et se faire un nom à Paris. Sur le moment, on partage déjà tout, les livres interdits,
Fils d’une aventurière, une de ces Polonaises en perpétuel exil qui vivaient de leur charme et de leur intelligence sur la Riviera, Wilhelm de Kostrowitzky a fait de brillantes études avant de convertir son goût des livres en puissance littéraire. D’un lycée à l’autre, au gré des finances aléatoires de sa jolie maman, il s’acoquine à quelques adolescents grandis aussi vite que lui. Certains devaient croiser ses pas plus tard, et se faire un nom à Paris. Sur le moment, on partage déjà tout, les livres interdits,
 Mais le piège des Italiens ne se refermera pas sur Apollinaire, qui reconnaît les vertus roboratives du futurisme. Ainsi son enthousiasme pour Delaunay et la peinture simultanée doit-il s’évaluer à l’aune des tensions du milieu de l’art parisien, gagné par la surchauffe patriotique de l’avant-guerre. En mars 1913, lors du Salon des Indépendants,
Mais le piège des Italiens ne se refermera pas sur Apollinaire, qui reconnaît les vertus roboratives du futurisme. Ainsi son enthousiasme pour Delaunay et la peinture simultanée doit-il s’évaluer à l’aune des tensions du milieu de l’art parisien, gagné par la surchauffe patriotique de l’avant-guerre. En mars 1913, lors du Salon des Indépendants,  De cette guerre, tellement moderne par son alliance de haute technologie et de bas instincts, de mélancolie et d’énergie, de peur et de surpassement de soi, Apollinaire va traduire les tristesses et les beautés. Il en fut l’Ovide et l’Homère. Aux poèmes de l’absence et de l’attente répond l’éclat paradoxal, explosif, de certains calligrammes, qui ont tant fait pour rejeter leur auteur parmi les suppôts d’un «patriotisme niais» ou d’une virilité risible. Il faut croire que notre génération, celle de Laurence Campa, n’a plus de telles préventions à l’égard du poète en uniforme ! Lequel, comme Campa le montre aussi, n’oublie pas le front des arts jusqu’en 1918 (il meurt un jour avant l’armistice !). Ajournés pour cause de conflit, Les Trois Don Juan paraissent en 1915. Là où Apollinaire voyait ou affectait de voir un expédient alimentaire, le lecteur d’aujourd’hui découvre avec bonheur une des plus heureuses divagations, drôles et érotiques à la fois, sur ce grand d’Espagne, obsédé de femmes et repoussant la mort et l’impossible à travers elles. Cette fantaisie admirable, qui absorbe Molière comme Byron sans le moindre scrupule, respire, au plus fort du conflit, l’immoralisme des Onze mille verges… Après son retour du front, le trépané va accumuler les aventures les plus audacieuses, signer des préfaces, seconder les galeries qui se lancent ou se réveillent. Adulé par la nouvelle génération, du Nord/Sud de Reverdy à
De cette guerre, tellement moderne par son alliance de haute technologie et de bas instincts, de mélancolie et d’énergie, de peur et de surpassement de soi, Apollinaire va traduire les tristesses et les beautés. Il en fut l’Ovide et l’Homère. Aux poèmes de l’absence et de l’attente répond l’éclat paradoxal, explosif, de certains calligrammes, qui ont tant fait pour rejeter leur auteur parmi les suppôts d’un «patriotisme niais» ou d’une virilité risible. Il faut croire que notre génération, celle de Laurence Campa, n’a plus de telles préventions à l’égard du poète en uniforme ! Lequel, comme Campa le montre aussi, n’oublie pas le front des arts jusqu’en 1918 (il meurt un jour avant l’armistice !). Ajournés pour cause de conflit, Les Trois Don Juan paraissent en 1915. Là où Apollinaire voyait ou affectait de voir un expédient alimentaire, le lecteur d’aujourd’hui découvre avec bonheur une des plus heureuses divagations, drôles et érotiques à la fois, sur ce grand d’Espagne, obsédé de femmes et repoussant la mort et l’impossible à travers elles. Cette fantaisie admirable, qui absorbe Molière comme Byron sans le moindre scrupule, respire, au plus fort du conflit, l’immoralisme des Onze mille verges… Après son retour du front, le trépané va accumuler les aventures les plus audacieuses, signer des préfaces, seconder les galeries qui se lancent ou se réveillent. Adulé par la nouvelle génération, du Nord/Sud de Reverdy à