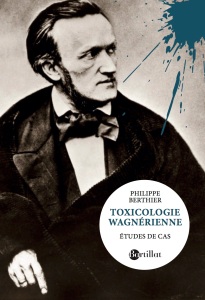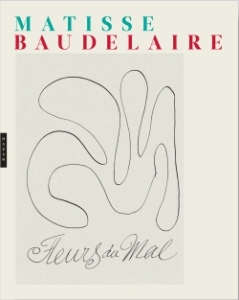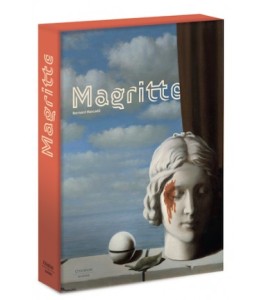Bouchardon ou l’antique fait homme, répétaient en chœur ses contemporains les plus avisés ! C’est que le sculpteur, l’un des plus éminents du règne de Louis XV, voua une passion égale à l’art grec et au sexe fort. Après avoir exploré l’intimité de Parmesan, le Louvre nous livre magnifiquement la sienne. On verra, du reste, que le Français n’ignorait rien des turpitudes du maniériste italien. La rétrospective de Guilhem Scherf et de Juliette Trey ne pratique pas le voile de pudeur. Elle s’ouvre sur la copie du Faune Barberini, que Bouchardon exécuta, à Rome, au titre des obligations scolaires de l’Académie de France. Son métier plus gras, plus sensuel, plus moderne et épidermique, transfigure le modèle vénéré et décuple l’impudeur inouïe de sa pose. A l’autre bout d’un parcours qui alterne habilement sculptures et dessins, inséparables leviers d’une perfection jamais desséchante, surgit le très suggestif Amour se faisant un arc de la massue d’Hercule, autour duquel le visiteur est appelé à tourner, comme Bouchardon roda autour de l’adolescent de chair qu’une série de sanguines montre sous toutes les coutures. Or, en 1750, le sourire de ce Cupidon espiègle et ses fesses rebondies, souvenir précis du Parmesan, déplurent, déçurent. L’«antiquité retrouvée », dont Bouchardon était le superbe champion, devait rester sourde aux grâces et aux invites du rocaille dont le janséniste La Font de Saint-Yenne, parmi d’autres, s’érigeait en pourfendeur. A revenir sur cette polémique révélatrice, comme le fait Scherf en détails, l’audace latente de l’œuvre force les silences de la censure morale pour qui sait lire entre les lignes. Le reproche fait à Bouchardon d’avoir dégradé l’image du jeune dieu tenait à deux choses, l’opération mécanique, triviale, de la taille de l’arc, et les volutes hanchées du contrapposto. Au fond, la souplesse érectile de l’Amour, plus explicite que son précédent italien, fait horreur à La Font de Saint-Yenne, et le bras gauche trop uni à la cuisse ne lui semblant d’un « effet heureux ». Dénégation caractérisée… Plutôt que blâmer le souci de réveiller les sens du public, il eût mieux fallu congratuler Bouchardon d’être parvenu à réchauffer le marbre et conjuguer tant de naturel à tant de noblesse. C’est précisément ce à quoi répond l’exposition. Là où l’histoire de l’art cantonnait au rôle d’annonciateur du néoclassicisme spartiate, que préfigurent assurément les bustes du baron Stosch et de ses tendres amis anglais, le Louvre nous révèle un fanatique du baroque romain et un homme pour qui, selon l’adage platonicien de Gautier, le beau est la splendeur du vrai. Adage que Fantin-Latour, le réaliste contraint et souvent contrit, fit sien…
Bouchardon ou l’antique fait homme, répétaient en chœur ses contemporains les plus avisés ! C’est que le sculpteur, l’un des plus éminents du règne de Louis XV, voua une passion égale à l’art grec et au sexe fort. Après avoir exploré l’intimité de Parmesan, le Louvre nous livre magnifiquement la sienne. On verra, du reste, que le Français n’ignorait rien des turpitudes du maniériste italien. La rétrospective de Guilhem Scherf et de Juliette Trey ne pratique pas le voile de pudeur. Elle s’ouvre sur la copie du Faune Barberini, que Bouchardon exécuta, à Rome, au titre des obligations scolaires de l’Académie de France. Son métier plus gras, plus sensuel, plus moderne et épidermique, transfigure le modèle vénéré et décuple l’impudeur inouïe de sa pose. A l’autre bout d’un parcours qui alterne habilement sculptures et dessins, inséparables leviers d’une perfection jamais desséchante, surgit le très suggestif Amour se faisant un arc de la massue d’Hercule, autour duquel le visiteur est appelé à tourner, comme Bouchardon roda autour de l’adolescent de chair qu’une série de sanguines montre sous toutes les coutures. Or, en 1750, le sourire de ce Cupidon espiègle et ses fesses rebondies, souvenir précis du Parmesan, déplurent, déçurent. L’«antiquité retrouvée », dont Bouchardon était le superbe champion, devait rester sourde aux grâces et aux invites du rocaille dont le janséniste La Font de Saint-Yenne, parmi d’autres, s’érigeait en pourfendeur. A revenir sur cette polémique révélatrice, comme le fait Scherf en détails, l’audace latente de l’œuvre force les silences de la censure morale pour qui sait lire entre les lignes. Le reproche fait à Bouchardon d’avoir dégradé l’image du jeune dieu tenait à deux choses, l’opération mécanique, triviale, de la taille de l’arc, et les volutes hanchées du contrapposto. Au fond, la souplesse érectile de l’Amour, plus explicite que son précédent italien, fait horreur à La Font de Saint-Yenne, et le bras gauche trop uni à la cuisse ne lui semblant d’un « effet heureux ». Dénégation caractérisée… Plutôt que blâmer le souci de réveiller les sens du public, il eût mieux fallu congratuler Bouchardon d’être parvenu à réchauffer le marbre et conjuguer tant de naturel à tant de noblesse. C’est précisément ce à quoi répond l’exposition. Là où l’histoire de l’art cantonnait au rôle d’annonciateur du néoclassicisme spartiate, que préfigurent assurément les bustes du baron Stosch et de ses tendres amis anglais, le Louvre nous révèle un fanatique du baroque romain et un homme pour qui, selon l’adage platonicien de Gautier, le beau est la splendeur du vrai. Adage que Fantin-Latour, le réaliste contraint et souvent contrit, fit sien…
 N’opposait-il pas, selon Jacque-Emile Blanche, la saine « tradition » aux « progrès de la folie et de l’orgueil » ? Dès 1879, à mots couverts, deux ténors de la critique lui faisaient grief d’une tiédeur vite venue… Tandis que Huysmans parle du « charme puritain et discret » d’une peinture trop retenue à son goût, Paul de Saint-Victor a ce mot : « Le pinceau de Fantin-Latour ne pourrait-il pas enfin quitter ou éclaircir son long deuil ? » Nous célébrons tous quelque enterrement, notait Baudelaire en 1846, à l’appui de sa définition du moderne et de la beauté paradoxale de l’habit noir… Sans doute Fantin trouvait-il du charme, et du « charme indigène », aux funérailles dont sa peinture est remplie. Son meilleur tableau reste L’Hommage à Delacroix de 1864. La nouvelle vague, avec Manet et Whistler pour phares, s’y rassemble et l’ensemble a une allure folle, une fermeté de facture et de composition, et une densité de pâte qui s’accordent encore à l’audace des tout débuts. Certains autoportraits datent de cette époque, l’un d’entre eux eut même les honneurs du Salon des refusés en 1863 (ce tableau non identifié et non retrouvé, sauf erreur, il me semble l’apercevoir dans la photographie de Fantin, au milieu de son atelier, qui orne le seuil de la rétrospective du Luxembourg). Sans doute Le Toast du Salon de 1865, que Bridget Alsdorf a réhabilité dans un livre décisif, serait-il considéré aujourd’hui comme un des must de la « nouvelle peinture » si son auteur ne l’avait lacéré, de rage, au lendemain d’une exposition dont il fut, avec Olympia, la risée. Pourquoi tant de haine ? Fantin avait choisi de peindre ses amis, Manet et Whistler toujours en tête, trinquant à la Vérité, laquelle n’était autre qu’un beau modèle d’atelier dressée au-dessus des messieurs en frac ou en kimono… Mieux que La Liberté de Delacroix, son Toast fusionnait l’allégorie et la chose vue. Alsdorf a raison d’y voir la marque de L’Atelier de Courbet et du Déjeuner sur l’herbe de Manet, où la femme se hisse au symbole sans cesser d’être un être de chair et de désir. Mais là était le hic. En détruisant l’œuvre dont la presse gaussa l’arrogance de mauvais goût, le neurasthénique Fantin effaçait autant une humiliation que l’aveu d’une frustration sexuelle qui s’avoue ailleurs. Ce que suggèrent ses autoportraits spectraux, la correspondance le confirme. Delacroix, Whistler et Manet agirent sur lui comme un surmoi paralysant. Les tributs qu’il aura multipliés au « génie » traduisent assez clairement le doute, que seul le succès final de sa peinture de « fantaisie » soulagera un peu. Ces rêveries vénitiennes enveloppent leurs étreintes possibles dans une atmosphère qui les déréalisent assez pour en faire un objet de fantasme enfin heureux. Que Fantin-Latour ait eu recours à la photographie, et notamment aux nus féminins les plus scabreux et les moins licites, ne fait que confirmer le transfert qui irrigue un univers pictural condamné à biaiser en permanence, pour le meilleur et le pire.
N’opposait-il pas, selon Jacque-Emile Blanche, la saine « tradition » aux « progrès de la folie et de l’orgueil » ? Dès 1879, à mots couverts, deux ténors de la critique lui faisaient grief d’une tiédeur vite venue… Tandis que Huysmans parle du « charme puritain et discret » d’une peinture trop retenue à son goût, Paul de Saint-Victor a ce mot : « Le pinceau de Fantin-Latour ne pourrait-il pas enfin quitter ou éclaircir son long deuil ? » Nous célébrons tous quelque enterrement, notait Baudelaire en 1846, à l’appui de sa définition du moderne et de la beauté paradoxale de l’habit noir… Sans doute Fantin trouvait-il du charme, et du « charme indigène », aux funérailles dont sa peinture est remplie. Son meilleur tableau reste L’Hommage à Delacroix de 1864. La nouvelle vague, avec Manet et Whistler pour phares, s’y rassemble et l’ensemble a une allure folle, une fermeté de facture et de composition, et une densité de pâte qui s’accordent encore à l’audace des tout débuts. Certains autoportraits datent de cette époque, l’un d’entre eux eut même les honneurs du Salon des refusés en 1863 (ce tableau non identifié et non retrouvé, sauf erreur, il me semble l’apercevoir dans la photographie de Fantin, au milieu de son atelier, qui orne le seuil de la rétrospective du Luxembourg). Sans doute Le Toast du Salon de 1865, que Bridget Alsdorf a réhabilité dans un livre décisif, serait-il considéré aujourd’hui comme un des must de la « nouvelle peinture » si son auteur ne l’avait lacéré, de rage, au lendemain d’une exposition dont il fut, avec Olympia, la risée. Pourquoi tant de haine ? Fantin avait choisi de peindre ses amis, Manet et Whistler toujours en tête, trinquant à la Vérité, laquelle n’était autre qu’un beau modèle d’atelier dressée au-dessus des messieurs en frac ou en kimono… Mieux que La Liberté de Delacroix, son Toast fusionnait l’allégorie et la chose vue. Alsdorf a raison d’y voir la marque de L’Atelier de Courbet et du Déjeuner sur l’herbe de Manet, où la femme se hisse au symbole sans cesser d’être un être de chair et de désir. Mais là était le hic. En détruisant l’œuvre dont la presse gaussa l’arrogance de mauvais goût, le neurasthénique Fantin effaçait autant une humiliation que l’aveu d’une frustration sexuelle qui s’avoue ailleurs. Ce que suggèrent ses autoportraits spectraux, la correspondance le confirme. Delacroix, Whistler et Manet agirent sur lui comme un surmoi paralysant. Les tributs qu’il aura multipliés au « génie » traduisent assez clairement le doute, que seul le succès final de sa peinture de « fantaisie » soulagera un peu. Ces rêveries vénitiennes enveloppent leurs étreintes possibles dans une atmosphère qui les déréalisent assez pour en faire un objet de fantasme enfin heureux. Que Fantin-Latour ait eu recours à la photographie, et notamment aux nus féminins les plus scabreux et les moins licites, ne fait que confirmer le transfert qui irrigue un univers pictural condamné à biaiser en permanence, pour le meilleur et le pire.
 L’amour des femmes, Albert Besnard (1849-1934) n’en fit pas une passion clandestine, presque honteuse, et la remarquable rétrospective du Petit Palais, vraie revanche sur l’oubli, examine cette prédilection avec une franchise stimulante. De tout ce qui peut aujourd’hui nous ramener à lui, son mundus muliebris constitue le meilleur passeport. La preuve que ce soi-disant pompier n’en fut pas un, c’est que le beau sexe étincelle dans sa riche peinture et y allume toutes sortes de choses. Sa verve, tout d’abord. L’indépendance du peintre, style et sujets, joue ainsi en sa faveur. Elle est d’autant plus méritoire que Besnard décida tôt de faire carrière… Comme la plupart des élèves de Cabanel et des futurs Prix de Rome, il acquit vite les moyens et les titres pour accéder aux commandes officielles et, en particulier, aux chantiers de peinture murale, vitrine du pouvoir par excellence. Sous la IIIème République, la décoration monumentale reste un prolongement de la prédication civique. Et c’était très bien ainsi, d’autant que la veine néobaroque ou néo-rocaille de Besnard ne s’épuisera jamais à couvrir les surfaces exigées. Sorbonne, Ecole de pharmacie, mairies d’arrondissement, jusqu’au Petit Palais, rien ne lui fait peur et rien n’entame son sens de l’espace et l’éclat d’une palette imprévisible, orientale avant même de se découvrir orientaliste. Le portrait, de même, lui allait comme un gant. Face au tapage des spécialistes du genre, Carolus-Duran et ses clones, il sait résister à la cacophonie des accessoires et à la virtuosité gratuite. Le modèle n’est jamais sacrifié à son image, qu’il s’agisse de proches d’Henri Rochefort (Besnard est très rad-soc), d’un ancien Communard devenu Ambassadeur de France à Rome, ou de brûlantes créatures dont on ne sait trop à quel monde elles appartiennent. Madame Pillet-Will, qui ébranla le fragile Mauclair en 1901, nous fait vite comprendre pourquoi on l’appelait la panthère…On navigue entre Largillière et Van Dongen. Plus piquante encore, la féline créature qui émerge de Féérie intime, justement qualifiée de baudelairienne en 1902, efface d’un coup les plâtreuses et théâtrales hétaïres de Cabanel. En peinture, il y a une vérité du médium qui ne trompe pas. Or Besnard fut aussi l’un des restaurateurs du pastel rococo, épiderme caressé et vapeur de lumière, de même qu’il se range parmi les poètes de l’eau-forte. Legros avait été son ami, Rops et Whistler ses pères… Le noir, il nous le rappelle, sied aux grands coloristes et aux grands amoureux. Besnard a donc bien mérité de la patrie. Doublement académicien, patron de l’Ecole des beaux-arts, directeur de la villa Médicis, il eut droit aux actualités Pathé-Gaumont et, avant Braque, à des funérailles nationales dans la cour du Louvre, quelques mois après les événements de février 34. Qui dit mieux ? Stéphane Guégan
L’amour des femmes, Albert Besnard (1849-1934) n’en fit pas une passion clandestine, presque honteuse, et la remarquable rétrospective du Petit Palais, vraie revanche sur l’oubli, examine cette prédilection avec une franchise stimulante. De tout ce qui peut aujourd’hui nous ramener à lui, son mundus muliebris constitue le meilleur passeport. La preuve que ce soi-disant pompier n’en fut pas un, c’est que le beau sexe étincelle dans sa riche peinture et y allume toutes sortes de choses. Sa verve, tout d’abord. L’indépendance du peintre, style et sujets, joue ainsi en sa faveur. Elle est d’autant plus méritoire que Besnard décida tôt de faire carrière… Comme la plupart des élèves de Cabanel et des futurs Prix de Rome, il acquit vite les moyens et les titres pour accéder aux commandes officielles et, en particulier, aux chantiers de peinture murale, vitrine du pouvoir par excellence. Sous la IIIème République, la décoration monumentale reste un prolongement de la prédication civique. Et c’était très bien ainsi, d’autant que la veine néobaroque ou néo-rocaille de Besnard ne s’épuisera jamais à couvrir les surfaces exigées. Sorbonne, Ecole de pharmacie, mairies d’arrondissement, jusqu’au Petit Palais, rien ne lui fait peur et rien n’entame son sens de l’espace et l’éclat d’une palette imprévisible, orientale avant même de se découvrir orientaliste. Le portrait, de même, lui allait comme un gant. Face au tapage des spécialistes du genre, Carolus-Duran et ses clones, il sait résister à la cacophonie des accessoires et à la virtuosité gratuite. Le modèle n’est jamais sacrifié à son image, qu’il s’agisse de proches d’Henri Rochefort (Besnard est très rad-soc), d’un ancien Communard devenu Ambassadeur de France à Rome, ou de brûlantes créatures dont on ne sait trop à quel monde elles appartiennent. Madame Pillet-Will, qui ébranla le fragile Mauclair en 1901, nous fait vite comprendre pourquoi on l’appelait la panthère…On navigue entre Largillière et Van Dongen. Plus piquante encore, la féline créature qui émerge de Féérie intime, justement qualifiée de baudelairienne en 1902, efface d’un coup les plâtreuses et théâtrales hétaïres de Cabanel. En peinture, il y a une vérité du médium qui ne trompe pas. Or Besnard fut aussi l’un des restaurateurs du pastel rococo, épiderme caressé et vapeur de lumière, de même qu’il se range parmi les poètes de l’eau-forte. Legros avait été son ami, Rops et Whistler ses pères… Le noir, il nous le rappelle, sied aux grands coloristes et aux grands amoureux. Besnard a donc bien mérité de la patrie. Doublement académicien, patron de l’Ecole des beaux-arts, directeur de la villa Médicis, il eut droit aux actualités Pathé-Gaumont et, avant Braque, à des funérailles nationales dans la cour du Louvre, quelques mois après les événements de février 34. Qui dit mieux ? Stéphane Guégan
 *Bouchardon (1698-1762). Une idée du beau, Musée du Louvre, jusqu’au 5 décembre. Du catalogue (Somogy éditions/Louvre éditions, 49€) et du volume que Juliette Trey consacre au millier de dessins de Bouchardon que conserve le Louvre (Mare § Martin/Louvre éditions, 110€), nous reparlerons quand il s’agira de faire le bilan objectif des meilleures réalisations de l’année en matière de livres d’art. Signalons le Solo que Guilhem Scherf consacre à L’Amour controversé de 1750 (Somogy éditions/Louvre éditions, 9,70€) et le brillant essai de Marc Fumaroli, sur qui glisse avantageusement l’opposition scolaire du rocaille et du néoclassicisme (Le comte de Caylus et Edme Bouchardon. Deux réformateurs du goût sous Louis XV, Somogy éditions/Louvre éditions, 7€). On en aura fini après avoir évoqué trop rapidement deux expositions remarquables, visibles au Louvre jusqu’au 16 janvier : tandis que Geste baroque frissonne des outrances sucrées de l’art autrichien des XVIIème et XVIIIème siècles, Un Suédois à Paris regroupe les perles de la collection du comte Carl Gustaf Tessin, diplomate et figure du monde des arts dans les années 1730-1740. Le meilleur du goût français, de Bouchardon à Lemoyne et Oudry, se prit à ses filets experts. Les Boucher en constituent l’acmé. A lui seul, Le Triomphe de Vénus, grand chef-d’œuvre du XVIIIème siècle, justifie ce formidable partenariat avec Stockholm.
*Bouchardon (1698-1762). Une idée du beau, Musée du Louvre, jusqu’au 5 décembre. Du catalogue (Somogy éditions/Louvre éditions, 49€) et du volume que Juliette Trey consacre au millier de dessins de Bouchardon que conserve le Louvre (Mare § Martin/Louvre éditions, 110€), nous reparlerons quand il s’agira de faire le bilan objectif des meilleures réalisations de l’année en matière de livres d’art. Signalons le Solo que Guilhem Scherf consacre à L’Amour controversé de 1750 (Somogy éditions/Louvre éditions, 9,70€) et le brillant essai de Marc Fumaroli, sur qui glisse avantageusement l’opposition scolaire du rocaille et du néoclassicisme (Le comte de Caylus et Edme Bouchardon. Deux réformateurs du goût sous Louis XV, Somogy éditions/Louvre éditions, 7€). On en aura fini après avoir évoqué trop rapidement deux expositions remarquables, visibles au Louvre jusqu’au 16 janvier : tandis que Geste baroque frissonne des outrances sucrées de l’art autrichien des XVIIème et XVIIIème siècles, Un Suédois à Paris regroupe les perles de la collection du comte Carl Gustaf Tessin, diplomate et figure du monde des arts dans les années 1730-1740. Le meilleur du goût français, de Bouchardon à Lemoyne et Oudry, se prit à ses filets experts. Les Boucher en constituent l’acmé. A lui seul, Le Triomphe de Vénus, grand chef-d’œuvre du XVIIIème siècle, justifie ce formidable partenariat avec Stockholm.
 **Fantin-Latour. A fleur de peau, Musée du Luxembourg jusqu’au 12 février. Catalogue sous la direction de Laure Dalon (RMN éditions, 35€). Les photographies érotiques, et la façon dont elles documentent la peinture de « fantaisie », en forment la partie la plus neuve. En 2013, Bridget Alsdorf signait la meilleure étude jamais consacrée à Fantin depuis la rétrospective de Douglas Druick et Michel Hoog (1982). Fellow Men : Fantin-Latour and The Problem of the Group in Nineteenth-Century French Painting (Princeton University Press, 45$) place l’idiosyncrasie instable du peintre au cœur de l’étude qu’elle consacre à ses portraits collectifs, dont elle explore chaque tension (mal vécue) et chaque pulsion (mal contenue). De son côté, Frédéric Chaleil a eu la brillante idée de réunir quelques-uns des grands textes inspirés par l’artiste. Ceux de Blanche et, à un moindre titre, de Gustave Kahn sont de purs bijoux, qui mériteraient de retenir davantage les historiens d’art (Fantin-Latour par ses contemporains, Les Editions de Paris, 15€).
**Fantin-Latour. A fleur de peau, Musée du Luxembourg jusqu’au 12 février. Catalogue sous la direction de Laure Dalon (RMN éditions, 35€). Les photographies érotiques, et la façon dont elles documentent la peinture de « fantaisie », en forment la partie la plus neuve. En 2013, Bridget Alsdorf signait la meilleure étude jamais consacrée à Fantin depuis la rétrospective de Douglas Druick et Michel Hoog (1982). Fellow Men : Fantin-Latour and The Problem of the Group in Nineteenth-Century French Painting (Princeton University Press, 45$) place l’idiosyncrasie instable du peintre au cœur de l’étude qu’elle consacre à ses portraits collectifs, dont elle explore chaque tension (mal vécue) et chaque pulsion (mal contenue). De son côté, Frédéric Chaleil a eu la brillante idée de réunir quelques-uns des grands textes inspirés par l’artiste. Ceux de Blanche et, à un moindre titre, de Gustave Kahn sont de purs bijoux, qui mériteraient de retenir davantage les historiens d’art (Fantin-Latour par ses contemporains, Les Editions de Paris, 15€).
 ***Albert Besnard (1849-1934). Modernités Belle Epoque, Paris, Petit-Palais, jusqu’au 29 janvier 2017. Catalogue sous la direction de Christine Gouzi, Somogy, 39€. Il faut absolument voir, dans ces mêmes murs, l’exposition Oscar Wilde. L’impertinent absolu (jusqu’au 15 janvier) sur laquelle se sont penchées toutes sortes de fées, y compris son petit-fils. L’Irlandais scandaleux passa les dernières années de sa vie à Paris, une manière d’élection, afin d’inverser l’éviction que la prude Albion venait de lui signifier. Sans être condamné à l’exil, Wilde avait préféré se rapprocher du monde libre. Et le Paris de Lautrec, Gide et Henri de Régnier l’accueillit, avec plus ou moins de chaleur, comme l’enfant prodigue, enfin revenu… Grand lecteur des Français, Gautier, Baudelaire et tant d’autres, Wilde se fit d’abord connaître par d’insolents articles sur la peinture, principalement anglaise, qui se voyait à Londres dans les années 1870. On lui pardonnera d’avoir parfois préféré les seconds couteaux du préraphaélisme à Whistler, Tissot et Legros, puisque ses choix répondaient au double impératif du beau et de la passion. Or, en ces matières, il n’était de loi que la sienne. SG
***Albert Besnard (1849-1934). Modernités Belle Epoque, Paris, Petit-Palais, jusqu’au 29 janvier 2017. Catalogue sous la direction de Christine Gouzi, Somogy, 39€. Il faut absolument voir, dans ces mêmes murs, l’exposition Oscar Wilde. L’impertinent absolu (jusqu’au 15 janvier) sur laquelle se sont penchées toutes sortes de fées, y compris son petit-fils. L’Irlandais scandaleux passa les dernières années de sa vie à Paris, une manière d’élection, afin d’inverser l’éviction que la prude Albion venait de lui signifier. Sans être condamné à l’exil, Wilde avait préféré se rapprocher du monde libre. Et le Paris de Lautrec, Gide et Henri de Régnier l’accueillit, avec plus ou moins de chaleur, comme l’enfant prodigue, enfin revenu… Grand lecteur des Français, Gautier, Baudelaire et tant d’autres, Wilde se fit d’abord connaître par d’insolents articles sur la peinture, principalement anglaise, qui se voyait à Londres dans les années 1870. On lui pardonnera d’avoir parfois préféré les seconds couteaux du préraphaélisme à Whistler, Tissot et Legros, puisque ses choix répondaient au double impératif du beau et de la passion. Or, en ces matières, il n’était de loi que la sienne. SG
Livres illustres, livres illustrés
 Les plus grands s’y sont attaqués, Füssli, Delacroix, Manet, Masson… Le sublime Hamlet est resté le rêve et le cauchemar de l’illustrateur, si libre que soit son accompagnement, disait Matisse, du texte. Un rêve, d‘abord. Hamlet place l’image devant une suite apparemment désordonnée de situations passionnelles, toutes aptes à frapper les esprits et stimuler les crayons. Il y a donc abondance, cascade, vertige. La difficulté n’est pas tant de dominer l’action dans ses hardiesses que de la saisir dans son halo de non-sens et presque de « nonsense ». Car la folie du monde, la folie des hommes, thème central du grand William, ne s’isole pas, elle colore l’ensemble de la pièce de toutes les nuances du noir des âmes et des désirs. La folie vaporise jusqu’au sentiment d’être. Aki Kuroda avait donc fort à faire. Il dit, en couverture, avoir voulu « interpréter » le texte. De fait, il le laisse respirer, en saisit la fantaisie, l’humour et la métaphysique dans la multiplicité de ses registres graphiques et chromatiques. L’œil passe du gris au rouge, du jaune au bleu, comme il passe d’un hommage crypté à Malevitch aux brouillages savoureusement boueux d’un De Kooning. A héros divisés, palette ouverte et scénographie centrifuge, théâtre dans le théâtre, of course. Le néant est toujours de bon conseil (William Shakespeare, Hamlet, interprété pat Aki Kuroda, Gallimard, 45€). SG
Les plus grands s’y sont attaqués, Füssli, Delacroix, Manet, Masson… Le sublime Hamlet est resté le rêve et le cauchemar de l’illustrateur, si libre que soit son accompagnement, disait Matisse, du texte. Un rêve, d‘abord. Hamlet place l’image devant une suite apparemment désordonnée de situations passionnelles, toutes aptes à frapper les esprits et stimuler les crayons. Il y a donc abondance, cascade, vertige. La difficulté n’est pas tant de dominer l’action dans ses hardiesses que de la saisir dans son halo de non-sens et presque de « nonsense ». Car la folie du monde, la folie des hommes, thème central du grand William, ne s’isole pas, elle colore l’ensemble de la pièce de toutes les nuances du noir des âmes et des désirs. La folie vaporise jusqu’au sentiment d’être. Aki Kuroda avait donc fort à faire. Il dit, en couverture, avoir voulu « interpréter » le texte. De fait, il le laisse respirer, en saisit la fantaisie, l’humour et la métaphysique dans la multiplicité de ses registres graphiques et chromatiques. L’œil passe du gris au rouge, du jaune au bleu, comme il passe d’un hommage crypté à Malevitch aux brouillages savoureusement boueux d’un De Kooning. A héros divisés, palette ouverte et scénographie centrifuge, théâtre dans le théâtre, of course. Le néant est toujours de bon conseil (William Shakespeare, Hamlet, interprété pat Aki Kuroda, Gallimard, 45€). SG
 L’hygiène du voyage, Marguerite Yourcenar l’appliqua à sa vie et son œuvre, ignorantes du mono-culturel, comme des frontières du temps et de l’espace. Il est vrai que la République des Lettres où l’écrivain prit place, dans les années 1930, mettait un point d’honneur à cultiver son cosmopolitisme et laissait courir en tous sens une curiosité qui s’est perdue. Les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar illustrent l’amour du vagabondage littéraire dès leur titre, à double horizon. L’Orient neuf qu’elles visitent s’étend de la Chine au vieil Amsterdam de Rembrandt, de l’Europe centrale à la Grèce de l’entre-deux-guerres. Ces nouvelles orientales, en outre, fondent leur nouveauté sur la réécriture d’anciens contes, ainsi renouvelés. Certaines sources sont chinoises, d’autres japonaises ou indiennes. S’il puise ici aux ballades balkaniques du Moyen Âge, le récit emprunte ailleurs aux simples fait-divers, réservoir d’anciennes pratiques. Une même errance, essence de toute fiction, relie l’ensemble. De peur d’en ralentir ou alourdir le pas, la main de Georges Lemoine se fait elle aussi orientale. Le vol de l’insecte lui sert de boussole, le grain du papier de limite. Ses légers crayons ne couvrent pas plus la page qu’ils n’en abusent. Quelques signes, presque rien, et le tour est joué. Même les Vanités de Philippe de Champaigne se délestent de leur jansénisme pesant… Ces Nouvelles orientales, Marguerite Yourcenar les confia initialement, en 1938, à Paul Morand, alors directeur de collection chez Gallimard. Grasset avait été jusque-là son principal éditeur. Emmanuel Boudot-Lamotte, entre les deux maisons rivales, fut le parfait trait d’union. Tendre ami d’André Fraigneau, l’un des piliers de Grasset, il s’occupa de Yourcenar, à partir de 1938, pour le compte de Gallimard, notamment des Nouvelles orientales et du Coup de grâce, roman construit sur un triangle amoureux impossible (Fraigneau n’était pas fait pour les femmes, quant à Marguerite…). La correspondance Yourcenar / Boudot-Lamotte s’adresse à ceux qu’intéressent la France de la « drôle de guerre », le milieu littéraire français, la culture américaine et, last but not least, l’épuration de l’édition parisienne, Grasset ayant particulièrement dégusté. (Marguerite Yourcenar, Nouvelles Orientales, illustrations de Georges Lemoine, Gallimard, 25€ ; idem, En 1939, l’Amérique commence à Bordeaux. Lettres à Emmanuel Boudot-Lamotte, Gallimard, 21€) SG
L’hygiène du voyage, Marguerite Yourcenar l’appliqua à sa vie et son œuvre, ignorantes du mono-culturel, comme des frontières du temps et de l’espace. Il est vrai que la République des Lettres où l’écrivain prit place, dans les années 1930, mettait un point d’honneur à cultiver son cosmopolitisme et laissait courir en tous sens une curiosité qui s’est perdue. Les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar illustrent l’amour du vagabondage littéraire dès leur titre, à double horizon. L’Orient neuf qu’elles visitent s’étend de la Chine au vieil Amsterdam de Rembrandt, de l’Europe centrale à la Grèce de l’entre-deux-guerres. Ces nouvelles orientales, en outre, fondent leur nouveauté sur la réécriture d’anciens contes, ainsi renouvelés. Certaines sources sont chinoises, d’autres japonaises ou indiennes. S’il puise ici aux ballades balkaniques du Moyen Âge, le récit emprunte ailleurs aux simples fait-divers, réservoir d’anciennes pratiques. Une même errance, essence de toute fiction, relie l’ensemble. De peur d’en ralentir ou alourdir le pas, la main de Georges Lemoine se fait elle aussi orientale. Le vol de l’insecte lui sert de boussole, le grain du papier de limite. Ses légers crayons ne couvrent pas plus la page qu’ils n’en abusent. Quelques signes, presque rien, et le tour est joué. Même les Vanités de Philippe de Champaigne se délestent de leur jansénisme pesant… Ces Nouvelles orientales, Marguerite Yourcenar les confia initialement, en 1938, à Paul Morand, alors directeur de collection chez Gallimard. Grasset avait été jusque-là son principal éditeur. Emmanuel Boudot-Lamotte, entre les deux maisons rivales, fut le parfait trait d’union. Tendre ami d’André Fraigneau, l’un des piliers de Grasset, il s’occupa de Yourcenar, à partir de 1938, pour le compte de Gallimard, notamment des Nouvelles orientales et du Coup de grâce, roman construit sur un triangle amoureux impossible (Fraigneau n’était pas fait pour les femmes, quant à Marguerite…). La correspondance Yourcenar / Boudot-Lamotte s’adresse à ceux qu’intéressent la France de la « drôle de guerre », le milieu littéraire français, la culture américaine et, last but not least, l’épuration de l’édition parisienne, Grasset ayant particulièrement dégusté. (Marguerite Yourcenar, Nouvelles Orientales, illustrations de Georges Lemoine, Gallimard, 25€ ; idem, En 1939, l’Amérique commence à Bordeaux. Lettres à Emmanuel Boudot-Lamotte, Gallimard, 21€) SG
 On pensait tout avoir de Sylvia Plath (1932-1963), tout savoir d’elle et de sa très belle poésie d’écorchée vive. Et voilà, nouvelle révélation, que La Table ronde réunit en un précieux album quelques-uns de ses « dessins » dont le public londonien, apprend-on sous la plume de sa fille, avait eu la primeur en 2011. Frieda Hughes, l’un des deux enfants qu’eut Sylvia avec le poète Ted Hughes, nous rappelle qu’il arriva à sa mère d’écrire sous l’inspiration des peintres, Gauguin, Klee, De Chirico et même le douanier Rousseau. Ses dessins, eux, racontent une autre histoire. Face à la feuille blanche, son « style primitif » (Sylvia dixit) n’a rien de primitiviste. La jeune femme, au contraire, serre le motif avec l’acharnement de celle qui sait que la poésie répondra à cette concentration d’effet. On pense à Dürer et Hopper plus qu’aux champions de l’archaïsant ou de l’enfantin. La suite parisienne, vues des toits, instantanés urbains, farniente d’une Américaine de passage, cafés et chats, possède le délicieux parfum du Paris des existentialistes, dont elle se moque gentiment. Mais les lecteurs d’Ariel, depuis George Steiner, se méfient de « l’altière nudité » que Sylvia Plath mettait dans tout. N’était-ce pas la marque d’une pudeur et d’une peur, d’un goût et d’un dégoût de la vie ? « Mourir est un art, comme tout le reste. Je m’y révèle exceptionnellement doué», énonce Dame Lazare. Ces croquis poussés en maître sont sa part solaire (Sylvia Path, Dessins, introduction de Frieda Hughes, La Table ronde, 22€).
On pensait tout avoir de Sylvia Plath (1932-1963), tout savoir d’elle et de sa très belle poésie d’écorchée vive. Et voilà, nouvelle révélation, que La Table ronde réunit en un précieux album quelques-uns de ses « dessins » dont le public londonien, apprend-on sous la plume de sa fille, avait eu la primeur en 2011. Frieda Hughes, l’un des deux enfants qu’eut Sylvia avec le poète Ted Hughes, nous rappelle qu’il arriva à sa mère d’écrire sous l’inspiration des peintres, Gauguin, Klee, De Chirico et même le douanier Rousseau. Ses dessins, eux, racontent une autre histoire. Face à la feuille blanche, son « style primitif » (Sylvia dixit) n’a rien de primitiviste. La jeune femme, au contraire, serre le motif avec l’acharnement de celle qui sait que la poésie répondra à cette concentration d’effet. On pense à Dürer et Hopper plus qu’aux champions de l’archaïsant ou de l’enfantin. La suite parisienne, vues des toits, instantanés urbains, farniente d’une Américaine de passage, cafés et chats, possède le délicieux parfum du Paris des existentialistes, dont elle se moque gentiment. Mais les lecteurs d’Ariel, depuis George Steiner, se méfient de « l’altière nudité » que Sylvia Plath mettait dans tout. N’était-ce pas la marque d’une pudeur et d’une peur, d’un goût et d’un dégoût de la vie ? « Mourir est un art, comme tout le reste. Je m’y révèle exceptionnellement doué», énonce Dame Lazare. Ces croquis poussés en maître sont sa part solaire (Sylvia Path, Dessins, introduction de Frieda Hughes, La Table ronde, 22€).
 Notre rapport aux animaux, dit-on, a changé, il est plus respectueux, plus responsable. Viendra peut-être un jour où, l’éthique dégénérant en morale liberticide, il ne sera plus possible d’offrir aux lecteurs le très singulier bestiaire que Marie NDiaye et Dominique Zehrfuss ont conçus ensemble, dans l’écoute l’une de l’autre, comme tout bon livre d’images doit l’être. Le leur fait écho aux imagiers de notre enfance, format oblong, texte ramassé sur son mystère, et « vingt-huit bêtes », qui sont autant de miniatures fantasques, détachées du papier blanc, mais habitées d’une étrange « vie intérieure ». Oiseaux, poissons, crustacés et mammifères, pareils aux divinités orientales, ont accédé à la sainteté loufoque des corps transparents et au grouillement kaléidoscopique de la baleine Jonas (sa cousine fait une apparition). Mais cette drôle de ménagerie ne se contente pas de défiler devant nos yeux attendris ou amusés, elle s’ouvre, chambre d’échos, à la poésie de Marie NDiaye. Les plus beaux chants d’amour ne sont pas nécessairement tristes. Le sien s’animalise secrètement par petites touches et subtils déplacements de mots répétés. N’était-ce qu’un songe ? Aux bêtes que nous sommes de le dire (Marie NDiaye et Dominique Zehrfuss, Vingt-huit bêtes ; un chant d’amour, Gallimard, 18,50€). SG
Notre rapport aux animaux, dit-on, a changé, il est plus respectueux, plus responsable. Viendra peut-être un jour où, l’éthique dégénérant en morale liberticide, il ne sera plus possible d’offrir aux lecteurs le très singulier bestiaire que Marie NDiaye et Dominique Zehrfuss ont conçus ensemble, dans l’écoute l’une de l’autre, comme tout bon livre d’images doit l’être. Le leur fait écho aux imagiers de notre enfance, format oblong, texte ramassé sur son mystère, et « vingt-huit bêtes », qui sont autant de miniatures fantasques, détachées du papier blanc, mais habitées d’une étrange « vie intérieure ». Oiseaux, poissons, crustacés et mammifères, pareils aux divinités orientales, ont accédé à la sainteté loufoque des corps transparents et au grouillement kaléidoscopique de la baleine Jonas (sa cousine fait une apparition). Mais cette drôle de ménagerie ne se contente pas de défiler devant nos yeux attendris ou amusés, elle s’ouvre, chambre d’échos, à la poésie de Marie NDiaye. Les plus beaux chants d’amour ne sont pas nécessairement tristes. Le sien s’animalise secrètement par petites touches et subtils déplacements de mots répétés. N’était-ce qu’un songe ? Aux bêtes que nous sommes de le dire (Marie NDiaye et Dominique Zehrfuss, Vingt-huit bêtes ; un chant d’amour, Gallimard, 18,50€). SG