 Longtemps marginalisé par une histoire de l’art incapable de l’absorber, Philippe-Jacques de Loutherbourg (1740-1812) vient d’y reprendre place avec fracas. Si le mot convient à sa peinture, moins répétitive qu’on ne le dit, et surtout plus dérangeante qu’on ne croit, il s’applique aussi à la vie de ce mauvais Français. Que le jeune Loutherbourg ait épousé une prostituée, qu’il ait aimé « le plaisir, le faste et la parure », comme l’écrit Diderot en 1763, qu’il eût même un faible pour l’illuminisme maçonnique des Lumières, nous ne saurions le lui reprocher, sauf à confondre les artistes avec les saints de Voragine. Ses meilleurs tableaux ne seraient-ils pas moins outranciers et moins mystérieux, moins fous en un mot, si Loutherbourg n’y avait mis une partie de ses vices et de ses manies hermétiques ? Va pour le libertinage et l’occultisme puisqu’ils nourrirent sa lecture des hommes et du monde en leurs secrètes correspondances. Mais notre cœur saigne à la vue des vastes compositions patriotiques, brossées de verve à la gloire des armées anglaises, que Loutherbourg exécuta en 1793-1795, au pire moment de notre histoire. On lui aurait pardonné facilement de ne pas partager les idées de la Révolution française, de ne pas adhérer à la Terreur, voire à la politique étrangère du Directoire. Après tout, il avait été l’un des plus jeunes membres de l’Académie royale de peinture sous Louis XV, et s’était installé à Londres dès 1771. Peindre hors de France et peindre contre, fût-ce pas mercantilisme, ce n’est pourtant pas la même chose. Si encore il s’agissait de mauvais tableaux !
Longtemps marginalisé par une histoire de l’art incapable de l’absorber, Philippe-Jacques de Loutherbourg (1740-1812) vient d’y reprendre place avec fracas. Si le mot convient à sa peinture, moins répétitive qu’on ne le dit, et surtout plus dérangeante qu’on ne croit, il s’applique aussi à la vie de ce mauvais Français. Que le jeune Loutherbourg ait épousé une prostituée, qu’il ait aimé « le plaisir, le faste et la parure », comme l’écrit Diderot en 1763, qu’il eût même un faible pour l’illuminisme maçonnique des Lumières, nous ne saurions le lui reprocher, sauf à confondre les artistes avec les saints de Voragine. Ses meilleurs tableaux ne seraient-ils pas moins outranciers et moins mystérieux, moins fous en un mot, si Loutherbourg n’y avait mis une partie de ses vices et de ses manies hermétiques ? Va pour le libertinage et l’occultisme puisqu’ils nourrirent sa lecture des hommes et du monde en leurs secrètes correspondances. Mais notre cœur saigne à la vue des vastes compositions patriotiques, brossées de verve à la gloire des armées anglaises, que Loutherbourg exécuta en 1793-1795, au pire moment de notre histoire. On lui aurait pardonné facilement de ne pas partager les idées de la Révolution française, de ne pas adhérer à la Terreur, voire à la politique étrangère du Directoire. Après tout, il avait été l’un des plus jeunes membres de l’Académie royale de peinture sous Louis XV, et s’était installé à Londres dès 1771. Peindre hors de France et peindre contre, fût-ce pas mercantilisme, ce n’est pourtant pas la même chose. Si encore il s’agissait de mauvais tableaux !
L’exil volontaire de Loutherbourg, au départ, n’était qu’indirectement politique. Fils d’artiste, l’Alsacien n’a plus droit à l’erreur dès qu’il découvre Paris et ses ateliers. On lui a prêté plusieurs maîtres, Carle Van Loo compris. Il semble qu’il doive son métier, vite confondant, au peintre de batailles, un peu routinier, que fut Casanova, le frère cadet de l’écrivain libertin que l’on sait. Quel destin ! Très tôt, de plus, Loutherbourg est mêlé à différents procès, signe des intermittences de sa morale et des aléas de sa bourse. Il est vrai que la formation du jeune homme coïncide parfaitement avec la guerre de Sept ans et s’achève en 1763, l’année de la victoire des Anglais et de l’humiliation de la France, « qui endommagea sans recours le prestige de la monarchie » (Marc Fumaroli). C’est le moment que Loutherbourg choisit pour sortir de l’ombre. Il triomphe alors au Salon avec de grands paysages rustiques, où le minéral, le végétal et l’animal orchestrent une partition violemment néerlandaise. Diderot, toujours à l’affût, s’exclame : « Phénomène étrange ! Un jeune peintre de vingt-deux ans, qui se montre, et se place tout de suite sur la ligne de Berghem ! Ses animaux sont peints de la même force et de la même vérité. C’est la même entente et la même harmonie générale. Il est large, il est moelleux, que n’est-il pas ? » Il y a un public, jusque dans les hautes sphères de la capitale, pour ces pastiches vigoureux du « goût flamand », hollandais en réalité. La production soutenue dont le nouveau Berghem va inonder le Salon frappe par un sens plus moderne du spectaculaire, du saisissement visuel. On glissera sur son étrange union avec Barbe Burlat, une jeune et belle courtisane de bas étage, future mère de ses enfants et objet d’un procès retentissant dès que les manigances furent connues. Loutherbourg fait argent de tout. Dès 1765, il cherche à s’établir à l’étranger. Ce sera chose faite six ans plus tard, une fois la séparation du couple rendue légale. Londres et son marché de l’art florissant lui tendent les bras, le célèbre acteur David Garrick aussi. Loutherbourg n’est pas parti sur un coup de tête. Ses premiers décors de théâtre datent de 1772, de même que sa première participation à l’exposition annuelle de la Royal Academy. L’intégration au tissu britannique sera fulgurante. En témoignent, à l’instar du superbe portrait poudré que Gainsborough a laissé du new-commer (Dulwich Picture Gallery), son mariage avec Lucy Paget, les commandes très particulières de William Beckford pour Fonthill, ses succès institutionnels et surtout le renouveau profond de sa peinture.
 Paysages anglais et montagnes suisses font davantage vibrer la corde sensible, celle qu’on dit pittoresque, et les sentiments d’effusion, ceux qu’on dit déjà romantiques. Loutherbourg, dans le Londres de Füssli, rejoint parallèlement la peinture d’histoire la plus « horrific ». Au cocktail de ses tempêtes à succès, que Turner regardera, l’exilé ajoute les frissons noirs du biblique miltonien ou les charmes de l’épopée militaire contemporaine. Exalter les armes britanniques, chanter les victoires de Valenciennes et d’Ouessant, grandir les félonies de Nelson à Aboukir, imposait de changer d’échelle et de ton. Mais Loutherbourg n’avait pas besoin de se faire violence pour déverser sur la toile cette espèce de fantasmagorie, testée à la scène depuis 1772, qui devait aboutir plus tard aux panoramas et au Radeau de la Méduse. L’outrance théâtrale aura aussi un impact certain sur la palette de Loutherbourg. En 1767, un critique français avait écrit de L’Amant curieux, tableau hélas perdu : « Rouge. Séduit les yeux et sort de la nature. » La presse de Londres, déchirée par un tel volcanisme, prendra moins de gants. Anthony Pasquin, en 1809, ironise sur le manteau d’Arlequin dont se bariolent les toiles incendiées, si rouges, du Français. Ne sont-elles pas criardes, tape-à-l’œil et faite pour le public des spectacles à quatre sous ? On ne saurait se montrer plus ingrat envers un artiste qui avait bousculé les bonnes manières de la peinture insulaire et lui avait donné le symbole définitif de la révolution industrielle, la Vue de Coalbrookdale, de nuit (Londres, Science Museum, voir ill.). Sous un ciel sublime, embrasé de particules incandescentes, le peintre dresse en 1802 le monde réel, entre Enfer social et Paradis paradoxal, soleil sanglant et lune froide, passion et raison. Il ne faut pas trop noircir le sens de l’œuvre, que Loutherbourg signa sur un fût métallique au premier plan, en alchimiste accompli.
Paysages anglais et montagnes suisses font davantage vibrer la corde sensible, celle qu’on dit pittoresque, et les sentiments d’effusion, ceux qu’on dit déjà romantiques. Loutherbourg, dans le Londres de Füssli, rejoint parallèlement la peinture d’histoire la plus « horrific ». Au cocktail de ses tempêtes à succès, que Turner regardera, l’exilé ajoute les frissons noirs du biblique miltonien ou les charmes de l’épopée militaire contemporaine. Exalter les armes britanniques, chanter les victoires de Valenciennes et d’Ouessant, grandir les félonies de Nelson à Aboukir, imposait de changer d’échelle et de ton. Mais Loutherbourg n’avait pas besoin de se faire violence pour déverser sur la toile cette espèce de fantasmagorie, testée à la scène depuis 1772, qui devait aboutir plus tard aux panoramas et au Radeau de la Méduse. L’outrance théâtrale aura aussi un impact certain sur la palette de Loutherbourg. En 1767, un critique français avait écrit de L’Amant curieux, tableau hélas perdu : « Rouge. Séduit les yeux et sort de la nature. » La presse de Londres, déchirée par un tel volcanisme, prendra moins de gants. Anthony Pasquin, en 1809, ironise sur le manteau d’Arlequin dont se bariolent les toiles incendiées, si rouges, du Français. Ne sont-elles pas criardes, tape-à-l’œil et faite pour le public des spectacles à quatre sous ? On ne saurait se montrer plus ingrat envers un artiste qui avait bousculé les bonnes manières de la peinture insulaire et lui avait donné le symbole définitif de la révolution industrielle, la Vue de Coalbrookdale, de nuit (Londres, Science Museum, voir ill.). Sous un ciel sublime, embrasé de particules incandescentes, le peintre dresse en 1802 le monde réel, entre Enfer social et Paradis paradoxal, soleil sanglant et lune froide, passion et raison. Il ne faut pas trop noircir le sens de l’œuvre, que Loutherbourg signa sur un fût métallique au premier plan, en alchimiste accompli.
Stéphane Guégan
Olivier Lefeuvre, Philippe-Jacques de Loutherbourg (1740-1812), Arthena, 120€. L’ouvrage a servi de catalogue à l’exposition du musée des Beaux-Arts de Strasbourg, Loutherbourg. Tourments et chimères, 17 novembre 2012-18 février 2013. /// Cette « magnifique et savante publication », comme l’écrit David Bindman en préface au volume, devrait rendre à l’artiste la place qu’il occupa, et le rôle qu’il joua, dans la peinture européenne de la fin du XVIIIe siècle, moment de bascule dont il fut un acteur décisif. D’une plume limpide, élégante, l’auteur retrace le singulier destin de Loutherbourg, pasticheur de la pastorale hollandaise et émule des tempêtes de Vernet, devenu un artiste de premier plan après sa traversée précoce de la Manche. Olivier Lefeuvre apporte une somme d’informations et d’analyses impressionnante à notre connaissance de l’homme, de sa formation, de sa réception critique, de ses frasques savoureuses et de sa rapide maîtrise du contexte anglais. Peut-être n’eût-il pas été superflu de peindre davantage la formidable révolution esthétique dont Londres fut le théâtre en ces mêmes années. De même, nous semble-t-il, Olivier Lefeuvre aurait pu pousser plus loin l’examen de la postérité de Loutherbourg, peintre entrepreneur, dont les « effets » traversent le XIXe siècle. L’auteur enfin ne se montre-t-il pas trop sceptique à l’égard des historiens anglo-saxons et de leur propension à mêler la biographie de ce personnage haut en couleurs, dont il serait imprudent de nier les convictions religieuses et hermétiques, à la lecture de ses tableaux ? Pour le reste, et c’est l’essentiel, un livre admirable.
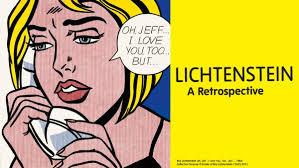
 C’est tout de même à Londres qu’on voit les meilleures expositions sur la peinture italienne. Les meilleures car les plus surprenantes, sujets et sélections. Avec Nicholas Penny à sa tête, la National Gallery sort régulièrement des sentiers battus pour redorer le blason des maîtres oubliés de la péninsule. Ce programme d’exhumations salutaire vient de profiter au merveilleux Federico Barocci (1535-1612), qu’on préfère d’ordinaire cantonner aux seconds rôles. Des peintres qui secouent ses catégories par leur style ou leurs dates, l’histoire de l’art se méfie. Baroche, au mieux, passe pour un peintre de transition, trait d’union incertain entre le maniérisme le plus raffiné et les débuts si intenses du baroque romain. Il serait né trop tard ou trop tôt. L’impression qu’inspire la présentation londonienne infirme ce jugement par défaut. Il faut plutôt jouir de cette peinture pour elle-même, son énergie effusive propre, sa sensualité entêtante et ses délicatesses inouïes, qui firent la gloire de l’artiste jusque dans la Prague de Rodolphe II. Autour de 1600, ses toiles se vendaient bien plus cher que celle du
C’est tout de même à Londres qu’on voit les meilleures expositions sur la peinture italienne. Les meilleures car les plus surprenantes, sujets et sélections. Avec Nicholas Penny à sa tête, la National Gallery sort régulièrement des sentiers battus pour redorer le blason des maîtres oubliés de la péninsule. Ce programme d’exhumations salutaire vient de profiter au merveilleux Federico Barocci (1535-1612), qu’on préfère d’ordinaire cantonner aux seconds rôles. Des peintres qui secouent ses catégories par leur style ou leurs dates, l’histoire de l’art se méfie. Baroche, au mieux, passe pour un peintre de transition, trait d’union incertain entre le maniérisme le plus raffiné et les débuts si intenses du baroque romain. Il serait né trop tard ou trop tôt. L’impression qu’inspire la présentation londonienne infirme ce jugement par défaut. Il faut plutôt jouir de cette peinture pour elle-même, son énergie effusive propre, sa sensualité entêtante et ses délicatesses inouïes, qui firent la gloire de l’artiste jusque dans la Prague de Rodolphe II. Autour de 1600, ses toiles se vendaient bien plus cher que celle du  S’il ne s’est pas arrêté devant les tendres peintures de la Chiesa Nuova et de Santa Sopra Minerva, deux des moments forts de l’exposition qui aurait charmé Stendhal, Astolphe de Custine a su émailler ses impressions de voyage d’aperçus sur la peinture italienne. On s’en convaincra notamment en relisant ses pages sur Rome. Comme les vrais nomades, ce romantique de la première heure (il a vingt ans sous
S’il ne s’est pas arrêté devant les tendres peintures de la Chiesa Nuova et de Santa Sopra Minerva, deux des moments forts de l’exposition qui aurait charmé Stendhal, Astolphe de Custine a su émailler ses impressions de voyage d’aperçus sur la peinture italienne. On s’en convaincra notamment en relisant ses pages sur Rome. Comme les vrais nomades, ce romantique de la première heure (il a vingt ans sous  Longtemps marginalisé par une histoire de l’art incapable de l’absorber, Philippe-Jacques de Loutherbourg (1740-1812) vient d’y reprendre place avec fracas. Si le mot convient à sa peinture, moins répétitive qu’on ne le dit, et surtout plus dérangeante qu’on ne croit, il s’applique aussi à la vie de ce mauvais Français. Que le jeune Loutherbourg ait épousé une prostituée, qu’il ait aimé « le plaisir, le faste et la parure », comme l’écrit
Longtemps marginalisé par une histoire de l’art incapable de l’absorber, Philippe-Jacques de Loutherbourg (1740-1812) vient d’y reprendre place avec fracas. Si le mot convient à sa peinture, moins répétitive qu’on ne le dit, et surtout plus dérangeante qu’on ne croit, il s’applique aussi à la vie de ce mauvais Français. Que le jeune Loutherbourg ait épousé une prostituée, qu’il ait aimé « le plaisir, le faste et la parure », comme l’écrit  Paysages anglais et montagnes suisses font davantage vibrer la corde sensible, celle qu’on dit pittoresque, et les sentiments d’effusion, ceux qu’on dit déjà romantiques. Loutherbourg, dans le Londres de Füssli, rejoint parallèlement la peinture d’histoire la plus « horrific ». Au cocktail de ses tempêtes à succès, que Turner regardera, l’exilé ajoute les frissons noirs du biblique miltonien ou les charmes de l’épopée militaire contemporaine. Exalter les armes britanniques, chanter les victoires de Valenciennes et d’Ouessant, grandir les félonies de Nelson à Aboukir, imposait de changer d’échelle et de ton. Mais Loutherbourg n’avait pas besoin de se faire violence pour déverser sur la toile cette espèce de fantasmagorie, testée à la scène depuis 1772, qui devait aboutir plus tard aux panoramas et au
Paysages anglais et montagnes suisses font davantage vibrer la corde sensible, celle qu’on dit pittoresque, et les sentiments d’effusion, ceux qu’on dit déjà romantiques. Loutherbourg, dans le Londres de Füssli, rejoint parallèlement la peinture d’histoire la plus « horrific ». Au cocktail de ses tempêtes à succès, que Turner regardera, l’exilé ajoute les frissons noirs du biblique miltonien ou les charmes de l’épopée militaire contemporaine. Exalter les armes britanniques, chanter les victoires de Valenciennes et d’Ouessant, grandir les félonies de Nelson à Aboukir, imposait de changer d’échelle et de ton. Mais Loutherbourg n’avait pas besoin de se faire violence pour déverser sur la toile cette espèce de fantasmagorie, testée à la scène depuis 1772, qui devait aboutir plus tard aux panoramas et au  Il y eut bien un autre Jean Clair que le Jean Clair que nous connaissons et qu’il est d’usage, aujourd’hui, de peindre en réac incurable. La polémique qu’il attise à toute occasion s’est vengée de ses coups de gueule en l’iconisant. Une fois pour toutes,
Il y eut bien un autre Jean Clair que le Jean Clair que nous connaissons et qu’il est d’usage, aujourd’hui, de peindre en réac incurable. La polémique qu’il attise à toute occasion s’est vengée de ses coups de gueule en l’iconisant. Une fois pour toutes,  *André Malraux, Lettres choisies 1920-1976, édition établie et annotée par François de Saint-Chéron, préface de
*André Malraux, Lettres choisies 1920-1976, édition établie et annotée par François de Saint-Chéron, préface de  Le génial Klimt avait de l’or dans les mains. Non qu’il fût riche, même au soir d’un parcours plutôt brillant, partagé entre commandes publiques et mécénat privé. L’imprévoyance, il est vrai, semble avoir été la vertu première du peintre, qui croqua la vie comme il aima les femmes, sans jamais compter. À partir de 1899, les enfants pleuvent, fruits des étreintes qu’abrite son atelier trompeusement sévère. Les modèles ont toujours eu de l’électricité pour deux. Elles furent, ces souveraines de l’ombre, le trait d’union entre l’art de Klimt et sa vie, les garantes d’une sève qui épargna au peintre les névroses du symbolisme chronophage. On raconte même que ses maîtresses et compagnes plus légitimes assistèrent en grand nombre à sa mise en terre. Stupeur de l’assistance et sourire de Dieu. Le faune rendait les armes à moins de 56 ans. Il n’y eut alors aucun Vasari moderne pour écrire que l’amour du beau sexe avait précipité sa chute. Tant mieux. Klimt s’endormit donc en paix tandis que la
Le génial Klimt avait de l’or dans les mains. Non qu’il fût riche, même au soir d’un parcours plutôt brillant, partagé entre commandes publiques et mécénat privé. L’imprévoyance, il est vrai, semble avoir été la vertu première du peintre, qui croqua la vie comme il aima les femmes, sans jamais compter. À partir de 1899, les enfants pleuvent, fruits des étreintes qu’abrite son atelier trompeusement sévère. Les modèles ont toujours eu de l’électricité pour deux. Elles furent, ces souveraines de l’ombre, le trait d’union entre l’art de Klimt et sa vie, les garantes d’une sève qui épargna au peintre les névroses du symbolisme chronophage. On raconte même que ses maîtresses et compagnes plus légitimes assistèrent en grand nombre à sa mise en terre. Stupeur de l’assistance et sourire de Dieu. Le faune rendait les armes à moins de 56 ans. Il n’y eut alors aucun Vasari moderne pour écrire que l’amour du beau sexe avait précipité sa chute. Tant mieux. Klimt s’endormit donc en paix tandis que la  Le livre que Wagner consacra à Beethoven fin 1870, à l’occasion du centenaire de la naissance du musicien et au moment où s’effondre le
Le livre que Wagner consacra à Beethoven fin 1870, à l’occasion du centenaire de la naissance du musicien et au moment où s’effondre le 
 On n’a rien vu quand on n’a pas vu se dresser le palais du Te dans la campagne de Mantoue ! Une amusante assonance pourrait laisser croire que la bâtisse est née de quelque folie exotique des années 1520-1530. L’usage veut qu’on parle de premier maniérisme, le plus virulent. Celui qui surgit après la mort de
On n’a rien vu quand on n’a pas vu se dresser le palais du Te dans la campagne de Mantoue ! Une amusante assonance pourrait laisser croire que la bâtisse est née de quelque folie exotique des années 1520-1530. L’usage veut qu’on parle de premier maniérisme, le plus virulent. Celui qui surgit après la mort de  *Ugo Bazzotti, Le Palais du Te. Mantoue, Seuil, 60€. Signalons aussi une première traduction en français de l’ouvrage classique de Julius von Schlosser, indispensable à qui veut comprendre le cadre mental et l’imaginaire dans lesquels s’inscrit le dernier maniérisme. Les éditions Macula publient en effet Les Cabinets d’art et de merveilles de la Renaissance tardive avec une préface et une postface de Patricia Falguières (372p., 31€). Paru voilà un siècle, l’ouvrage surgit en plein « tournant muséal », ultime réaction à l’apparent caprice qui gouvernait le collectionnisme des XVIe et XVIIe siècles. Mais ce dandy savant de Schlosser s’efforce de redonner sens à ce qui passait pour l’héritage encombrant d’une épistémè désuète. Vers 1600, de Fontainebleau à Prague, de Rome à Haarlem, le goût du merveilleux, de l’extravagance raffinée, de la licence poétique et érotique s’était répandu à grande vitesse et à plus grande échelle qu’on ne le pense. En bon Viennois, Schlosser rend compte d’un moment de civilisation, de ses capacités à affronter ses désirs et ses terreurs par l’insolite.
*Ugo Bazzotti, Le Palais du Te. Mantoue, Seuil, 60€. Signalons aussi une première traduction en français de l’ouvrage classique de Julius von Schlosser, indispensable à qui veut comprendre le cadre mental et l’imaginaire dans lesquels s’inscrit le dernier maniérisme. Les éditions Macula publient en effet Les Cabinets d’art et de merveilles de la Renaissance tardive avec une préface et une postface de Patricia Falguières (372p., 31€). Paru voilà un siècle, l’ouvrage surgit en plein « tournant muséal », ultime réaction à l’apparent caprice qui gouvernait le collectionnisme des XVIe et XVIIe siècles. Mais ce dandy savant de Schlosser s’efforce de redonner sens à ce qui passait pour l’héritage encombrant d’une épistémè désuète. Vers 1600, de Fontainebleau à Prague, de Rome à Haarlem, le goût du merveilleux, de l’extravagance raffinée, de la licence poétique et érotique s’était répandu à grande vitesse et à plus grande échelle qu’on ne le pense. En bon Viennois, Schlosser rend compte d’un moment de civilisation, de ses capacités à affronter ses désirs et ses terreurs par l’insolite.
 À la faveur de l’année France/Russie 2012 et de l’« ouverture » des archives russes, Intelligentsia s’intéresse à l’irrésistible attraction qu’exerça l’U.R.S.S. sur les intellectuels français, entre la Révolution de 17 et la reconnaissance que certains dissidents soviétiques trouvèrent chez nous à la fin des années 70. C’est donc l’histoire d’une illusion qui aura duré plus d’un demi-siècle, une illusion qu’écrivains et journalistes ont sciemment entretenue en poussant jusqu’à l’absurde la rhétorique révolutionnaire, antifasciste et humanitaire des grandes heures du stalinisme. Un soutien « sans défaillance », pour citer la belle préface d’Hélène Carrère d’Encausse au catalogue très fouillé de l’exposition. En 1955, détournant Marx, Raymond Aron ne trouva rien mieux que l’opium pour caractériser le phénomène d’envoûtement qui en cessa de s’amplifier après la chute brutale des tsars. Mais est-ce bien de drogue qu’il faut parler, de cécité subie et presque d’erreur pardonnable ? Le parcours d’un
À la faveur de l’année France/Russie 2012 et de l’« ouverture » des archives russes, Intelligentsia s’intéresse à l’irrésistible attraction qu’exerça l’U.R.S.S. sur les intellectuels français, entre la Révolution de 17 et la reconnaissance que certains dissidents soviétiques trouvèrent chez nous à la fin des années 70. C’est donc l’histoire d’une illusion qui aura duré plus d’un demi-siècle, une illusion qu’écrivains et journalistes ont sciemment entretenue en poussant jusqu’à l’absurde la rhétorique révolutionnaire, antifasciste et humanitaire des grandes heures du stalinisme. Un soutien « sans défaillance », pour citer la belle préface d’Hélène Carrère d’Encausse au catalogue très fouillé de l’exposition. En 1955, détournant Marx, Raymond Aron ne trouva rien mieux que l’opium pour caractériser le phénomène d’envoûtement qui en cessa de s’amplifier après la chute brutale des tsars. Mais est-ce bien de drogue qu’il faut parler, de cécité subie et presque d’erreur pardonnable ? Le parcours d’un  On ignore, le plus souvent, que la première explosive d’Hernani en février 1830 fut autant l’affaire des poètes chevelus que celle des architectes, théoriquement plus sages. Ils oublièrent ce soir-là compas et équerre, coupole et pilastre, et s’étourdirent comme Gautier, Nerval et
On ignore, le plus souvent, que la première explosive d’Hernani en février 1830 fut autant l’affaire des poètes chevelus que celle des architectes, théoriquement plus sages. Ils oublièrent ce soir-là compas et équerre, coupole et pilastre, et s’étourdirent comme Gautier, Nerval et