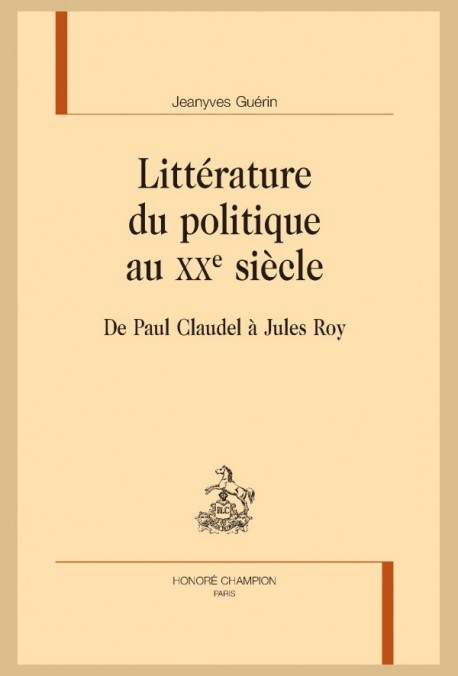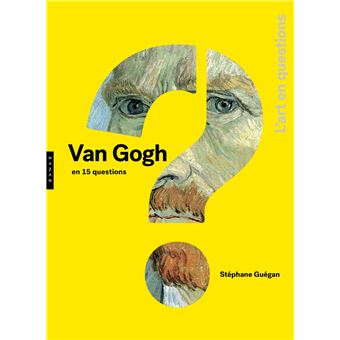Il est un mot que Baudelaire et Gautier se disputaient. Et ce mot, synonyme de malédiction, mais aussi étymologiquement de haine, c’était l’ennui, que le poète des Fleurs du mal renvoyait à sa racine latine et orthographiait avec une majuscule. Gautier, à qui il dédie lesdites Fleurs en 1857, et sur lequel il publiera une plaquette bientôt envoyée à Manet, aura essuyé toutes les formes de l’ennui, notamment au théâtre. L’ennui, rappelle-t-il ici et là, c’est « ce qu’on doit éviter en art ». Gautier suit si bien son propre conseil que sa critique théâtrale, souvent privée de biscuit, se divertit d’être condamnée aux fausses valeurs de la rampe. Certes, à vivre parmi nous, il aurait davantage souffert à exercer son métier de chroniqueur, forcé qu’il serait d’avaler, dans la même pilule, la médiocrité des scènes, le français bâclé et les pleurnicheries, ou les vitupérations, de rigueur. On pouvait encore, sous Napoléon III, dire ce qu’on avait sur le cœur et s’amuser des libertés du théâtre puisque le rire ou l’ironie, disait Baudelaire, n’est diabolique que lorsqu’il animalise sa victime, l’arrache à la communauté des âmes et absout le rieur de ses péchés. Le droit au blasphème, Gautier et Baudelaire eussent été contre… Entre avril 1857 et juin 1859, période que couvre le tome XIV de sa critique théâtrale impeccablement éditée par Patrick Berthier, les deux poètes se retrouvent aussi en Edgar Poe, dont les Nouvelles histoires extraordinaires paraissent alors avec grand succès. Autant que les Fleurs, où respire l’esprit de 1830 comme réinventé et chauffé à blanc, la traduction de « notre ami Charles Baudelaire » se promène dans les présents articles de Gautier. Leur morale ? Il suffit d’un peu d’imagination pour enrichir le réel du fantasque ou du fantastique qu’il suggère et contient. Et voilà que Le Diable dans le beffroi, Conversation d’Eiros avec Charmion s’imposent à l’avaleur de spectacle sur sa faim. Il est assez drôle que Le Retour du mari de Mario Uchard, en mars 1858, l’encourage à s’interroger sur la lucidité de Poe en matière de mal ordinaire : « En effet, il n’y a pas de raison à l’inexplicable, et le caprice n’a pas de lois. A moins qu’on n’admette cette perversité dont parle Edgar Poe, qui fait une chose parce qu’elle ne le devrait pas, espèce de rébellion intérieure par laquelle l’homme se prouve son indépendance. » Plus loin, voguant sur Les Mers polaires de Charles Edmond, grand spectacle en cinq actes et six tableaux du Cirque-Impérial, Gautier salue le cosmopolitisme de l’époque dont il est l’un des dévots. Le Gordon Pym, que Baudelaire a fait paraître dans le Moniteur en février-avril 1857, lui traverse la mémoire face au pôle de carton, notamment l’ultime dérive du canot des héros de Poe, défendu par on ne sait quel « inconnu formidable ».

L’art, et notamment l’essence du théâtre, ne saurait se plier complètement aux attentes du clan réaliste : le réalisme doit rester un moyen de rajeunissement, non une fin dogmatique, il ne doit pas sacrifier l’expression à l’impression, oublier qu’il est affaire de transposition subjective et de refus du banal. Gautier le répète à loisir et le confirme dans le grand essai qu’il publie alors sur Balzac, irréductible, dit-il, à Champfleury et ses amis. Au théâtre, il ne plébiscite pas davantage ce que Berthier nomme le réalisme bourgeois, Dumas fils et Augier, il leur préfère le trop oublié Léon Gozlan, qui avait été l’un des secrétaires, un peu nègre, de Balzac en son jeune temps. Mais les nouveautés de cet ordre restent rares. Gautier ne se gêne pas pour reprocher à la Comédie française de s’abonner aux reprises malheureuses (son horreur de Casimir Delavigne n’a pas faibli) ou attendues. Certes, Molière et Racine valent mieux que leurs supposés héritiers, surtout qu’au respect du texte s’ajoute enfin le respect de la structure narrative et scénique initiale : le concours de la danse et de la musique dans la comédie-ballet Le Bourgeois gentilhomme, les chœurs dans Athalie. Les classiques, à rebours de ce que croit notre époque, n’ont pas à être « adaptés » au goût du jour : « Que dirait-on si, dans quelque musée, on couvrait une ou plusieurs figures d’un tableau de Raphaël comme nuisant à la composition ou n’étant plus à la mode du jour. » Gautier ne savait pas si bien dire. Et que penserait-il des crimes qu’on brandit à la face de nos modernes metteurs en scène, de l’appropriation culturelle ou soupçon de racisme ? En 1857-1858, la négritude d’Othello ne lui semble pas ainsi un vain combat, c’est qu’il connaît Shakespeare par cœur et sait que la clef du drame réside dans l’amour d’une jolie blanche pour le Maure, amour que la Venise patricienne ne saurait tolérer. « Mais quand verrons-nous le noir Africain étouffer la blanche Desdemona ? » Blanchir Othello ou ne pas recourir à un acteur noir, comme il s’en trouvait déjà sur les scènes anglaises et américaines, c’était trahir le dramaturge élisabéthain que Gautier met au-dessus de tous, et tromper le public. Préserver la vérité de l’un et les intérêts de l’autre, il n’en démord pas. Pour rester avec Othello, son affadissement usuel lui semble intolérable. Et Gautier de rappeler, en ce domaine, l’apport d’un Vigny au regard de Ducis et ses prudences de gazelle. Dumas père a aussi arraché Hamlet aux usages corrupteurs du XVIIIe siècle. Et quand un acteur hors norme s’en mêle, la performance dépasse les attentes les plus folles, celles que la peinture radicale faisait encore germer dans l’esprit de Gautier : « Figurez-vous que dans une soirée Rouvière peint sur son corps trente ou quarante tableaux de Delacroix, aussi beaux, aussi fiers, aussi romantiques que s’ils étaient signés par l’illustre maître. »

A l’aube des années 1860 qui afficheront une sorte de renaissance romantique, Gautier n’a pas de mots assez allègres pour chanter chaque retour des premiers drames de l’auteur d’Antony. Juin 1857 : « La jeune génération ne connaît pas ce drame si hardi, si neuf, si simple et si vrai dans son exagération passionnée, qui transporta le chaleureux public de 1830 et valut à l’auteur d’ardentes ovations. » Mais il lui arrive aussi d’égratigner le premier romantisme. Berthier juge « émue » sa recension du Chatterton de Vigny ; elle l’est, mais les réserves balancent l’enthousiasme général. Elles visent à congédier définitivement les mythes de sa jeunesse chevelue, l’artiste maudit, élu de la Muse et vivant dans l’Olympe de sa pensée, fatalement pauvre et incompris, doublement étranger au monde donc. Cette histoire de suicide trop sentimentale se noie dans ses propres larmes. Gautier et sa bourse vide en profitent pour ironiser à propos du « noble auteur que sa position personnelle mettait à l’abri de semblables infortunes ». Loin d’être un don du ciel, la poésie est affaire de « rêverie, de temps et de hasard » ; quant au mal dont souffre le poète, il n’est pas uniquement d’origine sociale. En fait de vrai romantisme, coloré et exotique, Gautier ne dédaigne ses propres exploits chorégraphiques. Sur la scène mythique du théâtre de la Porte-Saint-Martin, la première de Yanko le bandit a lieu le 25 avril 1858. Située en Hongrie, l’intrigue vaguement policière fait la part belle à l’inévitable brigand, intrépide et aimé de deux bohémiennes au sang chaud. Il s’agissait autant d’importer une réalité autochtone en ethnologue que d’évoquer un monde positivement sauvage, qui rappelait Nodier et l’Esmeralda de l’exilé Hugo. Avec Sacountalâ, changement de décor et d’ambition. Le wagnérien Ernest Reyer et Gautier s’attaquaient à la scène de l’Opéra en adaptant une pièce indienne du poète Kâlidâsa. Le roi Douchmanta brûle pour la jeune et belle Sacountalâ. Amours compliquées, ermite castrateur (comme dans Atala), perte de la raison, contrée mystérieuse et nostalgie des bayadères… Le succès vint aussi des décors luxuriants, et surtout de la musique. Contrairement aux ballets antérieurs de Gautier, Yanko et Sacountalâ ne donnaient aucune prise au merveilleux. Seule la distance géographique creusait le monde ordinaire d’une dimension lyrique et poétique, extérieure au prosaïsme, que ni lui, ni Baudelaire, n’était disposé à laisser mourir.
Stéphane Guégan

Théophile Gautier, Critique théâtrale, tome XIV, avril 1857 – juin 1859, texte établi, annoté et présenté par Patrick Berthier, Honoré Champion, 2020, 90€. A lire également Théophile Gautier halluciné. Le Club des haschichins ou comment écrire sous l’emprise du cannabis, Collection Revue des deux mondes, 7€.
Parue dans la Revue des deux mondes en février 1846, la nouvelle géniale de Gautier, très ironique quant aux pouvoirs créateurs de la drogue, offre à Lucien d’Avray, auteur de l’avant-propos, l’occasion d’un développement passionnant sur l’usage et la nuisance des narcotiques au temps du romantisme. Mais il vaut jusqu’à nous.

L’exposition de la semaine / Pour être « extrêmement singulier », comme le XVIIe siècle le disait déjà de lui, Albrecht Altdorfer (vers 1480-1538) le fut au dernier degré. Aucune exposition, en France, avant celle du Louvre, – et malgré les conséquences de la Covid-19 sur les prêts –, n’avait cherché à le vérifier par la peinture, le dessin et l’estampe. Il n’était peut-être pas exceptionnel de briller en tout dans l’Europe des années 1500-1540. Mais l’idéal de l’artiste encyclopédique, et capable même de concevoir au-delà de la seule peinture, s’est merveilleusement réalisé en Altdorfer, maître et édile de Ratisbonne, au service des plus grands comme du petit peuple que ses xylographies volontiers naïves ravissaient, rival plus que suiveur de Dürer. Tenant tête commercialement à Nuremberg et Munich, grand pôle de la Bavière aux portes de la Bohème, la cité d’Altdorfer attendait de ses artistes une grande flexibilité d’inspiration et de diffusion. Et, habilement, le Louvre ne dissocie jamais création et réception. Voire migration : Mantegna et Raimondi, le graveur de Raphaël, étaient bien connus du peintre danubien, qui les cite ici et là… Les romantiques allemands, sous l’effet de l’oubli qui a vite recouvert la carrière d’Altdorfer prisèrent surtout le mystère des forêts épaisses, le charme puissant de la nature, qu’il acclimata aux sujets les plus variés et amplifia plus qu’aucun autre. En trois siècles d’amnésie, Altdorfer était devenu un homme des bois, l’antithèse rustaude et bonhomme de Dürer, au point que le IIIe Reich s’empara d’Albrecht et le fit revivre dans un roman imprégné d’idéologie Blut und Boden (sang et sol). L’instrumentalisation est certaine, quoique Altdorfer fût un fier représentant de la maniera tedesca et s’associât à l’expulsion de la très importante communauté juive de Ratisbonne, en 1519, peu de temps après la mort de l’empereur Maximilien Ier, l’un de ses patrons. On doit à ce sinistre épisode deux des estampes les plus émouvantes du parcours. Si nous ignorions qu’elles représentent la synagogue de la ville, quelques heures avant sa destruction, nous pourrions en vanter, le coeur léger, la remarquable perpective oblique et sa scrupuleuse attention au culte désormais interdit, comme aux deux personnages qui significativement s’effacent. Ces images nourrissent une section audacieuse, dédiée à l’église de la Schöne Maria de Ratisbonne et à la dévotion qu’elle suscita sur le lieu même qui symbolisait l’anti-judaïsme catholique d’une part de ses habitants. Les visiteurs pressés, il en est, ne retiendront peut-être que la composante religieuse et le prosélytisme d’un artiste qui y aura adapté son style singulier, fait de ruptures, disproportions, fulgurances et stridences, une esthétique que Friedrich Schlegel apparentait positivement à la dislocation générique des modernes. Les catégories de la peinture, en effet, risquent ici toutes sortes de fusions. Mais on ignore trop que le serviteur du Christ, le lecteur des deux Jean, l’illustrateur poignant de la Passion, satisfit d’autres demandes, moins ou autrement vertueuses. Le surprenant Altdorfer, en vérité, fut l’un des premiers, en Allemagne, à peindre la fable antique et son Eros propre, à pointer l’ambivalence gloutonne du lansquenet paillard et dévoreur, à s’attarder sur les amours champêtres des jeunes gens. En loyal sujet, il décora de nus impudiques, voire d’attouchements et de voyeurisme, la salle des bains du palais épiscopal de Ratisbonne dont un dessin des Offices permet de comprendre l’organisation ; quant aux fragments de fresque qui ont survécu, ils sont pleins de la sève sensuelle d’une Renaissance méridionale. Si étrange que fût Altdorfer, l’époque le lui rendait bien, et l’exposition les emboîte parfaitement. SG
*Albrecht Altdorfer. Maître de la Renaissance allemande, musée du Louvre, exposition (jusqu’au 4 janvier 2021) et catalogue indispensable (Louvre éditions /LIENART, 39€) sous la direction d’Hélène Grollemund, Séverine Lepape et Olivier Savatier Sjöholm.