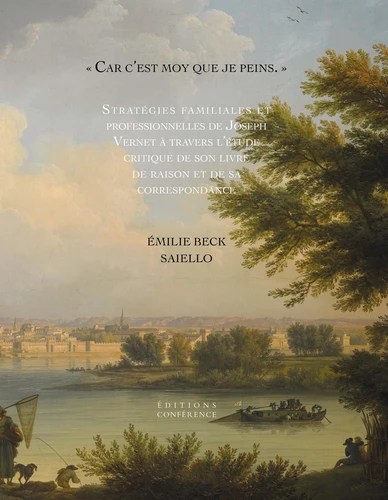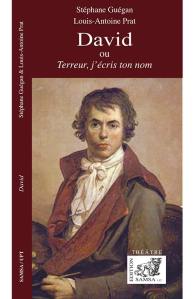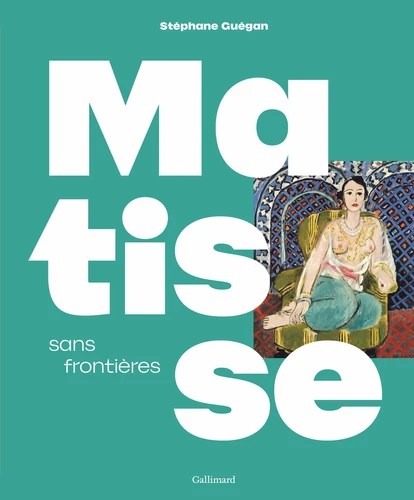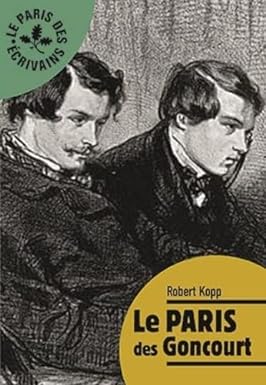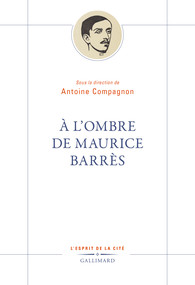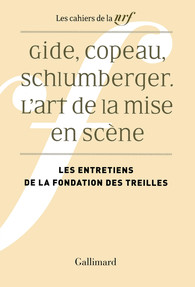« Pauvres belles comédiennes, pauvres reines sublimes ! – l’oubli les enveloppe tout entières, et le rideau de la dernière représentation, en tombant, les fait disparaître pour toujours », se lamente Théophile Gautier en janvier 1858. Rachel, qui fut la Sarah Bernhardt du renouveau tragique des années 1840, s’en est allée avant de vieillir, et avant de connaître les moyens de laisser d’elle plus que de faibles images de sa personne. Ses portraits peints, même saisis en action, ne sauraient remplacer l’éclat de la phonographie dont le critique appelle l’invention ; elle serait au son ce que la photographie est à l’apparence. Or les reines et les rois de la scène – et Gautier pense autant à Talma qu’il a vu jouer enfant qu’à Frédérick Lemaître et Marie Dorval, impriment en scène tout de leur génie, voix, poses, manières de marcher, de prendre la lumière, d’entrer et de sortir. Les corps parlent et la parole est geste. Comment se résigner à laisser disparaître ce qui a rendu uniques ces hommes et ces femmes en qui s’est traduit, et presque déposé, un moment de la sensibilité moderne? On ne lit jamais Gautier sans penser à Baudelaire et à leur attente commune d’un art du temps présent qui ne fût pas banal réalisme. Les chroniques théâtrales du premier, désormais entièrement et parfaitement éditées par Patrick Berthier, ont gagné à leur réunion. Il ne sera plus possible de parler de feuilletons superficiels ou trop bienveillants envers le tombereau de médiocrités que chaque jour ramenait sur les planches. Gautier n’a jamais craint de trier et étriller en presque quarante ans, ou, à l’inverse, de défendre les vrais successeurs de Corneille, Racine et Molière. La gloire de Rachel, précisément, fut d’avoir revigoré les formes usées de la tragédie, d’avoir redonné aux classiques l’accent et le frisson que deux siècles de routine leur avait fait perdre. Molière, dénaturé lui, exigeait, à l’inverse, qu’on le jouât dans le respect de l’esprit et de la composition de ses pièces, souvent mêlées d’interludes, musicaux ou pas. L’index général des feuilletons dramatiques de Gautier, dernière pierre posée à l’édifice des éditions Honoré Champion, confirme les préférences de l’écrivain et la capacité qu’il eut à détourner cette corvée hebdomadaire, ce « calice d’amertume », au profit de la création contemporaine et du bonheur de le lire ou de rire avec lui. Personne n’a parlé de Dumas, Hugo, Musset, trois de ses as, avec plus de soin et d’esprit ; personne n’a su mieux résumer une intrigue sans la dévoiler, les meilleures comme les pires ; personne enfin n’est resté fidèle à ce qu’il mit peut-être au-dessus de tout, Shakespeare et Balzac, Balzac et son théâtre, souvent empêché, de la cruauté truculente. Le romantisme de la vie réelle, marotte de Théophile, y avait trouvé son élixir.

Remy de Gourmont voyait juste quand il qualifia de « baudelairien » le catholicisme exacerbé, ultramontain et imprécateur de Barbey d’Aurevilly. Jeune, le Normand éruptif avait adulé Joseph de Maistre, Chateaubriand et Balzac ; il les sentit rejaillir, le génie de la poésie en sus, chez l’auteur des Fleurs du Mal, son plus grand choc sous le Second Empire, au procès duquel il s’est mêlé. A son tour, en 1865, rééditant sa Vieille maîtresse, son chef-d’œuvre avec Les Diaboliques, il juge et condamne le bégueulisme de l’époque, chrétiens compris, en leur opposant son éthique de la vérité et la conviction que le vice, crûment dit ou peint, porte en lui sa réfutation quand il n’est pas l’autre nom de la passion. A maints égards, ne serait-ce que l’adoubement et les conseils qu’il en reçut, Léon Bloy, converti de 1864, pouvait se considérer comme l’héritier direct du connétable des lettres et de son « sacerdoce de l’épée ». Fanny Arama n’est peut-être pas la première à les étudier ensemble, l’un dans la lumière de l’autre (on pense aux Antimodernes d’Antoine Compagnon), mais le livre très ambitieux que nos terribles bretteurs lui ont inspiré élargit son spectre à l’ensemble du XIXe siècle, et ses nouveaux usages médiatiques. La presse, hors de laquelle il est difficile d’exister littérairement après 1830, répond à leur double visée, l’affirmation d’une doctrine menacée par la modernité devenue incontrôlable, et la singularité d’un style attaqué par ceux-là mêmes qui auraient dû la soutenir, les plumes proches du clergé. Huysmans connaîtra le même sort. Ennemis du réalisme et du matérialisme absolu, Barbey et Bloy luttèrent en permanence sur deux fronts, et à « tapagèrent » (verbatim) contre ce Janus de siècle, puritain et impie. De cette violence verbale qui refuse toute limite, et subit la censure, résultait-il un possible danger, celui de perdre des lecteurs, scandalisés par le ton des vitupérateurs ou inaptes à les comprendre, c’est la question que pose aussi Fanny Arama. Baudelaire se frottait les mains à la perspective des profits de toute nature que le scandale des Fleurs ferait rejaillir sur elles. Barbey et Bloy, sérieux catholiques romains, ont suivi sa ligne de feu, aux confins d’une outrance qui, note l’auteur, inaugure les nécrologies inversées du surréalisme. D’un cadavre l’autre, en somme, sauf que les serviteurs du Christ condamnaient l’incroyance et l’inconduite de leurs contemporains au nom d’une morale plus élevée que le jeu littéraire. Il y a prophètes et prophètes.

Terroristes sans transcendance, les surréalistes ont beaucoup tiré à blanc. Leur cause, assez banale après un siècle de liberté artistique, postulait à grands cris un ultime affranchissement. Les chaînes de l’esclavage – entendez l’oppression du peuple, avaient été dénoncées par Marat ; André Breton et son gang, au départ, s’en prirent à la tyrannie de la raison. Cette quête illusoire de l’irrationnel, à moins de se couper la tête, possédait d’enivrants parfums, hérités et détournés à la fois du symbolisme et du romantisme (plutôt allemand et anglais, en l’occurrence). Quand Breton lit Au château d’Argol en mai 1939, il replonge dans les délices d’Ann Radcliffe et couvre de miel son auteur, Julien Gracq, débutant de 29 ans, auquel il adresse une de ces lettres désarmantes, mélange de naïve fatuité et d’effusion sororale, qui font le prix de l’épistolier habité, même pour ceux qui ne partagent pas sa religion des « grands secrets », plus alchimique qu’évangélique. Leur correspondance, impeccablement éditée par Bernard Vouilloux, comprend une centaine de lettres, cartes postales et télégrammes, et témoignent de rapports vite fraternels et d’une certaine fidélité, puisque seule la mort du patron (1966) les interrompra. Il y eut tout de même le silence des années de guerre, dû à l’exil volontaire de Breton aux Etats-Unis, exil dont il comprit en 1945 qu’il ne passerait pas facilement pour un acte de résistance (ce qu’il n’était pas). Le transfuge, de plus, prendra son temps pour « rentrer » (mai 1946 !) et aura toutes les peines du monde à rétablir sa place et sa légitimité au sein d’une République des lettres sartrisée. A peine revenu, il est saisi du projet des éditions du Sagittaire, qui tente de lancer avec l’aide de Gaëtan Picon une collection au nom ronflant, Les Héros de notre temps. A côté de Malraux et Bernanos, Breton est pressenti. On confierait à Gracq le volume, sous réserve que Breton le permît. Sa réponse feint d’être embarrassée, mais la vanité l’emporte sur les réticences que suscitent le titre de la série, son emphase comme son décalage au regard du long séjour américain. Au cours des 20 années qui suivent, les deux amis continuent à s’écrire sur un rythme espacé, se voient ou s’envoient leurs livres, dont Vouilloux relève les chaudes dédicaces. Rétif aux logiques d’appareil plus qu’aux prestiges de la littérature, étanche au néo-trotskysme de salon ou à l’antigaullisme furieux, assez peu surréaliste au fond, Gracq aura rendu possible un autre type d’échanges, ouverts, par exemple, aux écrivains qu’on associe peu aux lectures de Breton, de Châteaubriant à Chateaubriand, ou de Baudelaire à Barrès.

L’exergue pourrait dériver de Chrétien de Troyes, saint patron des romanciers français, il est emprunté à un Breton, André de son prénom et troubadour à ses heures : « Ce que j’ai aimé un jour, que je l’aie gardé ou non, je l’aimerai toujours. » Dominique Bona hisse les couleurs, Le Roi Arthur ressuscite un père auquel elle voue une affection inextinguible, et nous apprend combien cet homme d’Occitanie, à la riche carrière, politique et littéraire, fut pétri de légendes armoricaines par-delà sa fierté catalane. La force des souvenirs se transforme parfois en devoirs. L’heure était donc venue, Dominique Bona le sait, quitte à taquiner feu Maurice Druon, cramponné à son adage : « Je ne succède pas. » La fille du roi ne tient pas seulement à Arthur Conte, elle tient de lui, et d’abord sa propre passion arthurienne, formidable rêvoir au temps de son enfance, Graal universitaire, puis leçon de vie et d’écriture : le réel contient son dépassement, les mots l’ouvrent à nos passions, agissent sur nos convictions. Conte en avait, et bien ancrées. Ses racines, jamais répudiées, jusqu’à rouler les consonnes en plein Paris pompidolien, se situent au cœur des Pyrénées orientales. Fils d’un père vigneron, doublement du cru en somme, il doit à ses dons et facultés de ne pas avoir suivi un destin décidé par d’autres. Etudes brillantes, engagement politique aux côtés de la SFIO, drôle de guerre, STO, élection à la mairie de Salses-le-Château, tout se précipite entre 1920 et 1947. Puis ce sera la députation, encouragée par Léon Blum, une brève expérience de ministre en 1957 et la direction, 16 mois, de l’ORTF, l’amertume enfin d’être sacrifié aux bassesses de Palais. Les rois aussi en meurent. Mais l’injuste décision, fin 1973, si elle l’atteint, n’entame pas sa capacité de travail. Il avait été un journaliste prolixe, à verve, il poursuit son œuvre de romancier et d’historien, autant de facettes que Dominique Bona polit avec l’émotion et la justesse qu’elle met à arpenter l’autre versant de ses origines, aussi ensoleillé, mais moins corseté. C’est le côté des femmes, ses grands-mères, sa mère, qui trouvent chez elles, dans les livres qu’on cache (Colette) et la proximité des plus jeunes une énergie et des satisfactions dont l’auteur rend admirablement la tendre complicité. Raconter les siens de cette façon, fine, précise et probe, c’est fatalement se raconter et, par exemple, feuilleter avec nous le catalogue des lectures formatrices, d’âge en âge. Dominique Bona retrouve le plaisir qu’elle eut à lire Enid Blyton, récente victime des « éveillés », le Stendhal de La Chartreuse, George Sand, sœur de cœur, et d’autres chers disparus, notamment Michel Mohrt, natif de Morlaix et amoureux de Manet comme de Berthe Morisot. Dans La Maison du père, ce dernier écrivait qu’on ne connaît pas ses parents. Dominique Bona n’a rien oublié des siens. De père en fille, et du Canigou à Brocéliande, la transmission a opéré.

« Vingt ans en 45 » quant à lui, Nimier fut pire qu’un « hussard triste », il fut un hussard humilié. Il y avait eu la génération perdue, Drieu, Berl, Bernier ou Paulhan, que la guerre de 14 avait privée de sa jeunesse ; il y eut la génération volée, pour qui la guerre, la suivante, eut le goût amer d’un rendez-vous manqué. Parce que la facétie et le coq-à-l’âne lui servaient d’armure, Nimier n’a pas toujours été pris au sérieux. Or sa vie, et donc ses romans ou son œuvre critique, n’ont cessé de buter sur l’autre faute originelle, juin 40. Cette date à jamais porteuse de l’effondrement de toute une Nation ne l’a jamais lâché. A un journaliste venu l’interviewer en 1950, il dit son rêve inaccompli d’avoir pu se battre, et ajoute, goguenard, donc sincère : « Mais vous vous rappelez qu’il s’est passé en 1940 certains événements plutôt désagréables pour la France. Nos armées n’ayant pas pris précisément le chemin de Berlin, vexé, je me suis plongé dans les livres. » Son sens de la dignité le protégeait contre les fanfaronnades, et il se garda bien de bomber le torse pour avoir passé trois mois, en mars-août 1945, sous un uniforme, sinon de théâtre, de substitution. Il sort inguérissable, dit-il à un ami d’enfance, de ce donquichottisme sentimental à fausse jugulaire. Bleu sera le hussard de Nimier, comme buissonnière l’Europe d’Antoine Blondin (son meilleur livre). Bleu, c’est-à-dire mélancolique d’avoir été floué par l’Histoire. Autant que le souvenir de la défaite, les abus de l’épuration et les langues de bois de l’après-guerre, d’un camp à l’autre, étaient insupportables à Nimier. Marc Dambre, qui a déjà tant fait pour lui et à qui ce Quarto a été naturellement confié, le dit fortement en ouverture du volume. La collection fête ses trente ans avec panache bien que le Nimier comporte peu de raretés et d’inédits, l’excellente et copieuse biographie illustrée mise à part. Mais ces plus de 1200 pages, nettes de la moindre ride, répondent à d’autres besoins que la soif de l’inconnu. Dambre répond, à l’évidence, au souci de faire lire Nimier à une nouvelle génération, peut-être mieux préparée, hélas, que celle des « boomers » à entendre son pessimisme, à accepter ses regrets du pays perdu. Seront-ils sensibles ces nouveaux lecteurs, au-delà du style de haute lignée, a son aristocratisme de l’action, de l’amitié, de l’amour, de l’humour, du risque, quand l’existentialisme y jetait le doute, en vertu des « camarades » bien alignés et d’une philosophie balançant entre la solitude et la déréliction, également fatales ? Sans doute faut-il faire confiance à ce que ce classique autoproclamé appelait lui-même son romantisme.
Stéphane Guégan

Théophile Gautier, Chronique théâtrale, tome XXI, postface et index général par Patrick Berthier, Honoré Champion, 89,90€ // Fanny Arama, Portrait du polémiste en artiste. Jules Barbey d’Aurevilly et Léon Bloy, Classiques Garnier, 49€ // André Breton Julien Gracq, Correspondance 1939-1966, préface et édition de Bernard Vouilloux, avec la collaboration d’Henri Béhar, Gallimard, 21€ // Dominique Bona, de l’Académie française, Le roi Arthur, Gallimard, 22€ // Roger Nimier, Œuvres. Romans, Essais, Critique, Chroniques, édition établie et présenté par Marc Dambre, 32€ // Inattendus en théorie, car les souverains n’en publient pas, les Mémoires de l’ex-roi d’Espagne étaient prévisibles, au regard du scandale qui l’entache depuis 2020, et que ce livre cherche à expliquer, non à excuser : « Une grave erreur », écrit Juan Carlos, page 58. Bourbon par la grâce de Louis XIV, Orléans par sa mère, Juan Carlos aurait eu peu de chances de régner, à l’instar de son père, si Franco n’eût pas fait de lui, autre embardée du destin, son « successeur ». On connaît la suite. Le difficile virage démocratique du pays n’occupe qu’une partie de ces pages au ton peu formel. Plus intéressantes, plus inattendues, sont celles qui abordent l’économie du trône, très écornée au XIXe siècle et sous le franquisme. Le XXIe siècle et sa mouvante géopolitique rebattront les cartes. Exilé à Abu Dhabi, Juan Carlos devrait y mourir. Mais son souhait est d’être enterré en Espagne avec les honneurs, le livre le fait entendre avant de se refermer. Son fils Felipe, ainsi nommé en souvenir de Philippe V, l’exaucera-t-il ? C’est tout le sens de la réconciliation qui sert de sous-titre au livre et lui donne sa vraie raison. SG / Juan Carlos Ier d’Espagne, avec la collaboration de Laurence Debray, Mémoires, Stock, 26,90€.
ON EN PARLE

« La rêverie d’un homme qui a voyagé est autrement riche que celle d’un homme qui n’a jamais voyagé », affirmait Matisse en 1933 – il avait alors déjà vu l’Afrique du Nord, New York et Tahiti. Ce livre de Stéphane Guégan suit la chronologie de la vie et de l’œuvre de Matisse, et il rappelle ce que le peintre doit à l’étranger, mais le titre est trompeur : la préface, piquante, insiste sur la profonde francité de Matisse, ainsi que sur son inclination spirituelle – indiscutable quand on connaît son travail tardif à la chapelle du Rosaire, à Vence. / Louis-Henri de La Rochefoucauld, L’Express, 15 décembre 2025.
Un livre sur Henri Matisse fait toujours du bien. Cela tient à la profonde jeunesse de ses œuvres, d’autant plus grande qu’il avance en maturité. Matisse aide à enchanter les âges, il donne le courage de vieillir. Il en donne même l’envie. Le texte de Stéphane Guégan, historien d’art, qui accompagne les illustrations, est érudit sans lourdeur. Il insiste subtilement sur ce que le peintre doit aux artistes qui l’ont précédé, et aussi sur « l’homme d’émotions », attentif à rester fidèle à leur vérité. // Martine Lecoq, Réforme, décembre 2025.
Voir aussi Bérénice Levet et Stéphane Guégan, « Matisse. Le grand malentendu », Causeur, décembre 2025
Et la recension de Robert Kopp dans la Revue des deux mondes :