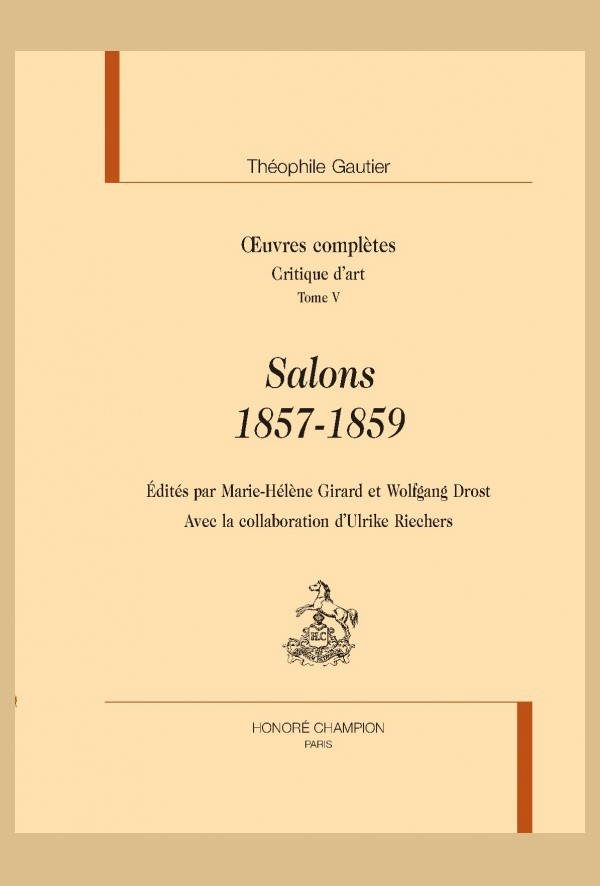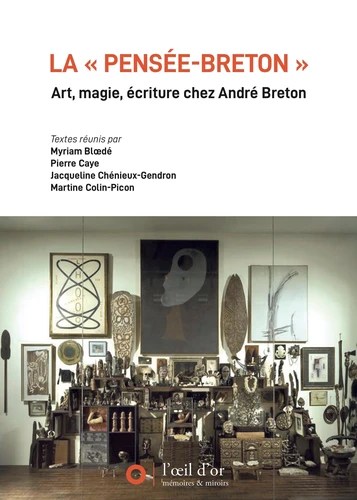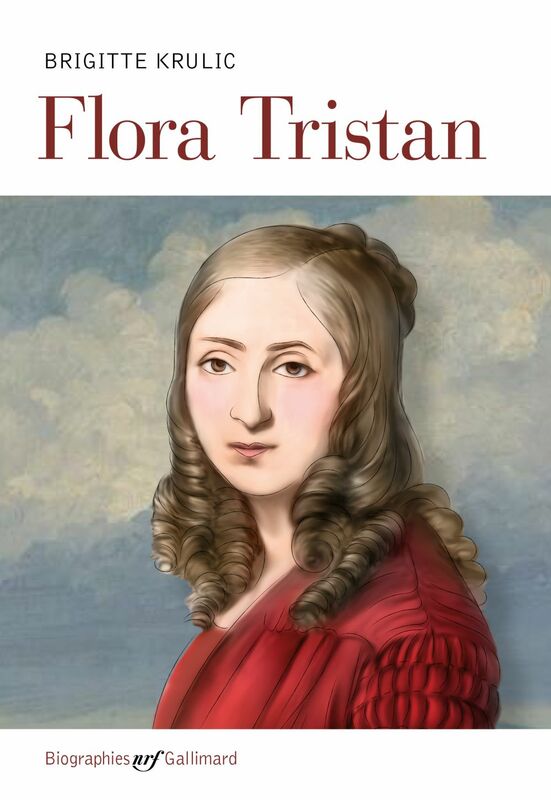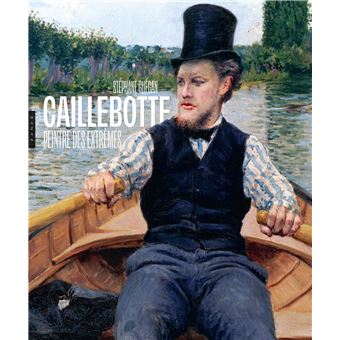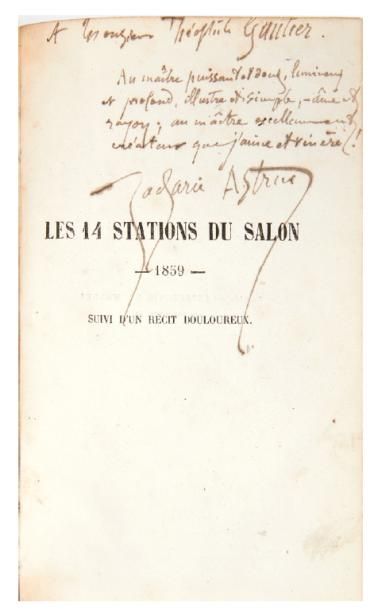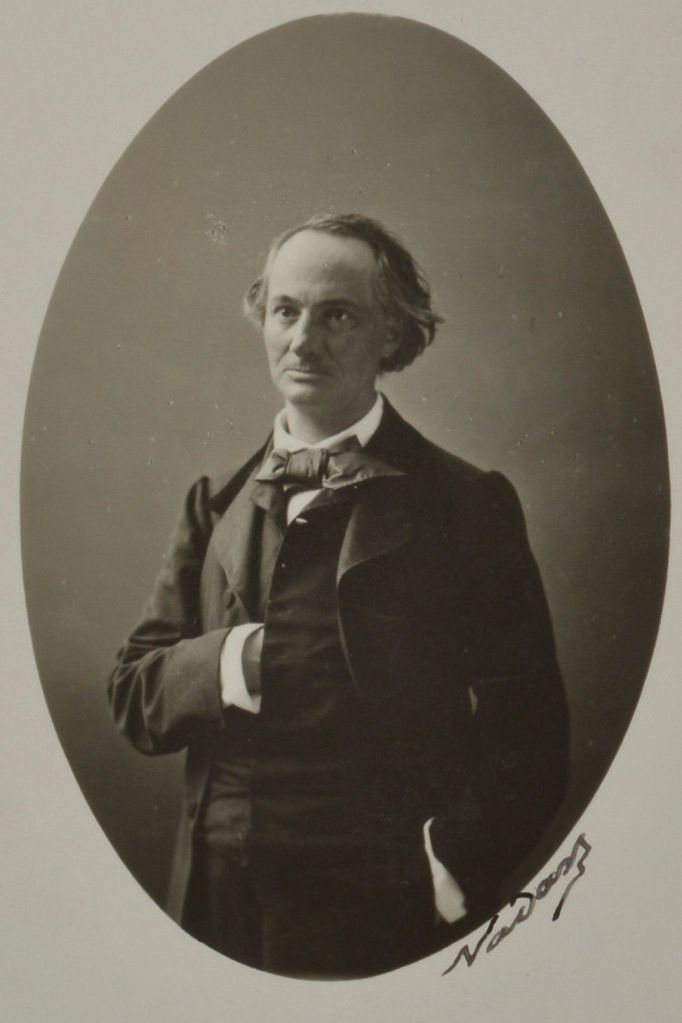Excès de vin, excès de vie, fièvre maligne, coup de froid fatal, la mort de Valentin de Boulogne a gardé son mystère. Mais, en cet été 1632, le milieu romain sait que le défunt, « Pictor famosus », était doublement « gallus », sujet de Louis XIII et exilé de sa Brie natale. Il est frappant que Roberto Longhi, dénicheur de l’acte de décès, l’ait publié quelques jours après la rencontre de Laval et Mussolini, bien décidés à contrer Hitler en 1935. Pour s’être rallié, on ne sait quand, on ne sait comment, à la nouveauté du Caravage en faisant aussi son miel de Ribera, de Manfredi et de Cecco del Caravaggio – le plus voyou des émules -, Valentin perce vers 1620, à presque trente ans. Aussitôt, la Rome des Barberini francophiles l’emploie, le fête, l’accouple à l’autre Français enrôlé par la grandeur papale, un Normand, l’éminent Poussin. Le chantier toujours continué de Saint-Pierre les rapprochera en 1629, comme on rapprocherait Manet et Degas aujourd’hui. Convoités, les tableaux de sa main quadruplent de prix dès qu’il s’éteint brutalement. La rivalité des collectionneurs italiens franchit vite les Alpes. Mazarin, Jabach et d’autres poussent notoriété et cote, le financier parisien François Oursel aussi. Lors de la dispersion de sa collection insigne, en 1670, la couronne se fait attribuer un Caravage, aujourd’hui au Louvre, et les quatre Évangélistes de Valentin, qui quittèrent Versailles sous la Révolution, avant d’y revenir sous Louis-Philippe, sauveur du château. Louis XIV avait fait des Valentin le principal ornement de son grand Salon, puis les fit transporter, en 1701, dans sa Chambre à coucher plutôt opulente. Double, en fait. Les tableaux de Valentin, jusque-là accrochés à hauteur d’homme, gagnèrent l’attique. De bas en haut, une manière d’élévation s’opère par ordre royal, les images changent de fonction, les évangélistes retrouvent celle du Verbe révélé. Ces chefs-d’œuvre de peinture, goûtés du jeune roi, veillent désormais sur l’âme et peut-être le salut du monarque vieillissant, et anxieux. Matthieu (ill.) et Marc, aux obliques contraires, ont été montrés au Louvre en 2017 par Annick Lemoine et Keith Christiansen ; l’ensemble bénéficie aujourd’hui d’une exposition passionnante, à Versailles, entièrement dédiée au décor où il s’insérait. Voilà nos tableaux retrouvant la cimaise et l’ordre esthétique. Ce n’est pas une raison de les réduire à leur sombre et sobre beauté, aux gestes et visages ordinaires qu’elle magnifie, à la présence insistante de modèles connus (frottés que nous sommes au reste du corpus), à l’intelligence des choses muettes et des couleurs, chaque toile ayant sa dominante, vive ou éteinte, selon l’identité que le peintre rend à ces hommes qui connurent ou non le Christ. On ne saurait peindre pareillement les inspirés, témoins de la vie de Jésus, et ceux qui vinrent après, et transmirent une parole médiate. Les images avaient aussi ce pouvoir, et Valentin, chez qui le sacré et le profane refusent de s’ignorer, n’oublie pas de nous le rappeler. Aussi son Saint Luc écrit-il, sans trembler, sous le regard du bœuf et d’une Madone à l’Enfant, une icône, une œuvre de l’Évangéliste lui-même, et la trace modeste d’une vision, d’un message d’en-Haut.

L’érosion du caravagisme, prévisible revers de fortune, a épargné les meilleurs, Caravage et Valentin, dont David a copié la sublime Cène, au Palazzo Matei, en 1779. Vingt-et-un ans plus tôt, toujours à Rome, Nicolas-Guy Brenet (1728-1792) s’attaquait à un tableau aussi intimidant, La Mise au tombeau du Christ. Réalisme et pathos tranchant, Caravaggio avait de quoi étourdir le Français issu d’un autre monde, fils de graveur modeste, élève de Charles Antoine Coypel et de Boucher, arrachant très tôt les prix de dessin et repéré aussi vite par l’institution académique qui en fait son protégé et l’envoie en Italie sans attendre qu’il remporte le Grand Prix de peinture. En 1753, il était arrivé second… De là à être tenu pour secondaire, il n’y avait qu’un pas. L’historiographie du XIXe siècle n’y résista pas. Souvent expéditive envers l’Ancien Régime, elle dira de Brenet qu’il « cultiva assidument le goût ennuyeux ». Mais le mal était parti de plus loin. Lors de ses funérailles, en février 1792, l’Académie royale, à laquelle David (son produit) n’avait pas encore coupé la tête, salua Brenet d’une formule mortelle : « Bon père, bon ami, bon maître, artiste instruit. » A condition de les lire vite, les Salons de Diderot ne semblaient guère plus chauds envers ce peintre d’histoire mobilisé, dès la fin du règne de Louis XV, par le grand programme d’ostentation monarchique et patriotique qu’on attribue au seul Louis XVI, et à son bras séculier, le comte d’Angiviller. La vertu, publique ou privée, et ses héros, voire ses héroïnes, occupèrent une génération de jeunes artistes, talentueux ou géniaux, durant la douzaine d’années qui menaient à 1789, du Du Guesclin de Brenet (notre ill.) au Brutus de David. Un siècle plus tard, alors que le peintre du Marat semblait surclasser ses contemporains, les meilleurs spécialistes de l’époque, de Pierre Rosenberg à Jean-Pierre Cuzin, réclamèrent plus d’égards et de recherches en faveur de Brenet. Après Marc Sandoz, mais en y mettant un soin documentaire plus fouillé, Marie Fournier a royalement exaucé le vœu de ses aînés. L’œuvre est considérable, près de 250 tableaux, et considérables leurs dimensions. Quand on peint alors pour le Roi et l’Église, la grandeur est partout. Les plus vastes chantiers, à l’appel des collégiales et chartreuses, ne faisaient pas trembler Brenet, que sa pauvreté incline à l’ubiquité. Le cruel Diderot, en 1767, le compare à un curé de campagne qui en donne à ses patrons pour leur argent. Trop d’effet mécanique, ou trop de réalisme (Caravage !), c’est aussi ce que le philosophe reproche à l’outrance dramatique du peintre laborieux, dans les deux sens du terme. La critique se justifie de cette gestuelle peu économe, de ces éclairages de théâtre, dont Brenet a parfois abusé, la mémoire pleine de Le Brun et Jouvenet. Mais quelle erreur se serait de méjuger les tableaux plus sobres, plus graves, plus émouvants, comme son François de Sales en prière, où s’humilient les apparences. N’oublions pas enfin que Gérard, Guérin, Girodet et Fabre passèrent entre les mains de cet artiste qu’il nous est enfin permis de juger sur pièces.

Le seul des jeunes émules de David à ne pas avoir connu l’atelier de Brenet, et ceci compte, fut Gros. Et qu’une partie du romantisme se soit formé auprès de lui n’a pas moins de sens. Détail piquant, un jeune Anglais, au lendemain de Waterloo, se sera aussi tourné vers l’ex-chantre de la geste napoléonienne. Richard Parkes Bonington avait vu le jour l’année de la Paix d’Amiens, mais il ne débarqua chez nous qu’en 1818, à 16 ans, poussé par son entrepreneur de père, aux affaires multiples, les images, le textile… Calais ne fut qu’une étape stratégique sur la route de Paris, aussi « british » que la capitale sous la Restauration. Pensons aux portraits que firent de Charles X et de la duchesse de Berry un Thomas Lawrence dépêché par la couronne d’Angleterre, sûre encore de tirer le meilleur parti de l’abaissement de sa rivale vaincue. Bonington, qui eut tant d’amis parisiens, de Colin à Delacroix, se contenta d’y faire fortune, et de contribuer à l’émergence d’une conscience nationale blessée, et donc avide d’images de son patrimoine monumental et de sa géographie hexagonale. La magie que Bonington imprime tôt à ses aquarelles, la transparence de ses huiles radieuses, double choc pour le milieu français, a parfois éclipsé le sujet de ses œuvres, voire le projet des éditeurs d’estampes et de « voyages romantiques » qu’il seconda avec une facilité de touche désarmante. Delacroix la signale à ses correspondants et nourrit, sous le Second Empire, une vraie mythologie : « personne dans cette école moderne, et peut-être avant lui, écrit-il à Thoré en 1861, n’a possédé cette légèreté dans l’exécution, qui, particulièrement dans l’aquarelle, fait de ses ouvrages des espèces de diamants dont l’œil est flatté et ravi, indépendamment de tout sujet et de toute imitation ». C’est le XXe siècle qui lut ici quelque annonce prophétique de l’art pur. Fausse route dont s’est toujours écarté Patrick Noon, le plus fin connaisseur de Bonington et du goût vénéto-britannique des années 1820. Du reste, le livre, le vaste bilan que publient les éditions Cohen & Cohen après nous avoir donné un Lawrence aussi généreux, déborde les limites de la monographie canonique et explore l’ensemble des forces et formes qui unirent Paris et Londres, avant 1830, dans un même destin. Car, le « Keats de la peinture », ainsi baptise-t-on rapidement Bonington, met aussi sa grâce délicatement effusive au service de la littérature de son pays : Shakespeare et Walter Scott prennent des couleurs. On voit Richard s’enflammer pour les Grecs et contre l’Ottoman. On le voit enfin, tel un Turner plus diaphane, déposer ses bagages à Venise et s’enchanter des dédales et canaux pouilleux, réponse italienne aux plages du Nord et aux labyrinthiques cités médiévales. Songeons que Charles Nodier identifiait Rouen, réveillée et rompue au « tourisme », à la « Palmyre du Moyen Âge ». A sa mort, le 23 septembre 1828, le prodige et prodigue Bonington, qui peignit avec l’air de ses claires marines, fut pleuré comme l’un des « nôtres ». Le Salon de 1824, « Salon anglais », ne quitterait plus les mémoires.

La part que prirent les Anglais au renouvellement de la peinture de paysage chez leurs voisins vient d’être rappelée. Il y aurait néanmoins un peu de masochisme national à désigner en Bonington et Constable les seuls agents de la révolution que la presse parisienne relève, souvent en ces termes, au cours des années 1820. Pour mieux faire coïncider esthétique et politique, l’habitude de parler d’une « école de 1830 » suivit, en outre, les Trois glorieuses. Théodore Rousseau (1812-1867), au nom prédestiné, profita plus que d’autres du mariage apparent des libertés conquises, une façon de traduire sans manière l’expérience de la nature semblait avoir ouvert la route au régime de Juillet, d’autant plus que le fils aîné de Louis-Philippe, Ferdinand, ne tarda pas à patronner ces paysagistes soucieux de substituer l’organique à l’ordre humain, l’empirique aux formules codifiées, « l’agreste » au « champêtre », pour citer une lettre oubliée du chantre des sous-bois. Elle appartient aux innombrables données de première main que réserve le livre décisif de Simon Kelly ; cet expert reconnu de l’art du XIXe siècle et de son marché étudie enfin la nouveauté de notre artiste, manière et sujets, au regard des discours et de la dynamique commerciale qui en assurèrent le succès, le triomphe, devrait-on dire. La légende édifiée par les premiers commentateurs préférait héroïser la figure du « grand refusé ». Ce qui était une réalité, le refoulement massif de Rousseau hors du Salon au cours des années 1830-1840, n’a que trop dissimulé la stratégie payante de l’artiste, appuyée à d’autres leviers et réseaux. Le plus visible, quoique désormais mieux documenté, nous ramène aux aigles de la critique d’art, les deux Théophile, Gautier et Thoré, avant que le Baudelaire de 1845, leur lecteur attentif, ne place Rousseau « à la tête de l’école moderne du paysage ». Plus la victime du jury, où siègent les survivants de l’ère davidienne, est interdite de cité, plus la parole contestataire des polygraphes se déchaîne et valorise l’exclu des cimaises officielles. Le vocabulaire de la défense annonçait la rhétorique des années 1870 : originalité, naïveté, vigueur de sensation, franchise d’impression. Thoré, intime du peintre, célèbre une sorte de mystique panthéiste en écho au matérialisme déiste des Lumières. Kelly a parfaitement mesuré le poids des milieux socialistes sur la carrière florissante de Rousseau, de Pierre Leroux et George Sand aux fouriéristes. L’un d’entre eux, le savoureux Sabatier-Ungher, crédite l’artiste, en 1851, d’avoir su rendre « le fouillis de la nature, où l’on ne voit jamais tout du premier coup d’œil ». 1848 avait entretemps ramené le proscrit au Salon, mais un proscrit riche. Car la cote de l’artiste n’a cessé de croître, soutenue par des collectionneurs, des marchands et des cercles alternatifs que l’esprit d’entreprise du Second empire devait galvaniser. Chercheur né, et chiffres inédits en mains, Kelly nous ouvre définitivement les yeux sur tout un processus de promotion, que Rousseau accompagna d’une souplesse accrue envers Napoléon III et ce monarchiste de Durand-Ruel. Monet n’a plus qu’à surgir.

Longtemps, et de son vivant même, Pierre Bonnard (1867-1947) fut accusé d’impressionnisme tardif, d’avoir dérogé au XXe siècle, en somme, et d’être resté l’esclave de la perception quand ses rivaux, de vrais inventeurs eux, s’en étaient émancipés. À sa mort, un article des Cahiers d’art le condamnait en bloc ; il était signé de Christian Zervos, pâle séide de Picasso, et révolta Matisse. Malgré d’autres réactions similaires, Balthus en France, d’autres aux États-Unis, Bonnard fit progressivement l’objet d’une relégation vertueuse, à bonne distance des récits autorisés de la modernité. Près d’un demi-siècle devait s’écouler avant la reprise des hostilités. On veut évidemment parler de la fracassante rétrospective de 1984, qu’organise Jean Clair au nez des « clercs » de l’époque. Scandale, polémique, mais succès. Les expositions consacrées à Bonnard allaient se multiplier jusqu’à aujourd’hui, Isabelle Cahn a souvent été associée à leur commissariat. Et la synthèse qu’elle signe cette année en regroupe les fruits. Plus, ce volume aux images innombrables, et parfois rares, rejoint la collection des Phares de son éditeur. Qui, en dehors de Jean Clair, auteur d’une monographie décisive dès 1975, eût parié alors sur ce cheval ? Qui l’eût admis dans l’écurie baudelairienne des dieux du beau ? C’est chose faite, on s’en réjouit. Après le chapitre d’ouverture sur « le temps des Nabis » et la troisième voie qu’ils ouvrent, à mi-chemin du réalisme et du symbolisme, et chacun de façon singulière, Isabelle Cahn propose une lecture diachronique de cinquante ans de peinture, gravure, livres illustrés et photographie, que Bonnard ait commandé ou pas l’objectif. L’attachement au nouveau médium, et au cinéma bientôt, précipite son évolution après 1900, et conditionne de nouvelles inscriptions du temps et de l’espace, – thème cher à l’auteure -, au contact de la rue parisienne (Bonnard a tout du flâneur et du croqueur), du nu (au moment où une partie de la modernité le déclare périmé) et de l’univers domestique, théâtre des possibilités infinies qu’offrent sa vie avec Marthe et l’ombre portée de quelques aventures sans lendemain. Si Bonnard s’est vite guéri des tentations du décoratif, ou d’une peinture tournant le dos au réel par esthétisme japonisant, il n’a rien abdiqué de la volonté première de repousser les limites usuelles du chevalet ; et l’on comprend que le vieux Monet l’ait souvent consulté au sujet des Nymphéas en cours, et invité à Giverny. Isabelle Cahn ouvre, du reste, son livre sur une toile représentant le 14 juillet 1890, que je suis tenté de rapprocher, pour l’éclat pavoisé, de la fameuse Rue Montorgueil d’Orsay. Le tableau de Monet (1878) avait été remontré en 1889 dans l’exposition Monet/Rodin de la galerie Georges Petit. Deux tableaux républicains, assurément. Mais le Bonnard qu’Isabelle Cahn nous propose n’a pas la tête politique, il aurait répondu à l’affaire Dreyfus et aux deux guerres mondiales par une sorte de persistance ou de résistance arcadienne, par des « compositions radieuses et atemporelles ». Qu’elle me pardonne de ne pas la suivre sur ce chemin-là.

C’est là même où Bonnard avait exposé durant la guerre, deux accrochages où la presse salua une ferveur inentamée, qu’Augustin Rouart fit ses vrais débuts en 1948, et appela l’attention sur sa peinture volontairement, gravement inactuelle. Autre bravade, il s’offrit le luxe d’avoir pour préfacier le plus inflammable critique d’art du moment. Waldemar-George, que sa judéité avait réduit au silence sous la botte, retrouvait sa plume des grands jours. Ce fanatique de la figuration, à qui on reprochait d’avoir applaudi à la peinture italienne d’avant l’Axe, couvrait donc de son autorité un « jeune homme » de quarante ans, étanche aux avant-gardes du moment. Waldemar-George savait Augustin d’illustre lignée, peintre par le sang, la collectionnite et une vocation familiale au contre-courant (voir Le Nageur de 1943). Ses deux grands-pères, à n’en pas douter, revivaient en lui, Henri Rouart, ami de Degas et pilier des expositions impressionnistes, Henry Lerolle, lié aussi à Degas par leur maître commun, un ingriste de stricte obédience. Le père d’Augustin, Louis le tempétueux et l’amoureux, Louis le pieux aussi, avait sympathisé avec Maurice Denis et d’autres réinventeurs de l’art sacré. Riche ascendance, n’est-ce pas ? Mais ce n’était pas tout. Par cousinage, le « jeune homme » touchait à Manet et Berthe Morisot… D’autres se seraient dérobés et auraient renoncé à la térébenthine. Mais la mystique familiale fit un autre adepte, aussi peu préoccupé de sa carrière que fidèle à des choix plastiques volontiers hors d’âge : les autoportraits, très nombreux, l’affirment crânement. L’hommage de la mairie du VIIIe arrondissement remet devant nos yeux une peinture parente des frères Limbourg, de Dürer ou d’Holbein, autant de petites toiles épurées, que ses clients américains devaient rapprocher du précisionnisme des années 20 et du tout premier Hopper. Une poésie assez semblable les porte vers les figures solitaires, le vide prometteur de l’espace, ou la bénédiction lumineuse. Quand la pensée triste et rêveuse d’Augustin l’appelle sur les plages de Noirmoutier, un besoin d’apaisement se devine. D’où vient cette sensation d’ordre et de fragilité en concurrence ? D’abandon et de distance au réel entrevu ? Jean-Marie Rouart, le fils d’Augustin, note joliment que son père « avait une dilection particulière pour les enfants et pour les fleurs : deux modèles éphémères ». La remarque vaudrait pour Manet, le peintre des passages, je la tire du livre que le romancier vient de dédier à la mémoire de son peintre de père, plus peintre que père peut-être. L’adulation rétrospective, danger de l’exercice, n’y a aucune part. C’est le portrait tendre d’un homme qui n’apprivoisa jamais le bonheur, le chercha moins autour de lui, près des siens, qu’en dehors du monde. Or la peinture ne suffit pas à rendre heureux, et la vivre comme un apostolat, jusqu’à cultiver une certaine gêne financière, non plus. Après avoir été le modèle favori, Jean-Marie Rouart se saisit donc des pinceaux et avoue sans détour s’être construit contre ce père plus absenté qu’absent. Cela n’interdit pas les connivences, le respect et une sorte de pacte secret, que Waldemar-George laissait deviner en appliquant la formule que Gautier prêtait déjà à Platon : le beau est la splendeur du vrai. En fils reconnaissant, l’Académicien tire de son dictionnaire intime un autre mot pour le dire : féérie. Stéphane Guégan /
*Sous la direction de Béatrice Sarrazin (dir.), Chefs-d’œuvre de la Chambre du Roi, Éditions In Fine, 19€ // Marie Fournier, Nicolas-Guy Brenet (1728-1792), Arthena, 110€ /// Patrick Noon, Bonington. Le virtuose romantique, Cohen & Cohen éditeurs, 138€ //// Simon Kelly, Théodore Rousseau and the Rise of the Modern Art Market, Bloomsbury Publishing, 108$ ///// Isabelle Cahn, Bonnard, Citadelles & Mazenod, Collection « Les Phares », 199€ ////// Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, Augustin Rouart. Entre père et fils, Gallimard, 26€. L’exposition Augustin Rouart, mairie du 8e arrondissement, 56 bd Malesherbes, reste visible jusqu’au 30 mai.