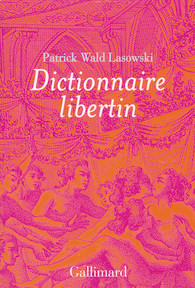Au commencement était le jardin, hortus en latin, garten en allemand, garden en anglais, un mot qui dans toutes les langues porte l’espoir de l’éternel printemps et d’une harmonie possible entre le monde et soi. Le jardin primitif, c’est la grotte, la caverne, mais en plein soleil, sur le fil qui sépare la verdure de sa clôture. Un lieu sacré et donc séparé, le lieu du sacré, avec ce qu’il implique, dirait Bataille, d’interdit et de transport sensuel, voire érotique… Bien qu’elle se veuille un discret hommage aux meilleurs paysagistes français, actifs à travers le monde d’aujourd’hui, l’exposition du Grand Palais envoûte comme la fresque pompéienne qui en marque le seuil, et le grand Giuseppe Penone qui suit. La peinture ne s’est jamais bornée à ouvrir une fenêtre illusoire sur le monde, elle donne réalité à ce très vieux sentiment de l’unité pré-adamique. Il est toujours salutaire de revenir aux origines de ce que les modernes et leur fatuité pensent avoir inventé : non, nous ne sommes pas les premiers à nous sentir coresponsables de la biosphère et à vouloir en transmettre la beauté native après en avoir joui. Nous nous sentons seulement plus coupables, et pour de bonnes raisons, d’avoir tant défiguré l’œuvre des Dieux ou de Dieu. Ne croyant qu’aux religions fertiles et génératrices de vie, Laurent Le Bon s’est placé résolument sur le versant solaire de son sujet. Pour ceux qui suspecteraient cette soudaine vocation jardinière d’opportunisme écolo, rappelons qu’il se fit connaître, voilà quelques années, par un livre sur le château de Courances, aux parterres duquel son exposition ouvre l’une de ses cimaises. A l’instar de l’illustre abbé Delille, le doublement vert immortel du quai Conti, il semble dire à chaque visiteur : « Un jardin, à mes yeux, est un vaste tableau. Soyez peintre. » Comme nous n’avons pas hélas le génie de Dürer, Fragonard, Delacroix, Cézanne, Caillebotte, Klimt, Picasso, Matisse, Dubuffet et bien d’autres, mieux vaut s’abandonner voluptueusement au flux de cet immense herbier qui témoigne d’une dévotion multiséculaire pour l’œuvre du vivant. On attribue aux romantiques d’avoir voulu peindre, non plus d’après, mais comme ou avec la nature. Jardins redonne à cette coopération une perspective plus longue, où le plus modeste relevé botanique voisine avec les plus majestueuses vedute. Dans cette alternance magnifiquement orchestrée des deux infinis, d’œuvres inconnues et de chefs-d’œuvre, apparaît la figure du jardinier lui-même, alter ego du peintre qui le représente en godillots crottés ou pieds nus, saint laïc d’un monde réduit à lui-même. Et si l’histoire de l’art, qui sent parfois un peu le renfermé, faisait une place à l’hortus pictor aux côtés du pictor doctus ! Laurent Le Bon nous en donne un avant-goût résolument précis et printanier.
Au commencement était le jardin, hortus en latin, garten en allemand, garden en anglais, un mot qui dans toutes les langues porte l’espoir de l’éternel printemps et d’une harmonie possible entre le monde et soi. Le jardin primitif, c’est la grotte, la caverne, mais en plein soleil, sur le fil qui sépare la verdure de sa clôture. Un lieu sacré et donc séparé, le lieu du sacré, avec ce qu’il implique, dirait Bataille, d’interdit et de transport sensuel, voire érotique… Bien qu’elle se veuille un discret hommage aux meilleurs paysagistes français, actifs à travers le monde d’aujourd’hui, l’exposition du Grand Palais envoûte comme la fresque pompéienne qui en marque le seuil, et le grand Giuseppe Penone qui suit. La peinture ne s’est jamais bornée à ouvrir une fenêtre illusoire sur le monde, elle donne réalité à ce très vieux sentiment de l’unité pré-adamique. Il est toujours salutaire de revenir aux origines de ce que les modernes et leur fatuité pensent avoir inventé : non, nous ne sommes pas les premiers à nous sentir coresponsables de la biosphère et à vouloir en transmettre la beauté native après en avoir joui. Nous nous sentons seulement plus coupables, et pour de bonnes raisons, d’avoir tant défiguré l’œuvre des Dieux ou de Dieu. Ne croyant qu’aux religions fertiles et génératrices de vie, Laurent Le Bon s’est placé résolument sur le versant solaire de son sujet. Pour ceux qui suspecteraient cette soudaine vocation jardinière d’opportunisme écolo, rappelons qu’il se fit connaître, voilà quelques années, par un livre sur le château de Courances, aux parterres duquel son exposition ouvre l’une de ses cimaises. A l’instar de l’illustre abbé Delille, le doublement vert immortel du quai Conti, il semble dire à chaque visiteur : « Un jardin, à mes yeux, est un vaste tableau. Soyez peintre. » Comme nous n’avons pas hélas le génie de Dürer, Fragonard, Delacroix, Cézanne, Caillebotte, Klimt, Picasso, Matisse, Dubuffet et bien d’autres, mieux vaut s’abandonner voluptueusement au flux de cet immense herbier qui témoigne d’une dévotion multiséculaire pour l’œuvre du vivant. On attribue aux romantiques d’avoir voulu peindre, non plus d’après, mais comme ou avec la nature. Jardins redonne à cette coopération une perspective plus longue, où le plus modeste relevé botanique voisine avec les plus majestueuses vedute. Dans cette alternance magnifiquement orchestrée des deux infinis, d’œuvres inconnues et de chefs-d’œuvre, apparaît la figure du jardinier lui-même, alter ego du peintre qui le représente en godillots crottés ou pieds nus, saint laïc d’un monde réduit à lui-même. Et si l’histoire de l’art, qui sent parfois un peu le renfermé, faisait une place à l’hortus pictor aux côtés du pictor doctus ! Laurent Le Bon nous en donne un avant-goût résolument précis et printanier.
 Au commencement était l’utopie… Pissarro, en dehors de l’album des Turpitudes sociales, adopta et manifesta une forme d’anarchisme plutôt douce. Malgré des revenus modestes, que le succès arrondit à partir des années 1880-1890 (ses prix restent toutefois bien plus bas alors que ceux de Monet), il n’avait jamais laissé son épouse s’occuper seule de la cuisine et de leurs nombreux enfants. La domesticité bourgeoise, fût-ce à la campagne, exige quelques petites mains. Plus proche de Proudhon que des poseurs de bombes, Pissarro se méfiait même des peintres explosifs, il préféra cultiver, à tous égards, son jardin… Gauguin en fit les frais, il est vrai que le catholicisme du peintre de Pont-Aven et de Tahiti répugnait au libertaire athée. L’exposition du Luxembourg, qui bénéficie de l’expertise de Richard Brettell et Joachim Pissarro, se penche sur les vingt dernières années de son existence (1884-1903), qui eurent Eragny pour épicentre bucolique, années d’abord secouées par l’insurrection pointilliste, avant que le drapeau noir ne fasse couler le sang… Cas unique, Pissarro fut de toutes les expositions impressionnistes, jusqu’à l’ultime, en 1886, où Seurat et Signac, frottés eux aussi d’anarchisme, prirent le pouvoir au grand dam de Monet, Renoir, Sisley et Caillebotte. Le peintre, son fils Lucien, et leurs jeunes amis provoquèrent le départ des anciens et lancèrent à grands fracas la cause du néo-impressionnisme. A 56 ans, Pissarro père n’avait écouté que « la crise » – c’est son mot – qui emportait à nouveau ses pinceaux. Contrôle extrême de la composition, mélange optique et harmonie des complémentaires : la rupture avec l’impressionnisme « romantique » était consommée. Rupture éphémère… Ébranlé par la mort précoce de Seurat et vendant mal ses tableaux néo, Pissarro se rendit à l’évidence dès 1891 : « Je crois que tu as raison, écrit-il à Lucien, c’est fini le pointillé. » Il n’avait accepté que trop longtemps de « refroidir la sensation ». Sa peinture libérée pouvait recommencer. L’exposition du Luxembourg en suit les ultimes rebonds.
Au commencement était l’utopie… Pissarro, en dehors de l’album des Turpitudes sociales, adopta et manifesta une forme d’anarchisme plutôt douce. Malgré des revenus modestes, que le succès arrondit à partir des années 1880-1890 (ses prix restent toutefois bien plus bas alors que ceux de Monet), il n’avait jamais laissé son épouse s’occuper seule de la cuisine et de leurs nombreux enfants. La domesticité bourgeoise, fût-ce à la campagne, exige quelques petites mains. Plus proche de Proudhon que des poseurs de bombes, Pissarro se méfiait même des peintres explosifs, il préféra cultiver, à tous égards, son jardin… Gauguin en fit les frais, il est vrai que le catholicisme du peintre de Pont-Aven et de Tahiti répugnait au libertaire athée. L’exposition du Luxembourg, qui bénéficie de l’expertise de Richard Brettell et Joachim Pissarro, se penche sur les vingt dernières années de son existence (1884-1903), qui eurent Eragny pour épicentre bucolique, années d’abord secouées par l’insurrection pointilliste, avant que le drapeau noir ne fasse couler le sang… Cas unique, Pissarro fut de toutes les expositions impressionnistes, jusqu’à l’ultime, en 1886, où Seurat et Signac, frottés eux aussi d’anarchisme, prirent le pouvoir au grand dam de Monet, Renoir, Sisley et Caillebotte. Le peintre, son fils Lucien, et leurs jeunes amis provoquèrent le départ des anciens et lancèrent à grands fracas la cause du néo-impressionnisme. A 56 ans, Pissarro père n’avait écouté que « la crise » – c’est son mot – qui emportait à nouveau ses pinceaux. Contrôle extrême de la composition, mélange optique et harmonie des complémentaires : la rupture avec l’impressionnisme « romantique » était consommée. Rupture éphémère… Ébranlé par la mort précoce de Seurat et vendant mal ses tableaux néo, Pissarro se rendit à l’évidence dès 1891 : « Je crois que tu as raison, écrit-il à Lucien, c’est fini le pointillé. » Il n’avait accepté que trop longtemps de « refroidir la sensation ». Sa peinture libérée pouvait recommencer. L’exposition du Luxembourg en suit les ultimes rebonds.
 Au commencement était Rodin… Anselm Kiefer en aime les corps déchiquetés et amoureusement recomposés, il en connaît aussi l’enfer, ces dessins luxurieux que le maître ne montrait qu’aux initiés et aux femmes qu’il voulait faire rougir et séduire. Il a lu également le grand livre de Rilke, que les Éditions de Paris ont la bonne idée de rééditer à prix modique. Bref, Kiefer était mûr pour accepter l’invitation du musée Rodin, depuis peu rafraîchi de façon spectaculaire. Encore fallut-il d’abord convaincre l’éminent artiste de lire ce chef-d’œuvre oublié que sont Les Cathédrales de France, seul livre que le sculpteur ait majoritairement écrit et religieusement publié en 1914. Le rêve secret de Véronique Mattiussi a toujours été de le mettre au centre d’une exposition. C’est chose faite et le résultat a peut-être dépassé ses désirs les plus fous. Car Kiefer s’est pris au jeu. Qui sait si le bombardement de la cathédrale de Reims, qui traumatisa tant d’artistes en cette même année 1914, ne travaille pas les grands tableaux de la première salle, ils sentent la pierre brûlée, le fer et le verre fondus… Leur souffle chaud saisit, avant que la section suivante ne nous ramène à des passions incendiaires plus sympathiques, l’Éros à travers lequel Rodin pensait le gothique et, plus largement, l’esthétique. Le moins qu’on puisse dire est que le désir domine la plupart des « livres » récents de Kiefer, bien étudiés par le catalogue. L’hommage qu’ils rendent aux dessins les plus lestes de Rodin crève les yeux. Kiefer adhère résolument au sculpteur des convulsions humaines, où le pulsionnel secoue formes et lignes autant qu’il éclaire dans sa lumière crue la vérité multiple de la vie. Les titres parlent, qui renvoient à des lectures entre lesquelles parvient à se dégager une belle unité d’inspiration. Rien pourtant ne semblait devoir relier Les Cathédrales de Rodin, Le Bleu du ciel de Bataille (dédié à André Masson) et Les Falaises de marbre de Jünger. Mais Kiefer, en vrai lecteur, ne demande pas aux écrivains de simples prétextes à divaguer au cœur de ses propres obsessions. Il fait émerger le sens profond des livres qu’il fait siens. Comme le Masson du Con d’Irène, s’électrisant au souvenir des illustrateurs de Sade, ses Cathédrales de papier réconcilient l’architecture et l’étreinte, la peau et la pierre, l’arcade et l’échine, le sacré et sa profanation imaginaire. Il y a acte d’écriture, transformation du texte lu en nouvelle partition. Les cathédrales de Rodin reprennent corps et retrouvent leur lumière d’avant-guerre…
Au commencement était Rodin… Anselm Kiefer en aime les corps déchiquetés et amoureusement recomposés, il en connaît aussi l’enfer, ces dessins luxurieux que le maître ne montrait qu’aux initiés et aux femmes qu’il voulait faire rougir et séduire. Il a lu également le grand livre de Rilke, que les Éditions de Paris ont la bonne idée de rééditer à prix modique. Bref, Kiefer était mûr pour accepter l’invitation du musée Rodin, depuis peu rafraîchi de façon spectaculaire. Encore fallut-il d’abord convaincre l’éminent artiste de lire ce chef-d’œuvre oublié que sont Les Cathédrales de France, seul livre que le sculpteur ait majoritairement écrit et religieusement publié en 1914. Le rêve secret de Véronique Mattiussi a toujours été de le mettre au centre d’une exposition. C’est chose faite et le résultat a peut-être dépassé ses désirs les plus fous. Car Kiefer s’est pris au jeu. Qui sait si le bombardement de la cathédrale de Reims, qui traumatisa tant d’artistes en cette même année 1914, ne travaille pas les grands tableaux de la première salle, ils sentent la pierre brûlée, le fer et le verre fondus… Leur souffle chaud saisit, avant que la section suivante ne nous ramène à des passions incendiaires plus sympathiques, l’Éros à travers lequel Rodin pensait le gothique et, plus largement, l’esthétique. Le moins qu’on puisse dire est que le désir domine la plupart des « livres » récents de Kiefer, bien étudiés par le catalogue. L’hommage qu’ils rendent aux dessins les plus lestes de Rodin crève les yeux. Kiefer adhère résolument au sculpteur des convulsions humaines, où le pulsionnel secoue formes et lignes autant qu’il éclaire dans sa lumière crue la vérité multiple de la vie. Les titres parlent, qui renvoient à des lectures entre lesquelles parvient à se dégager une belle unité d’inspiration. Rien pourtant ne semblait devoir relier Les Cathédrales de Rodin, Le Bleu du ciel de Bataille (dédié à André Masson) et Les Falaises de marbre de Jünger. Mais Kiefer, en vrai lecteur, ne demande pas aux écrivains de simples prétextes à divaguer au cœur de ses propres obsessions. Il fait émerger le sens profond des livres qu’il fait siens. Comme le Masson du Con d’Irène, s’électrisant au souvenir des illustrateurs de Sade, ses Cathédrales de papier réconcilient l’architecture et l’étreinte, la peau et la pierre, l’arcade et l’échine, le sacré et sa profanation imaginaire. Il y a acte d’écriture, transformation du texte lu en nouvelle partition. Les cathédrales de Rodin reprennent corps et retrouvent leur lumière d’avant-guerre…
Stéphane Guégan
*Jardins, Grand Palais, jusqu’au 24 juillet. Catalogue sous la direction de Laurent Le Bon, éditions de la RMN – Grand Palais, 49€.
**Kiefer / Rodin, Musée Rodin, jusqu’au 22 octobre 2017. Catalogue sous la direction de Véronique Mattiussi, Gallimard / Musée Rodin, 35€.
***Pissarro à Eragny. La nature retrouvée, Musée du Luxembroug, jusqu’au 9 juillet 2017. Catalogue sous la direction de Richard Brettell et Joachim Pissarro, éditions de la RMN – Grand Palais, 35€.
 Au commencement était Dieu / Jan Blanc est le jeune doyen de la Faculté des lettres de l’université de Genève, où il enseigne l’histoire de l’art de la période moderne. Ses travaux portent sur la peinture néerlandaise et britannique des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans la collection des Phares, il est déjà l’auteur de Vermeer : la fabrique de la gloire, dont il a été parlé en grand bien ici. Si ce livre s’intéressait aux éclipses de la renommée, Van Gogh. Ni Dieu, ni maître (Citadelles & Mazenod, 189€) s’intéresse aux éclipses de la foi. D’après Jan Blanc, la peinture du Hollandais est profondément marquée par « l’affirmation de son incroyance ». Ce fils de pasteur, ce pasteur avorté, brièvement tenté par l’évangélisation du Borinage belge, aurait donc accepté la douloureuse hypothèse que Dieu pourrait ne pas exister et cherché, en dehors de l’institution ecclésiale, dans l’homme et dans l’art, les preuves du divin. La correspondance de Van Gogh témoigne constamment des oscillations du peintre entre morale athée et déisme éclairé. Selon l’auteur, Van Gogh serait à rapprocher des apôtres de la révolution sociale et des négateurs de la métaphysique postkantienne. Mais que gagne-t-on à pousser Van Gogh sous la lumière de Marx et de Nietzsche ? La question se pose assez vite au lecteur. Car Jan Blanc reconnaît que l’incroyance de Van Gogh n’était ni systématique, ni militante, et qu’elle le porta à fonder, à travers sa peinture, « une existence éthique ». On sait Van Gogh, d’un autre côté, pétri de Millet, Michelet, Hugo et Renan. Mais avaient-ils eux aussi complètement rompu avec le catholicisme ? Privilégiant la composante spirituelle inhérente à l’humanisme de Van Gogh, le livre minore ou ignore des aspects de sa personnalité et de son cheminement dont il est dommage de frustrer le lecteur. Il en va ainsi de la sexualité du peintre, des liens qu’il noua avec le milieu de la prostitution, il en va aussi de l’argent et de l’intérêt que l’artiste a toujours attaché au marché de la peinture moderne. Ne nous attardons pas sur les pages les plus contestables, comme celles consacrées à l’atelier de Cormon où le Hollandais continua ses classes après s’être installé à Paris, et venons-en aux vertus de cette synthèse écrite de façon nerveuse, qui épouse la peinture plus qu’elle ne colle aux documents. Jan Blanc a l’habitude de manier les idées et la théorie de l’art, cela se sent et renforce ses analyses. Il n’oublie pas, en outre, l’ascendance néerlandaise de l’artiste, ce qui le ramène à son domaine de spécialité et permet des comparaisons indéniablement justes. SG
Au commencement était Dieu / Jan Blanc est le jeune doyen de la Faculté des lettres de l’université de Genève, où il enseigne l’histoire de l’art de la période moderne. Ses travaux portent sur la peinture néerlandaise et britannique des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans la collection des Phares, il est déjà l’auteur de Vermeer : la fabrique de la gloire, dont il a été parlé en grand bien ici. Si ce livre s’intéressait aux éclipses de la renommée, Van Gogh. Ni Dieu, ni maître (Citadelles & Mazenod, 189€) s’intéresse aux éclipses de la foi. D’après Jan Blanc, la peinture du Hollandais est profondément marquée par « l’affirmation de son incroyance ». Ce fils de pasteur, ce pasteur avorté, brièvement tenté par l’évangélisation du Borinage belge, aurait donc accepté la douloureuse hypothèse que Dieu pourrait ne pas exister et cherché, en dehors de l’institution ecclésiale, dans l’homme et dans l’art, les preuves du divin. La correspondance de Van Gogh témoigne constamment des oscillations du peintre entre morale athée et déisme éclairé. Selon l’auteur, Van Gogh serait à rapprocher des apôtres de la révolution sociale et des négateurs de la métaphysique postkantienne. Mais que gagne-t-on à pousser Van Gogh sous la lumière de Marx et de Nietzsche ? La question se pose assez vite au lecteur. Car Jan Blanc reconnaît que l’incroyance de Van Gogh n’était ni systématique, ni militante, et qu’elle le porta à fonder, à travers sa peinture, « une existence éthique ». On sait Van Gogh, d’un autre côté, pétri de Millet, Michelet, Hugo et Renan. Mais avaient-ils eux aussi complètement rompu avec le catholicisme ? Privilégiant la composante spirituelle inhérente à l’humanisme de Van Gogh, le livre minore ou ignore des aspects de sa personnalité et de son cheminement dont il est dommage de frustrer le lecteur. Il en va ainsi de la sexualité du peintre, des liens qu’il noua avec le milieu de la prostitution, il en va aussi de l’argent et de l’intérêt que l’artiste a toujours attaché au marché de la peinture moderne. Ne nous attardons pas sur les pages les plus contestables, comme celles consacrées à l’atelier de Cormon où le Hollandais continua ses classes après s’être installé à Paris, et venons-en aux vertus de cette synthèse écrite de façon nerveuse, qui épouse la peinture plus qu’elle ne colle aux documents. Jan Blanc a l’habitude de manier les idées et la théorie de l’art, cela se sent et renforce ses analyses. Il n’oublie pas, en outre, l’ascendance néerlandaise de l’artiste, ce qui le ramène à son domaine de spécialité et permet des comparaisons indéniablement justes. SG




















 Si l’effroyable et humiliante guerre de Sept Ans (1756-1763) affecta passagèrement les Gobelins, elle empoisonna la vie et l’économie des soyeux lyonnais bien plus encore. Les exportations soudain dégringolèrent, ou rejoignirent les produits de contrebande, aux risques et périls des firmes françaises. En 1760, on lisait dans le London Chronicle: «dans tous les lieux publics, nos dames semblent plus françaises qu’anglaises. La législation a prohibé l’importation des soieries françaises, dentelles et lin; et pour cette raison même, les obtenir est devenu des plus désirables et des plus distingués.» Les obtenir, les copier ou les capter… Quatre ans plus tard, les douanes anglaises saisissaient un livre d’échantillons en provenance de Lyon, via Paris et Dunkerque. Il rejoindra en 1972 les collections du Victoria and Albert Museum, après avoir appartenu à la London Company of Weavers et d’autres manufactures britanniques. La Bibliothèque des Arts en publie un fac-similé et retrace l’histoire rocambolesque d’un volume qui passa de main en main durant deux siècles. Avec l’aide d’une ample documentation visuelle, et à partir des portraits de l’époque et de leurs accessoires, Lesley Ellis Miller montre à quelles extrémités délicieuses pouvaient déjà conduire la mode vestimentaire et la guerre commerciale que se livraient les pays d’Europe. Son enquête de très longue haleine l’a conduite à identifier les deux G du livre d’échantillons, qui appartient à son musée, et à reconstituer le marché conflictuel de l’habillement de luxe au mitan du XVIIIe siècle. Pierre Arizzoli-Clémentel, dans sa postface, parle en connaisseur du «voile» que lève cette «étude capillaire» sur «le monde industrieux et attachant des soyeux» de Lyon et des marchands-merciers de Paris.
Si l’effroyable et humiliante guerre de Sept Ans (1756-1763) affecta passagèrement les Gobelins, elle empoisonna la vie et l’économie des soyeux lyonnais bien plus encore. Les exportations soudain dégringolèrent, ou rejoignirent les produits de contrebande, aux risques et périls des firmes françaises. En 1760, on lisait dans le London Chronicle: «dans tous les lieux publics, nos dames semblent plus françaises qu’anglaises. La législation a prohibé l’importation des soieries françaises, dentelles et lin; et pour cette raison même, les obtenir est devenu des plus désirables et des plus distingués.» Les obtenir, les copier ou les capter… Quatre ans plus tard, les douanes anglaises saisissaient un livre d’échantillons en provenance de Lyon, via Paris et Dunkerque. Il rejoindra en 1972 les collections du Victoria and Albert Museum, après avoir appartenu à la London Company of Weavers et d’autres manufactures britanniques. La Bibliothèque des Arts en publie un fac-similé et retrace l’histoire rocambolesque d’un volume qui passa de main en main durant deux siècles. Avec l’aide d’une ample documentation visuelle, et à partir des portraits de l’époque et de leurs accessoires, Lesley Ellis Miller montre à quelles extrémités délicieuses pouvaient déjà conduire la mode vestimentaire et la guerre commerciale que se livraient les pays d’Europe. Son enquête de très longue haleine l’a conduite à identifier les deux G du livre d’échantillons, qui appartient à son musée, et à reconstituer le marché conflictuel de l’habillement de luxe au mitan du XVIIIe siècle. Pierre Arizzoli-Clémentel, dans sa postface, parle en connaisseur du «voile» que lève cette «étude capillaire» sur «le monde industrieux et attachant des soyeux» de Lyon et des marchands-merciers de Paris. Last but lot least, le catalogue de l’exposition François Boucher. Fragments d’une vision du monde, qui eut lieu au musée Gl. Holtegaard en 2012, nous arrive enfin. Comme il est superbe, on se dit qu’on a bien fait d’attendre… Montrer François Boucher au Danemark, l’un des pays d’ancrage de «l’Europe française» de Louis Réau, c’était le ramener à la maison! Soixante-dix dessins, rococo à souhait, très déshabillés le plus souvent, résument la trajectoire d’un artiste qui se joua des frontières avec constance. Frontières politiques, on l’a dit. Mais frontières esthétiques au même degré. Françoise Joulie a voulu donner un plein écho à cette plasticité, qui fait passer Boucher du tableau royal au dessin pour amateurs, de la tapisserie au livre illustré, de l’estampe au bibelot, mais aussi du rustique à l’exotique, du religieux au laïc, de la pastorale priapique au stoïcisme romain… La légende du libertin, n’écoutant que sa libido insatiable, n’a plus cours désormais. On préfère peindre le chéri de la Pompadour en redoutable chef d’entreprise, ajusté aux diverses options d’un marché centrifuge. Il n’existait guère de conflit majeur entre Mercure et Vénus. Si le meilleur de Boucher possède l’énergie érotique et l’accent de vérité des meilleurs peintres de nu, c’est que le modèle vivant, femmes et hommes, scrutés sous tous les angles, fragmentés à plaisir, a très souvent précédé le monde plus idéal du tableau. Ce marivaudage sérieux, récompense méritée, retiendra les plus grands, de
Last but lot least, le catalogue de l’exposition François Boucher. Fragments d’une vision du monde, qui eut lieu au musée Gl. Holtegaard en 2012, nous arrive enfin. Comme il est superbe, on se dit qu’on a bien fait d’attendre… Montrer François Boucher au Danemark, l’un des pays d’ancrage de «l’Europe française» de Louis Réau, c’était le ramener à la maison! Soixante-dix dessins, rococo à souhait, très déshabillés le plus souvent, résument la trajectoire d’un artiste qui se joua des frontières avec constance. Frontières politiques, on l’a dit. Mais frontières esthétiques au même degré. Françoise Joulie a voulu donner un plein écho à cette plasticité, qui fait passer Boucher du tableau royal au dessin pour amateurs, de la tapisserie au livre illustré, de l’estampe au bibelot, mais aussi du rustique à l’exotique, du religieux au laïc, de la pastorale priapique au stoïcisme romain… La légende du libertin, n’écoutant que sa libido insatiable, n’a plus cours désormais. On préfère peindre le chéri de la Pompadour en redoutable chef d’entreprise, ajusté aux diverses options d’un marché centrifuge. Il n’existait guère de conflit majeur entre Mercure et Vénus. Si le meilleur de Boucher possède l’énergie érotique et l’accent de vérité des meilleurs peintres de nu, c’est que le modèle vivant, femmes et hommes, scrutés sous tous les angles, fragmentés à plaisir, a très souvent précédé le monde plus idéal du tableau. Ce marivaudage sérieux, récompense méritée, retiendra les plus grands, de  Il faut plus que du talent pour réussir le portrait de Diderot. Beaucoup, de son vivant, s’y sont essayés. Très peu ont atteint leur but et comblé le modèle qui connaissait bien la peinture et la sculpture, si bien qu’il s’en méfiait. N’étaient-elles pas trop promptes à embellir et donc affadir la réalité ? Du tableau de Louis Michel Van Loo, où
Il faut plus que du talent pour réussir le portrait de Diderot. Beaucoup, de son vivant, s’y sont essayés. Très peu ont atteint leur but et comblé le modèle qui connaissait bien la peinture et la sculpture, si bien qu’il s’en méfiait. N’étaient-elles pas trop promptes à embellir et donc affadir la réalité ? Du tableau de Louis Michel Van Loo, où  Il vero Polichinello, selon la formule que Diderot s’appliquait, a autant fait souffrir les pinceaux de l’Académie royale, cible captive de ses fameux Salons, que les spécialistes de la
Il vero Polichinello, selon la formule que Diderot s’appliquait, a autant fait souffrir les pinceaux de l’Académie royale, cible captive de ses fameux Salons, que les spécialistes de la  Elle aura été, en fin de compte, bien moins énervée que la rentrée scolaire ! À croire que la littérature n’intéresse plus grand monde. Il faut dire qu’elle fait un peu la gueule, notre littérature. Quand par miracle elle renonce à l’invertébré et au nombrilisme, elle distille trop souvent une misanthropie de bon aloi. Cette tradition a ses classiques, du Rolla de Musset à La Nausée de qui vous savez. Le filon du cafardeux aboutit logiquement à
Elle aura été, en fin de compte, bien moins énervée que la rentrée scolaire ! À croire que la littérature n’intéresse plus grand monde. Il faut dire qu’elle fait un peu la gueule, notre littérature. Quand par miracle elle renonce à l’invertébré et au nombrilisme, elle distille trop souvent une misanthropie de bon aloi. Cette tradition a ses classiques, du Rolla de Musset à La Nausée de qui vous savez. Le filon du cafardeux aboutit logiquement à