
En mai prochain, deux siècles après s’en être allé, Napoléon Ier devrait pouvoir vérifier si la ferveur nationale a baissé ou non à son endroit. Or le combat n’est pas gagné d’avance. Le procès du passé étant devenu ce qu’il est, il ne serait pas étonnant, avouons-le, que l’empereur, cet Aigle, y ait laissé quelques plumes. N’a-t-il pas accumulé « les crimes », pour parler comme Chateaubriand, entre Brumaire et Waterloo ? Creusé lui-même sa tombe après y avoir entraîné des millions d’hommes, sacrifiés à sa mégalomanie pré-hitlérienne ? Le pire, s’agissant de l’ogre insatiable, serait même ailleurs. Car le catalogue de ses méfaits s’est récemment alourdi, au feu des nouveaux catéchismes. Nous étions habitués à lire ou entendre que Bonaparte, nouveau Robespierre, fut un grand massacreur des libertés publiques, sans pitié avec ses ennemis de l’extérieur et de l’intérieur, aussi tyrannique dans les affaires de l’Etat et de l’Art. Que n’a-t-on écrit sur le style Empire, froid, lourd, propagandiste ? Aujourd’hui, c’est l’homme qui rétablit l’esclavage et répudia Joséphine que, de préférence, on condamne et passe par les armes de la bonne conscience anhistorique. D’où l’interrogation immanquable du lecteur après avoir lu le nouvel essai de Philippe Forest au sous-titre biblique : ne s’est-il pas altéré ce « vide » dont nous serions les héritiers, plus que des campagnes militaires, du Code civil ou de l’immense programme esthétique des années 1804-1815, dernier sursaut de l’Europe française ? La thèse du deuil inconsolable, aggravée de siècle en siècle, possède de solides lettres de noblesse, que cite et commente très bien Forest, convoquant Balzac, Hugo, Barrès, Léon Bloy ou Élie Faure. Pareil titan ne saurait mourir, pensaient ces écrivains de l’« uomo di Plutarchia » que Pascal Paoli avait vu en lui… Nous n’en sommes plus là. Forest aime à penser que l’histoire, comme tout récit, ne serait qu’une fiction déterminée par notre présent, une fable, un songe sans substance propre, disponible à toutes nos projections. La fiction de la fiction qu’est le pouvoir, ajouterait Pascal, quand il oublie ses origines. Or Bonaparte n’a jamais nié les siennes, non pas cette Corse dont il fut chassé avec les siens en 1793, mais la succession des dynasties sur le solde desquelles il établit la sienne. Au Salon de 1808, Le Couronnement de David, et non Le Sacre de Napoléon, ne symbolisait pas la prévisible sacralisation du politique moderne, ivre de lui-même. Jacobin rallié, ce peintre que Forest n’aime pas beaucoup y résumait le songe inséparable de l’épopée napoléonienne, la réunion de la monarchie et de la république sous le double regard, métaphore géniale du tableau, de la France et de Dieu. L’histoire n’est pas faite que de mots et d’illusions, elle est ce qui demeure des annales nationales sous le regard changeant des historiens et de ceux qui les lisent. Un roc, comme Sainte-Hélène.

Les romans de Jean-Marie Rouart ont presque tous l’Histoire de France pour compagne obligée, ses héros se mesurent ou se heurtent aux plus grands et, comme eux, rêvent leurs vies autant qu’ils vivent leurs rêves, selon la parole de Drieu que l’écrivain a toujours fait sienne. Tout ainsi le fascine chez Napoléon, l’énergie qu’il déploie et la mélancolie qui l’habite, voire la pulsion de mort qui fait glisser le moderne Alexandre vers l’échec. On n’est pas très étonné de retrouver l’empereur, mais serti de lumière, au détour d’Ils voyagèrent vers des pays perdus, et de le retrouver dans la bouche d’un des deux protagonistes essentiels du livre, De Gaulle himself : « Sa gloire serait moins grande sans le grand roman qu’il a aidé à construire autour de lui. » Cela ne veut pas dire que Bonaparte lui semblait un conquérant de papier, cela signifie que son action et son écho avaient également profité du souffle des écrivains. De Gaulle, dévoreur insatiable de littérature galvanisante, n’a pas agi différemment, dès qu’il s’est donné une dimension épique. Et juin 1940, à cet égard, ne le prit pas par surprise. Avant que Malraux ne le statufie, Paul Morand aurait pu être le scribe providentiel. Mais la rencontre n’eut pas lieu… En poste à Londres, l’homme pressé précipite son retour en France. Sa seule concession à De Gaulle fut l’étonnante Elisabeth de Miribel, longtemps attachée au diplomate, et qui règne sur le petit monde de Carlton Gardens, quartier général de la France libre, quand commence le récit de Rouart. Le 11 novembre 1942, une bombe éclate : Pétain s’est transporté à Alger après que les Allemands eurent envahi la zone libre, fonçant à la rencontre des troupes anglo-américaines fraîchement débarquées en terre d’empire. De Gaulle et son cercle sont effondrés. À Alger, la consternation fait d’autres victimes. Fernand Bonnier de La Chapelle rengaine le 7,65 qu’il réservait à Darlan, lequel entrevoit aussitôt sa réconciliation avec le maréchal. Plus rien n’empêche Pétain de faire éclater la haine de ce Reich qui l’a compromis aux yeux des Français. Le voilà rentré dans l’histoire quand en sortent brusquement De Gaulle et sa bande, Gaston Palewski, Kessel, Druon, Aron et même le jeune Derrida que cette volte-face, agente de la déconstruction, enchante secrètement. Rouart, qui sait qu’un écrivain a tous les droits, prend celui de rebattre les cartes et, plus audacieux encore, pousse la confusion qu’il sème joyeusement jusqu’à faire ondoyer la ligne supposée nette entre bons et méchants. Comme la vie, la vérité historique « est heureusement plus complexe ». Pour l’avoir détournée de son lit habituel et nous faire goûter à la Russie d’un Staline en grande forme, Rouart signe son roman le plus picaresque, d’une verve inflexible, d’une drôlerie continue, et d’une fièvre érotique martialement assumée. C’est dire qu’évoluent, au milieu des vilains messieurs qui font la guerre, de jolies femmes qui font l’amour. Rouart prend le même plaisir à peindre leurs (d)ébats qu’à laisser zigzaguer son récit, vrai comme les songes.

Dès les premiers mots, nous y sommes, en scène, dans l’angoisse de « l’actrice adolescente » qui vient d’y pénétrer. Le nouveau roman de Louis-Antoine Prat s’élance à l’instant même où débute la pièce, un huis-clos peu sartrien, qui en ébauche l’intrigue. C’est que la fiction des planches constitue plus que le décor de L’Imprudence récompensée, titre qui hésite entre Molière et Marivaux : le merveilleux scénique et ses rebonds, heureux ou tragiques, commandent la vie même de ses personnages, de plein gré ou à leur insu. Prenez cette novice, elle surgit de nulle part, et ira où ses 18 ans et sa fausse innocence la portent. Comme le lecteur entraîné par l’incipit, l’éclairagiste ne la quitte pas des yeux, braque ses projecteurs sur le corsage de l’inconnue, brodé de lettres qui invitent peut-être à l’amour. Le romantisme de Prat, sensible dans l’écriture, a toujours aimé les prophéties tissées d’ombre. Deux autres acteurs donnent la réplique, du haut de leur expérience. Il y a l’éternel « vieil homme », et il y a Berthe Bavière, aussi âgée, assez pour avoir joué, « peu avant la Seconde Guerre mondiale, dans des comédies de Guitry où le maître lui réservait des emplois sur mesure ». Ses charmes d’ingénue avaient su troubler un Pierre Laval, un Gaston Palewski, un Paul Reynaud… Mais près de quarante ans ont passé sur l’éclat de sa jeunesse. Car nous sommes en 1975, l’année de l’affaire Meilhan, des attentats d’Orly, de la Loi Veil, du plan de soutien de Giscard aux classes défavorisées… La libération sexuelle ne fait plus la différence entre les catégories sociales, et Guillaume, l’auteur de la pièce qui ouvre le drame, est prêt à se plier aux prouesses de Cythère avec celle que vous savez. Il est pourtant marié à Christine, prénom qui sent le martyre. Elle est riche, raffinée, délaissée. Jusque-là, il ne l’avait trompée qu’en pensée, mais l’épouse malheureuse a compris que, cette fois, Guillaume ne s’en tiendrait pas aux rêveries inactives. « À quarante ans, on n’hésite plus devant grand-chose. » Celle qui donne corps à la tentation, la fille aux corsages affriolants, se prénomme Florence, ressemble à un Bronzino et apporte précisément au roman une insouciance fuyante qu’on dira toscane, bien que le fantôme vénitien de Desdémone plane sur les destins que Prat croise et décroise tout au long d’un récit qui s’encombre rapidement d’un crime atroce et d’une double enquête policière. La vie de Guillaume, si contrôlée, bascule. Il n’aspirait qu’aux succès du théâtre de boulevard, il avait apprivoisé la souffrance que donne la lecture des classiques à ceux qui se savent incapables de les égaler, et l’argent du ménage entretenait l’illusion qu’il était auteur. L’équilibre fragile des couples sans passion réelle, ni vrais désirs, n’exige guère plus qu’une amourette d’été pour voler en éclats. Mais Florence est la fleur dantesque qui relie le Paradis à l’Enfer. Comme toujours chez Prat, les œuvres d’art ont un rôle à jouer, il est ici central. Parti du théâtre, son roman ne peut que s’y refermer, avant que le rideau ne se lève à nouveau.

La fiction, l’histoire de l’art aime de plus en plus s’en vêtir. Dario Gamboni n’emprunte à cette vogue que la forme dialoguée de son dernier livre, sans doute ce que la discipline à produit de mieux en 2020. La marche récente des musées y trouve notamment une occasion de s’examiner. Car le musée tel que nous l’avons connu pourrait disparaître dans les dix-quinze ans à venir. Cette menace touche au tournant global de nos sociétés du loisir ; plus promptes à l’oubli de soi qu’à son perfectionnement, elles n’ont plus besoin du savoir que les « vieux » musées thésaurisaient et diffusaient, certains depuis la Renaissance, en vue de fédérer autour de l’œuvre d’art et ses multiples résonances une communauté de pensée toujours élargie. Ces lieux tiraient leur prestige de la rareté de ce qu’ils montraient et de l’excellence de leur didactisme, mot désormais péjoratif. Il répugne notamment aux pourfendeurs de l’élitisme, qui prônent, vieille lune, l’émotion contre l’érudition, la sensation contre le sens, le confort sans efforts. Les mêmes se réjouissent que certains musées tendent déjà au supermarché pour visiteurs décomplexés, ou se soient transformés en espaces thérapeutiques pour causes vertueuses, voire en succursales communautaristes. À l’aube du présent siècle, des observateurs aussi lucides que Francis Haskell et Jean Clair nous en avaient averti, l’évolution des mœurs muséales et l’attrait du spectaculaire couvaient une trahison de plus grande échelle. Entretemps, la course à la plus-value médiatique s’est amplifiée, entraînant la multiplication des expositions à intérêt réduit, le triomphe du fac-similé, les gestes d’architecte indifférents à l’esprit des lieux, et la disparition ou, du moins, la refonte brutale de ces musées particuliers, plus intimes, qui étaient nés de la volonté d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un collectionneur. En treize chapitres, Gamboni a fait le choix de certains d’entre eux, hors de toute limite géographique. Croyant à la valeur de l’in-situ, en disciple de Quatremère de Quincy, il les a tous revus, il salue donc, en connaissance, certaines nouveautés et déplore surtout ce qui est venu contrecarrer la philosophie de ses « musées d’auteur ». Que les artistes (Vela, Canova…) aient édifié un temple à leur génie, les collectionneurs un palais à leur goût (Isabella Stewart Gardner, Nissim de Camondo…), l’important est qu’ils n’oubliaient jamais la vocation formatrice de leurs « maisons ». Quels que soient les autres motifs à accumuler des œuvres et à les présenter au public, le défi de la mort et de la transmission a toujours sa part dans ces dépôts du temps et du beau, où chaque chose semble occuper une place méditée, parler au visiteur, suggérer un parcours intérieur. La figure du chemin donne au livre de Gamboni son objet, sa manière, sa poésie douce-amère. Luttant contre la nostalgie de son sujet, il se compose d’échanges imaginaires : deux cousins, réunis par un deuil familial, se penchent sur ces drôles d’inventions votives que devraient rester ces musées intimes, à partir desquels une reconquête du domaine semble possible.
Stéphane Guégan
Philippe Forest, Napoléon. La fin et le commencement, Des hommes qui ont fait la France. L’Esprit de la Cité, Gallimard, 16€ // Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, Ils voyagèrent vers des pays perdus, Albin Michel, 21,90€ (en librairie le 7 janvier 2021) /// Louis-Antoine Prat, L’Imprudence récompensée, Editions El Viso, 15€ //// Dario Gamboni, Le Musée comme expérience, Hazan, 29€.
A l’occasion de la reparution de Parallèlement (Hazan, 2020), Verlaine, Bonnard, Vollard et votre serviteur sont les invités de Kathleen Evin et de son Humeur vagabonde, France Inter, samedi 9 janvier 2021, 19:16.
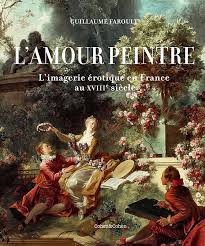



















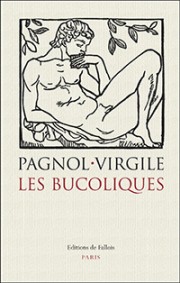
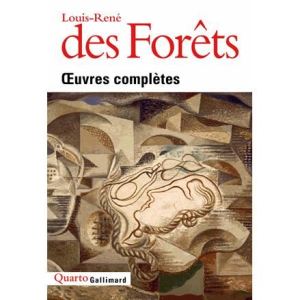



 Notre G6 des lettres classiques s’est longtemps composé de plumes masculines : Boileau, Bossuet et Racine y siégeaient parmi
Notre G6 des lettres classiques s’est longtemps composé de plumes masculines : Boileau, Bossuet et Racine y siégeaient parmi  Le 14 juillet 1673, soit cinq ans avant La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette écrivait ceci à son amie
Le 14 juillet 1673, soit cinq ans avant La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette écrivait ceci à son amie  Nous étions avec
Nous étions avec  Les anniversaires en ce début d’année nous bousculent. Après Le Sacre et ses tempi affolés, Alcools et son ivresse indémodable. Stravinsky, Apollinaire, 1913… Il ne manque que la réouverture du
Les anniversaires en ce début d’année nous bousculent. Après Le Sacre et ses tempi affolés, Alcools et son ivresse indémodable. Stravinsky, Apollinaire, 1913… Il ne manque que la réouverture du  Le livre de Campa, énorme et léger, érudit et vif, maîtrise une information confondante sans y noyer son lecteur. Nombreux et périlleux étaient pourtant les obstacles à surmonter. La Belle époque ne bute-t-elle pas sur la méconnaissance, de plus en en plus répandue, de notre histoire politique? La poésie, elle, n’attire guère les foules, encore moins celle d’une période que l’on présente habituellement comme intermédiaire entre le symbolisme et le surréalisme. Et que dire du milieu pictural, si ouvert et cosmopolite, dont Apollinaire fut l’un des acteurs et des témoins essentiels ! Comment aborder enfin le nationalisme particulier de ce «Russe», né en Italie de père inconnu, et fier de défendre l’art français avant de se jeter dans la guerre de 14 par anti-germanisme ? Or la biographie de Campa ne se laisse jamais déborder par l’ampleur qu’elle s’assigne et la qualité d’écriture qu’elle s’impose. On ne saurait oublier la difficulté majeure de l’entreprise, Apollinaire lui-même et sa méfiance instinctive, nietzschéenne, des catégories auxquelles la librairie française obéissait servilement. Ce n’était pas son moindre charme aux yeux de Picasso. Pour avoir refusé la pensée unique et la tyrannie de l’éphémère, ces dieux du XXe siècle, l’écrivain et le critique d’art restent donc difficiles à saisir. Nos codes s’affolent à sa lecture. Il faut pourtant l’accepter en bloc. On aimerait tant qu’il ait prêché le modernisme sans retenue, au mépris de ce que l’art du jour mettait justement en péril, dans une adhésion totale à chacune des nouveautés dont se réclamaient ses contemporains. Entre 1898 et 1918, de la mort de Mallarmé à la sienne, il fut pourtant tout autre chose que le chantre abusé des avant-gardes européennes.
Le livre de Campa, énorme et léger, érudit et vif, maîtrise une information confondante sans y noyer son lecteur. Nombreux et périlleux étaient pourtant les obstacles à surmonter. La Belle époque ne bute-t-elle pas sur la méconnaissance, de plus en en plus répandue, de notre histoire politique? La poésie, elle, n’attire guère les foules, encore moins celle d’une période que l’on présente habituellement comme intermédiaire entre le symbolisme et le surréalisme. Et que dire du milieu pictural, si ouvert et cosmopolite, dont Apollinaire fut l’un des acteurs et des témoins essentiels ! Comment aborder enfin le nationalisme particulier de ce «Russe», né en Italie de père inconnu, et fier de défendre l’art français avant de se jeter dans la guerre de 14 par anti-germanisme ? Or la biographie de Campa ne se laisse jamais déborder par l’ampleur qu’elle s’assigne et la qualité d’écriture qu’elle s’impose. On ne saurait oublier la difficulté majeure de l’entreprise, Apollinaire lui-même et sa méfiance instinctive, nietzschéenne, des catégories auxquelles la librairie française obéissait servilement. Ce n’était pas son moindre charme aux yeux de Picasso. Pour avoir refusé la pensée unique et la tyrannie de l’éphémère, ces dieux du XXe siècle, l’écrivain et le critique d’art restent donc difficiles à saisir. Nos codes s’affolent à sa lecture. Il faut pourtant l’accepter en bloc. On aimerait tant qu’il ait prêché le modernisme sans retenue, au mépris de ce que l’art du jour mettait justement en péril, dans une adhésion totale à chacune des nouveautés dont se réclamaient ses contemporains. Entre 1898 et 1918, de la mort de Mallarmé à la sienne, il fut pourtant tout autre chose que le chantre abusé des avant-gardes européennes. Fils d’une aventurière, une de ces Polonaises en perpétuel exil qui vivaient de leur charme et de leur intelligence sur la Riviera, Wilhelm de Kostrowitzky a fait de brillantes études avant de convertir son goût des livres en puissance littéraire. D’un lycée à l’autre, au gré des finances aléatoires de sa jolie maman, il s’acoquine à quelques adolescents grandis aussi vite que lui. Certains devaient croiser ses pas plus tard, et se faire un nom à Paris. Sur le moment, on partage déjà tout, les livres interdits,
Fils d’une aventurière, une de ces Polonaises en perpétuel exil qui vivaient de leur charme et de leur intelligence sur la Riviera, Wilhelm de Kostrowitzky a fait de brillantes études avant de convertir son goût des livres en puissance littéraire. D’un lycée à l’autre, au gré des finances aléatoires de sa jolie maman, il s’acoquine à quelques adolescents grandis aussi vite que lui. Certains devaient croiser ses pas plus tard, et se faire un nom à Paris. Sur le moment, on partage déjà tout, les livres interdits,
 Mais le piège des Italiens ne se refermera pas sur Apollinaire, qui reconnaît les vertus roboratives du futurisme. Ainsi son enthousiasme pour Delaunay et la peinture simultanée doit-il s’évaluer à l’aune des tensions du milieu de l’art parisien, gagné par la surchauffe patriotique de l’avant-guerre. En mars 1913, lors du Salon des Indépendants,
Mais le piège des Italiens ne se refermera pas sur Apollinaire, qui reconnaît les vertus roboratives du futurisme. Ainsi son enthousiasme pour Delaunay et la peinture simultanée doit-il s’évaluer à l’aune des tensions du milieu de l’art parisien, gagné par la surchauffe patriotique de l’avant-guerre. En mars 1913, lors du Salon des Indépendants,  De cette guerre, tellement moderne par son alliance de haute technologie et de bas instincts, de mélancolie et d’énergie, de peur et de surpassement de soi, Apollinaire va traduire les tristesses et les beautés. Il en fut l’Ovide et l’Homère. Aux poèmes de l’absence et de l’attente répond l’éclat paradoxal, explosif, de certains calligrammes, qui ont tant fait pour rejeter leur auteur parmi les suppôts d’un «patriotisme niais» ou d’une virilité risible. Il faut croire que notre génération, celle de Laurence Campa, n’a plus de telles préventions à l’égard du poète en uniforme ! Lequel, comme Campa le montre aussi, n’oublie pas le front des arts jusqu’en 1918 (il meurt un jour avant l’armistice !). Ajournés pour cause de conflit, Les Trois Don Juan paraissent en 1915. Là où Apollinaire voyait ou affectait de voir un expédient alimentaire, le lecteur d’aujourd’hui découvre avec bonheur une des plus heureuses divagations, drôles et érotiques à la fois, sur ce grand d’Espagne, obsédé de femmes et repoussant la mort et l’impossible à travers elles. Cette fantaisie admirable, qui absorbe Molière comme Byron sans le moindre scrupule, respire, au plus fort du conflit, l’immoralisme des Onze mille verges… Après son retour du front, le trépané va accumuler les aventures les plus audacieuses, signer des préfaces, seconder les galeries qui se lancent ou se réveillent. Adulé par la nouvelle génération, du Nord/Sud de Reverdy à
De cette guerre, tellement moderne par son alliance de haute technologie et de bas instincts, de mélancolie et d’énergie, de peur et de surpassement de soi, Apollinaire va traduire les tristesses et les beautés. Il en fut l’Ovide et l’Homère. Aux poèmes de l’absence et de l’attente répond l’éclat paradoxal, explosif, de certains calligrammes, qui ont tant fait pour rejeter leur auteur parmi les suppôts d’un «patriotisme niais» ou d’une virilité risible. Il faut croire que notre génération, celle de Laurence Campa, n’a plus de telles préventions à l’égard du poète en uniforme ! Lequel, comme Campa le montre aussi, n’oublie pas le front des arts jusqu’en 1918 (il meurt un jour avant l’armistice !). Ajournés pour cause de conflit, Les Trois Don Juan paraissent en 1915. Là où Apollinaire voyait ou affectait de voir un expédient alimentaire, le lecteur d’aujourd’hui découvre avec bonheur une des plus heureuses divagations, drôles et érotiques à la fois, sur ce grand d’Espagne, obsédé de femmes et repoussant la mort et l’impossible à travers elles. Cette fantaisie admirable, qui absorbe Molière comme Byron sans le moindre scrupule, respire, au plus fort du conflit, l’immoralisme des Onze mille verges… Après son retour du front, le trépané va accumuler les aventures les plus audacieuses, signer des préfaces, seconder les galeries qui se lancent ou se réveillent. Adulé par la nouvelle génération, du Nord/Sud de Reverdy à  Marc Fumaroli n’a pas son pareil pour secouer les certitudes de l’histoire culturelle et rafraîchir notre vision de ce que l’on appelait encore, avant la réforme des programmes scolaires, l’âge classique. Son inutilité semble aujourd’hui une évidence à la plupart des enseignants. Au lieu de s’en attrister une fois de plus, on notera que le mépris des vieilles humanités, poussé à ce degré d’intolérance, rappelle les débats qui avaient agité le monde savant sous
Marc Fumaroli n’a pas son pareil pour secouer les certitudes de l’histoire culturelle et rafraîchir notre vision de ce que l’on appelait encore, avant la réforme des programmes scolaires, l’âge classique. Son inutilité semble aujourd’hui une évidence à la plupart des enseignants. Au lieu de s’en attrister une fois de plus, on notera que le mépris des vieilles humanités, poussé à ce degré d’intolérance, rappelle les débats qui avaient agité le monde savant sous  On ne pouvait pas mieux l’aborder qu’en partant du génial Gracián. L’Homme de cour est le titre fallacieux sous lequel parut, dans une traduction flottante, le grand livre épigrammatique du jésuite espagnol. Autour du roi soleil, les représentants de l’ordre ignacien jouissent alors d’une faveur certaine. C’est qu’ils ont poli leurs griffes avec le même opportunisme qu’Amelot le texte de Gracián, toilettage qui lui valut de devenir un best-seller et un bréviaire de stratégie laïque jusqu’à
On ne pouvait pas mieux l’aborder qu’en partant du génial Gracián. L’Homme de cour est le titre fallacieux sous lequel parut, dans une traduction flottante, le grand livre épigrammatique du jésuite espagnol. Autour du roi soleil, les représentants de l’ordre ignacien jouissent alors d’une faveur certaine. C’est qu’ils ont poli leurs griffes avec le même opportunisme qu’Amelot le texte de Gracián, toilettage qui lui valut de devenir un best-seller et un bréviaire de stratégie laïque jusqu’à  Il fut un temps où l’on n’écrivait guère par vocation sacrée ni obsession d’être publié. Écrire revenait à parler, à converser autrement, librement, à prolonger sa vie plus qu’à la grimer ou la flatter, sans égards pour les bienséances et la censure qu’imposait la chose imprimée. Pour s’être plus que d’autres méfié des servitudes et des risques du livre, Tallemant des Réaux (1619-1682) fut un auteur tardif. On parle bien de bombe à retardement… Il n’a rejoint le cercle des classiques confirmés, ou fréquentables, qu’en 1960, grâce aux bons soins d’Antoine Adam, sourd aux préventions esthétiques et morales qui s’étaient accumulées sur le manuscrit des Historiettes. Cet éminent professeur de la vieille Sorbonne, bon connaisseur du Fracasse de Gautier, cédait volontiers au magnétisme de la littérature Louis XIII. Verdeur de vue et style brutal, souci du détail et mépris de la composition, réalisme en un mot, Tallemant préfère regarder de près que juger de haut. Comme il se fiche de bien écrire, il excelle à brosser son époque telle qu’il l’a vécue. D’autres, dès avant Voltaire, peindront le Grand siècle avec les couleurs guindées d’un mythe toujours vivace. Le témoignage de Tallemant en sape par avance les fondations, la rhétorique, l’hypocrisie, la veulerie ancillaire et la fausse majesté. Dans son admirable préface, vrai morceau de littérature libertine, au sens que le premier XVIIe donnait à ce mot, Michel Jeanneret examine une à une les audaces de cette chronique déniaisée d’un temps qu’on découvre moins corseté, et moins fermé au mouvement brownien des sociétés modernes. Parce qu’elles en recueillent l’écume, récits, intrigues et confessions intimes, les Historiettes épousent le parti et la verve des élites lettrées où le talent l’emportait sur la naissance, le fait et l’effet sur les cachoteries assommantes. Mme de Rambouillet, Mme de Scudéry et Ninon de Lenclos furent les muses d’une fronde des esprits affranchis et des mœurs déliées. Imagine-t-on aujourd’hui une plume capable de s’amuser des plus hauts personnages de l’État comme Tallemant et ses amies le faisaient d’Henri IV, de Richelieu et de Louis XIII ? Verbe et parole découvrent les joies de l’escrime. C’est l’autre cour, celle qui mène à Rétif, aux romantiques et aux Hussards. Nimier assouplissait ses épées en lisant le cardinal de Retz, l’ami de Tallemant… Il fut enterré, belle sortie, non loin de
Il fut un temps où l’on n’écrivait guère par vocation sacrée ni obsession d’être publié. Écrire revenait à parler, à converser autrement, librement, à prolonger sa vie plus qu’à la grimer ou la flatter, sans égards pour les bienséances et la censure qu’imposait la chose imprimée. Pour s’être plus que d’autres méfié des servitudes et des risques du livre, Tallemant des Réaux (1619-1682) fut un auteur tardif. On parle bien de bombe à retardement… Il n’a rejoint le cercle des classiques confirmés, ou fréquentables, qu’en 1960, grâce aux bons soins d’Antoine Adam, sourd aux préventions esthétiques et morales qui s’étaient accumulées sur le manuscrit des Historiettes. Cet éminent professeur de la vieille Sorbonne, bon connaisseur du Fracasse de Gautier, cédait volontiers au magnétisme de la littérature Louis XIII. Verdeur de vue et style brutal, souci du détail et mépris de la composition, réalisme en un mot, Tallemant préfère regarder de près que juger de haut. Comme il se fiche de bien écrire, il excelle à brosser son époque telle qu’il l’a vécue. D’autres, dès avant Voltaire, peindront le Grand siècle avec les couleurs guindées d’un mythe toujours vivace. Le témoignage de Tallemant en sape par avance les fondations, la rhétorique, l’hypocrisie, la veulerie ancillaire et la fausse majesté. Dans son admirable préface, vrai morceau de littérature libertine, au sens que le premier XVIIe donnait à ce mot, Michel Jeanneret examine une à une les audaces de cette chronique déniaisée d’un temps qu’on découvre moins corseté, et moins fermé au mouvement brownien des sociétés modernes. Parce qu’elles en recueillent l’écume, récits, intrigues et confessions intimes, les Historiettes épousent le parti et la verve des élites lettrées où le talent l’emportait sur la naissance, le fait et l’effet sur les cachoteries assommantes. Mme de Rambouillet, Mme de Scudéry et Ninon de Lenclos furent les muses d’une fronde des esprits affranchis et des mœurs déliées. Imagine-t-on aujourd’hui une plume capable de s’amuser des plus hauts personnages de l’État comme Tallemant et ses amies le faisaient d’Henri IV, de Richelieu et de Louis XIII ? Verbe et parole découvrent les joies de l’escrime. C’est l’autre cour, celle qui mène à Rétif, aux romantiques et aux Hussards. Nimier assouplissait ses épées en lisant le cardinal de Retz, l’ami de Tallemant… Il fut enterré, belle sortie, non loin de