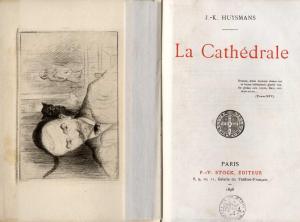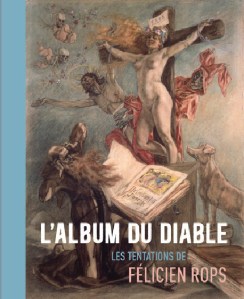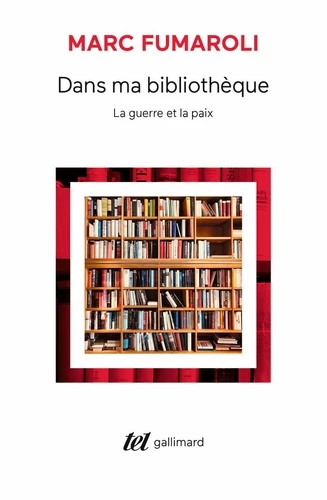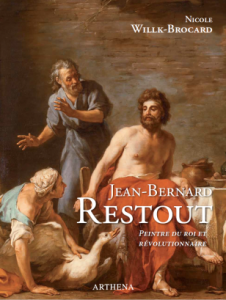Ouvrons ou rouvrons Jean Santeuil, ce merveilleux faux départ de La Recherche. Proust s’amuse déjà à brouiller les pistes, rebaptiser les tableaux et renommer leurs auteurs : « Cette année-là La Gandara exposa au Champ-de-Mars un portrait de Jean Santeuil. Ses anciens camarades d’Henri IV n’auraient certainement pas reconnu l’écolier désordonné […] dans le brillant jeune homme qui semblait encore poser devant tout Paris, sans timidité comme sans bravade […] ». Faut-il que le jeune Marcel ait été snob à 25 ans pour attribuer à Antonio de La Gandara (1861-1917), chéri du faubourg Saint-Germain et de la Plaine Monceau, la paternité d’un tableau réalisé par Jacques-Emile Blanche, et exposé au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts en 1892 ! Snob, Proust l’a été à l’heure de ses chroniques mondaines du Figaro, et l’est resté, pour de bonnes et de mauvaises raisons, les unes et les autres indispensables à l’alchimie cruelle et drôlissime de La Recherche. Parce que noblesse oblige et expose conjointement ses membres aux aléas de la vanité, elle offre à l’observation le spectacle d’une humanité qui balance du superlatif au futile. Plus que l’argent, le luxe, c’est-à-dire la dépense gratuite, scandaleuse au regard de la raison utile, demeure en grande partie l’apanage de l’aristocratie à la charnière des XIXe et XXe siècles. Et si l’on se marie souvent hors de sa caste vers 1900, c’est par instinct de survie et désir d’assurer la continuité d’une civilisation menacée. Autant que les écrivains qu’on dit mondains, les peintres de Salon en furent les auxiliaires, les portraitistes de société en particulier, selon l’étiquette qui a cessé d’être valorisante après 1918. L’Aurélien d’Aragon, ébauché en juin 1940, s’en prend à Picabia, alias Zamora, un peintre passé de mode, comme La Gandara, précise l’œil de Moscou. Notre époque, égarée par sa rancœur sociale, est plus défavorable encore aux pinceaux du gratin. Haro sur la peinture des riches. Même Sargent, à qui le public fait fête en ce moment, a dû en répondre, sous l’injonction de quelques journalistes oublieux que la peinture ne s’évalue pas selon leurs critères, et qu’elle doit une part de son invention formelle et poétique à l’aplomb, sinon à l’orgueil, voire à l’arrogance, de certains de ses motifs.

La réussite d’un portrait de société dépend même de son pouvoir à ne pas écraser sous le rang qu’il incarne l’individu qu’elle éternise, puisque l’immortalité, disait déjà Alberti, est la finalité du genre. Si l’on revient maintenant à La Gandara (mais l’avons-nous quitté ?), il est fascinant de le voir passer en quelques années d’une aristocratie à l’autre, de la butte Montmartre à la Plaine Monceau, de Rodolphe Salis et du Chat noir à la comtesse Greffulhe. Passionnante est ainsi la lecture du catalogue raisonné de son œuvre peint, enfin disponible, et dû à la piété familiale de Xavier Mathieu. Sa persévérance à nous faire connaître et aimer cette peinture qui a déserté les cimaises de nos musées – mais dont de récentes ventes montrent l’attrait qu’elle exerce sur une nouvelle vague de collectionneurs, nous avait déjà valu une monographie et l’exposition du musée Lambinet, le présent catalogue les complète à maints égards.

Publié pour ainsi dire à compte d’auteur, il lui sera pardonné certaines scories, bien excusables au regard de l’information accumulée et des redécouvertes de toutes sortes. L’immense mérite de Xavier Mathieu se mesure, en effet, à sa façon d’étudier les œuvres et leur réception, l’identité des modèles et les liens, souvent de proximité, qui unissaient l’artiste au monde dont il se fit le greffier proustien. Elles défilent, une à une, ces princesses, de plus ou moins grande naissance, ces étoiles de la scène comme Sarah Bernhardt et Ida Rubinstein, ces poétesses tentées aussi par les dorures, telle Anna de Noailles, ou ces femmes de grands écrivains, aussi délaissées que Madame d’Annunzio… La Gandara, si attentif aux robes et accessoires par amour du beau linge, ne renouvelle pas toujours ses formules, mais il ne se répète jamais. Son prestige en souffrirait, son amour-propre aussi. « L’anguille », selon le mot de Colette, qui se fit peindre par lui en 1911, fut-il ce « Whistler de la décadence » que Maurice Guillemot voyait en lui ? La formule est à manier avec des pincettes, compte tenu des modèles de l’artiste et de la double vassalité qu’elle implique. Certes, personne n’a aussi bien croqué Jean Lorrain et son œil éthéré, ou Robert de Montesquiou, aux prises avec sa trouble neurasthénie et son dandysme existentiel. Même Boldini paraît plus retenu en comparaison. Quant au whistlérisme de La Gandara, il relève des raccourcis de la presse et de l’hispanisme commun aux deux peintres. Notre amoureux des dos qui s’éloignent et des profils irrésistibles, ceux de Mme Gautreau ou de la bouillonnante princesse de Caraman-Chimay, n’a pas négligé Watteau et les peintres du Directoire. Quoique de père mexicain et de mère anglaise, Antonio fut français jusqu’au bout des moustaches.

Proust mène aussi à La Gandara à la faveur de portraits bien réels, comme celui de Louisa de Mornand (1864-1963), dont Louis d’Albufera fut toqué avant de se marier (plus convenablement) avec Anna Masséna, princesse d’Essling. Un mariage impérial ! Le musée de Grenoble, à qui il avait été offert en 1935, a déposé la toile à Cabourg, villa du Temps retrouvé ! La robe pervenche aux reflets changeants crisse merveilleusement dans la lumière ; un petit chien, sur les genoux de la belle, rappelle à dessein le XVIIIe siècle français. Exécuté en 1907, la toile a laissé dans la correspondance de Proust, proche du modèle, un écho aux séances de pose : « Quelles heures délicieuses vous devez passer, [La Gandara] est si intéressant, si merveilleusement artiste. » Selon le tome III du Cercle de Marcel Proust, Louisa accéda à 13 ans au monde de la galanterie ; en outre, Marcel lui envoyait ses livres avec des dédicaces salées. Vient de paraître le tome IV de cette admirable série, enrichie régulièrement des recherches en cours sur la sociabilité proustienne. Une des entrées y est consacrée à Albert Flament, dont la date de naissance est rectifiée (1875 et non plus 1877). Ce n’est pas la seule retouche utile que s’autorise Caroline Szylowicz, très au fait des ventes d’autographes et des archives de la Fondation des Treilles. J’ajouterai que Flament, proche de Montesquiou, n’eut guère son pareil pour parler de La Gandara dont il fut le familier. Le site Antonio de La Gandara reproduit un possible portrait de Flament, absent du catalogue raisonné ! Quant au reste de ce tome IV du Cercle de Marcel Proust, il brille par ses lumières sur Helleu, autre pinceau de Salon, Robert Dreyfus (le premier des proches à avoir livré ses souvenirs, rappelle Antoine Compagnon), Louis d’Albufera, qu’on retrouve avec joie, et l’admirable Elisabeth de Clermont-Tonnerre, dont Mathieu Vernet a raison d’épingler la tendance à confondre Proust et sa légende. Mais, dira-t-on, c’était pour la bonne cause.

Attaché à nul cercle, parfait inconnu des lettres, petit provincial orphelin de père et de mère à 25 ans, Bernard Grasset (1881-1955) ne manque pas de culot en revanche. Il fonde sa maison en 1907 avec trois fois rien… Quand il sera devenu l’un des plus grands éditeurs parisiens, il posera pour Blanche à son tour, et en smoking. Cette manière de consécration, en 1924, tendait à effacer les années de guerre, dont il sortit très marqué, et le lâchage de Proust, passé à la concurrence. Ce n’est pas à Grasset qu’avait pensé Marcel, au départ, pour Swann. Il savait Le Temps perdu, premier titre de La Recherche avant sa démultiplication cellulaire, difficile, voire impossible, à publier. En 1909, il qualifiait son « long livre » d’obscène, en pensant aux passages aptes à horrifier Calmann-Lévy, l’éditeur des Plaisirs et des Jours (ce chef-d’œuvre de dissimulation au regard des « mœurs »). Peu éditable, le livre l’est non moins en raison de son état alors : sa dactylographie prendra trois ans ! 1912, annus horribilis, est celle du refus que lui opposent Gide et Schlumberger au nom des Editions de la NRF. Ils ont longtemps maquillé les raisons de ce refus, prétextant que le snobisme de Proust, collaborateur du Figaro, et l’énormité de l’ouvrage les avaient décidés, et non sa lecture. Nous savons depuis 1999 que les piliers de la NRF hésitèrent, une semaine entière, au lu d’un manuscrit qui dut autant les fasciner que les glacer. Quoi qu’il en soit, René Blum, le frère de Léon et son égal en raffinement littéraire, rabattit Proust vers le jeune Grasset en février 1913. C’est ainsi que Le Temps perdu devint Du côté de chez Swann au prix, écrit Pascal Fouché, d’« une avalanche de corrections » et des rallonges d’argent de l’auteur, puisque les frais d’édition et le surcoût des va-et-vient d’épreuves furent à sa charge. « Achevé d’imprimer », le 8 novembre, tiré à 2217 exemplaires, le livre reçoit bon accueil, Blanche signant la recension la plus percutante. La guerre devait rebattre les cartes, et Grasset se retirer du jeu en 1916, sans se rendre compte, écrit Fouché, « que ce renoncement restera comme un moment clé de sa vie d’éditeur ». La si vive correspondance Grasset-Proust, passionnante en soi, ouvre un vaste champ d’analyses au savantissime Paul Fouché, et au lecteur un trésor de données nouvelles quant à l’économie, en tout sens, de ce Swann impubliable, mais gros d’une mythologie à venir.
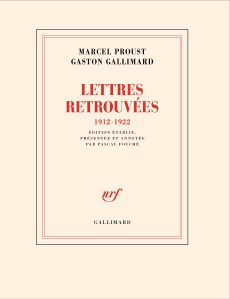
Dès janvier 1914, informé que certains éditeurs cherchent à détacher Proust de Grasset, la NRF, par la voix de Gide, tente une approche mi-cavalière, mi-pénitentielle. « Grave erreur », « honte » et « remords cuisants » succèdent, dans cette lettre célèbre, à l’aveu d’une lecture qui s’avoue gloutonne. Une série d’événements allaient jouer en faveur des repentis. La mort accidentelle d’Agostinelli, en mai, brise Proust et, ainsi qu’il l’écrit à Montesquiou, lui fait renoncer à corriger les épreuves du « second volume ». La NRF en donne tout de même des extraits en juin et juillet 1914. Rien n’est gagné encore, c’est la guerre qui met fin, écrit Fouché, à l’aventure Grasset. A l’ombre des jeunes filles en fleurs passe sous le pavillon des Editions de la NRF, confiées à Gaston Gallimard, au cours de l’hiver 1916. Trois ans seront nécessaires au lissage du texte et aux tractations entre un éditeur, entièrement acquis à l’écrivain, et un auteur très difficile à satisfaire en matière contractuelle et éditoriale. Car les négociations roulent sur les Jeunes filles, une nouvelle édition de Swann et le volume des Pastiches et mélanges. Quand Gaston et Marcel ne parlent pas chiffres et épreuves, la peinture les soude un peu plus, moins La Gandara, que Renoir, Cézanne, Manet et Lautrec. Mais leur correspondance de chats, désormais abondée de lettres inédites ou retranscrites, croise « l’ancien monde » à l’occasion, de Louisa de Mornand à Albert Flament, auquel Proust fait envoyer les Jeunes filles pour recension. Le dossier de presse du Prix Goncourt 1919, si bien étudié par Thierry Laget, ne comporte aucun article de lui ! Gardons le meilleur pour la fin, à savoir la dédicace que Proust fit à Gaston, le 29 avril 1921, du Côté de Guermantes, II : « A vous mon cher Gaston que j’aime de tout mon cœur (bien que vous pensiez quelquefois le contraire !) et avec qui ce serait gentil de passer de longues et réconfortantes soirées. Mais vous ne prenez jamais l’initiative. Les miennes échouent toujours devant mon téléphone aussi éloignant qu’au temps où vous refusiez Swann. Votre bien reconnaissant et bien fidèle et bien tendre ami. Marcel Proust. » Après la grande boucherie, le retour de l’âge d’or. Stéphane Guégan

Xavier Mathieu, Antonio de La Gandara. Le catalogue de son œuvre, 1861-1917, préface de Jean-David Jumeau-Lafond, Association des Amis d’Antonio de La Gandara, 170€ // Le Cercle de Marcel Proust, IV, actes du colloque organisé par Jérôme Bastianelli et Jean-Yves Tadié, édités sous la direction d’Elyane Dezon-Jones, Honoré Champion, 2025, 42€ // Marcel Proust et Bernard Grasset, Correspondance, précédée de Proust chez Grasset, une aventure éditoriale, Pascal Fouché (éd.), Grasset, 25€ // Marcel Proust / Gaston Gallimard, Lettres retrouvées 1912-1922, édition établie, présentée et annotée par Pascal Fouché, Gallimard, 21€ / La livraison d’automne de la NRF (n°662, septembre 2025, 20€) amplifie la moisson proustienne de quelques perles, à commencer par deux lettres de Jacques Rivière retrouvées dans les papiers de Bernard de Fallois. Elles ont trait à l’article de Proust sur Flaubert et à celui de Rivière sur Proust, respectivement NRF janvier et février 1920. Alban Cerisier éclaire justement ce doublé programmatif après la relance de la revue en juin 1919. De son côté, Pascal Fouché réexamine, à partir de lettres inédites, les difficiles relations que Proust entretint avec Calmann-Lévy, qui aurait pu être l’éditeur de Jean Santeuil, le roman de l’Affaire Dreyfus.
VUS, LUS, REÇUS
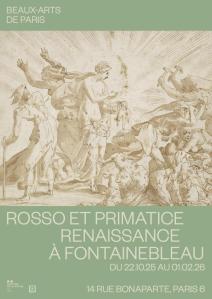
Il y a le génie des lieux, l’eau, la nature, les pierres, l’architecture, et il y a les génies du lieu, le florentin Rosso et le mantouan Primatice, réunis par le mécénat de François Ier, à la tête d’une équipe d’artistes et d’artisans dont le roi attend qu’ils transportent Rome en France. Les premières traces du chantier remontent à 1527, l’année du sac de la ville de saint Pierre. Le transfert symbolique que rêve François Ier, plus malheureux dans l’art de la guerre, a fasciné Louis Dimier, que Proust lisait dans L’Action française. Notre Renaissance continue à éblouir tout visiteur du château de Fontainebleau qui a plutôt bien traversé les siècles, la galerie d’Ulysse mise à art, détruite sous Louis XV. Le mariage du politique, du sacré et de l’érotique y trouva un espace adapté aux plus ambitieux desseins. Riche d’une cinquantaine de dessins et estampes à couper le souffle, tant le gracieux et son contraire font assaut d’invention, l’exposition des Beaux-Arts de Paris ne sépare jamais les décors, que ces feuillent préparent souvent, du bâtiment même. Le public progresse comme s’il s’y trouvait, de programme en programme. Heureux temps où il était encore loisible de parler de « maniérisme » (mot aujourd’hui démonétisé) à propos de ces corps dilatés, de ces visages tourmentés et de ces lumières en zigzag ! Bornons-nous à saluer ce corpus magnifique et ce travail d’une érudition époustouflante. La Mort de Sémélé de Léon Davent d’après Primatice, inouïe de sensualité et de pathos, annonce le grand Poussin, aussi bellifontain que Picasso. SG / Rosso et Primatice. Renaissance à Fontainebleau, Beaux-Arts de Paris, jusqu’au 1er février 2026, catalogue sous la direction des commissaires, Hélène Gasnault et Giulia Longo, avec la participation de Luisa Capodieci et Dominique Cordellier, Beaux-Arts de Paris éditions, 25€.

Qu’il y eût opportunité, et même nécessité, à consacrer au peintre David une nouvelle « synthèse » en cette année du centenaire de sa mort, nul ne le nierait. David Chanteranne, 51 ans, et trente de recherche napoléonienne à son actif, s’est donc lancé avec hardiesse et un certain panache dans son écriture, fréquent chez les experts de Bonaparte. Ce n’est pas sa première tentative en terre davidienne. En 2004, l’auteur contribuait largement au succès de l’exposition consacrée au Sacre, le tableau et la chose, aux côtés de Sylvain Laveissière, Anne Dion et Alain Pougetoux. Déjà un anniversaire ! Exposition qui, doublée par la publication d’un remarquable album de Jean Tulard, rappelait, s’il était besoin, la passion des ex-Jacobins pour l’Empereur (lui-même très admiratif de Robespierre avant 1800). Conscient que tout se touche, Chanteranne s’est gardé de sacrifier l’empereur des peintres au peintre de l’empereur. Son livre couvre donc la longue carrière de David, mêlée de politique, et évite l’anachronisme de l’artiste prérévolutionnaire, cher à Thomas Crow, écrit « Crown » dans la bibliographie (sublime coquille, sans gravité). On pourrait chipoter ça et là : le Jupiter et Antiope de Sens, s’il est du tout jeune David – ce qu’on aimerait croire en raison de sa parenté avec François Boucher, a peu de chance d’être un tableau de concours. Par ailleurs, le crédit que l’auteur accorde aux « autobiographies » de David et aux écrits de sa descendance mériterait d’être modéré de temps en temps. Quoi qu’il en soit, le livre existe, il a été conçu avec sérieux et écrit avec esprit. SG / David Chanteranne, Jacques-Louis David. L’empereur des peintres, Passés/composés, 2025, 24€. Voir aussi Sébastien Allard, Jacques-Louis David, carnet d’expo, Gallimard/Musée du Louvre, 11,50€ et ma recension de la présente exposition dans Commentaire (https://www.commentaire.fr/peinture-et-politique-exposer-david/).

L’index d’un livre en dit beaucoup, plus parfois que l’auteur ne le souhaiterait lui-même. Prenez le magistral volume des Essais littéraires d’Aragon (La Pléiade, 2025, 86€) et promenez-vous dans les allées bien sarclées des noms et titres d’ouvrage qu’il recense avec le soin infaillible de Rodolphe Perez. Que Hugo et Rimbaud dominent la liste, rien d’anormal, Aragon fut un mélange instable des deux. Il est plus piquant de constater que Barrès l’emporte sur Balzac, Lénine sur Flaubert, Gorki sur Drieu, et que Musset égale à peu près Baudelaire. On est moins étonné de trouver, en situation éminente, Lewis Carroll : Aragon aura contribué à son installation au sein du panthéon littéraire, note Philippe Jaworski en tête de la délicieuse et savante édition qu’il nous propose des Alice et de La Chasse au Snark, l’ensemble étant assorti des illustrations originelles et d’un bouquet d’autres. Ah, les surréalistes, que serions-nous sans eux ? A en croire la rumeur, nous devrions à ces éternels enfants le débarquement de Carroll sur nos plages. Il est vrai qu’Aragon, encouragé par Nancy Cunard, s’agite dès 1929 et confirme, deux ans plus tard, l’adoubement de l’Anglais qui a su, le rire en bandoulière, révéler le nonsense et l’étrange constitutifs de l’enfance. L’enfant sage que fut Louis se venge des livres édifiants dont il fut gavé (catéchisme où il passera maître devenu communiste). Je n’ai jamais pu croire que Breton et sa bande aient inauguré la fortune française de Carroll, et ce que nous apprend le volume de Jaworski conforte mes doutes. Entre 1869, date de sa première édition française, et 1907, date de la démultiplication des éditions illustrées (notamment celle, sublime, d’Arthur Rakham), on imagine mal que le milieu parisien soit resté sourd aux beautés hilarantes et terrifiantes du Londonien. Du reste, en 1931, Gringoire, à la faveur d’une nouvelle traduction, rappelait à ses lecteurs que Proust « goûtait fort » cette œuvre insolite, née de l’onirisme qu’elle met en scène, à la manière de La Recherche. SG / Lewis Carroll, Alice suivi de La Chasse au Snark, édition bilingue et traductions nouvelles de Philippe Jaworski, 207 illustrations, Gallimard, La Bibliothèque de La Pléiade, 64€.
On en parle !
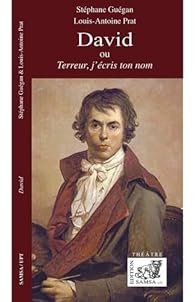
Luc-Antoine Lenoir, « Fin de règne », Le Figaro, Hors-Série David, 2025, à propos de David ou Terreur, j’écris ton nom, de Stéphane Guégan et Louis-Antoine Prat, Samsa éditions, Bruxelles, 12€ : « On se régale des tournures habiles, des répliques qui claquent, à destination de Joseph-Marie Vien ou d’Élisabeth Vigée Le Brun, des jugements lapidaires sur les tableaux des autres. […] Les auteurs de cette pièce inclassable sont des historiens de l’art […]. On les découvre dramaturges tout aussi convaincants. Leur David a de l’aisance, presque des convictions dans l’arrivisme ; il avance avec une résolution tranquille vers les lieux où se décide la réputation. […] Vient la Révolution. Les dialogues restituent l’emphase d’un monde qui se croit nouveau : serments, grands mots, promesses d’innocence retrouvée. Robespierre est un ami et, avec lui, David s’engage pleinement pour la Terreur. […] Reste la question qui fâche : jusqu’où l’art peut-il justifier l’action qu’il magnifie ? Après l’épreuve, Bonaparte entre en scène, puis Napoléon. S’ensuit un étonnant dialogue critique sur Le Sacre. L’Empereur sait qu’il devra désormais une part de sa gloire au peintre et lui confie ses attentes politiques […]. Après cette acmé, le peintre n’aura plus que des souvenirs. La mélancolie s’installe en aval d’une vie d’aventures. Il ne sait plus s’il fut témoin ou acteur de son siècle. On sort de cette lecture – en attendant l’adaptation sur les planches ? – un peu plus clairvoyant sur les relations de l’art et du pouvoir, et surtout, ému. Au théâtre, c’est toujours une victoire. »