 Comment croire au divorce qu’on dit consommé entre nous et les grands Anciens? La langue des poètes latins est-elle si morte que ça? L’étudier si vain? Ces questions d’actualité, Virgile les tranche en sa faveur. Il n’est que d’ouvrir son œuvre «impérissable», disaient gravement nos professeurs, dont nous avions tort de pouffer. L’avenir le prouverait. L’avenir, c’est ce volume de La Pléiade, 1200 pages d’intensité intacte, bilinguisme parfait et cuir vert, comme le printemps éternel du cygne de Mantoue.
Comment croire au divorce qu’on dit consommé entre nous et les grands Anciens? La langue des poètes latins est-elle si morte que ça? L’étudier si vain? Ces questions d’actualité, Virgile les tranche en sa faveur. Il n’est que d’ouvrir son œuvre «impérissable», disaient gravement nos professeurs, dont nous avions tort de pouffer. L’avenir le prouverait. L’avenir, c’est ce volume de La Pléiade, 1200 pages d’intensité intacte, bilinguisme parfait et cuir vert, comme le printemps éternel du cygne de Mantoue.
Tout y est, Les Bucoliques, Les Géorgiques et L’Énéide, dont on ne remerciera jamais assez Auguste d’en avoir interdit la destruction contre l’avis de l’auteur, saisi de mauvais scrupules à son dernier souffle… Cette édition n’aurait pas été complète sans les textes controversés, mais délectables, qu’on lui attribue hypothétiquement. On ne prête qu’aux riches, c’est si vrai concernant Virgile! Les Bucoliques, dont Gide et Mallarmé rêvèrent d’égaler les églogues amoureuses, prennent d’emblée possession de leur lecteur: «Tityre, toi, […] tu médites un poème des bois.» La simplicité agreste, presque terrienne, du poète dénonce par avance le mièvre de certains de ses imitateurs. Théocrite avait trouvé un héritier direct, l’antique Grèce son extension naturelle, Rome était dans son rôle. L’Italie des récoltes généreuses, le pays des faunes et des ombres courtes, Les Géorgiques en disent la beauté brûlante. C’est l’âge d’or tel que seules les époques troublées parviennent à l’imaginer et à l’imposer aux imaginations, en estompant les souffrances qui s’y rencontrent du «voile» dont parle Sainte-Beuve. Baudelaire, qui avait récolté quelques prix de latin au collège, a bien lu le deuxième livre des Géorgiques et le fait miroiter dans son propre Cygne, où la modernité parisienne, fascinante et angoissante, réveille le souvenir des grandes douleurs d’Andromaque. L’Énéide, troisième opus et suprême effort, hante ainsi Les Fleurs du Mal comme elle se lit derrière bien des pages de Racine, Chateaubriand et Proust, ou nombre de toiles de Poussin, Ingres, Masson et Picasso. Le poète césarien s’attaque donc à l’épopée, genre supérieur, au soir d’une existence moins paisible qu’on ne le croit. Le renversement qu’il opère au regard du modèle homérique, placer L’Odyssée avant L’Iliade, lui permet d’introduire dans la peinture de la violence guerrière, et la violence la plus crue, un effet de miroir et un hommage aux dieux qui avaient permis de fermer le cycle infernal des guerres civiles. Comme Les Bucoliques, L’Énéide s’offre dans une nouvelle traduction, que les plus savants liront parallèlement au texte latin… Bien d’autres, avant nous, n’ont pas cru déchoir, être moins modernes, en procédant ainsi. Philippe Huzé, qui signe l’une des introductions du volume, rend hommage à ces passeurs, ces vecteurs d’admiration, ces vérificateurs de l’adage formulé par Jacques Perret: «Un chef-d’œuvre grandit de tous les chefs-d’œuvre qu’il suscite».
Stéphane Guégan
*Virgile, Œuvres complètes, édition bilingue, établie par Jeanne Dion et Philippe Huzé, avec Alain Michel pour Les Géorgiques, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 59€.
 Cette année, l’album de la Pléiade emprunte son masque vénitien à Hugo Pratt et achève en beauté la canonisation du divin Casanova. Paraissent, en effet, au même moment, les tomes II et III d’Histoire de ma vie, qui couvrent la période des aventures allant de la fameuse évasion des Piombi à l’année 1774. Le mémorialiste ne poussera pas plus loin le récit de son destin nomade et libertin, fidèle à la promesse qu’il a faite à son lecteur de ne pas l’ennuyer avec la comptabilité du vieil âge. Les «folies de la jeunesse», pense-t-il, servent mieux son livre et la littérature. Car Casanova peut désormais être reconnu pleinement pour un maître des lettres françaises. SG
Cette année, l’album de la Pléiade emprunte son masque vénitien à Hugo Pratt et achève en beauté la canonisation du divin Casanova. Paraissent, en effet, au même moment, les tomes II et III d’Histoire de ma vie, qui couvrent la période des aventures allant de la fameuse évasion des Piombi à l’année 1774. Le mémorialiste ne poussera pas plus loin le récit de son destin nomade et libertin, fidèle à la promesse qu’il a faite à son lecteur de ne pas l’ennuyer avec la comptabilité du vieil âge. Les «folies de la jeunesse», pense-t-il, servent mieux son livre et la littérature. Car Casanova peut désormais être reconnu pleinement pour un maître des lettres françaises. SG
 Deux siècles ont été nécessaires à cette petite révolution de palais, au sens gustatif du terme. Et Stendhal aujourd’hui retirerait les propos rudes que lui avait inspirés cette autobiographie unique en sa première édition, proprement monstrueuse. Enfant dénaturé d’une double traduction, du français vers l’allemand, puis de l’allemand au français, elle fit malgré tout son petit effet dans le Paris de la Restauration, comme le note Michel Delon en tête de l’album. Sainte-Beuve pressent un écrivain de la race des Sévigné et des Bussy là où le bibliophile Jacob croit deviner un faux de Stendhal… La méprise est belle, elle est digne de la liberté de ton et d’invention qui court à travers le texte et dont on prend enfin la pleine mesure. Faut-il s’évertuer à y démêler le faux du vrai quand Casanova lui-même se vantait d’avoir mis en scène sa vie avant de la mettre en mots? Delon a construit son nouveau Casanova sur l’ubiquité première de sa personne et de son personnage, réunis à travers le regard unifié du texte qui nous y donne accès. Le peu d’images fiables de l’écrivain semble confirmer son art du dédoublement et son goût de la diversité. L’album se referme sur les incarnations cinématographiques d’un séducteur dont le grand écran s’est vite emparé. Dernier avatar d’une longue série, le film d’Albert Serra, Histoire de ma mort, a retrouvé autrement la truculence de Fellini et nous rappelle que Casanova a aimé les belles comme les laides, les jeunes comme les vieilles, par amour de ce qui ne s’explique pas. SG
Deux siècles ont été nécessaires à cette petite révolution de palais, au sens gustatif du terme. Et Stendhal aujourd’hui retirerait les propos rudes que lui avait inspirés cette autobiographie unique en sa première édition, proprement monstrueuse. Enfant dénaturé d’une double traduction, du français vers l’allemand, puis de l’allemand au français, elle fit malgré tout son petit effet dans le Paris de la Restauration, comme le note Michel Delon en tête de l’album. Sainte-Beuve pressent un écrivain de la race des Sévigné et des Bussy là où le bibliophile Jacob croit deviner un faux de Stendhal… La méprise est belle, elle est digne de la liberté de ton et d’invention qui court à travers le texte et dont on prend enfin la pleine mesure. Faut-il s’évertuer à y démêler le faux du vrai quand Casanova lui-même se vantait d’avoir mis en scène sa vie avant de la mettre en mots? Delon a construit son nouveau Casanova sur l’ubiquité première de sa personne et de son personnage, réunis à travers le regard unifié du texte qui nous y donne accès. Le peu d’images fiables de l’écrivain semble confirmer son art du dédoublement et son goût de la diversité. L’album se referme sur les incarnations cinématographiques d’un séducteur dont le grand écran s’est vite emparé. Dernier avatar d’une longue série, le film d’Albert Serra, Histoire de ma mort, a retrouvé autrement la truculence de Fellini et nous rappelle que Casanova a aimé les belles comme les laides, les jeunes comme les vieilles, par amour de ce qui ne s’explique pas. SG
– Casanova, Histoire de ma vie, tomes 2 et 3, édition établie sous la direction de Gérard Lahouati et Marie-Françoise Luna, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 57,50€.
 Il y a de bonnes manières de rajeunir les classiques, et il y en a de fort mauvaises. La mise en scène de théâtre et d’opéra nous le démontre tous les jours. À rebours des lectures qui abusent de l’appropriation et de l’anachronisme, et vident le répertoire de sa substance pour complaire à nos «attentes éclairées», l’Eschyle de Florence Dupont remonte le temps et nous confronte aux pratiques et aux besoins d’une société très différente de la nôtre. L’illusion d’un héritage continu, pérenne et sévère, et celle d’un code tragique, qui privilégie le texte épuré sur la performance vivante, viennent d’Aristote, elles volent toutes deux ici en éclats. Ce petit bijou d’érudition, d’intelligence et d’humour, est le premier titre d’une collection prometteuse. Avant d’éclairer le sens des sept tragédies qui forment le «corpus» d’Eschyle, Florence Dupont s’attelle à déconstruire l’idée qui a longtemps prévalu de leur auteur et de leur fonction. Car le supposé père du drame moderne, le prétendu Shakespeare grec, eût été très étonné de s’entendre nommer ainsi, lui dont «l’écriture» ne formait pas l’état. «C’est au mieux une responsabilité civique», précise Florence Dupont. Ce que nous appelons les «œuvres» d’Eschyle n’en font pas un écrivain au sens actuel du mot, d’autant plus que ce catalogue, qui compta plus de cent pièces, s’est vu progressivement châtré de sa musique et de ses effets scéniques les plus détonants. Devenu l’un des pères de la nation athénienne, un siècle après sa mort, le grand homme va petit à petit servir de caution à une esthétique qu’il n’aurait pas cautionnée. Ses «écritures éphémères» étaient ainsi condamnées à se figer et se décolorer. Qu’il traite de la guerre contre les Perses, du destin d’Œdipe ou d’Oreste, la préoccupation principale d’Eschyle, vis-à-vis d’un public avide de passions fortes et de situations pathétiques, était de faire chanter, danser, agir le chœur autour duquel l’action s’enveloppait. Florence Dupont y insiste, au Ve siècle av J.-C., le texte ne précède pas la mise en scène, il n’est pas destiné à être lu, mais à être joué, et sa diffusion est soumise au greffier de la cité. Si l’oralité vouait certaines pièces à disparaître, la perte de leur esprit initial fut plus grave encore. Au fil des siècles, Eschyle rétrécit et se métamorphose. Mal aimé de l’âge dit classique, en raison des obscurités d’un texte désormais orphelin de la scène athénienne, il ne connaît de revalorisation qu’après 1750. De Diderot à Barthes, en passant par Hugo, Gautier, Leconte de Lisle et Claudel, Eschyle devint alors un classique du primitivisme barbare! SG
Il y a de bonnes manières de rajeunir les classiques, et il y en a de fort mauvaises. La mise en scène de théâtre et d’opéra nous le démontre tous les jours. À rebours des lectures qui abusent de l’appropriation et de l’anachronisme, et vident le répertoire de sa substance pour complaire à nos «attentes éclairées», l’Eschyle de Florence Dupont remonte le temps et nous confronte aux pratiques et aux besoins d’une société très différente de la nôtre. L’illusion d’un héritage continu, pérenne et sévère, et celle d’un code tragique, qui privilégie le texte épuré sur la performance vivante, viennent d’Aristote, elles volent toutes deux ici en éclats. Ce petit bijou d’érudition, d’intelligence et d’humour, est le premier titre d’une collection prometteuse. Avant d’éclairer le sens des sept tragédies qui forment le «corpus» d’Eschyle, Florence Dupont s’attelle à déconstruire l’idée qui a longtemps prévalu de leur auteur et de leur fonction. Car le supposé père du drame moderne, le prétendu Shakespeare grec, eût été très étonné de s’entendre nommer ainsi, lui dont «l’écriture» ne formait pas l’état. «C’est au mieux une responsabilité civique», précise Florence Dupont. Ce que nous appelons les «œuvres» d’Eschyle n’en font pas un écrivain au sens actuel du mot, d’autant plus que ce catalogue, qui compta plus de cent pièces, s’est vu progressivement châtré de sa musique et de ses effets scéniques les plus détonants. Devenu l’un des pères de la nation athénienne, un siècle après sa mort, le grand homme va petit à petit servir de caution à une esthétique qu’il n’aurait pas cautionnée. Ses «écritures éphémères» étaient ainsi condamnées à se figer et se décolorer. Qu’il traite de la guerre contre les Perses, du destin d’Œdipe ou d’Oreste, la préoccupation principale d’Eschyle, vis-à-vis d’un public avide de passions fortes et de situations pathétiques, était de faire chanter, danser, agir le chœur autour duquel l’action s’enveloppait. Florence Dupont y insiste, au Ve siècle av J.-C., le texte ne précède pas la mise en scène, il n’est pas destiné à être lu, mais à être joué, et sa diffusion est soumise au greffier de la cité. Si l’oralité vouait certaines pièces à disparaître, la perte de leur esprit initial fut plus grave encore. Au fil des siècles, Eschyle rétrécit et se métamorphose. Mal aimé de l’âge dit classique, en raison des obscurités d’un texte désormais orphelin de la scène athénienne, il ne connaît de revalorisation qu’après 1750. De Diderot à Barthes, en passant par Hugo, Gautier, Leconte de Lisle et Claudel, Eschyle devint alors un classique du primitivisme barbare! SG
*Florence Dupont, Eschyle, Ides et Calendes, coll. Le Théâtre de, 10€.




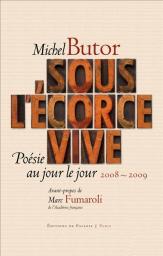
 Une lettre d’écrivain n’est pas un acte d’écriture comme les autres. Et quand le destinataire se trouve être aussi un homme ou une femme de plume, l’affaire se complique terriblement. Quatre livres indispensables en apportent la preuve, traversés qu’ils sont par la même fascination du pouvoir des mots et ce qu’on peut leur fait jouer. De Gide à Kerouac, en passant par Paulhan et Beckett, ces correspondances se construisent sur la fiction qu’elles fondent. Puis, un beau jour, les faux-semblants se délitent et le verbe, en sa vérité foncière, reprend alors ses droits. Gide, donc, le grand Gide, grand surtout par son
Une lettre d’écrivain n’est pas un acte d’écriture comme les autres. Et quand le destinataire se trouve être aussi un homme ou une femme de plume, l’affaire se complique terriblement. Quatre livres indispensables en apportent la preuve, traversés qu’ils sont par la même fascination du pouvoir des mots et ce qu’on peut leur fait jouer. De Gide à Kerouac, en passant par Paulhan et Beckett, ces correspondances se construisent sur la fiction qu’elles fondent. Puis, un beau jour, les faux-semblants se délitent et le verbe, en sa vérité foncière, reprend alors ses droits. Gide, donc, le grand Gide, grand surtout par son  Si curieux qu’il soit aussi, l’attelage que formèrent Bloch et Paulhan ressemble au précédent par les différences et les dissensions qu’il eut à constamment vaincre. De même âge, ayant fait ainsi l’expérience de la guerre de 14-18 à trente ans, le second avec plus de vaillance et moins de scrupule idéologique que le premier, ils se croisent, à l’été 1920, dans les bureaux de la N.R.F, dont Paulhan vient d’être nommé secrétaire général. Il en prendra la direction, comme on sait, en février 1925, à la mort de
Si curieux qu’il soit aussi, l’attelage que formèrent Bloch et Paulhan ressemble au précédent par les différences et les dissensions qu’il eut à constamment vaincre. De même âge, ayant fait ainsi l’expérience de la guerre de 14-18 à trente ans, le second avec plus de vaillance et moins de scrupule idéologique que le premier, ils se croisent, à l’été 1920, dans les bureaux de la N.R.F, dont Paulhan vient d’être nommé secrétaire général. Il en prendra la direction, comme on sait, en février 1925, à la mort de Indiscutable, inaliénable fut la fibre française du jeune Beckett, qui endura les «années noires» sur le sol élu et se mêla à la nébuleuse de la résistance intellectuelle. Sa correspondance confirme, s’il était besoin, son attachement au pays de Baudelaire, Rimbaud, Gide et Proust, quatre de ses auteurs de prédilection. Mais il en est beaucoup d’autres. Rien, à dire vrai, ne lui échappe au cours des années 1920-1930, d’Éluard et Breton qu’il traduit, à
Indiscutable, inaliénable fut la fibre française du jeune Beckett, qui endura les «années noires» sur le sol élu et se mêla à la nébuleuse de la résistance intellectuelle. Sa correspondance confirme, s’il était besoin, son attachement au pays de Baudelaire, Rimbaud, Gide et Proust, quatre de ses auteurs de prédilection. Mais il en est beaucoup d’autres. Rien, à dire vrai, ne lui échappe au cours des années 1920-1930, d’Éluard et Breton qu’il traduit, à  Fils d’un mulâtre de Saint-Domingue qui avait fini général d’Empire – le fameux «diable noir» craint des Autrichiens et même de Bonaparte – , le bel Alexandre était fier de sa crinière crépue et sûr de son ascendant sur les dames. L’une d’entre elles, la célèbre Mélanie Waldor, ne lésinait pas sur les épithètes, dans ses tendres missives, pour rallumer une flamme déjà éteinte en 1831. «Sang africain», «âme de feu», le ton était celui de la passion ardente, ardente et meurtrie. Le premier volume de la correspondance de Dumas, éditée par le très savant
Fils d’un mulâtre de Saint-Domingue qui avait fini général d’Empire – le fameux «diable noir» craint des Autrichiens et même de Bonaparte – , le bel Alexandre était fier de sa crinière crépue et sûr de son ascendant sur les dames. L’une d’entre elles, la célèbre Mélanie Waldor, ne lésinait pas sur les épithètes, dans ses tendres missives, pour rallumer une flamme déjà éteinte en 1831. «Sang africain», «âme de feu», le ton était celui de la passion ardente, ardente et meurtrie. Le premier volume de la correspondance de Dumas, éditée par le très savant
 Un bon roman n’est jamais l’effet du hasard, surtout quand il fait des caprices du destin le levier de ses «incroyables» coups de théâtre. La mécanique romanesque tient davantage du complot réussi. C’est pourquoi les conspirations, les sociétés secrètes et les agents doubles ont toujours tenté la littérature la plus ouverte à ses propres jeux.
Un bon roman n’est jamais l’effet du hasard, surtout quand il fait des caprices du destin le levier de ses «incroyables» coups de théâtre. La mécanique romanesque tient davantage du complot réussi. C’est pourquoi les conspirations, les sociétés secrètes et les agents doubles ont toujours tenté la littérature la plus ouverte à ses propres jeux.  Peu disposé aux compromis de la presse, assez rusé pour les déjouer en feignant de les servir,
Peu disposé aux compromis de la presse, assez rusé pour les déjouer en feignant de les servir,  Dans la France des années 1850, qu’on s’imagine à tort étanche aux novateurs, Adolphe Moreau était connu comme le loup blanc. Cet agent de change riche à millions avait un cœur d’or et des murs chargés de trésors. Et
Dans la France des années 1850, qu’on s’imagine à tort étanche aux novateurs, Adolphe Moreau était connu comme le loup blanc. Cet agent de change riche à millions avait un cœur d’or et des murs chargés de trésors. Et 
 Alors qu’Adolphe Moreau (1800-1859) achetait ses premiers Delacroix, Hugo faisait fortune sur les scènes de l’Est parisien, contre vents et marées. De Marie Tudor, donné à La Porte Saint-Martin en novembre 1833, et qui vient d’entrer en Folio Théâtre (5€), on se souvient plus de la première chahutée et de l’échec relatif que du texte admirable. En trois journées, qui ne s’embarrassent d’aucune fidélité à l’histoire anglaise, Hugo ramasse son drame, celui de l’amour et du pouvoir, bien entendu. Les destins et les amants se plient au caprice du poète, rival déclaré du grand
Alors qu’Adolphe Moreau (1800-1859) achetait ses premiers Delacroix, Hugo faisait fortune sur les scènes de l’Est parisien, contre vents et marées. De Marie Tudor, donné à La Porte Saint-Martin en novembre 1833, et qui vient d’entrer en Folio Théâtre (5€), on se souvient plus de la première chahutée et de l’échec relatif que du texte admirable. En trois journées, qui ne s’embarrassent d’aucune fidélité à l’histoire anglaise, Hugo ramasse son drame, celui de l’amour et du pouvoir, bien entendu. Les destins et les amants se plient au caprice du poète, rival déclaré du grand  Constance de Bartillat a le sourire, sa maison va bien et continue à tracer son chemin en pleine indépendance intellectuelle. Dès l’entrée de ses locaux, rue Crébillon, on bute sur les piles de nouveautés, rééditions d’introuvables ou créations non moins indispensables. La dernière en date, déjà un succès de librairie, compte 1200 pages, fruit du travail exemplaire de Jean Lacoste, Marie-Laure Prévost et de leur éditeur. Si le Journal de guerre de
Constance de Bartillat a le sourire, sa maison va bien et continue à tracer son chemin en pleine indépendance intellectuelle. Dès l’entrée de ses locaux, rue Crébillon, on bute sur les piles de nouveautés, rééditions d’introuvables ou créations non moins indispensables. La dernière en date, déjà un succès de librairie, compte 1200 pages, fruit du travail exemplaire de Jean Lacoste, Marie-Laure Prévost et de leur éditeur. Si le Journal de guerre de  On savait que le courant était très bien passé entre Ezra Pound et
On savait que le courant était très bien passé entre Ezra Pound et  L’Italie, Venise notamment, devait s’offrir bientôt comme l’autre trait d’union qui mène de Gautier à Pound ? C’est à Rapallo que l’Américain devait rédiger son précis ironique de littérature, How to read, en 1927-1928. Les éditions
L’Italie, Venise notamment, devait s’offrir bientôt comme l’autre trait d’union qui mène de Gautier à Pound ? C’est à Rapallo que l’Américain devait rédiger son précis ironique de littérature, How to read, en 1927-1928. Les éditions 