 Sans Liszt connaîtrait-on la comtesse d’Agoult, se demandait Charles Dupêchez en 1990 ? Leurs amours tumultueuses et le déclassement qu’avait encouru l’intrépide Marie en « suivant » son beau pianiste étaient, il y a 25 ans, plus célèbres que les écrits de la frondeuse. L’oubli se construit, aiment à dire les féministes, selon qui la mémoire littéraire réserve préférablement ses trous aux écrivains du beau sexe. Sans s’effacer, Marie d’Agoult (1805-1876) vit certes son étoile posthume pâlir au cours du premier XXe siècle. Mais ce fut le sort commun de tout un pan de notre romantisme, que de bons esprits dirent alors moins profond que le romantisme allemand ou moins touchant que le romantisme anglais. Pour nous avoir écartés d’une part de nous-mêmes, cette absurde hiérarchie n’eut pas raison du meilleur de Marie d’Agoult. On continua à consulter ses Mémoires et son livre décisif sur la révolution de 1848, dont elle fut une partisane ardente sur le mode lamartinien, on commença aussi à comprendre que sa correspondance, objet d’abord d’un culte familial, jetait une lumière nette sur l’époque où cette grande dame des lettres régna, les années 1830-1850, qui se trouvent être l’un des plus hauts moments de l’art français. Comme nombreux furent les écrivains, les peintres et les penseurs politiques à fréquenter son salon, elle donna à sa plume le tour souvent indiscret et drôle de la conversation. Aragon aurait dit qu’elle pratiquait un « français vivant », celui de son ami Drieu, qu’il opposait à la « langue morte » de Gide. Dans ses lettres, la comtesse ne parle pas seulement à ses destinataires choisis, elle nous parle, elle s’adresse aux lecteurs futurs de cet autre journal intime et mondain qu’est sa correspondance. Quatre volumes de ce monument sont parus. Les éditions Honoré Champion et Charles Dupêchez, seule maison et seul érudit capables de porter l’entreprise, nous en offrent deux autres. Ils courent ensemble du printemps 1844 à l’hiver 1848, qui vit l’élection massive de Louis-Napoléon Bonaparte et la fin des illusions pour Marie et ce qu’elle appelait, d’un mot qu’elle avait raison de ne pas aimer, le parti humanitaire.
Sans Liszt connaîtrait-on la comtesse d’Agoult, se demandait Charles Dupêchez en 1990 ? Leurs amours tumultueuses et le déclassement qu’avait encouru l’intrépide Marie en « suivant » son beau pianiste étaient, il y a 25 ans, plus célèbres que les écrits de la frondeuse. L’oubli se construit, aiment à dire les féministes, selon qui la mémoire littéraire réserve préférablement ses trous aux écrivains du beau sexe. Sans s’effacer, Marie d’Agoult (1805-1876) vit certes son étoile posthume pâlir au cours du premier XXe siècle. Mais ce fut le sort commun de tout un pan de notre romantisme, que de bons esprits dirent alors moins profond que le romantisme allemand ou moins touchant que le romantisme anglais. Pour nous avoir écartés d’une part de nous-mêmes, cette absurde hiérarchie n’eut pas raison du meilleur de Marie d’Agoult. On continua à consulter ses Mémoires et son livre décisif sur la révolution de 1848, dont elle fut une partisane ardente sur le mode lamartinien, on commença aussi à comprendre que sa correspondance, objet d’abord d’un culte familial, jetait une lumière nette sur l’époque où cette grande dame des lettres régna, les années 1830-1850, qui se trouvent être l’un des plus hauts moments de l’art français. Comme nombreux furent les écrivains, les peintres et les penseurs politiques à fréquenter son salon, elle donna à sa plume le tour souvent indiscret et drôle de la conversation. Aragon aurait dit qu’elle pratiquait un « français vivant », celui de son ami Drieu, qu’il opposait à la « langue morte » de Gide. Dans ses lettres, la comtesse ne parle pas seulement à ses destinataires choisis, elle nous parle, elle s’adresse aux lecteurs futurs de cet autre journal intime et mondain qu’est sa correspondance. Quatre volumes de ce monument sont parus. Les éditions Honoré Champion et Charles Dupêchez, seule maison et seul érudit capables de porter l’entreprise, nous en offrent deux autres. Ils courent ensemble du printemps 1844 à l’hiver 1848, qui vit l’élection massive de Louis-Napoléon Bonaparte et la fin des illusions pour Marie et ce qu’elle appelait, d’un mot qu’elle avait raison de ne pas aimer, le parti humanitaire.
 Son cœur d’aristocrate chrétienne et libérale brûlait donc pour tous les hommes. Réconciliant en elle la banque allemande et la gentry française désargentée, Marie de Flavigny voit le jour au lendemain du Sacre de Napoléon Ier. À 22 ans, sans qu’elle ait son mot à dire, elle est mariée au comte Charles d’Agoult, auquel elle donnera, sans amour, deux filles qu’elle aimera éperdument. La différence d’âge s’aggrave des différences de goût. Marie tend au romantisme sa jeunesse bafouée et trouve chez les premières héroïnes de George Sand, libres de vivre et d’aimer comme bon leur semble, de dangereux miroirs à ses frustrations. Liszt surgit en décembre 1832. Sa jeunesse, son génie, sa beauté se font adorer dès la première rencontre. Après deux années de rencontres clandestines, Marie lui abandonne tout, son mari, sa fille Claire et les convenances de son milieu. Sand, complice d’abord, jalouse ensuite, lui fera payer cher l’escapade italienne où les tournées du pianiste virtuose, en plus du besoin de s’éloigner de Paris, entraînent les amants vite légendaires. À travers leur couple improbable se réalisait le romantisme des unions impossibles, des couples byroniens, au mépris de la morale commune… L’idylle pouvait-elle durer, résister au priapisme et au narcissisme de Liszt ? Elle dura près de six ans et connut une lente et douloureuse agonie jusqu’en 1844. En mai, la rupture était consommée et Marie séparée des trois enfants nés de sa folie. Leur éducation ramenait le bourreau des claviers et des cœurs à ses pusillanimités petites- bourgeoises. Mais la reine déchue n’est pas nue. Elle a repris pied dès son retour, fin 1839, en France. Dans cette reconstruction de soi, tenir un salon est déterminant. Marie d’Agoult l’affirme à l’un de ses plus chers confidents, le peintre Lehmann, élève d’Ingres et le portraitiste des amants (notre ill.). Il faut que l’Europe sache que se réunit chez elle la fine fleur de la création française et que s’y discute le sort du pays. Car la revenante soutient Lamartine, ennemi déclaré du gouvernement de plus en plus conservateur de Louis-Philippe. Ayant vite rompu avec Sand, dont la rivalité l’avait aidée à se donner une identité littéraire, Marie ne cache pas ses réserves à l’endroit du « socialisme » de George et de « la sacristie poudreuse du culte Leroux ».
Son cœur d’aristocrate chrétienne et libérale brûlait donc pour tous les hommes. Réconciliant en elle la banque allemande et la gentry française désargentée, Marie de Flavigny voit le jour au lendemain du Sacre de Napoléon Ier. À 22 ans, sans qu’elle ait son mot à dire, elle est mariée au comte Charles d’Agoult, auquel elle donnera, sans amour, deux filles qu’elle aimera éperdument. La différence d’âge s’aggrave des différences de goût. Marie tend au romantisme sa jeunesse bafouée et trouve chez les premières héroïnes de George Sand, libres de vivre et d’aimer comme bon leur semble, de dangereux miroirs à ses frustrations. Liszt surgit en décembre 1832. Sa jeunesse, son génie, sa beauté se font adorer dès la première rencontre. Après deux années de rencontres clandestines, Marie lui abandonne tout, son mari, sa fille Claire et les convenances de son milieu. Sand, complice d’abord, jalouse ensuite, lui fera payer cher l’escapade italienne où les tournées du pianiste virtuose, en plus du besoin de s’éloigner de Paris, entraînent les amants vite légendaires. À travers leur couple improbable se réalisait le romantisme des unions impossibles, des couples byroniens, au mépris de la morale commune… L’idylle pouvait-elle durer, résister au priapisme et au narcissisme de Liszt ? Elle dura près de six ans et connut une lente et douloureuse agonie jusqu’en 1844. En mai, la rupture était consommée et Marie séparée des trois enfants nés de sa folie. Leur éducation ramenait le bourreau des claviers et des cœurs à ses pusillanimités petites- bourgeoises. Mais la reine déchue n’est pas nue. Elle a repris pied dès son retour, fin 1839, en France. Dans cette reconstruction de soi, tenir un salon est déterminant. Marie d’Agoult l’affirme à l’un de ses plus chers confidents, le peintre Lehmann, élève d’Ingres et le portraitiste des amants (notre ill.). Il faut que l’Europe sache que se réunit chez elle la fine fleur de la création française et que s’y discute le sort du pays. Car la revenante soutient Lamartine, ennemi déclaré du gouvernement de plus en plus conservateur de Louis-Philippe. Ayant vite rompu avec Sand, dont la rivalité l’avait aidée à se donner une identité littéraire, Marie ne cache pas ses réserves à l’endroit du « socialisme » de George et de « la sacristie poudreuse du culte Leroux ».

Elle sait aussi, en parfaite femme du monde, ne pas parler politique aux plus fidèles de ses correspondants et visiteurs, Vigny en particulier. Elle parvient même, par amitié, à souffrir le conservatisme de la singulière Hortense Allart, qui n’admet de liberté qu’en matière de sexe, et de féminisme qu’en termes de mœurs. Agir en homme, tel est l’idéal. Dans ses échanges avec Michelet, Proudhon, Buloz ou le très pressant Girardin, Marie affiche un aplomb qui fait notre bonheur. Quant au sien, il est difficile de s’en faire une idée précise : la neurasthénie menace cette femme brisée, et le souvenir obsessionnel de Liszt semble cacher ou justifier une vie amoureuse en berne. Reste l’écriture, où elle excelle et se raconte. Daniel Stern, nom éloquent de plume, ne publie pas que de l’autofiction. Outre ses positions politiques, d’un républicanisme modéré, il faudrait gloser davantage ses choix littéraires, notamment son goût de Stendhal, de La Chartreuse notamment, dont elle partage l’admiration de Balzac. Le Salon de peinture, de même, la passionne. Marie est du parti d’Ingres, qui a laissé un portrait délicieusement patricien de son champion en jupons. Concernant le génial Chassériau, rival de Lehmann, on la sent partagée entre réflexes claniques et inclinaisons profondes. Marie avait croisé à Rome le portraitiste de Lacordaire, elle suit de près l’affaire du décor de l’escalier de la Cour des Comptes. A cet égard, l’histoire de l’art n’a pas tiré tout le parti possible de la lecture de cette correspondance au sujet de Chassériau et de ses protecteurs, Tocqueville et Delphine de Girardin, que la comtesse traite de Béatrix parce qu’elle a jeté son dévolu sur le jeune peintre… Étonnamment, il ne semble pas qu’elle se soit reconnue elle-même, en lisant Balzac, sous les traits fielleux de Béatrix de Rochefide. Mais si ce roman breton transpose génialement les amours de Franz et Marie, il est moins conforme à la vérité qu’à la perfidie de George Sand, qui souffla le sujet à Balzac. Ce dernier, du reste, ne se montrait plus chez Marie d’Agoult depuis 1841 et le fameux dîner où le peintre du Paris moderne rencontra Ingres, de retour d’Italie.
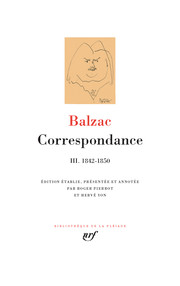 La comtesse a presque disparu du troisième et dernier tome de la correspondance de Balzac, dû au regretté Roger Pierrot et à son digne émule Hervé Yon, les deux éditeurs de La Pléiade. Entre 1842 et 1850, celui que Baudelaire nommait « le plus grand homme de notre siècle » sans exagérer le moins du monde, le titan dont David d’Angers fit le buste olympien en 1844-45, se multiplie dangereusement. Ces années, pour nous, brillent de la publication du plus grand roman de notre littérature, Illusions perdues, que Balzac dédie à Hugo sur épreuves… La scène l’occupe beaucoup alors, elle réveille d’anciens appétits de succès, lui fait écrire à Frédérick Lemaître et à Marie Dorval, assister à la renaissance de Musset, tandis que s’élance l’entreprise éditoriale de la Comédie humaine dont les volumes s’impriment, et donnent la mesure de leur auteur unique. Géant de papier, en tous sens, Balzac fascine Gautier et de plus jeunes, Baudelaire, Champfleury et Courbet. Lui rêve de l’Académie, brigue le fauteuil de Chateaubriand, ce qui politiquement et esthétiquement avait du sens. Le quai Conti, hélas, résiste plus qu’Eve Hanska, enfin veuve, et avec laquelle Honoré sillonne l’Europe, de Russie en Italie, avant de l’épouser… Cela donne à ses lettres une teinte voyageuse et amoureuse admirable. S’il s’octroie des vacances, c’est que le besoin de recharger sa palette et ménager sa monture se fait aussi de plus en plus sentir. Mais la réclusion totale ne va pas à ce Parisien, et sa correspondance nous permet de le suivre chez la belle comtesse Merlin, cantatrice d’origine cubaine, ou chez James de Rothschild, à la table duquel il croise Liszt en 1845… A rebours de cette dispersion et de sa santé flanchante, la fermeté idéologique de Balzac traverse le régime de Juillet à son crépuscule avec le même panache. Fidèle à sa particule de fantaisie autant qu’à la monarchie et à l’Église, l’écrivain fut horrifié par les journées de février 1848. Le sac des Tuileries, qui frappa aussi Delacroix et Flaubert, glisse dans sa correspondance une vraie page de roman. Jusqu’au bout, il prit plaisir à fréquenter les milieux légitimistes et taquiner la « démagogie » d’un Hugo ou d’un Lamartine, qu’il croisait chez Delphine de Girardin. Quant aux bourgeois parvenus, aux élites ralliées, il continua à en crucifier les combines à travers romans et théâtre. Son agonie ressembla à ses livres « avec je ne sais quoi d’effaré et de terrible mêlé au réel » (Hugo). C’est à Gautier qu’il revint de le dire complètement, dès 1859, dans une plaquette mémorable. Théophile fut le destinataire de l’un des derniers billets de Balzac. Daté du 10 juin 1850, il contient le fameux codicille, « Je ne puis ni lire, ni écrire », dont seul un écrivain et un lecteur aussi prolixes que Gautier pouvait sonder le fond de désespoir. On sait que l’annonce de la mort du maître, survenu le 18 août, foudroya Gautier alors qu’il lisait, au Florian, le Journal des débats, « la seule feuille dont l’entrée soit libre dans ce pays absolutiste » qu’était la Vénétie autrichienne.
La comtesse a presque disparu du troisième et dernier tome de la correspondance de Balzac, dû au regretté Roger Pierrot et à son digne émule Hervé Yon, les deux éditeurs de La Pléiade. Entre 1842 et 1850, celui que Baudelaire nommait « le plus grand homme de notre siècle » sans exagérer le moins du monde, le titan dont David d’Angers fit le buste olympien en 1844-45, se multiplie dangereusement. Ces années, pour nous, brillent de la publication du plus grand roman de notre littérature, Illusions perdues, que Balzac dédie à Hugo sur épreuves… La scène l’occupe beaucoup alors, elle réveille d’anciens appétits de succès, lui fait écrire à Frédérick Lemaître et à Marie Dorval, assister à la renaissance de Musset, tandis que s’élance l’entreprise éditoriale de la Comédie humaine dont les volumes s’impriment, et donnent la mesure de leur auteur unique. Géant de papier, en tous sens, Balzac fascine Gautier et de plus jeunes, Baudelaire, Champfleury et Courbet. Lui rêve de l’Académie, brigue le fauteuil de Chateaubriand, ce qui politiquement et esthétiquement avait du sens. Le quai Conti, hélas, résiste plus qu’Eve Hanska, enfin veuve, et avec laquelle Honoré sillonne l’Europe, de Russie en Italie, avant de l’épouser… Cela donne à ses lettres une teinte voyageuse et amoureuse admirable. S’il s’octroie des vacances, c’est que le besoin de recharger sa palette et ménager sa monture se fait aussi de plus en plus sentir. Mais la réclusion totale ne va pas à ce Parisien, et sa correspondance nous permet de le suivre chez la belle comtesse Merlin, cantatrice d’origine cubaine, ou chez James de Rothschild, à la table duquel il croise Liszt en 1845… A rebours de cette dispersion et de sa santé flanchante, la fermeté idéologique de Balzac traverse le régime de Juillet à son crépuscule avec le même panache. Fidèle à sa particule de fantaisie autant qu’à la monarchie et à l’Église, l’écrivain fut horrifié par les journées de février 1848. Le sac des Tuileries, qui frappa aussi Delacroix et Flaubert, glisse dans sa correspondance une vraie page de roman. Jusqu’au bout, il prit plaisir à fréquenter les milieux légitimistes et taquiner la « démagogie » d’un Hugo ou d’un Lamartine, qu’il croisait chez Delphine de Girardin. Quant aux bourgeois parvenus, aux élites ralliées, il continua à en crucifier les combines à travers romans et théâtre. Son agonie ressembla à ses livres « avec je ne sais quoi d’effaré et de terrible mêlé au réel » (Hugo). C’est à Gautier qu’il revint de le dire complètement, dès 1859, dans une plaquette mémorable. Théophile fut le destinataire de l’un des derniers billets de Balzac. Daté du 10 juin 1850, il contient le fameux codicille, « Je ne puis ni lire, ni écrire », dont seul un écrivain et un lecteur aussi prolixes que Gautier pouvait sonder le fond de désespoir. On sait que l’annonce de la mort du maître, survenu le 18 août, foudroya Gautier alors qu’il lisait, au Florian, le Journal des débats, « la seule feuille dont l’entrée soit libre dans ce pays absolutiste » qu’était la Vénétie autrichienne.
 Il devait mettre en scène ce coup du destin dans une des chroniques dramatiques que Patrick Berthier vient de recueillir dans le tome 9 de son édition complète, aussi passionnant que les précédents. L’actualité théâtrale des deux années qui précèdent le 2 décembre 1851 a beaucoup à nous apprendre sur le climat politique, justement, qui déteint sur tout. En accord avec le patron de La Presse, le centre-gauche Émile de Girardin, Gautier persifle une censure de plus en plus tatillonne, signe que la IIe République perd confiance en elle et se coupe de sa base, avant de pousser Louis-Napoléon aux extrêmes. Théophile reste soumis au feu roulant des innombrables salles de la capitale, dont il est un des seuls chroniqueurs à couvrir le spectre entier. Point de repos dominical pour qui publie, chaque lundi, ses magnifiques colonnes, si belles à lire, si utiles à étudier aujourd’hui. En avril 1851, Gautier adresse le début de son feuilleton, respectueusement ironique, au comte Charles de Montalembert, auteur d’un projet de loi qui visait à réserver le dimanche au repos prescrit par l’Église ! Le sort des travailleurs troublait désormais moins l’ancien complice de Lacordaire que leur salut. A défaut du bois de Boulogne et des coteaux de Meudon, sa table, sa plume, ses chats et les forces vives de la scène meublaient les fins de semaine d’un Théophile enchaîné à la copie. Ce qu’il avait trouvé au théâtre des funambules sous Louis-Philippe, il le demande désormais au cirque et aux spectacles de ballon. Les danseuses espagnoles, qui font claquer l’espace, règnent toujours sur son cœur et ses souvenirs. Mais où trouver ailleurs cette énergique densité de vie ? Musset et Balzac restent, à ses yeux, la seule issue, à condition de les bien jouer. Aussi Gautier ne perd aucune occasion de réclamer un peu plus d’audace des romantiques qui dirigent désormais les salles parisiennes. Ils n’osent, ces anciens rebelles, pratiquer les changements à vue que réclame le théâtre si mobile et capricieux de Musset. Au lieu de cela, le rideau de manœuvre s’obstine à tomber, ralentir une action hachée en petits morceaux. Quand on ne toilette pas le texte, on pétrifie la parole et les corps. Balzac, qui eut tant à lutter avec les eunuques de son époque, sera mort sans avoir assisté aux représentations de son chef-d’œuvre, Mercadet, qui domine la vie théâtrale en 1851… Chacun s’y trouve flagellé, du politicien au journaliste, du soupirant veule au créancier volé, car tous sont agis par l’obsession de l’argent et l’égoïsme le plus noir. La censure grimaça mais autorisa la satire des spéculateurs parce que la forme n’en était pas trop agressive et la scène où elle se jouait peu populaire. Pour Gautier, Balzac y égalait le grand Molière. Mercadet, c’était la superbe de Don Juan allié aux chicaneries de M. Dimanche. Les bourgeois sont les nouveaux seigneurs d’un monde qui ne respecte ses lois qu’en apparence. Encore sous le choc d’articles le plus souvent négatifs, Mme Hanska écrit à Gautier : « Merci, Monsieur, merci, c’est tout ce que je puis vous dire. Merci pour lui qui vous a tant aimé – merci pour moi qui ai tant souffert. – Depuis plus de huit jours je suis abreuvée de fiel, de venin, de poison ». Balzac obligeait. Stéphane Guégan
Il devait mettre en scène ce coup du destin dans une des chroniques dramatiques que Patrick Berthier vient de recueillir dans le tome 9 de son édition complète, aussi passionnant que les précédents. L’actualité théâtrale des deux années qui précèdent le 2 décembre 1851 a beaucoup à nous apprendre sur le climat politique, justement, qui déteint sur tout. En accord avec le patron de La Presse, le centre-gauche Émile de Girardin, Gautier persifle une censure de plus en plus tatillonne, signe que la IIe République perd confiance en elle et se coupe de sa base, avant de pousser Louis-Napoléon aux extrêmes. Théophile reste soumis au feu roulant des innombrables salles de la capitale, dont il est un des seuls chroniqueurs à couvrir le spectre entier. Point de repos dominical pour qui publie, chaque lundi, ses magnifiques colonnes, si belles à lire, si utiles à étudier aujourd’hui. En avril 1851, Gautier adresse le début de son feuilleton, respectueusement ironique, au comte Charles de Montalembert, auteur d’un projet de loi qui visait à réserver le dimanche au repos prescrit par l’Église ! Le sort des travailleurs troublait désormais moins l’ancien complice de Lacordaire que leur salut. A défaut du bois de Boulogne et des coteaux de Meudon, sa table, sa plume, ses chats et les forces vives de la scène meublaient les fins de semaine d’un Théophile enchaîné à la copie. Ce qu’il avait trouvé au théâtre des funambules sous Louis-Philippe, il le demande désormais au cirque et aux spectacles de ballon. Les danseuses espagnoles, qui font claquer l’espace, règnent toujours sur son cœur et ses souvenirs. Mais où trouver ailleurs cette énergique densité de vie ? Musset et Balzac restent, à ses yeux, la seule issue, à condition de les bien jouer. Aussi Gautier ne perd aucune occasion de réclamer un peu plus d’audace des romantiques qui dirigent désormais les salles parisiennes. Ils n’osent, ces anciens rebelles, pratiquer les changements à vue que réclame le théâtre si mobile et capricieux de Musset. Au lieu de cela, le rideau de manœuvre s’obstine à tomber, ralentir une action hachée en petits morceaux. Quand on ne toilette pas le texte, on pétrifie la parole et les corps. Balzac, qui eut tant à lutter avec les eunuques de son époque, sera mort sans avoir assisté aux représentations de son chef-d’œuvre, Mercadet, qui domine la vie théâtrale en 1851… Chacun s’y trouve flagellé, du politicien au journaliste, du soupirant veule au créancier volé, car tous sont agis par l’obsession de l’argent et l’égoïsme le plus noir. La censure grimaça mais autorisa la satire des spéculateurs parce que la forme n’en était pas trop agressive et la scène où elle se jouait peu populaire. Pour Gautier, Balzac y égalait le grand Molière. Mercadet, c’était la superbe de Don Juan allié aux chicaneries de M. Dimanche. Les bourgeois sont les nouveaux seigneurs d’un monde qui ne respecte ses lois qu’en apparence. Encore sous le choc d’articles le plus souvent négatifs, Mme Hanska écrit à Gautier : « Merci, Monsieur, merci, c’est tout ce que je puis vous dire. Merci pour lui qui vous a tant aimé – merci pour moi qui ai tant souffert. – Depuis plus de huit jours je suis abreuvée de fiel, de venin, de poison ». Balzac obligeait. Stéphane Guégan
Marie de Flavigny, comtesse d’Agoult, Correspondance générale, édition établie et annotée par Charles Dupêchez, tomes 5 (mai 1844 – 1846) et 6 (1847-1848), Honoré Champion, 120 € et 95 €.
Honoré de Balzac, Correspondance, tome III, 1842-1850, édition de Roger Pierrot et Hervé Yon, La Bibliothèque de la Pléiade, 59 €.
Théophile Gautier, Œuvres complètes. Critique théâtrale, tome IX, juillet 1850 – octobre 1851, texte établi, présenté et annoté par Patrick Berthier, Honoré Champion, 95 €.
Save the date /// Retrouvez Gautier, Fracasse, Charles Dantzig et votre serviteur sur France Culture, dimanche 25 février, dans l’émission Personnages en personne…
Et lire aussi…
 Étaient-elles faites pour se rencontrer et, plus encore, s’apprécier? Tout séparait, au fond, Marie d’Agoult et Hortense Allart, l’origine sociale, les opinions politiques, le rapport à l’écriture et le rapport au sexe. Puisque l’Italie les avait réunies en pleine fugue de la comtesse, Charles Dupêchez s’est senti autorisé à écrire leur biographie croisée. Il a fort bien fait, son livre possède l’esprit, la concision, la liberté de ton de ces deux femmes qui eurent l’intelligence de ne pas confondre leur libération avec le rejet de la société, le mépris des hommes et de ce qu’il faut bien appeler la nature, n’en déplaise aux assommantes suffragettes américaines ou américanisées. D’extraction bourgeoise et tôt orpheline, Hortense (1801-1879) apprit vite à user de ses charmes et de sa plume. Elle était de ces femmes qui ont plus de chien que de beauté. Chateaubriand, dont elle fut la dernière maîtresse, la trouvait agitée et froide dans l’alcôve. L’enchanteur vieillissant avait-il su mettre en émoi cette femme de presque trente ans ? L’histoire ne le dit pas, elle dit, en revanche, que la menue Allart eut maints amants (dont Sainte-Beuve) apparemment conquis par son amour de l’amour. Sa religion en ce domaine consistait à suggérer aux femmes de disposer des hommes comme ceux-ci disposaient des femmes. Elle récusait la nécessité d’être vierge au moment du mariage et préconisait l’éducation poussée des demoiselles. Le temps du servage marital était fini. Quant au reste, elle s’opposa aux excès du démocratisme moderne avec la ferveur qu’elle mettait à dénoncer les leurres du romanesque à deux sous. Un sacré bout de femme. Plus qu’une confidente, la comtesse d’Agoult trouva auprès d’elle une émulation saine et durable. Ce livre ne saurait être mieux venu. SG / Charles Dupêchez, Hortense et Marie. Une si belle amitié 1838-1876, Flammarion, 21,90€.
Étaient-elles faites pour se rencontrer et, plus encore, s’apprécier? Tout séparait, au fond, Marie d’Agoult et Hortense Allart, l’origine sociale, les opinions politiques, le rapport à l’écriture et le rapport au sexe. Puisque l’Italie les avait réunies en pleine fugue de la comtesse, Charles Dupêchez s’est senti autorisé à écrire leur biographie croisée. Il a fort bien fait, son livre possède l’esprit, la concision, la liberté de ton de ces deux femmes qui eurent l’intelligence de ne pas confondre leur libération avec le rejet de la société, le mépris des hommes et de ce qu’il faut bien appeler la nature, n’en déplaise aux assommantes suffragettes américaines ou américanisées. D’extraction bourgeoise et tôt orpheline, Hortense (1801-1879) apprit vite à user de ses charmes et de sa plume. Elle était de ces femmes qui ont plus de chien que de beauté. Chateaubriand, dont elle fut la dernière maîtresse, la trouvait agitée et froide dans l’alcôve. L’enchanteur vieillissant avait-il su mettre en émoi cette femme de presque trente ans ? L’histoire ne le dit pas, elle dit, en revanche, que la menue Allart eut maints amants (dont Sainte-Beuve) apparemment conquis par son amour de l’amour. Sa religion en ce domaine consistait à suggérer aux femmes de disposer des hommes comme ceux-ci disposaient des femmes. Elle récusait la nécessité d’être vierge au moment du mariage et préconisait l’éducation poussée des demoiselles. Le temps du servage marital était fini. Quant au reste, elle s’opposa aux excès du démocratisme moderne avec la ferveur qu’elle mettait à dénoncer les leurres du romanesque à deux sous. Un sacré bout de femme. Plus qu’une confidente, la comtesse d’Agoult trouva auprès d’elle une émulation saine et durable. Ce livre ne saurait être mieux venu. SG / Charles Dupêchez, Hortense et Marie. Une si belle amitié 1838-1876, Flammarion, 21,90€.
 Simultanément au tome IX des Chroniques dramatiques, Honoré Champion fait paraître le tome I des Contes et Nouvelles de Théophile Gautier, au sommaire duquel se trouvent quelques-uns de ses meilleurs récits fantastiques, de La Cafetière à Omphale, des Jeunes France à Fortunio, la perle se trouvant être, hommage crypté à Balzac, La Morte amoureuse. De part et d’autre de Mademoiselle de Maupin (1835), le jeune romantique à crinière léonine s’est donc plu à pratiquer la forme courte, qui est aux cycles de poème ce que représente le sonnet, une manière de quintessence. Cette concentration de forme s’ajuste parfaitement au climat hoffmannien des premiers contes où le surnaturel s’immisce à petits pas et projette son trouble sur le lecteur. L’espace et le temps semblent aspirés par les désirs ou les inquiétudes des personnages, qui basculent soudain dans un autre temps et un autre espace, avant d’être rappelés, mais changés, à la vie normale. Le sommeil, la danse, l’ivresse ouvrent des portes sur un au-delà pré-freudien. Le romantisme dit le réel en saisissant l’imagination. Et le fantastique est autant l’occasion que la métaphore idéale d’une démarche qui refuse de réduire la fiction à un genre ou une lecture unique. C’est, du moins, la position de Gautier, comme Anne Geisler le note au sujet des Jeunes France. Loin d’être la simple parodie des extravagances 1830, comme on continue à l’écrire, le volume rend impossible toute catégorisation traditionnelle. Le thème de l’amour s’y révèle riche en harmoniques aussi dérangeantes. À sa manière, Gautier égratigne « la sainte institution du mariage », objet des attaques d’une Hortense Allart ou d’une Marie d’Agoult. L’attrait de la bigamie, traité de façon goguenarde, prendra un tour plus dramatique dans Laquelle des deux ? et Fortunio. De façon plus noire, La Morte amoureuse, où la chasteté des prêtres est décrite comme une torture masochiste, confronte le lecteur au choix du héros, partagé entre le désir et le renoncement, la castration volontaire et l’appel du diable. Avec Alain Montandon, on y goûtera la réécriture d’un XVIIIe siècle auquel se rattache Gautier, celui de Manon Lascaut ou de La Religieuse. Plus généralement, comme les éditeurs y insistent tous, le jeu référentiel, aux antipodes du mythe romantique d’une création pure de tout emprunt, se déploie en pleine et consciente liberté. SG // Théophile Gautier, Œuvres complètes. Contes et nouvelles, tome I, texte établi, présenté et annoté par Alain Montandon, Anne Geisler-Szmulewicz, Françoise Court-Pérez et François Brunet, Honoré Champion, 120 €.
Simultanément au tome IX des Chroniques dramatiques, Honoré Champion fait paraître le tome I des Contes et Nouvelles de Théophile Gautier, au sommaire duquel se trouvent quelques-uns de ses meilleurs récits fantastiques, de La Cafetière à Omphale, des Jeunes France à Fortunio, la perle se trouvant être, hommage crypté à Balzac, La Morte amoureuse. De part et d’autre de Mademoiselle de Maupin (1835), le jeune romantique à crinière léonine s’est donc plu à pratiquer la forme courte, qui est aux cycles de poème ce que représente le sonnet, une manière de quintessence. Cette concentration de forme s’ajuste parfaitement au climat hoffmannien des premiers contes où le surnaturel s’immisce à petits pas et projette son trouble sur le lecteur. L’espace et le temps semblent aspirés par les désirs ou les inquiétudes des personnages, qui basculent soudain dans un autre temps et un autre espace, avant d’être rappelés, mais changés, à la vie normale. Le sommeil, la danse, l’ivresse ouvrent des portes sur un au-delà pré-freudien. Le romantisme dit le réel en saisissant l’imagination. Et le fantastique est autant l’occasion que la métaphore idéale d’une démarche qui refuse de réduire la fiction à un genre ou une lecture unique. C’est, du moins, la position de Gautier, comme Anne Geisler le note au sujet des Jeunes France. Loin d’être la simple parodie des extravagances 1830, comme on continue à l’écrire, le volume rend impossible toute catégorisation traditionnelle. Le thème de l’amour s’y révèle riche en harmoniques aussi dérangeantes. À sa manière, Gautier égratigne « la sainte institution du mariage », objet des attaques d’une Hortense Allart ou d’une Marie d’Agoult. L’attrait de la bigamie, traité de façon goguenarde, prendra un tour plus dramatique dans Laquelle des deux ? et Fortunio. De façon plus noire, La Morte amoureuse, où la chasteté des prêtres est décrite comme une torture masochiste, confronte le lecteur au choix du héros, partagé entre le désir et le renoncement, la castration volontaire et l’appel du diable. Avec Alain Montandon, on y goûtera la réécriture d’un XVIIIe siècle auquel se rattache Gautier, celui de Manon Lascaut ou de La Religieuse. Plus généralement, comme les éditeurs y insistent tous, le jeu référentiel, aux antipodes du mythe romantique d’une création pure de tout emprunt, se déploie en pleine et consciente liberté. SG // Théophile Gautier, Œuvres complètes. Contes et nouvelles, tome I, texte établi, présenté et annoté par Alain Montandon, Anne Geisler-Szmulewicz, Françoise Court-Pérez et François Brunet, Honoré Champion, 120 €.
 « De tous les auteurs du XIXe siècle, Alfred de Musset est le seul, sans doute, dont le théâtre reste vraiment vivant de nos jours », écrit Simon Jeune, en 1990, au seuil de ce qui reste la meilleure édition en la matière (La Pléiade, Gallimard). En tête de l’essai qu’il vient de consacrer au sujet, Sylvain Ledda, grand expert du théâtre romantique, écrit plus généreusement : « Avec Victor Hugo, Musset est le seul dramaturge de l’ère romantique à susciter la curiosité durable des metteurs en scène. » La curiosité de notre pauvre époque se cognant vite à ses limites, nos planches sont plutôt chiches envers Balzac, Gozlan, Gautier, voire Scribe. Le génial Dumas père s’en sort mieux. Musset, du reste, mérite sa survie parmi nous. Le lire ou l’entendre, c’est l’adopter. Nul besoin même d’adapter à la scène ces pièces et proverbes qui ne furent pas écrits pour. Ses mots, dit Ledda, ont un tel pouvoir évocateur qu’ils peignent espace, intrigues et caractères hors de toute représentation matérielle. Musset invente, dès 1832, et après qu’on eut sifflé sa Nuit vénitienne, le spectacle chez soi… Les salles, les loges, le public, les directeurs, sont à sa merci. Son théâtre imaginaire, qu’on a cru longtemps impossible à jouer, postule les changements à vue et refuse d’interrompre une scène quand un personnage y entre. La vie est mobile, la vie est une, dira Gautier, le théâtre doit l’être… Ledda nous rappelle la fièvre des commencements. Né coiffé, un père spécialiste de Rousseau, un aïeul proche de Carmontelle, l’adolescent lit Shakespeare, Schiller, Goethe, se forme tôt à la pratique des comédies de salon. Hugo, Dumas et Vigny électrisent ses vingt ans. 1830 ! Le drame, historique ou moderne, demande un art des ficelles et des carcasses qui répugne à sa fantaisie et son goût des mélanges. Ledda parle bien de la diversité générique qui règne dans chaque pièce, comme de la porosité psychologique qui trouble les personnages. Ses grands thèmes sont connus, la perte de l’innocence, la force de l’amitié, la fragilité ou la cécité de l’amour, l’illusion politique, l’incurable besoin de plaire. On ne badine pas avec Musset. Le libertinage fut le masque d’une vision déniaisée des femmes et des hommes. Éternel. SG // Sylvain Ledda, Le Théâtre d’Alfred de Musset, Ides et Calendes, 10€.
« De tous les auteurs du XIXe siècle, Alfred de Musset est le seul, sans doute, dont le théâtre reste vraiment vivant de nos jours », écrit Simon Jeune, en 1990, au seuil de ce qui reste la meilleure édition en la matière (La Pléiade, Gallimard). En tête de l’essai qu’il vient de consacrer au sujet, Sylvain Ledda, grand expert du théâtre romantique, écrit plus généreusement : « Avec Victor Hugo, Musset est le seul dramaturge de l’ère romantique à susciter la curiosité durable des metteurs en scène. » La curiosité de notre pauvre époque se cognant vite à ses limites, nos planches sont plutôt chiches envers Balzac, Gozlan, Gautier, voire Scribe. Le génial Dumas père s’en sort mieux. Musset, du reste, mérite sa survie parmi nous. Le lire ou l’entendre, c’est l’adopter. Nul besoin même d’adapter à la scène ces pièces et proverbes qui ne furent pas écrits pour. Ses mots, dit Ledda, ont un tel pouvoir évocateur qu’ils peignent espace, intrigues et caractères hors de toute représentation matérielle. Musset invente, dès 1832, et après qu’on eut sifflé sa Nuit vénitienne, le spectacle chez soi… Les salles, les loges, le public, les directeurs, sont à sa merci. Son théâtre imaginaire, qu’on a cru longtemps impossible à jouer, postule les changements à vue et refuse d’interrompre une scène quand un personnage y entre. La vie est mobile, la vie est une, dira Gautier, le théâtre doit l’être… Ledda nous rappelle la fièvre des commencements. Né coiffé, un père spécialiste de Rousseau, un aïeul proche de Carmontelle, l’adolescent lit Shakespeare, Schiller, Goethe, se forme tôt à la pratique des comédies de salon. Hugo, Dumas et Vigny électrisent ses vingt ans. 1830 ! Le drame, historique ou moderne, demande un art des ficelles et des carcasses qui répugne à sa fantaisie et son goût des mélanges. Ledda parle bien de la diversité générique qui règne dans chaque pièce, comme de la porosité psychologique qui trouble les personnages. Ses grands thèmes sont connus, la perte de l’innocence, la force de l’amitié, la fragilité ou la cécité de l’amour, l’illusion politique, l’incurable besoin de plaire. On ne badine pas avec Musset. Le libertinage fut le masque d’une vision déniaisée des femmes et des hommes. Éternel. SG // Sylvain Ledda, Le Théâtre d’Alfred de Musset, Ides et Calendes, 10€.


























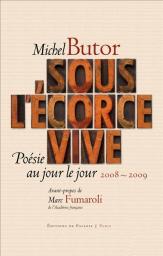

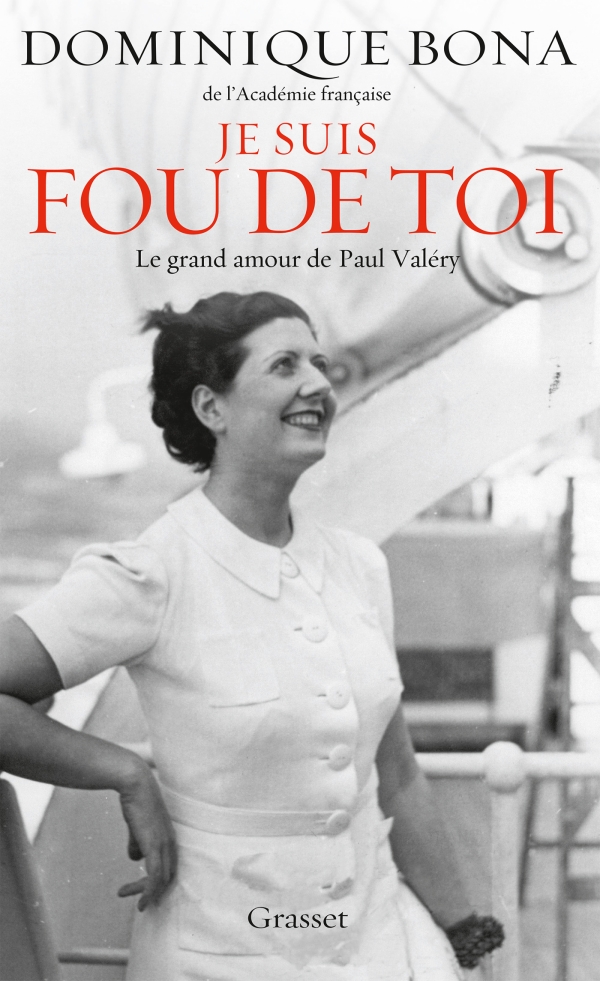
 Si Corot hante le premier, Degas et
Si Corot hante le premier, Degas et  Fils d’un mulâtre de Saint-Domingue qui avait fini général d’Empire – le fameux «diable noir» craint des Autrichiens et même de Bonaparte – , le bel Alexandre était fier de sa crinière crépue et sûr de son ascendant sur les dames. L’une d’entre elles, la célèbre Mélanie Waldor, ne lésinait pas sur les épithètes, dans ses tendres missives, pour rallumer une flamme déjà éteinte en 1831. «Sang africain», «âme de feu», le ton était celui de la passion ardente, ardente et meurtrie. Le premier volume de la correspondance de Dumas, éditée par le très savant
Fils d’un mulâtre de Saint-Domingue qui avait fini général d’Empire – le fameux «diable noir» craint des Autrichiens et même de Bonaparte – , le bel Alexandre était fier de sa crinière crépue et sûr de son ascendant sur les dames. L’une d’entre elles, la célèbre Mélanie Waldor, ne lésinait pas sur les épithètes, dans ses tendres missives, pour rallumer une flamme déjà éteinte en 1831. «Sang africain», «âme de feu», le ton était celui de la passion ardente, ardente et meurtrie. Le premier volume de la correspondance de Dumas, éditée par le très savant

 La rencontre des deux hommes remonte à 1826, et nous ramène à ce foyer du romantisme que fut le cercle du peintre Gérard, un élève de
La rencontre des deux hommes remonte à 1826, et nous ramène à ce foyer du romantisme que fut le cercle du peintre Gérard, un élève de  S’ouvrant sur une vue de la maison de la Fornarina, à quelques pas des fresques très déshabillées de la Farnesina, le volume final contribue résolument au culte de Raphaël et de l’érotisme dont procèdent, selon les auteurs, et la peinture italienne et le regard attentif, caressant et vigoureux, qu’il convient de lui porter.
S’ouvrant sur une vue de la maison de la Fornarina, à quelques pas des fresques très déshabillées de la Farnesina, le volume final contribue résolument au culte de Raphaël et de l’érotisme dont procèdent, selon les auteurs, et la peinture italienne et le regard attentif, caressant et vigoureux, qu’il convient de lui porter.