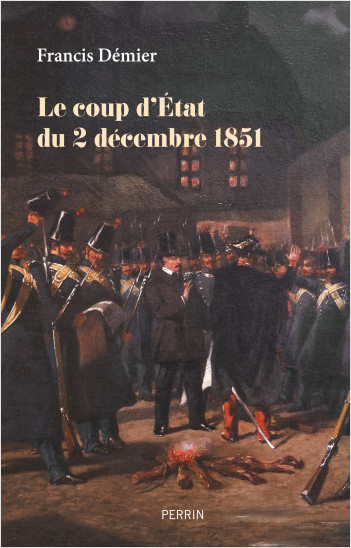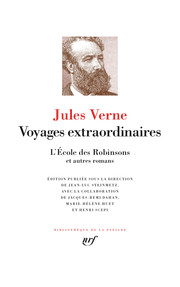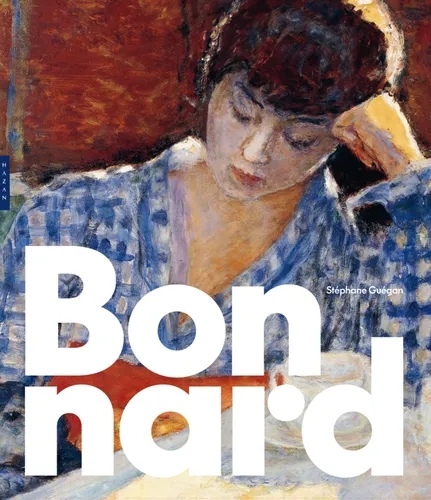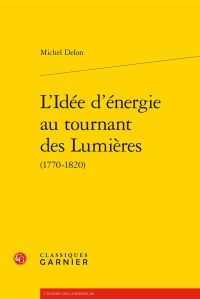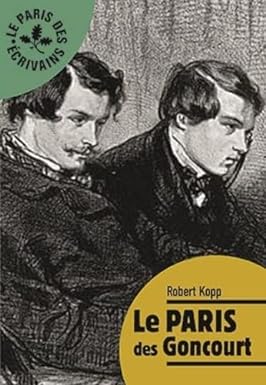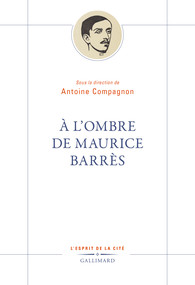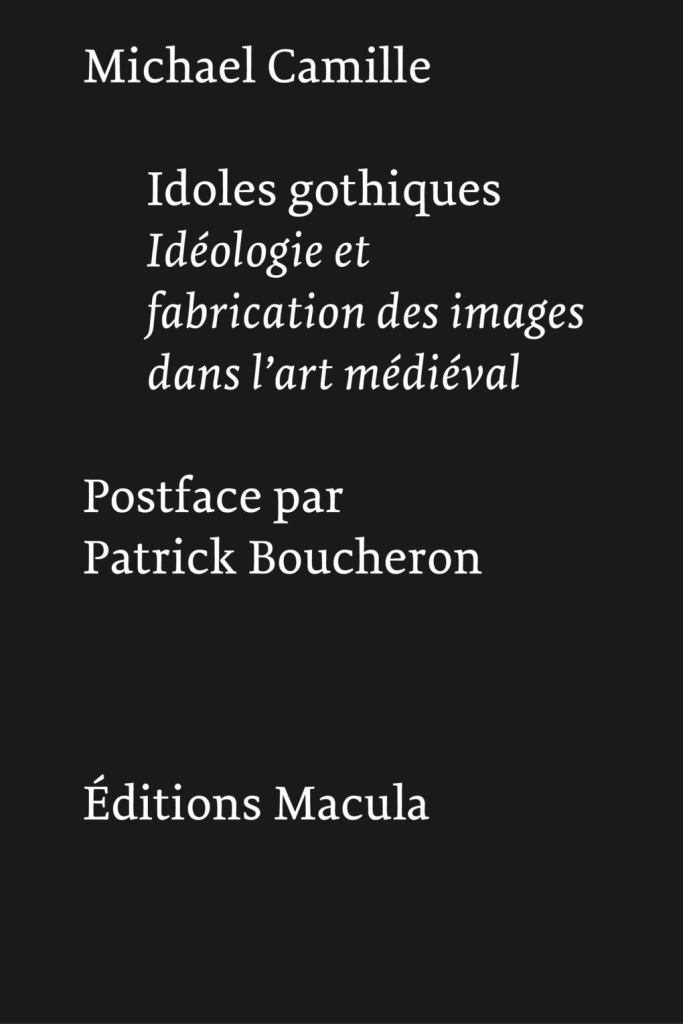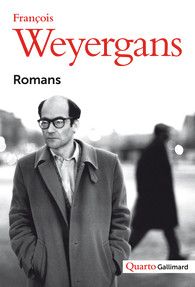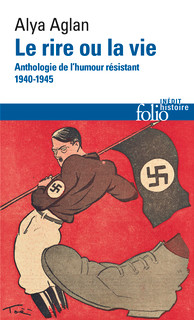La version intégrale du texte qui va suivre a paru dans Relire les Salons de Charles Baudelaire, publié par Classiques Garnier en 2023, sous la direction de Didier Philippot et Henri Scepi. Je les remercie, ainsi que l’éditeur, d’en avoir autorisé la reprise partielle. Notons au passage que ce volume contient plusieurs études passionnantes relatives au Salon qui nous occupe…
Parent pauvre des études baudelairiennes malgré l’édition encore utile qu’en a donnée André Ferran (L’Archer, 1933), le Salon de 1845 reste un texte à réévaluer dans son contenu, sa structure et l’intertexte qui étoffe, ouvertement ou non, ses analyses. Les pages qui suivent voudraient ébaucher ce réexamen nécessaire. Si toute littérature est chorale, les circonstances et les contours médiatiques de l’événement pèsent ici d’un poids plus lourd. Sans compter les articles que Charles Asselineau donna au Journal des Théâtres, corpus découvert par Jean Ziegler et ignoré de Ferran, il nous paraît aujourd’hui évident que Baudelaire s’est imposé de lire bon nombre de ses confrères avant de publier sa « brochure » de 72 pages (Jules Labitte éditeur). Elle semble avoir circulé modestement à partir de la mi-mai 1845, date qui permit au poète d’absorber la presse contemporaine, journaux et revues de toute couleur politique et esthétique, jusqu’à la fin avril. Or le paysage critique de la fin de la monarchie de Juillet montre une richesse d’acteurs et de positions dont on commence à peine à prendre la mesure, richesse déterminée par l’incertitude des esprits et l’effervescence idéologique d’une époque consciente de glisser vers de proches changements, quels qu’ils soient. Le fameux appel qui clôt le Salon de 1845 de Baudelaire, en faveur de « l’héroïsme de la vie moderne », n’emprunte le ton de la prophétie qu’en raison de l’impuissance des artistes à « entendre », estime-t-il, le « vent qui soufflera demain », comme si ces mêmes artistes étaient sourds à ce qui travaille la société ou l’art, et s’attardaient parmi « les limbes » de la routine.

Devenu pléthorique à la fin du règne de Louis-Philippe, plus de 3000 numéros, le Salon, soit « l’exposition des artistes vivants », rend plus sensibles ses faiblesses, il est même accusé de les stimuler […]. Très ironique, Baudelaire vérifie le triomphe de la redite, de la citation, du « métier » sur l’invention, ou de l’anecdote sur le langage des formes. En conséquence, il promeut deux critères corrélés, l’inattendu et l’inaccompli. A la fin du règne de Louis XV, la recension du Salon royal de peinture et de sculpture était proche de constituer un genre, mais un genre hybride à plusieurs degrés, parce que participant du littéraire et du journalisme, de l’éloge et de la polémique, de l’institution et de ses marges. […] Le « Salon » désigna assez vite et l’espace du Louvre où se tenait l’exposition réservée aux artistes agréés et reçus de l’Académie, et sa recension imprimée, sous des formes diverses. Plus la Révolution s’approche, plus brochures et libelles cèdent à l’attrait du blâme, souvent anonyme, et confondent la critique des artistes du roi avec celle du monarque, sa politique des arts avec son art de la politique. Sans s’imaginer, sans même souhaiter la fin de l’Ancien régime le plus souvent, cette grogne accrue y aura contribué à son échelle. Le phénomène se répétera sous la Restauration après la levée de la censure républicaine et impériale, le romantisme ne serait pas devenue une passion publique autrement.

La mémoire de cette autre révolution, et de la part qu’y prit la presse, ne se perdra pas, et Baudelaire en témoignera […]. Pour son entrée en littérature, ce dernier, héritier avoué de Diderot et Stendhal, ne peut que se prévaloir d’une double capacité : l’intransigeance du discours épidictique, d’un côté ; la compétence de l’amateur, et non du « littérateur », de l’autre. A ce mot conservons la nuance péjorative qu’y introduit Baudelaire lui-même en 1845, il ne ménage pas ses efforts, du reste, pour ne pas être confondu avec une plume néophyte ou ancillaire : « ce que nous disons, les journaux n’oseraient l’imprimer. Nous serons donc bien cruels et bien insolents ? non pas, au contraire, impartiaux. Nous n’avons pas d’amis, c’est un grand point, et pas d’ennemis. » Nous verrons qu’il n’en est rien. Mais l’ouverture de Baudelaire ne s’embarrasse pas de ces nuances, elle préfère éreinter : « la critique des journaux, tantôt niaise, tantôt furieuse, jamais indépendante, a, par ses mensonges et ses camaraderies effrontées, dégoûté le bourgeois de ces utiles guide-ânes qu’on nomme comptes rendus de Salons. » Initiateur de la brochure où il rend compte de l’exposition, Baudelaire cherche à garantir ce qu’il donne à lire d’une probité insoupçonnable : cette parole de vérité, il la gage en quelque sorte, la leste d’une indépendance éditoriale […].

L’autre usage qu’il remodèle dans ce sens concerne l’introduction de son compte-rendu. Généralement, les salonniers y discutaient les tendances du moment, les œuvres importantes de l’année et, pour le déplorer, déroulaient la liste de celles qui avaient été écartées du Louvre. Exclusivement recruté parmi les membres des « quatre premières sections de l’Académie royale des beaux-arts », pour citer le livret de 1831, le jury du Salon n’aura jamais cessé d’être l’objet d’attaques virulentes à partir de cette date inaugurale, elles auront nourri un « anti-académisme », souvent outrancier, qui culminera en 1847 et s’épanouira après février 1848. On sent l’exaspération croître à l’époque où Baudelaire se jette dans l’arène avec l’ambition déclarée de ne pas se plier à la rhétorique de ses confrères. A s’en tenir aux plus éminents d’entre eux, Théophile Thoré et Théophile Gautier […], les jurés de l’Institut sont rappelés à leur devoir d’équité envers la jeune école, quand bien même elle serait peu conforme à la vulgate enseignée à l’Ecole des Beaux-Arts et encore largement tributaire, comme le notait Marc Fumaroli, de la doctrine davidienne.

C’est ainsi que Gautier consacre son premier feuilleton, le 11 mars 1845, aux « tableaux refusés », selon une formule stigmatisante qu’il retourne contre ceux qui en sont la cause […]. Il ne leur est rien épargné, et Gautier libère sa colère d’une façon qui n’est pas sans annoncer la coda de Baudelaire : « D’où sortez-vous ? où passez-vous votre vie pour être aussi étrangers à tout ce qui s’est fait depuis vingt ans ? Vous ne respirez donc pas l’air qui remplit nos poumons ? » De la proscription qui touche tout ou partie des envois de la jeune peinture, qu’elle s’inscrive dans les pas de Delacroix ou d’Ingres, Gautier se plait à souligner l’incohérence et le corporatisme. […] Le républicain Thoré conspue, sans plus de ménagement, « l’autocratie du jury » et son « autorité usurpée » ; il laisse même flotter la rumeur que « ce malheureux tribunal secret et irresponsable a eu bien de la peine à se constituer cette année. » On sait, en effet, que des académiciens aussi éminents qu’Ingres, Delaroche, Horace Vernet et le sculpteur David d’Angers refusent désormais de participer à l’écrémage drastique des œuvres soumises annuellement au jurés. […] Gautier est aussi de ceux qui jugent la réforme du jury « nécessaire », et qui anticipent les dispositions du Second Empire, à savoir de mêler aux représentants de l’administration des « critiques » et des artistes récompensés ou élus.

Baudelaire prend d’emblée le contre-pieds de ses confrères. Pas plus qu’il ne croit légitime de fustiger le philistinisme obligé du bourgeois, […] il ne pourfend la politique royale à travers le Salon : « C’est avec le même mépris de toute opposition et de toutes criailleries systématiques, […], c’est avec le même esprit d’ordre, le même amour du bon sens, que nous repoussons loin de cette petite brochure toute discussion, et sur les jurys en général, et sur le jury de peinture en particulier, et sur la réforme du jury devenue, dit-on, nécessaire, et sur le mode et la fréquence des expositions, etc… D’abord il faut un jury, ceci est clair – et quant au retour annuel des expositions […], un esprit juste verra toujours qu’un grand artiste n’y peut que gagner, vu sa fécondité naturelle, et qu’un médiocre n’y peut trouver que le châtiment mérité. » […] Mais son refus du systématisme, trait précoce et pérenne de sa critique d’art, l’autorise à venger, en cours d’examen, et de façon cinglante, les artistes qui auraient souffert injustement des rigueurs du jury. L’un d’entre eux, figure éminente de l’hôtel Pimodan, […] n’expose qu’un « solide » Christ en croix (ill.) : « Il est à regretter que M. Boissard [de Boisdenier], qui possède les qualités d’un bon peintre, n’ait pas pu faire voir cette année un tableau allégorique représentant la Musique, la Peinture et la Poésie. Le jury, trop fatigué sans doute ce jour-là de sa rude tâche, n’a pas jugé convenable de l’admettre. » Au sujet de la Vision de sainte Thérèse de Louis de Planet dont l’Eros tridentin conjugue volupté et morbidité, Baudelaire parle d’un tableau malmené par la presse et, semble-t-il, « bafoué » par le jury. […]

D’un commun hispanisme, rude chez l’un, tendre chez l’autre, Boissard et Planet sont la confirmation vivante de ce que l’introduction de Baudelaire suggère des effets d’une autre émulation. Car le Salon, à ses yeux, est partie prenante d’un dispositif d’ensemble qui vise à édifier le goût général. Et Baudelaire, hors de toute ironie, salue l’action de Louis-Philippe […] : en plus du retour annuel de l’exposition, le public et les artistes doivent « à l’esprit éclairé et libéralement paternel [du] roi […] la jouissance de six musées (la galerie des Dessins, le supplément de la galerie Française, le musée Espagnol, le musée Standish, le musée de Versailles, le musée de Marine) ». Nous avons rappelé ici que la mention de « la galerie Française » signalait le récent accroissement des tableaux français du premier XVIIIe siècle. Au cœur du Louvre, désormais ouvert aux esthétiques que le purisme du Museum révolutionnaire avait chassées de ses cimaises, Baudelaire dégage du Salon, en 1845, les multiples retombées du « musée espagnol », ouvert en 1838, et de la peinture rocaille en cours de réévaluation.

Baudelaire n’en reste pas moins attaché à l’ancienne hiérarchie des genres, qui structure sa brochure et n’a rien d’une commodité : elle procède, au contraire, de convictions intimes, promises à s’affermir à mesure que le constat d’un déclin de la peinture d’histoire ou d’imagination devait se confirmer. Au-delà de sa redéfinition de « l’idéal », qu’il sépare de toute généralité classicisante et de toute exemplarité moralisante, Baudelaire valorise déjà l’invention poétique de l’image et sa capacité, si riche soit-elle d’expérience vécue, à nous arracher aux limites ordinaires de notre condition. […] Outre la hiérarchie des genres, il suit, le cas échéant, l’ordre et le grade que « l’estime publique » assigne aux œuvres. […] Et s’il commence par gloser les quatre tableaux de Delacroix, son intention n’est pas de brusquer la vox populi et l’administration des Beaux-Arts. Accablé de commandes officielles […], le peintre de La Barque de Dante (ill.) a ainsi triomphé des adversaires de sa jeunesse : « M. Delacroix restera toujours un peu contesté, juste autant qu’il faut pour ajouter quelques éclairs à son auréole. Et tant mieux ! Il a le droit d’être toujours jeune, car il ne nous a pas trompés, lui, il ne nous a pas menti comme quelques idoles ingrates que nous avons portées dans nos panthéons. M. Delacroix n’est pas encore de l’Académie, mais il en fait partie moralement ; dès longtemps il a tout dit, dit tout ce qu’il faut pour être le premier – c’est convenu ; – il ne lui reste plus – prodigieux tour de force d’un génie sans cesse en quête du neuf – qu’à progresser dans la voie du bien – où il a toujours marché. »

Au vu de La Madeleine dans le désert, il surenchérit en disant Delacroix « plus fort que jamais, et dans une voie de progrès sans cesse renaissante, c’est-à-dire qu’il est plus que jamais harmoniste. » Que cet art d’unir les tons avec science et puissance expressive se charge ou non de résonances fouriéristes alors, identifie ou pas entente chromatique et refondation sociétale, l’impératif d’harmonie domine l’ensemble du Salon de 1845. L’éreintage d’Horace Vernet confirme cette primauté du tout-ensemble, élaboration, narration et impression sur le public. Après avoir dit pourquoi la toile de Delacroix, Le Sultan de Maroc entouré de sa garde et de ses officiers (ill.) surclassait tout, Baudelaire immole la principale attraction du Salon de 1845. En quelques lignes, les plus sévères peut-être du texte, La Prise de la smala d’Abd el-Kader, immense tableau de propagande coloniale, est ramené à son échec plastique et sa dispersion visuelle, dictée par la méthode additive de Vernet et sa rivalité ouverte avec les nouveaux modes du spectaculaire : « Cette peinture africaine est plus froide qu’une belle journée d’hiver. – Tout y est d’une blancheur et d’une clarté désespérantes. L’unité, nulle ; mais, une foule de petites anecdotes intéressantes – un vaste panorama de cabaret […]. vraiment c’est une douleur que de voir un homme d’esprit patauger dans l’horrible. – M. Horace Vernet n’a donc jamais vu les Rubens, les Véronèse, les Tintoret, les Jouvenet, morbleu !… » […] Les tableaux « africains » de Delacroix et Vernet se situent ainsi aux deux extrémités de l’invention picturale, et fixent les pôles positif et négatif de l’art du moment avec la netteté d’une symétrique parlante.

Le survol auquel Baudelaire s’astreint ensuite a trouvé ses bornes, et l’essentiel de son analyse tendra à enregistrer tel défaut d’audace, telle indécision de moyen ou de but. Mais il fallait bien qu’une exception se dégageât « des régions moyennes du goût et de l’esprit ». Un élève d’Ingres, obscur alors, oublié aujourd’hui, eut le privilège d’être « le plus bel avènement de l’année », écrit Asselineau de William Haussoulier et de son Bain de jouvence, qui ne nous semble plus mériter tant d’honneurs. […] Soutenir celui que la presse brocarde ou ignore a visiblement tenté Baudelaire, comme l’archaïsme sensuel et mélancolique de ce tableau assez cru de coloris. […] L’unique réserve, celle du pastiche, tient en une question cuisante : « M. Haussoulier serait-il de ces hommes qui en savent trop long sur leur art ? […] Qu’il se défie de son érudition, qu’il se défie même de son goût – mais c’est là un illustre défaut – et ce tableau contient assez d’originalité pour promettre un heureux avenir. » Pour paraphraser Baudelaire, un tableau doit avoir foi en sa beauté, et n’emprunter aux grands aînés que ce que sa propre originalité peut vivifier. Aussi son hostilité au mimétisme passif, béquille secrète ou recyclage valorisant, traverse-t-elle l’ensemble de sa recension, et le rend-elle injuste envers Chassériau dont le Portrait d’Ali ben Ahmed (notre ill.), supposé trop delacrucien, « reste l’une des plus belles œuvres du Salon », écrit Asselineau. Rien de comparable avec les larcins du très populaire Robert-Fleury, dépouilleur de Rubens et Rembrandt : ils condamnent une peinture aussi racoleuse que multi-référentielle. Une vingtaine d’années après son émergence, le romantisme, hormis Delacroix, achève de s’épuiser ou de s’apostasier, tels Louis Boulanger et surtout Achille Devéria, l’ex-chroniqueur balzacien des élégances 1820 en qui se dessinait le Constantin Guys des années 1850-1860.

Aucun renoncement à soi, aucun travestissement, aucun subterfuge n’échappe à Baudelaire en 1845 […], elle ne l’empêche pas toutefois de concéder quelques louanges aux artistes sans génie, mais capables de bien faire ou de le surprendre. Ainsi s’avoue-t-il sensible à l’énergie, inspiration et facture, de ce « pseudo-Delacroix » de Debon, ou des suiveurs de Ribera ; la bonhomie flamande d’un Meissonier, quoique retenue et comprimée, ne le laisse pas froid, pas plus que le préraphaélisme des élèves d’Ingres. Si l’obsession du dessin, mariée à une certaine rudesse expressive et réaliste, fait du maître, écrit-il, le premier portraitiste de France, ses émules, à contrevenir aux lois du paysage, se voient parfois corriger. Le devenir du paysage moderne, selon Baudelaire, se joue entre Théodore Rousseau et Camille Corot, unis par la même naïveté, où le critique identifie moins quelque authenticité miraculeusement préservé qu’une approche du réel, du motif, fondée sur une communion sensible et une expression vivifiante. […] Baudelaire, face aux sculpteurs, redit son peu de sympathie pour ceux qui tendent au mimétisme trop poussé et frise les effets du moulage. Une coda fulgurante suit la section de la statuaire et la confirme. Ce que l’art a gagné en virtuosité, il l’a perdu en invention, idées, tempérament. D’où l’appel à inverser les priorités : « Au vent qui soufflera demain nul ne tend l’oreille ; et pourtant l’héroïsme de la vie moderne nous entoure et nous presse. – Nos sentiments vrais nous étouffent assez pour que nous les connaissions. – Ce ne sont ni les sujets ni les couleurs qui manquent aux épopées. Celui-là sera le peintre, le vrai peintre, qui saura arracher à la vie actuelle son côté épique, et nous faire voir et comprendre, avec de la couleur ou du dessin, combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottes vernies. – Puissent les vrais chercheurs nous donner l’année prochaine cette joie singulière de célébrer l’avènement du neuf ! » Baudelaire ne doit pas faire oublier que d’autres que lui, Thoré et Gautier, par exemple, envisagent alors un développement « actualiste » du romantisme. […] Mais il fut bien le seul salonnier à souligner, sous le regard du Bertin d’Ingres gravé par Henriquel-Dupont (ill.), l’urgence vitale de ce nouveau souffle.
Stéphane Guégan
BAUDELAIRE, LE SALON, SES MARGES, SES ÉCHOS

Une exposition qui vous empoigne de la première à la dernière salle, un catalogue solide de bout en bout, cela devient rare. Au Petit Palais, après un silence de près 60 ans, Théodore Rousseau a les honneurs de cimaises françaises. Il était temps de relever le gant, le meilleur de la recherche récente est anglo-saxon : Simon Kelly, Greg M. Thomas, Edouard Kopp, Scott Allan et quelques autres ont su rafraîchir la vision d’un artiste que Baudelaire plaçait à la tête de « l’école moderne du paysage », et rapprochait de Delacroix en raison de leur pente commune à la mélancolie et aux toiles centripètes. Parler de la « naïveté » et de l’« originalité » de Rousseau , comme le poète le fit en 1845, n’avait rien de naïf, ni d’original. Une pleine phalange de journalistes et d’écrivains, après 1831, appuie le jeune frondeur, sa « franche étude de la nature » (Gautier, 1833), son sens de l’organique, et l’empathie qui le conduit à couler son moi au cœur des éléments, déchaînés ou apaisés, sauvages ou champêtres. L’extraordinaire Vue du Mont-Blanc (Copenhague) qui ouvre le parcours n’a rien perdu du pouvoir de saisissement qui secoua nos aînés. A ce panorama en furie, où formes et forces s’affrontent sous un vent biblique, Rousseau travailla sa vie entière, sans ruiner l’énergie primitive de 1834. On pense à Frenhofer et au Chef-d’œuvre inconnu. Trente ans d’une carrière aussi agitée s’y résument, que la commissaire Servane Dargnies-de Vitry déploie en alternant subtilement peintures, dessins et photographies, en variant aussi les angles de lecture, de l’esthétique au politique, de l’essor de la biologie, cette nouvelle pensée du vivant, à l’écologie, cette réponse naissante aux effets de l’âge de et du fer. Le Massacre des innocents (La Haye), où subsiste le souvenir de la célèbre gravure de Raphaël et Raimondi, désigne allégoriquement les abattages barbares en forêt de Fontainebleau. La toile inachevée, et comme dépecée, de 1847 n’en est que plus dramatique. La déforestation continuant, parallèlement à la conversion touristique du site, que le peintre déplore non moins, Rousseau usera de ses leviers politiques sous le Second Empire et obtiendra, en 1861, la création d’une « réserve artistique », l’ancêtre de parcs nationaux. Le républicanisme sincère, quoique distant, de Rousseau, pour avoir été mythifié par les hommes de 1848, ne l’empêcha pas de vendre des tableaux aux fils de Louis-Philippe et au comte de Morny. Peut-être un portait de collectionneur, comme celui de Paul Collot par son ami Millet, eût-il permis de rappeler l’autre révolution rousseauiste : elle eut les acteurs du marché de l’art pour héros, voire les salles de vente pour théâtre tempétueux. Et, au bout, la fortune. SG / Servane Dargnies-de Vitry (dir.), Théodore Rousseau. La Voix de la forêt, Paris Musées, 35€. Petit Palais de Paris, jusqu’au 7 juillet 2024.

Trois articles qui ont fait le tour du monde, et du monde de l’art en premier lieu, un texte qui n’a cessé de semer le malentendu depuis 1863, Le Peintre de la vie moderne a besoin d’une écoute impartiale pour être compris. Les belles pages qu’Henri Scepi a placées en tête de cette réédition en désamorcent les pièges : au-delà de ce que son titre annonce d’adhérence au réalisme et au monde actuel, Baudelaire y bataille avec les champions du prosaïsme et du progressisme. Du reste, pas plus qu’en 1845-1846, le peintre de ses vœux reste introuvable en 1863. Malgré ses croquis alertes et son sens de la composition, Constantin Guys ne saurait être salué comme le Delacroix de la modernité, même s’il n’aplanit pas, à rebours de Gavarni, « les rudesses de la vie ». La quinzaine d’années qui s’est écoulée depuis les premiers Salons a vu la capitale se métamorphoser et le temps s’accélérer. Baudelaire change de référent : ce n’est plus le panache des criminels, c’est la mode, la vie élégante, la rue parcourue de voitures à chevaux, c’est même la guerre, de mouvement elle aussi. Autant d’indices du neuf, aptes à défier le jeu de l’imagination et le travail de la mémoire. Car rien n’échappe à l’estampille du présent, ni les corps, ni la façon de se vêtir ou de se tenir dans l’espace public, le poète le réaffirme avec l’ambition de l’historien des mœurs que l’enfer moderne horrifie et fascine. La modernité fatalement se dédouble, et l’impératif d’allier les contraires se fait entendre, l’instantané du croquis et la profondeur du grand art. Autant que la physionomie de l’époque, sa psychologie latente est à enregistrer. L’art ancien ne s’est-il pas fait l’historien de son propre temps en retenant l’exceptionnel ? Car la poésie est du côté des résistances, des conditions et des situations atypiques, du dandysme à la prostitution. Le Balzac de Splendeurs et misères des courtisanes, que Baudelaire cite, n’a pas quitté son horizon. SG / Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, Folio, Gallimard, 3€.

Un lion rugissant, cherchant qui dévorer (quærens quem devoret)… Au moment de légender ce célèbre portrait de Jeanne Duval (Orsay), en puisant à la Première épître de saint Pierre et en filant amoureusement la métaphore féline et diabolique, Baudelaire s’est-il souvenu du passage suivant ? Il est tiré du Salon de 1847 (Hetzel) de Théophile Gautier et concerne un des paysages (non localisé) que Paul Flandrin exposa cette année-là, ce même Flandrin auquel le futur poète des Fleurs du Mal, deux ans plus tôt, reprochait d’avoir eu l’extravagance d’« ingriser la campagne » : « Dans un ravin mêlé d’arbres et de roches, un cerf et sa biche se reposent, couchés sur la mousse, avec un sentiment de sécurité parfaite ; l’air ne leur apporte aucune émanation inquiétante ; mais regardez cette tache fauve sur cette grosse pierre, c’est une lionne qui guette le groupe heureux et qui s’est placée au-dessous du vent pour ne pas se trahir par son âcre parfum. Elle mesure et médite son bond, aplatie contre terre, déroulée comme un serpent, le mufle appuyé sur les pattes. […] Cette petite toile, pâle de ton et d’un aspect peu saisissant au premier abord, nous a tenu arrêté longtemps devant elle. Cette lionne cachée et ces cerfs à deux doigts du danger et qui ne pensent à rien, n’est-ce pas toute la vie humaine ? N’y a-t‑il pas toujours autour de nous-mêmes, à nos moments de relâche et de sécurité, un malheur à l’affût prêt de nous sauter d’un bond sur les épaules ? […] Quand la bête féroce cachée doit-elle nous enfoncer ses dents et ses griffes dans la chair ? Nul ne le sait ; mais elle est toujours là qui rôde, quærens quem devoret. » Dans le cadre des Œuvres complètes de Gautier, le tome II de la Critique d’art, composé des Salons de 1844-1849, paraitra à la fin de septembre 2024 chez Honoré Champion. Nous en reparlerons, bien entendu.