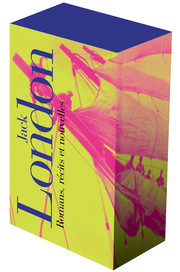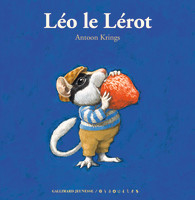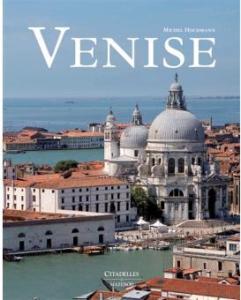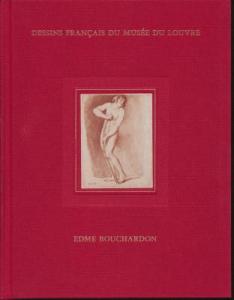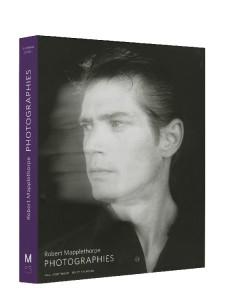Il n’est pas de poème des Fleurs du Mal qui ait été plus remanié et rapiécé, de manuscrit en manuscrit, de revues en livres, que Le Vin des chiffonniers, comme si le texte et son sujet restaient fatalement liés par-delà le premier pressage… Cette ode à l’éthylisme joyeux et vengeur date très probablement des années 1842-1843, années d’affirmation violente. Retour de l’Océan indien, la majorité bientôt atteinte, Baudelaire se jette dans la vie d’artiste avec l’héritage paternel, à la barbe de son beau-père, le général Aupick, qui pensait, l’innocent, le détourner des lettres et de la bohème à grandes doses d’excursions tropicales. Il en rapporta le goût des « négresses » et une impatience intacte à se séparer du « monde honorable », selon l’expression dont il usera avec sa mère, en décembre 1848, pour qualifier sa vie moins cadrée. C’est, du reste, vers cette époque, que Charles fit don du poème, en son écriture initiale, à Daumier (notre photo), qu’il tenait pour le plus grand des modernes, à égalité et distance d’Ingres et Delacroix. Leur rencontre avait largement précédé la Révolution de février et l’éphémère feu d’enthousiasme qu’elle leur causa. L’île Saint-Louis, au milieu des années 1840, ne ressemblait pas encore à une vitrine de Noël pour investisseurs incultes. Un tout autre monde, de toutes autres valeurs, y occupent les hôtels particuliers d’un Grand siècle fantomatique, ou se serrent dans les immeubles de rapports moins flamboyants. En fonction des moyens, les séjours durent ou s’espacent, on vit seul ou en groupe. Ainsi le meilleur de l’art français, avant 1848, se croise-t-il sur les rives des blanchisseuses de Daumier. Outre le génial caricaturiste, que Baudelaire fréquente, Préault, Deroy, Gautier, Balzac et la future Présidente en furent quelques-uns des résidents ou hôtes de passage.
Il n’est pas de poème des Fleurs du Mal qui ait été plus remanié et rapiécé, de manuscrit en manuscrit, de revues en livres, que Le Vin des chiffonniers, comme si le texte et son sujet restaient fatalement liés par-delà le premier pressage… Cette ode à l’éthylisme joyeux et vengeur date très probablement des années 1842-1843, années d’affirmation violente. Retour de l’Océan indien, la majorité bientôt atteinte, Baudelaire se jette dans la vie d’artiste avec l’héritage paternel, à la barbe de son beau-père, le général Aupick, qui pensait, l’innocent, le détourner des lettres et de la bohème à grandes doses d’excursions tropicales. Il en rapporta le goût des « négresses » et une impatience intacte à se séparer du « monde honorable », selon l’expression dont il usera avec sa mère, en décembre 1848, pour qualifier sa vie moins cadrée. C’est, du reste, vers cette époque, que Charles fit don du poème, en son écriture initiale, à Daumier (notre photo), qu’il tenait pour le plus grand des modernes, à égalité et distance d’Ingres et Delacroix. Leur rencontre avait largement précédé la Révolution de février et l’éphémère feu d’enthousiasme qu’elle leur causa. L’île Saint-Louis, au milieu des années 1840, ne ressemblait pas encore à une vitrine de Noël pour investisseurs incultes. Un tout autre monde, de toutes autres valeurs, y occupent les hôtels particuliers d’un Grand siècle fantomatique, ou se serrent dans les immeubles de rapports moins flamboyants. En fonction des moyens, les séjours durent ou s’espacent, on vit seul ou en groupe. Ainsi le meilleur de l’art français, avant 1848, se croise-t-il sur les rives des blanchisseuses de Daumier. Outre le génial caricaturiste, que Baudelaire fréquente, Préault, Deroy, Gautier, Balzac et la future Présidente en furent quelques-uns des résidents ou hôtes de passage.
 Ce Paris-là, Frédéric Vitoux l’a montré dans l’un de ses meilleurs livres, s’est prolongé jusqu’à l’âge d’or de l’entre-deux-guerres, jusqu’à Drieu, Aragon et Dos Passos. Ce Paris-là, c’est celui de l’enquête majeure qu’Antoine Compagnon a choisi de lancer sur les traces des chiffonniers et la diaspora qu’ils forment, entre le romantisme et Manet, entre le verbe et l’image, au cœur de la modernité française. Nous savions, pour l’avoir croisé chez Daumier, Charlet, Traviès, Gavarni, Charles Nègre (notre photo, plus bas) et le peintre d’Olympia, que ce Diogène du Peuple avait glissé son crochet et sa hotte ici et là, au gré de déambulations nocturnes, avinées et payantes. Mais il manquait un ouvrage qui précisât, en amont du mythe, la réalité sociale du chiffonnier, son comportement politique et son utilité collective afin d’expliquer, à nouveaux frais, son ubiquité textuelle et visuelle. Pour Walter Benjamin, l’affaire était simple. Baudelaire se serait reconnu en ces parias magnifiques par fraternité insurrectionnelle. Sa fidélité au chiffonnier, sous le Second Empire, signerait une manière d’alliance secrète avec la flambée quarante-huitarde, malgré les dénégations du poète, qui se dit « dépolitiqué » au soir du 2 décembre 1851…
Ce Paris-là, Frédéric Vitoux l’a montré dans l’un de ses meilleurs livres, s’est prolongé jusqu’à l’âge d’or de l’entre-deux-guerres, jusqu’à Drieu, Aragon et Dos Passos. Ce Paris-là, c’est celui de l’enquête majeure qu’Antoine Compagnon a choisi de lancer sur les traces des chiffonniers et la diaspora qu’ils forment, entre le romantisme et Manet, entre le verbe et l’image, au cœur de la modernité française. Nous savions, pour l’avoir croisé chez Daumier, Charlet, Traviès, Gavarni, Charles Nègre (notre photo, plus bas) et le peintre d’Olympia, que ce Diogène du Peuple avait glissé son crochet et sa hotte ici et là, au gré de déambulations nocturnes, avinées et payantes. Mais il manquait un ouvrage qui précisât, en amont du mythe, la réalité sociale du chiffonnier, son comportement politique et son utilité collective afin d’expliquer, à nouveaux frais, son ubiquité textuelle et visuelle. Pour Walter Benjamin, l’affaire était simple. Baudelaire se serait reconnu en ces parias magnifiques par fraternité insurrectionnelle. Sa fidélité au chiffonnier, sous le Second Empire, signerait une manière d’alliance secrète avec la flambée quarante-huitarde, malgré les dénégations du poète, qui se dit « dépolitiqué » au soir du 2 décembre 1851…
 Même assortie de sa composante mélancolique, qui fait du rebut le symbole d’un monde victime d’obsolescence accélérée, la thèse de Benjamin, qui a encore ses émules, souffre d’être à la fois plus idéologique et maximaliste que concrète et prismatique… Lorsque Le Vin des chiffonniers rejoindra Les Fleurs en 1857, il y sera fait mention des « mouchards », absents de la version de 1843, et mêlés désormais à la ténébreuse cohorte des recycleurs de détritus et d’informations. Ne comptez pas sur Baudelaire pour exempter la « peinture de la vie moderne » des illusions du réel et de la dualité des choses. Avant d’en juger, estime Compagnon, mieux vaut connaître de quoi on parle. Ces chiffonniers de tous âges et de tous sexes étaient de 30 à 40 mille dans Paris, et leur activité vitale à l’économie urbaine, notamment à la fabrication du papier où la pâte à bois n’entre pas encore. Sans récupération organisée, point de journaux et de livres, dont le règne de Louis-Philippe fait bondir les chiffres. L’écrivain, en saluant son frère en « sauvagerie », a d’abord la reconnaissance du ventre, Privat d’Anglemont l’a dit mieux que tous. Avec beaucoup d’autres, qui n’avaient pas son talent et son ironie, ce proche de Baudelaire témoigne d’un souci aigu de la société contemporaine. C’est l’ère des typologies et, dira Benjamin, des « panoramas » de papier. Pour se comprendre dans sa diversité brouillée et ses hiérarchies mobiles, l’enfer balzacien multiplie les images de soi, inventorie les métiers, les milieux et fabrique des héros en habit noir ou en guenilles. Bien qu’antérieure, l’imagerie explose alors et ce livre en rassemble, pour la première fois, une moisson confondante, qui transcende esthétiques et médiums.
Même assortie de sa composante mélancolique, qui fait du rebut le symbole d’un monde victime d’obsolescence accélérée, la thèse de Benjamin, qui a encore ses émules, souffre d’être à la fois plus idéologique et maximaliste que concrète et prismatique… Lorsque Le Vin des chiffonniers rejoindra Les Fleurs en 1857, il y sera fait mention des « mouchards », absents de la version de 1843, et mêlés désormais à la ténébreuse cohorte des recycleurs de détritus et d’informations. Ne comptez pas sur Baudelaire pour exempter la « peinture de la vie moderne » des illusions du réel et de la dualité des choses. Avant d’en juger, estime Compagnon, mieux vaut connaître de quoi on parle. Ces chiffonniers de tous âges et de tous sexes étaient de 30 à 40 mille dans Paris, et leur activité vitale à l’économie urbaine, notamment à la fabrication du papier où la pâte à bois n’entre pas encore. Sans récupération organisée, point de journaux et de livres, dont le règne de Louis-Philippe fait bondir les chiffres. L’écrivain, en saluant son frère en « sauvagerie », a d’abord la reconnaissance du ventre, Privat d’Anglemont l’a dit mieux que tous. Avec beaucoup d’autres, qui n’avaient pas son talent et son ironie, ce proche de Baudelaire témoigne d’un souci aigu de la société contemporaine. C’est l’ère des typologies et, dira Benjamin, des « panoramas » de papier. Pour se comprendre dans sa diversité brouillée et ses hiérarchies mobiles, l’enfer balzacien multiplie les images de soi, inventorie les métiers, les milieux et fabrique des héros en habit noir ou en guenilles. Bien qu’antérieure, l’imagerie explose alors et ce livre en rassemble, pour la première fois, une moisson confondante, qui transcende esthétiques et médiums.
 Si le chiffonnier devient un « répondant allégorique » (Starobinski) de l’artiste, la raison déborde l’idée très portée alors du déclassement ontologique et, après 1848, de la solidarité entre les classes (l’artiste, sauf exception, est un bourgeois voué aux contorsions dès qu’il entend le faire oublier). Bref, la parenté du poète et du chiffonnier, insiste Compagnon, ne s’épuise pas dans « l’argument politique » si souvent invoqué. Il était bon de rappeler au lecteur que le trieur d’ordures vit généralement mieux que l’ouvrier et qu’il ne participa pas nécessairement aux insurrections, en 1832 et 1848, aux côtés des ventres-creux et des rares écrivains et peintres à avoir fait, tel Baudelaire, le coup de feu. Au reste, refroidi par la tournure des événements, l’attitude incohérente ou déceptive des nouveaux maîtres, le bain de sang de juin et le retour d’« un Bonaparte », le poète n’abjure pas la « sensibilité sociale » qui est la sienne, et que Le Vin des chiffonniers n’est pas seul à contenir. Sans l’oublier, Compagnon rend audibles les autres résonances, poétiques celles-ci, du thème. Baudelaire s’assimile tout de son frère putatif, de l’argot au choc inspirateur des pavés. Ce livre refermé, on ne lira plus jamais Une charogne, Le Soleil, Les Petites vieilles et Le Vin des chiffonniers de la même façon, de même qu’on ne regardera plus Manet (notre photo) comme avant. Stéphane Guégan
Si le chiffonnier devient un « répondant allégorique » (Starobinski) de l’artiste, la raison déborde l’idée très portée alors du déclassement ontologique et, après 1848, de la solidarité entre les classes (l’artiste, sauf exception, est un bourgeois voué aux contorsions dès qu’il entend le faire oublier). Bref, la parenté du poète et du chiffonnier, insiste Compagnon, ne s’épuise pas dans « l’argument politique » si souvent invoqué. Il était bon de rappeler au lecteur que le trieur d’ordures vit généralement mieux que l’ouvrier et qu’il ne participa pas nécessairement aux insurrections, en 1832 et 1848, aux côtés des ventres-creux et des rares écrivains et peintres à avoir fait, tel Baudelaire, le coup de feu. Au reste, refroidi par la tournure des événements, l’attitude incohérente ou déceptive des nouveaux maîtres, le bain de sang de juin et le retour d’« un Bonaparte », le poète n’abjure pas la « sensibilité sociale » qui est la sienne, et que Le Vin des chiffonniers n’est pas seul à contenir. Sans l’oublier, Compagnon rend audibles les autres résonances, poétiques celles-ci, du thème. Baudelaire s’assimile tout de son frère putatif, de l’argot au choc inspirateur des pavés. Ce livre refermé, on ne lira plus jamais Une charogne, Le Soleil, Les Petites vieilles et Le Vin des chiffonniers de la même façon, de même qu’on ne regardera plus Manet (notre photo) comme avant. Stéphane Guégan
*Antoine Compagnon, Les Chiffonniers de Paris, Paris, Gallimard, 32€.
Journée d’étude : Baudelaire et la peinture
Mardi 7 novembre 2017, 9h30 à 17h
Sous la direction d’Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, et d’André Guyaux, professeur de littérature à Paris-Sorbonne
Charles Baudelaire fut, dès 1845, un critique d’art averti et passionné. Les critiques de ses Salons et des Expositions mettent en valeur la profondeur et la vivacité de ses jugements esthétiques. Il voua à Eugène Delacroix un véritable culte, désignant le peintre comme un des plus grands artistes de son temps.
Cette journée d’étude aura lieu au musée Delacroix, au sein du dernier atelier de l’artiste, atelier où, sans doute, Baudelaire fut reçu. Elle réunira spécialistes de la peinture, de l’estampe, de la littérature, de la photographie.
Avec des interventions de Claire Chagniot, Catherine Delons, Wolfgang Drost, Stéphane Guégan, Ségolène Le Men, Paul-Louis Roubert, Fabrice Wilhelm.
Informations et réservations au 01.44.41.86.50 ou par mail : contact.musee-delacroix@louvre.fr
Stéphane Guégan : 1848/1849 : Delacroix entre Baudelaire et Gautier (résumé)
Sous la IIème République, dont il fut le serviteur et l’un des grands bénéficiaires, Delacroix poursuit son Journal, qui n’a rien de la chronique atrabilaire d’un bourgeois apeuré, à rebours de ce qu’en dit T. J. Clark en 1973. Quarante-cinq plus tard, il est peut-être permis de voir les choses autrement. Delacroix est dans l’époque. Les fréquentes poussées de mélancolie, à laquelle la situation ajoute son flottement propre, n’entament pas son sens de l’observation et sa sociabilité. Qu’avait-il besoin de recevoir Baudelaire en février 1849 ou d’assister, un mois plus tard, en compagnie de Gautier, à une séance d’hypnose et/ou de somnambulisme ? C’est ma première question. La seconde portera sur les postions politiques des uns et des autres. La vulgate baudelairienne nous parle tantôt d’utopies socialistes, tantôt de républicanisme sans lendemain. De son côté, les experts de Delacroix, sans doute moins attachés à l’idéal de 1789 et du Directoire qu’il ne l’était, aiment à le peindre en réactionnaire frileux, se barricadant à Champrosay avec ses « gens ». J’examinerai pour finir le tableau qui résume, à bien des égards, ces mois si tendus politiquement de 1849, si riches d’expériences aussi, Lady Macbeth (New Brunswick). Notre hypothèse est que l’œuvre, présentée au Salon de 1850-51, doit une partie de sa cristallisation à la séance de magnétisme organisée par Gautier, auquel Delacroix fit don du tableau… À l’évidence, comme Claude Pichois fut le premier à le proposer, Baudelaire fait écho au tableau dans L’Idéal, l’une des plus belles Fleurs du mal, publiée précisément dès avril 1851. J’ajouterai que le poète fut sans doute sensible à la façon dont Gautier avait rendu compte de cette Lady Macbeth « automatique », avant de se la voir offrir. SG
 Baudelaire encore et toujours… Une grande part des lettres conservées de Baudelaire ont eu sa mère pour destinataire. Le mot n’est pas trop fort. Qu’il s’agisse de l’adolescent agité et de ses promesses de bonne conduite, du poète aux abois et de ses demandes d’argent, ou de l’homme de douleur et de ses espoirs de rétablissement, un fils continue à parler à celle qui n’a jamais quitté ses pensées, à celle qu’il veut convaincre de son génie et de morale paradoxale, à celle dont il doit parfois forcer le silence et l’intraitable conformisme. Sans doute ne guérit-on jamais de l’enfance… Dans son cas, le souvenir des tendresses maternelles eut très tôt, trop tôt, le goût du fruit interdit. A treize ans, pour faire pardonner une scolarité aussi brillante que désordonnée, l’adolescent écrit déjà comme un dieu. Mais il en faudrait plus pour attendrir « maman », devenue Mme Aupick, du nom du général qu’elle a épousé après le décès du père de Baudelaire. Or le militaire exige de voir le prodige, qu’il traite d’abord en fils, rentrer dans le droit chemin. Pour cela, tous les moyens sont tentés, du voyage en bateau à la mise sous tutelle. Baudelaire sera un poète sous contrôle, le notaire Narcisse Ancelle lui imposant progressivement un train de vie impropre à ses mœurs et son nomadisme… Incapable de comprendre un tel mode d’existence, ni davantage le travailleur qu’il fut d’emblée, le couple n’a pas digéré qu’il pût dilapider l’héritage paternel de façon aussi peu utile… Après la mort d’Aupick, et bien qu’admirative des « répréhensibles » Fleurs du Mal, Caroline résistera très souvent aux appels de fonds. C’est pourtant du fond de sa détresse, quand la maladie s’ajoutera à la misère, que ce fils aimant, mais combustible et dur, lui écrit d’admirables et souvent déchirantes lettres. On les trouvera réunies dans ce volume, avec leur ratures : « significatives de circonstances matérielles et de l’état d’esprit de l’épistolier », elles révèlent aussi, ajoute Catherine Delons, « l’élan, le cheminement de la pensée ». La grande baudelairienne, qui sait combien la dépendance maternelle a autant structuré que détruit le poète, nous fait entendre la voix de cette mère et de cette affection à éclipses. Les lettres qu’elle adressa à son fils ont été probablement détruites par ses soins, pas celles qu’elle envoya à Ancelle, à quoi s’ajoutent les billets d’Aupick au demi-frère du poète. L’ensemble est merveilleusement édité et commenté par Catherine Delons. Rien n’empêche de l’inclure à « l’œuvre » de Baudelaire, mais rien n’interdit d’y voir saigner, selon le mot du poète catholique, un « cœur mis à nu» et une plume en lutte avec ses chimères. SG // Baudelaire, Lettres à sa mère 1834-1866, correspondance établie, présentée et annotée par Catherine Delons, Editions Manucius, 28€
Baudelaire encore et toujours… Une grande part des lettres conservées de Baudelaire ont eu sa mère pour destinataire. Le mot n’est pas trop fort. Qu’il s’agisse de l’adolescent agité et de ses promesses de bonne conduite, du poète aux abois et de ses demandes d’argent, ou de l’homme de douleur et de ses espoirs de rétablissement, un fils continue à parler à celle qui n’a jamais quitté ses pensées, à celle qu’il veut convaincre de son génie et de morale paradoxale, à celle dont il doit parfois forcer le silence et l’intraitable conformisme. Sans doute ne guérit-on jamais de l’enfance… Dans son cas, le souvenir des tendresses maternelles eut très tôt, trop tôt, le goût du fruit interdit. A treize ans, pour faire pardonner une scolarité aussi brillante que désordonnée, l’adolescent écrit déjà comme un dieu. Mais il en faudrait plus pour attendrir « maman », devenue Mme Aupick, du nom du général qu’elle a épousé après le décès du père de Baudelaire. Or le militaire exige de voir le prodige, qu’il traite d’abord en fils, rentrer dans le droit chemin. Pour cela, tous les moyens sont tentés, du voyage en bateau à la mise sous tutelle. Baudelaire sera un poète sous contrôle, le notaire Narcisse Ancelle lui imposant progressivement un train de vie impropre à ses mœurs et son nomadisme… Incapable de comprendre un tel mode d’existence, ni davantage le travailleur qu’il fut d’emblée, le couple n’a pas digéré qu’il pût dilapider l’héritage paternel de façon aussi peu utile… Après la mort d’Aupick, et bien qu’admirative des « répréhensibles » Fleurs du Mal, Caroline résistera très souvent aux appels de fonds. C’est pourtant du fond de sa détresse, quand la maladie s’ajoutera à la misère, que ce fils aimant, mais combustible et dur, lui écrit d’admirables et souvent déchirantes lettres. On les trouvera réunies dans ce volume, avec leur ratures : « significatives de circonstances matérielles et de l’état d’esprit de l’épistolier », elles révèlent aussi, ajoute Catherine Delons, « l’élan, le cheminement de la pensée ». La grande baudelairienne, qui sait combien la dépendance maternelle a autant structuré que détruit le poète, nous fait entendre la voix de cette mère et de cette affection à éclipses. Les lettres qu’elle adressa à son fils ont été probablement détruites par ses soins, pas celles qu’elle envoya à Ancelle, à quoi s’ajoutent les billets d’Aupick au demi-frère du poète. L’ensemble est merveilleusement édité et commenté par Catherine Delons. Rien n’empêche de l’inclure à « l’œuvre » de Baudelaire, mais rien n’interdit d’y voir saigner, selon le mot du poète catholique, un « cœur mis à nu» et une plume en lutte avec ses chimères. SG // Baudelaire, Lettres à sa mère 1834-1866, correspondance établie, présentée et annotée par Catherine Delons, Editions Manucius, 28€
 L’impossibilité qu’eurent Baudelaire et sa mère à s’aimer, ou se détester vraiment, tient à juste titre une grande place dans cette nouvelle biographie du poète à laquelle certains reprocheront sans doute de ne rien apporter d’inédit. Des imprécisions et notations hâtives émaillent ce récit alerte, rançon amère de ses vertus, dira-t-on. Quant à l’évolution politique, de part et d’autre le coup d’Etat du 2 décembre, le portrait est bien trop schématique, les digressions sur les « utopies socialistes » trop datées, l’héritage républicain sous-estimé. Il est faux d’écrire : « Si théologiquement Baudelaire s’écarte de (Joseph) de Maistre, politiquement, en revanche, il en est sans doute proche. » On pourrait presque écrire l’inverse. Il est faux d’avancer, autre exemple d’approximation , que Lola de Valence fut refusée au Salon puisque Manet ne songea pas l’y exposer. Et pourquoi laisser penser que le célèbre quatrain de Baudelaire (le bijou rose et noir…) aurait subi le même oukase, le peintre l’ayant rendu public en gravant lui-même, dès 1863, les vers de son ami sous l’image de la danseuse ? De manière générale, l’information relative au critique d’art et à la passion picturale de Baudelaire est moins nourrie que ce que Marie-Christine Natta dit du poète et de sa carrière nécessairement heurtée dans les lettres et le journalisme. Cette spécialiste de Barbey d’Aurevilly et du dandysme, auteur d’un très bon Delacroix (Tallandier, 2010), n’usurpe pas ses droits à vouloir ranger Baudelaire parmi les émules de Brummel, Byron et autres apatrides de la société commune. Partant, Marie-Christine Natta met en évidence tout ce qui légitime la thèse d’une révolte précoce et durable contre l’ordre social, thèse qui sent un peu le sociologisme des années 1960-1970. Quand le jeune Baudelaire, écartelé entre son narcissisme de rentier et sa difficulté à devenir le poète qu’il rêve d’être, se cabre, Natta sent déjà se manifester un refus plus catégorique : « persuade-toi donc bien d’une chose, que tu me sembles toujours ignorer ; c’est que vraiment pour mon malheur, je ne suis pas fait comme les autres hommes », hurle-t-il à sa mère, en août 1844, après qu’elle eut pris la décision d’imposer à ce fils, monstrueusement impécunieux, un conseil judiciaire en la personne d’Ancelle. Baudelaire brûle, quand les autres consomment, brûle comme si la vie ne pouvait jamais offrir assez, comme si la démesure était la seule réponse à l’asthénie bourgeoise. Natta voit déjà poindre là le poète de la double postulation existentielle, le protecteur des « filles », le quarante-huitard paradoxal, le moderne sceptique et enfin le prétendant à l’Académie. A dire vrai, c’est le mélange d’aristocratisme, de sensibilité sociale et de miséricorde chrétienne (où l’on retrouve Joseph de Maistre et peut-être Veuillot) qui fit la grandeur unique. Les gamineries du noceur empêché avaient eu du bon. SG /Marie-Christine Natta, Baudelaire, Perrin, 27€.
L’impossibilité qu’eurent Baudelaire et sa mère à s’aimer, ou se détester vraiment, tient à juste titre une grande place dans cette nouvelle biographie du poète à laquelle certains reprocheront sans doute de ne rien apporter d’inédit. Des imprécisions et notations hâtives émaillent ce récit alerte, rançon amère de ses vertus, dira-t-on. Quant à l’évolution politique, de part et d’autre le coup d’Etat du 2 décembre, le portrait est bien trop schématique, les digressions sur les « utopies socialistes » trop datées, l’héritage républicain sous-estimé. Il est faux d’écrire : « Si théologiquement Baudelaire s’écarte de (Joseph) de Maistre, politiquement, en revanche, il en est sans doute proche. » On pourrait presque écrire l’inverse. Il est faux d’avancer, autre exemple d’approximation , que Lola de Valence fut refusée au Salon puisque Manet ne songea pas l’y exposer. Et pourquoi laisser penser que le célèbre quatrain de Baudelaire (le bijou rose et noir…) aurait subi le même oukase, le peintre l’ayant rendu public en gravant lui-même, dès 1863, les vers de son ami sous l’image de la danseuse ? De manière générale, l’information relative au critique d’art et à la passion picturale de Baudelaire est moins nourrie que ce que Marie-Christine Natta dit du poète et de sa carrière nécessairement heurtée dans les lettres et le journalisme. Cette spécialiste de Barbey d’Aurevilly et du dandysme, auteur d’un très bon Delacroix (Tallandier, 2010), n’usurpe pas ses droits à vouloir ranger Baudelaire parmi les émules de Brummel, Byron et autres apatrides de la société commune. Partant, Marie-Christine Natta met en évidence tout ce qui légitime la thèse d’une révolte précoce et durable contre l’ordre social, thèse qui sent un peu le sociologisme des années 1960-1970. Quand le jeune Baudelaire, écartelé entre son narcissisme de rentier et sa difficulté à devenir le poète qu’il rêve d’être, se cabre, Natta sent déjà se manifester un refus plus catégorique : « persuade-toi donc bien d’une chose, que tu me sembles toujours ignorer ; c’est que vraiment pour mon malheur, je ne suis pas fait comme les autres hommes », hurle-t-il à sa mère, en août 1844, après qu’elle eut pris la décision d’imposer à ce fils, monstrueusement impécunieux, un conseil judiciaire en la personne d’Ancelle. Baudelaire brûle, quand les autres consomment, brûle comme si la vie ne pouvait jamais offrir assez, comme si la démesure était la seule réponse à l’asthénie bourgeoise. Natta voit déjà poindre là le poète de la double postulation existentielle, le protecteur des « filles », le quarante-huitard paradoxal, le moderne sceptique et enfin le prétendant à l’Académie. A dire vrai, c’est le mélange d’aristocratisme, de sensibilité sociale et de miséricorde chrétienne (où l’on retrouve Joseph de Maistre et peut-être Veuillot) qui fit la grandeur unique. Les gamineries du noceur empêché avaient eu du bon. SG /Marie-Christine Natta, Baudelaire, Perrin, 27€.