 Ces trois expos-là sont à voir. Plus discrètes que certains blockbusters, elles ont aussi trouvé leur public, et l’ont comblé surtout, loin des coups de projecteur assez prévisibles de la presse. Sade en Suisse, à Genève même, pour commencer. A priori, cela paraît presque aussi improbable que les recherches de l’oncle du divin marquis sur les amours platoniques de Pétrarque et de sa Laure adorata. Et pourtant la chose est vraie dans les deux cas. Michel Delon, qui a déjà tant fait pour ce centenaire et nous libérer de la vulgate post-surréaliste, est parvenu également à diriger l’exposition de la fondation Martin Bodmer et son somptueux catalogue, où chaque document, une partie de sa correspondance inédite et savoureuse notamment, fait l’objet d’une reproduction lisible en miroir de sa transcription. Les amateurs d’autographes et de verve épistolaire apprécieront. Ce luxe ravit, car il est le signe que Sade a acquis définitivement rang parmi les aigles de la République des lettres malgré son Eros dévorant. A part quelques puritains incurables, notre époque accepte désormais son double moi, même si les excès de l’un n’étaient pas nécessairement indispensables aux débordements de l’autre. Plume et sexe, l’atavisme familial réclame désormais des droits… De père en fils, le visiteur s’en convaincra, les Sade pratiquaient une sexualité plus rude et plus papillonnante que la moyenne. L’oncle, aussi abbé soit-il, ne manifeste aucun goût pour la supposée abstinence de sa charge. C’est à lui que l’on doit l’un des premiers livres savants sur Pétrarque et l’idée hautement séduisante, mais jamais vérifiée à ce jour, que Laure avait été Sade par mariage. Michel Delon s’amuse, et nous avec lui, des réserves que multiplie l’abbé au sujet de ce poète plus lyrique que viril, échec qui fait dire à l’oncle déniaisé que le XVIIIe siècle était supérieur au Moyen Âge en matière de romance. Son très combustible neveu va bâtir son œuvre sur le distinguo des désirs physiques et des sentiments, que sa vie de roué, de voluptueux, ne lui a permis d’éprouver ensemble que fortuitement. En somme, Sade fut bien un «athée en amour», déhiérarchisant et requalifiant sans cesse les instances du corps et de l’âme, «un questionneur exceptionnel qui nous protège des moralismes et des dogmatismes. La leçon d’amour qu’il nous donne, conclut superbement Delon, reste à lire parmi ses défis et ses paradoxes.»
Ces trois expos-là sont à voir. Plus discrètes que certains blockbusters, elles ont aussi trouvé leur public, et l’ont comblé surtout, loin des coups de projecteur assez prévisibles de la presse. Sade en Suisse, à Genève même, pour commencer. A priori, cela paraît presque aussi improbable que les recherches de l’oncle du divin marquis sur les amours platoniques de Pétrarque et de sa Laure adorata. Et pourtant la chose est vraie dans les deux cas. Michel Delon, qui a déjà tant fait pour ce centenaire et nous libérer de la vulgate post-surréaliste, est parvenu également à diriger l’exposition de la fondation Martin Bodmer et son somptueux catalogue, où chaque document, une partie de sa correspondance inédite et savoureuse notamment, fait l’objet d’une reproduction lisible en miroir de sa transcription. Les amateurs d’autographes et de verve épistolaire apprécieront. Ce luxe ravit, car il est le signe que Sade a acquis définitivement rang parmi les aigles de la République des lettres malgré son Eros dévorant. A part quelques puritains incurables, notre époque accepte désormais son double moi, même si les excès de l’un n’étaient pas nécessairement indispensables aux débordements de l’autre. Plume et sexe, l’atavisme familial réclame désormais des droits… De père en fils, le visiteur s’en convaincra, les Sade pratiquaient une sexualité plus rude et plus papillonnante que la moyenne. L’oncle, aussi abbé soit-il, ne manifeste aucun goût pour la supposée abstinence de sa charge. C’est à lui que l’on doit l’un des premiers livres savants sur Pétrarque et l’idée hautement séduisante, mais jamais vérifiée à ce jour, que Laure avait été Sade par mariage. Michel Delon s’amuse, et nous avec lui, des réserves que multiplie l’abbé au sujet de ce poète plus lyrique que viril, échec qui fait dire à l’oncle déniaisé que le XVIIIe siècle était supérieur au Moyen Âge en matière de romance. Son très combustible neveu va bâtir son œuvre sur le distinguo des désirs physiques et des sentiments, que sa vie de roué, de voluptueux, ne lui a permis d’éprouver ensemble que fortuitement. En somme, Sade fut bien un «athée en amour», déhiérarchisant et requalifiant sans cesse les instances du corps et de l’âme, «un questionneur exceptionnel qui nous protège des moralismes et des dogmatismes. La leçon d’amour qu’il nous donne, conclut superbement Delon, reste à lire parmi ses défis et ses paradoxes.»
 Comme Sade, Viollet-le-Duc a été mangé à toutes les sauces. La comparaison s’arrête là, bien que la formidable exposition de la Cité de l’architecture ait tenu à mettre l’accent sur la part d’ombre du rationaliste, vénéré de tout le XXe siècle, celui d’Auguste Perret avant celui des structuralistes. Si nous sommes encore réticents à assumer les ambivalences de notre histoire, s’agissant du colonialisme ou de Vichy, nous acceptons volontiers les ambiguïtés de nos héros nationaux. Viollet-le-Duc l’est resté pour le pire et le meilleur. Lui colle à la peau le souvenir d’un restaurateur autoritaire, qui aurait confondu l’amour du Moyen Âge et l’amour de soi, l’exhumation des traces et le fantasme de la complétude. Autre reproche qui le poursuit, son rationalisme froid mérite lui aussi d’être réexaminé à l’instar des autres poncifs de sa légende. Ce que l’exposition nous montre, ce que le catalogue nous dit avec éloquence, cadre peu avec «les orientations profondes» (Antoine Pinon) du personnage, autant dire l’imaginaire hyperactif sous la logique constructive apparente. On n’échappe pas ses fantasmes, Sade l’affirme jusqu’en prison, Viollet-le-Duc le confirme en marge de sa droiture inflexible. Des beaux dessins qu’il a tracés tôt en Italie, faisant primer l’atmosphère des vieilles églises sur l’ordre gothique, jusqu’aux détails de ses chantiers, de Notre-Dame à Pierrefonds, le diable s’est bien logé dans les détails. Par un ultime pied-de-nez aux faveurs qu’il avait reçues du Second Empire, il déclare, en 1874, sa flamme républicaine et se rangera derrière le panache de Gambetta. Décidément, l’imprévu marchait à ses côtés.
Comme Sade, Viollet-le-Duc a été mangé à toutes les sauces. La comparaison s’arrête là, bien que la formidable exposition de la Cité de l’architecture ait tenu à mettre l’accent sur la part d’ombre du rationaliste, vénéré de tout le XXe siècle, celui d’Auguste Perret avant celui des structuralistes. Si nous sommes encore réticents à assumer les ambivalences de notre histoire, s’agissant du colonialisme ou de Vichy, nous acceptons volontiers les ambiguïtés de nos héros nationaux. Viollet-le-Duc l’est resté pour le pire et le meilleur. Lui colle à la peau le souvenir d’un restaurateur autoritaire, qui aurait confondu l’amour du Moyen Âge et l’amour de soi, l’exhumation des traces et le fantasme de la complétude. Autre reproche qui le poursuit, son rationalisme froid mérite lui aussi d’être réexaminé à l’instar des autres poncifs de sa légende. Ce que l’exposition nous montre, ce que le catalogue nous dit avec éloquence, cadre peu avec «les orientations profondes» (Antoine Pinon) du personnage, autant dire l’imaginaire hyperactif sous la logique constructive apparente. On n’échappe pas ses fantasmes, Sade l’affirme jusqu’en prison, Viollet-le-Duc le confirme en marge de sa droiture inflexible. Des beaux dessins qu’il a tracés tôt en Italie, faisant primer l’atmosphère des vieilles églises sur l’ordre gothique, jusqu’aux détails de ses chantiers, de Notre-Dame à Pierrefonds, le diable s’est bien logé dans les détails. Par un ultime pied-de-nez aux faveurs qu’il avait reçues du Second Empire, il déclare, en 1874, sa flamme républicaine et se rangera derrière le panache de Gambetta. Décidément, l’imprévu marchait à ses côtés.
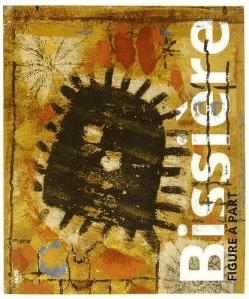 Roger Bissière est aussi un être de légendes. Il y a le camouflet de 1964, peu avant sa mort, lorsqu’il se fit souffler par Rauschenberg le grand prix de la Biennale de Venise. Il y aussi l’aura respectée du vieux maître, brouillant à plaisir la frontière entre figuration et abstraction depuis son Lot d’adoption, saisissant la nature, cycles et lumières, dans le filet d’une peinture pudique aux fragiles damiers. Son beau visage à la Titien, ses grandes mains noueuses et tordues à la Renoir, et ses casquettes de marin, alimentaient une image fièrement rustique à la Gauguin, sauvage retiré de tout, ne vivant que pour sa peinture et l’espèce de panthéisme qui l’habitait… Il y avait enfin l’homme que l’Occupation avait fait entrer dans le silence, en réserve de meilleurs jours, quand tant d’autres, à divers titres et différentes fins, avaient préféré continuer à travailler. Le choix n’a rien pour étonner. Comme le rappelle la splendide exposition de Bordeaux, la première rétrospective consacrée au peintre depuis trop longtemps, Bissière, fils de notaire et pas paysan le moins du monde, avait les idées et un tempérament bien trempés. Après une formation fort académique et même un passage un peu forcé à la Villa Médicis avant la guerre de 14, il s’impose parmi les cubistes les plus soucieux de marier Cézanne, Ingres et Fouquet. Ils ont aujourd’hui mauvaise réputation, accusés et accablés qu’ils sont d’avoir parlé de «rappel à l’ordre», et non de «retour à l’ordre», aux lendemains des tranchées. Avant de condamner ces artistes proches de Le Corbusier ou de la N.R.F., il eût peut-être fallu se demander contre quoi ils dressaient leur besoin de discipline… Le Bissière des années 1930, marqué par Picasso, se faisait une idée très libérale des exigences du «tableau», au regard de la peinture qui «se confinait dans une imitation imbécile et sans espoir.» La différence entre réalisme et mimétisme était donc consommée au moment où éclata la guerre. Vint donc le grand silence. Du moins est-ce la thèse la plus répandue. Est-elle juste pour autant ? Une partie de production des années 1945-1946 pourrait remonter plus tôt. Certains documents invitent à se poser la question. Bissière expose galerie de France en février 1944, sauf erreur… Qu’y montra le grand peintre? Cela reste à voir.
Roger Bissière est aussi un être de légendes. Il y a le camouflet de 1964, peu avant sa mort, lorsqu’il se fit souffler par Rauschenberg le grand prix de la Biennale de Venise. Il y aussi l’aura respectée du vieux maître, brouillant à plaisir la frontière entre figuration et abstraction depuis son Lot d’adoption, saisissant la nature, cycles et lumières, dans le filet d’une peinture pudique aux fragiles damiers. Son beau visage à la Titien, ses grandes mains noueuses et tordues à la Renoir, et ses casquettes de marin, alimentaient une image fièrement rustique à la Gauguin, sauvage retiré de tout, ne vivant que pour sa peinture et l’espèce de panthéisme qui l’habitait… Il y avait enfin l’homme que l’Occupation avait fait entrer dans le silence, en réserve de meilleurs jours, quand tant d’autres, à divers titres et différentes fins, avaient préféré continuer à travailler. Le choix n’a rien pour étonner. Comme le rappelle la splendide exposition de Bordeaux, la première rétrospective consacrée au peintre depuis trop longtemps, Bissière, fils de notaire et pas paysan le moins du monde, avait les idées et un tempérament bien trempés. Après une formation fort académique et même un passage un peu forcé à la Villa Médicis avant la guerre de 14, il s’impose parmi les cubistes les plus soucieux de marier Cézanne, Ingres et Fouquet. Ils ont aujourd’hui mauvaise réputation, accusés et accablés qu’ils sont d’avoir parlé de «rappel à l’ordre», et non de «retour à l’ordre», aux lendemains des tranchées. Avant de condamner ces artistes proches de Le Corbusier ou de la N.R.F., il eût peut-être fallu se demander contre quoi ils dressaient leur besoin de discipline… Le Bissière des années 1930, marqué par Picasso, se faisait une idée très libérale des exigences du «tableau», au regard de la peinture qui «se confinait dans une imitation imbécile et sans espoir.» La différence entre réalisme et mimétisme était donc consommée au moment où éclata la guerre. Vint donc le grand silence. Du moins est-ce la thèse la plus répandue. Est-elle juste pour autant ? Une partie de production des années 1945-1946 pourrait remonter plus tôt. Certains documents invitent à se poser la question. Bissière expose galerie de France en février 1944, sauf erreur… Qu’y montra le grand peintre? Cela reste à voir.
Stéphane Guégan
*Sade, un athée en amour, fondation Martin-Bodmer, Coligny (Genève) jusqu’au 12 avril 2015. Catalogue sous la direction de Michel Delon, Albin Michel, 49 €.
*Viollet-le-Duc. Les visions d’un architecte, Cité de l’architecture et du Patrimoine, Paris, jusqu’au 3 mars 2015. Catalogue sous la direction de Laurence de Finance et Jean-Michel Leniaud, Norma Editions, 38€, désormais le livre de référence sur la question.
*Bissière. Figure à part, musée des beaux-Arts de Bordeaux, jusqu’au 15 mars, catalogue sous la direction d’Ivonne Papin-Drastik et Isabelle Bissière, Fage éditions, 30 €.
Samedi 14 février 14h 30
Deuxième séance du Séminaire : La querelle de l’art contemporain : quel état de la modernité?
Sous la direction de Robert Kopp
Faculté de théologie protestante
83, boulevard Arago – 75014 Paris
Questions d’esthétique
avec Nathalie Heinich et Jean Clair




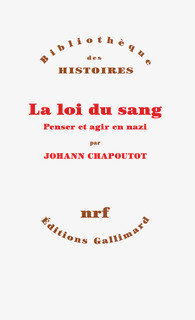
 Directes à souhait, ces «nouvelles mises au point» sont remarquables à plusieurs titres, bien qu’elles portent maintenant sur des «révélations» connues des spécialistes : preuve est ainsi faite de la composante subversive, moitié politique, moitié morale, des Mouches et de Huis Clos, un rapport des Renseignements généraux du 14 janvier 1943 corroborant le témoignage de Sartre et celui d’autres membres du Comité national des écrivains, un des foyers de la résistance intellectuelle; confirmation est donnée au fait que
Directes à souhait, ces «nouvelles mises au point» sont remarquables à plusieurs titres, bien qu’elles portent maintenant sur des «révélations» connues des spécialistes : preuve est ainsi faite de la composante subversive, moitié politique, moitié morale, des Mouches et de Huis Clos, un rapport des Renseignements généraux du 14 janvier 1943 corroborant le témoignage de Sartre et celui d’autres membres du Comité national des écrivains, un des foyers de la résistance intellectuelle; confirmation est donnée au fait que 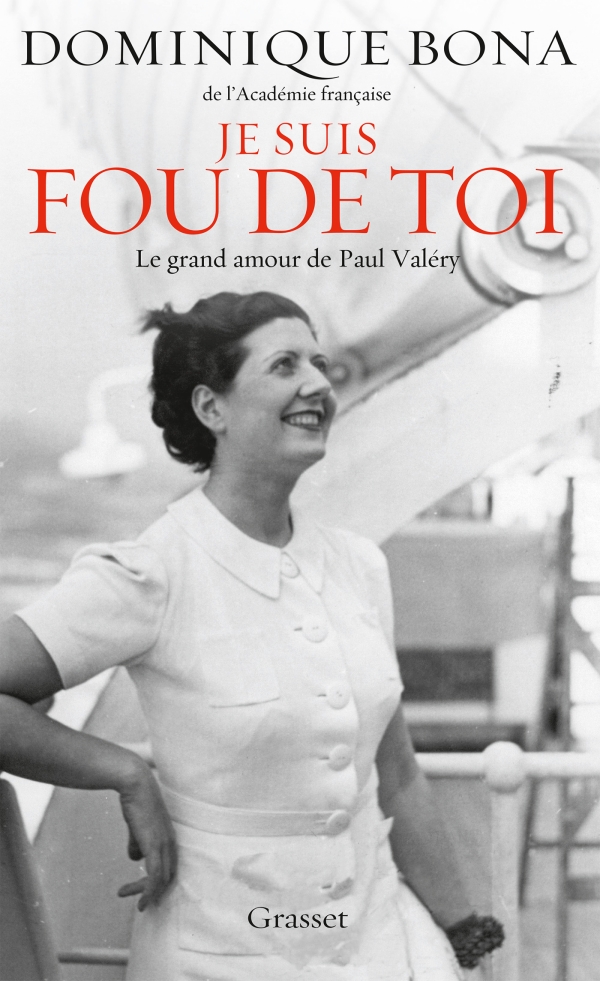
 Si Corot hante le premier, Degas et
Si Corot hante le premier, Degas et 



 – Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),
– Paul Éluard, Grain-d’Aile, illustré par Chloé Poizat, Nathan/Réunion des musées nationaux-Grand Palais, 14,90€. /// En 1951, un an avant d’être emporté par une crise cardiaque, et en marge de tout activisme politique (Ode à Staline, 1950),  *Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’
*Sarah Frioux-Salgas (dir.), «L’Atlantique noir de Nancy Cunard», Gradhiva, Revue d’anthropologie et d’histoire des arts, n°18, Musée du Quai Branly, 20€. /// Celle qui se voulait «l’inconnue» ne l’est pas aux lecteurs d’ *Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de
*Serge Sanchez, Man Ray, Folio biographies, Gallimard, 8,49€. /// Récit alerte comme le fut la vie du plus français des Américains. Que serait la planète du dadaïsme historique sans le cosmopolitisme du New York des années 1910? Man Ray, issu de l’immigration des Juifs russes, s’est rêvé peintre avant de découvrir que la photographie pouvait en être plus qu’un succédané. C’est un trentenaire déjà riche de multiples expériences et d’une culture solide (lecteur et mélomane, il a même croisé Robert Henri, le maître de 
 Je mentirai en disant l’inverse d’El Lissitzky. L’expérience de la totalité, catalogue d’une exposition qui tourne, aujourd’hui à Malaga, demain à Barcelone… La France se serrera la ceinture! Demeure son catalogue qui préfère la minceur savante à l’obésité redondante. Maintes raisons justifient qu’on en parle après Arts and Architecture: la première est qu’
Je mentirai en disant l’inverse d’El Lissitzky. L’expérience de la totalité, catalogue d’une exposition qui tourne, aujourd’hui à Malaga, demain à Barcelone… La France se serrera la ceinture! Demeure son catalogue qui préfère la minceur savante à l’obésité redondante. Maintes raisons justifient qu’on en parle après Arts and Architecture: la première est qu’ Un bon roman n’est jamais l’effet du hasard, surtout quand il fait des caprices du destin le levier de ses «incroyables» coups de théâtre. La mécanique romanesque tient davantage du complot réussi. C’est pourquoi les conspirations, les sociétés secrètes et les agents doubles ont toujours tenté la littérature la plus ouverte à ses propres jeux.
Un bon roman n’est jamais l’effet du hasard, surtout quand il fait des caprices du destin le levier de ses «incroyables» coups de théâtre. La mécanique romanesque tient davantage du complot réussi. C’est pourquoi les conspirations, les sociétés secrètes et les agents doubles ont toujours tenté la littérature la plus ouverte à ses propres jeux.  Peu disposé aux compromis de la presse, assez rusé pour les déjouer en feignant de les servir,
Peu disposé aux compromis de la presse, assez rusé pour les déjouer en feignant de les servir,  Livre fondamental, et si précieux que ses détenteurs ne s’en dessaisissaient pas, il était devenu introuvable, il revient en librairie dix-sept ans après sa publication, et presque son invention. Car
Livre fondamental, et si précieux que ses détenteurs ne s’en dessaisissaient pas, il était devenu introuvable, il revient en librairie dix-sept ans après sa publication, et presque son invention. Car  Ainsi Grenier nous rappelle-t-il qu’il fut à la fois partisan d’une intervention de la France en
Ainsi Grenier nous rappelle-t-il qu’il fut à la fois partisan d’une intervention de la France en  Nommé à Montpellier après l’armistice, Grenier passe l’été et une partie de l’automne dans le sud de la France. À peine remet-il le pied à Paris, en novembre, qu’il ébauche le grand interrogatoire dont devait naître Sous l’Occupation. Ses dons d’écrivains éclatent dans la saisie hugolienne, déhiérarchisée, des choses vues et senties; il enregistre aussi, en juste, le mensonge colporté par la presse de grande diffusion, sous surveillance étroite, comme on sait. Mais sans doute existait-il des moyens pour dire le sentiment antiallemand que Grenier vérifie parmi tous ces signes qu’émettent une ville et une population réduites aux masques et aux stratégies d’évitement: «Et c’est une des choses les plus surprenantes que de voir à ce sujet la faillite de la presse.» Voilà une réflexion qui devrait combler de joie
Nommé à Montpellier après l’armistice, Grenier passe l’été et une partie de l’automne dans le sud de la France. À peine remet-il le pied à Paris, en novembre, qu’il ébauche le grand interrogatoire dont devait naître Sous l’Occupation. Ses dons d’écrivains éclatent dans la saisie hugolienne, déhiérarchisée, des choses vues et senties; il enregistre aussi, en juste, le mensonge colporté par la presse de grande diffusion, sous surveillance étroite, comme on sait. Mais sans doute existait-il des moyens pour dire le sentiment antiallemand que Grenier vérifie parmi tous ces signes qu’émettent une ville et une population réduites aux masques et aux stratégies d’évitement: «Et c’est une des choses les plus surprenantes que de voir à ce sujet la faillite de la presse.» Voilà une réflexion qui devrait combler de joie  Entre la mort de César et le flop d’Actium, qui mit un terme aux ambitions de Marc-Antoine, tout s’est joué pour Octave. Fils adoptif du premier, ennemi juré du second, il peut prendre désormais les poses d’un dieu vivant. Auguste en tout, il a le physique de l’emploi, nous dit
Entre la mort de César et le flop d’Actium, qui mit un terme aux ambitions de Marc-Antoine, tout s’est joué pour Octave. Fils adoptif du premier, ennemi juré du second, il peut prendre désormais les poses d’un dieu vivant. Auguste en tout, il a le physique de l’emploi, nous dit On n’a jamais autant bâti, reconstruit, embelli Rome et ses capitales satellitaires. Non que tout y fût de marbre, comme le voudrait la légende. Mais le bilan monumental, architecture, sculpture et peinture, reste confondant. Qui d’autre qu’un fils d’Énée, à la fois Mars et Vénus, aurait pu autant professer la saine simplicité rustique des anciens, manifester autant de superbe et s’adonner aux plaisirs? Xavier Darcos, à qui rien de l’antiquité amoureuse n’est étranger, nous dépeint un Auguste ardent au sexe et actif jusqu’à sa mort. Ne descendait-il pas de Vénus en droite ligne? Le fameux portait du Vatican, trouvé dans la villa de son épouse Livie, l’affuble de deux accessoires liés à sa noble ascendance, une armure à trophées militaires et un Cupidon espiègle, qui singe le bras tendu de l’imperator. Les écrits licencieux de Properce, Tibulle et
On n’a jamais autant bâti, reconstruit, embelli Rome et ses capitales satellitaires. Non que tout y fût de marbre, comme le voudrait la légende. Mais le bilan monumental, architecture, sculpture et peinture, reste confondant. Qui d’autre qu’un fils d’Énée, à la fois Mars et Vénus, aurait pu autant professer la saine simplicité rustique des anciens, manifester autant de superbe et s’adonner aux plaisirs? Xavier Darcos, à qui rien de l’antiquité amoureuse n’est étranger, nous dépeint un Auguste ardent au sexe et actif jusqu’à sa mort. Ne descendait-il pas de Vénus en droite ligne? Le fameux portait du Vatican, trouvé dans la villa de son épouse Livie, l’affuble de deux accessoires liés à sa noble ascendance, une armure à trophées militaires et un Cupidon espiègle, qui singe le bras tendu de l’imperator. Les écrits licencieux de Properce, Tibulle et