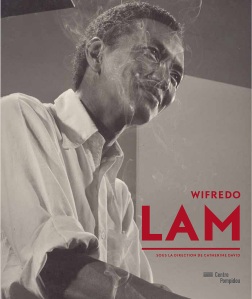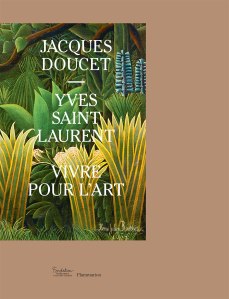Cher Guy Scarpetta, vous avez mille fois raison, j’ai eu tort de parler du « vide sidéral » de la vie culturelle parisienne, oubliant ainsi les « créations passionnantes » qu’on y voit, « noyées dans un flot de médiocrités »… Carambolages, au Grand Palais, dites-vous, « est absolument remarquable ». J’y suis donc allé, j’ai vu et je suis vaincu. J’ai aussitôt saisi pourquoi votre baroquisme inné s’était ému au spectacle du charivari visuel que propose l’exposition. Le mot doit s’entendre positivement, selon l’humour et l’hygiène des contraires qu’il postule. Se plaçant sous l’autorité du très en cour Aby Warburg, saint patron d’une histoire de l’art affranchie de ses supposées marottes, Carambolages tire la langue aux savoirs institués et entremêle ce qu’ailleurs, livres, musées et consciences, on sépare par respect du récit canonique des formes. Là où règnent d’ordinaire l’ordre du temps, la logique des influences, la succession des styles, le cloisonnement des nations et des continents, l’iconoclasme un peu vindicatif de Jean-Hubert Martin plante le drapeau du transhistorique et du transculturel. On parle beaucoup, en ce moment, à propos du milieu, de l’éternelle guerre des anciens et des modernes. Vaines et confuses paroles. N’est-il pas un peu contradictoire d’en appeler à une libération de l’histoire de l’art et d’en interdire certaines approches, au prétexte qu’elles seraient périmées ou, pire, réactionnaires ? Jugeons plutôt sur pièce… Arracher les œuvres du génie humain à leur contexte de production et de signification initial, Malraux fut l’un des premiers à le réclamer. On pense maintes fois aux Voix du silence à travers Carambolages. La vogue du multiculturalisme et de l’hybridation profite, semble-t-il au prophète des frontières qu’on abat.
Cher Guy Scarpetta, vous avez mille fois raison, j’ai eu tort de parler du « vide sidéral » de la vie culturelle parisienne, oubliant ainsi les « créations passionnantes » qu’on y voit, « noyées dans un flot de médiocrités »… Carambolages, au Grand Palais, dites-vous, « est absolument remarquable ». J’y suis donc allé, j’ai vu et je suis vaincu. J’ai aussitôt saisi pourquoi votre baroquisme inné s’était ému au spectacle du charivari visuel que propose l’exposition. Le mot doit s’entendre positivement, selon l’humour et l’hygiène des contraires qu’il postule. Se plaçant sous l’autorité du très en cour Aby Warburg, saint patron d’une histoire de l’art affranchie de ses supposées marottes, Carambolages tire la langue aux savoirs institués et entremêle ce qu’ailleurs, livres, musées et consciences, on sépare par respect du récit canonique des formes. Là où règnent d’ordinaire l’ordre du temps, la logique des influences, la succession des styles, le cloisonnement des nations et des continents, l’iconoclasme un peu vindicatif de Jean-Hubert Martin plante le drapeau du transhistorique et du transculturel. On parle beaucoup, en ce moment, à propos du milieu, de l’éternelle guerre des anciens et des modernes. Vaines et confuses paroles. N’est-il pas un peu contradictoire d’en appeler à une libération de l’histoire de l’art et d’en interdire certaines approches, au prétexte qu’elles seraient périmées ou, pire, réactionnaires ? Jugeons plutôt sur pièce… Arracher les œuvres du génie humain à leur contexte de production et de signification initial, Malraux fut l’un des premiers à le réclamer. On pense maintes fois aux Voix du silence à travers Carambolages. La vogue du multiculturalisme et de l’hybridation profite, semble-t-il au prophète des frontières qu’on abat.
 Porté par une scénographie simple et belle, un double flux continu, un par étage, irrigue donc près de deux cents pièces de toutes origines et de toutes époques, du tréfonds des âges aux réjouissants Avatars de Vénus de Jean-Jacques Lebel, deux cents pièces regroupées par séquences qui ne disent pas leur nom, mais flirtent avec les universaux (la mort, le sexe, etc.) et les préoccupations du jour (on y croise même un tapis de prière orné d’une kalachnikov). Les codes tourbillonnent, les différences s’estompent et maintes étincelles peuvent naître du choc mental provoqué par la fausse neutralité de l’accrochage. Aucun obstacle n’entrave, même les cartels marginalisés, l’écoute d’un public redevenu maître de ses lectures, comme l’annonce un slogan en anglais (installation de Maurizio Nannucci, 2010), au seuil du parcours initiatique. « A la lumière de la mondialisation et de la dégradation des cultures classique et chrétienne, il s’avère nécessaire de trouver une taxinomie qui réponde aux attentes d’un public qui n’est pas celui des amateurs et qui n’en est pas moins en quête d’expériences esthétiques », affirme le commissaire. Pareil constat eût surpris Warburg et Malraux aux yeux de qui le relativisme universaliste fondait la possibilité d’éclairer les phénomènes culturels de transmission, de migration et non de perte. Il n’est pas de langues mortes, affirmait Francastel de son côté. Nous n’avons pas à accepter l’idée d’un héritage en voie de disparition. Il nous faut lutter, au contraire, contre le recul ou la manipulation des humanités classiques, dont la composante « chrétienne » nous apparaît même plus précieuse depuis les récents événements. Malraux n’aimait pas les Madones de Raphaël, qu’il ne dissociait pas de leur descendance pompiériste. Qu’elles relèvent d’un contexte religieux autre que le nôtre, ne l’oublions pas, n’entrait pour rien dans son rejet du divino Sanzio. Quant à savoir s’il faut adapter l’offre des musées, ne sont-ils pas déjà suffisamment menacés par l’ère du ludique et du soft ? Mais revenons, cette parenthèse faite, aux associations « métissées » de Carambolages et aux perles qu’elle exhume, tant il est vrai que les réserves de nos musées dessinent souvent le purgatoire de nos tabous. La Nymphe au bain de Sergel, si proche de Füssli dans son priapisme grinçant, et Les Larmes de saint Pierre du bien oublié Petrini réclament les cimaises du Louvre.
Porté par une scénographie simple et belle, un double flux continu, un par étage, irrigue donc près de deux cents pièces de toutes origines et de toutes époques, du tréfonds des âges aux réjouissants Avatars de Vénus de Jean-Jacques Lebel, deux cents pièces regroupées par séquences qui ne disent pas leur nom, mais flirtent avec les universaux (la mort, le sexe, etc.) et les préoccupations du jour (on y croise même un tapis de prière orné d’une kalachnikov). Les codes tourbillonnent, les différences s’estompent et maintes étincelles peuvent naître du choc mental provoqué par la fausse neutralité de l’accrochage. Aucun obstacle n’entrave, même les cartels marginalisés, l’écoute d’un public redevenu maître de ses lectures, comme l’annonce un slogan en anglais (installation de Maurizio Nannucci, 2010), au seuil du parcours initiatique. « A la lumière de la mondialisation et de la dégradation des cultures classique et chrétienne, il s’avère nécessaire de trouver une taxinomie qui réponde aux attentes d’un public qui n’est pas celui des amateurs et qui n’en est pas moins en quête d’expériences esthétiques », affirme le commissaire. Pareil constat eût surpris Warburg et Malraux aux yeux de qui le relativisme universaliste fondait la possibilité d’éclairer les phénomènes culturels de transmission, de migration et non de perte. Il n’est pas de langues mortes, affirmait Francastel de son côté. Nous n’avons pas à accepter l’idée d’un héritage en voie de disparition. Il nous faut lutter, au contraire, contre le recul ou la manipulation des humanités classiques, dont la composante « chrétienne » nous apparaît même plus précieuse depuis les récents événements. Malraux n’aimait pas les Madones de Raphaël, qu’il ne dissociait pas de leur descendance pompiériste. Qu’elles relèvent d’un contexte religieux autre que le nôtre, ne l’oublions pas, n’entrait pour rien dans son rejet du divino Sanzio. Quant à savoir s’il faut adapter l’offre des musées, ne sont-ils pas déjà suffisamment menacés par l’ère du ludique et du soft ? Mais revenons, cette parenthèse faite, aux associations « métissées » de Carambolages et aux perles qu’elle exhume, tant il est vrai que les réserves de nos musées dessinent souvent le purgatoire de nos tabous. La Nymphe au bain de Sergel, si proche de Füssli dans son priapisme grinçant, et Les Larmes de saint Pierre du bien oublié Petrini réclament les cimaises du Louvre.
 S’ouvriront-elles un jour au « street art », détestable formule, qui flotte sur toutes les langues et fascine les édiles après avoir été leur cauchemar ? Sous ce vocable anglais parade désormais la postérité plus ou moins digeste du graffiti des années 1970-1980 : le « writing » d’alors, frère des « affiches qui chantent tout haut » d’Apollinaire, a acquis lettres de noblesse et parts de marché dans un affolement qui rappelle la frénésie qui porta les spéculateurs vers l’art chinois de la fin du XXe siècle, vivier notoire de croûtes. En se labélisant et en s’arrondissant, le graffiti a moins perdu son âme (toute forme d’art vise sa reconnaissance) que son intérêt (esthétique, cette fois). Né de et dans la rue, plutôt à New York qu’à Pantin, cette peinture éminemment urbaine, fa presto des temps modernes, s’est vite répandue à toutes les capitales d’Europe, murs et métros « en attente » d’eux-mêmes, pour le dire comme Sophie Pujas, qui a consacré un livre à succès au genre (Tana, 2015). Elle vient de signer le portrait aussi inspiré de Lokiss, vétéran vif et tatoué des années folles où Paris découvrait, sous le choc, le rap et les tags aux rudes syncopes colorées. La crise n’avait pas endormi New York l’insalubre, au contraire des avant-gardes françaises, pantouflardes et prisonnières du formalisme ou de l’imagerie Mao. Faut-il donner des noms ? Ces noms-là étaient et sont interchangeables. A New York, du côté de La Chapelle, se nommer, c’était refuser les masses dissolvantes ou les utopies de salon. Bombes en mains, on épinglait sa carte de visite un peu partout, bien visible, bien lisible de préférence. Le vieux Norman Mailer a dit ce qu’il fallait penser de cette « religion du nom », autrement féconde que notre lamentable « religion du non ». Pujas a d’autres ardeurs. Adepte des formes brèves et du traits rapide, elle accroche ses aphorismes nets sur le destin de son peintre, qui n’a pas tardé à quitter le bâtiment, et la simple calligraphie existentielle, pour la peinture totale : « Je modélise mes affects. Je n’explique pas. » L’excellente Galerie Celal a voulu le vérifier, elle montre, en ce moment, ses récentes Topologies, celles d’un artiste aux coups de feu souverains. Je lui dis : « Masson ? » Il répond : « Matta ». On ne va pas se fâcher. Lokiss faisait danser les murs, il plonge maintenant ses déflagrations cosmiques et ses portraits songeurs dans l’alu des métallos. Son exposition précédente alignait ceux de Drieu, Aragon et Malraux. Un artiste qui lit aussi bien qu’il ne peint, rare aubaine. Normal que la bio de Pujas en soit toute électrisée.
S’ouvriront-elles un jour au « street art », détestable formule, qui flotte sur toutes les langues et fascine les édiles après avoir été leur cauchemar ? Sous ce vocable anglais parade désormais la postérité plus ou moins digeste du graffiti des années 1970-1980 : le « writing » d’alors, frère des « affiches qui chantent tout haut » d’Apollinaire, a acquis lettres de noblesse et parts de marché dans un affolement qui rappelle la frénésie qui porta les spéculateurs vers l’art chinois de la fin du XXe siècle, vivier notoire de croûtes. En se labélisant et en s’arrondissant, le graffiti a moins perdu son âme (toute forme d’art vise sa reconnaissance) que son intérêt (esthétique, cette fois). Né de et dans la rue, plutôt à New York qu’à Pantin, cette peinture éminemment urbaine, fa presto des temps modernes, s’est vite répandue à toutes les capitales d’Europe, murs et métros « en attente » d’eux-mêmes, pour le dire comme Sophie Pujas, qui a consacré un livre à succès au genre (Tana, 2015). Elle vient de signer le portrait aussi inspiré de Lokiss, vétéran vif et tatoué des années folles où Paris découvrait, sous le choc, le rap et les tags aux rudes syncopes colorées. La crise n’avait pas endormi New York l’insalubre, au contraire des avant-gardes françaises, pantouflardes et prisonnières du formalisme ou de l’imagerie Mao. Faut-il donner des noms ? Ces noms-là étaient et sont interchangeables. A New York, du côté de La Chapelle, se nommer, c’était refuser les masses dissolvantes ou les utopies de salon. Bombes en mains, on épinglait sa carte de visite un peu partout, bien visible, bien lisible de préférence. Le vieux Norman Mailer a dit ce qu’il fallait penser de cette « religion du nom », autrement féconde que notre lamentable « religion du non ». Pujas a d’autres ardeurs. Adepte des formes brèves et du traits rapide, elle accroche ses aphorismes nets sur le destin de son peintre, qui n’a pas tardé à quitter le bâtiment, et la simple calligraphie existentielle, pour la peinture totale : « Je modélise mes affects. Je n’explique pas. » L’excellente Galerie Celal a voulu le vérifier, elle montre, en ce moment, ses récentes Topologies, celles d’un artiste aux coups de feu souverains. Je lui dis : « Masson ? » Il répond : « Matta ». On ne va pas se fâcher. Lokiss faisait danser les murs, il plonge maintenant ses déflagrations cosmiques et ses portraits songeurs dans l’alu des métallos. Son exposition précédente alignait ceux de Drieu, Aragon et Malraux. Un artiste qui lit aussi bien qu’il ne peint, rare aubaine. Normal que la bio de Pujas en soit toute électrisée.
 Continuons à caramboler puisque l’exercice est propice aux sentiers peu battus. Jeudi dernier, c’était jour de vernissage au musée d’Art moderne de la ville de Paris, cette merveille des années 30 à flanc de colline. Alger la blanche, loin de la casbah. L’exposition de Marquet l’Africain, du reste, y attire les visiteurs en grand nombre, juste retour des choses. Paula Modersohn-Becker (1876-1907) va rapidement, nécessairement susciter un élan comparable, car il est peu, très peu d’expositions aussi utiles et frappantes que celle-là. Jeudi dernier, Fabrice Hergott, le directeur du lieu, ne cachait pas son émotion. Un ancien rêve se réalisait, né à Cologne, en 2008, lors de la rencontre organisée par le Musée Ludwig entre les portraits intenses de Modersohn-Becker et la peinture du Fayoum. La gravité des chrétiens d’Egypte triomphait soudain des siècles et des kilomètres. Je me souviens encore de ma propre surprise lorsque je reçus le livre de Diane Radycki, livre d’une rare intelligence, immédiatement glosé ici. Rien ne remplace toutefois la vue des tableaux eux-mêmes, concentré de ce qu’a produit de mieux la peinture féminine (je crois à cette catégorie obsolète). Autour de 1900, entre Cézanne et Gauguin, deux artistes à qui Modersohn-Becker tint tête par admiration et indépendance, les femmes avaient enfin accédé à l’école des Beaux-Arts et à la plupart des ateliers privés, mais elles passaient encore pour les pourvoyeuses naturelles d’un art plus souriant et sucré que direct et incarné. Frontale, réaliste sous la synthèse des formes, la peinture de Modersohn-Becker saisit, elle, plus que le regard. On l’a dite parfois expressionniste, comme on parlerait d’une fatalité germanique. C’est exagéré, dommageable à la justesse dont elle dote chaque visage, ceux de l’enfance la tirant vers le meilleur d’elle-même. Allez savoir pourquoi cette femme libre, peu embarrassée de ses ambitions et ses désirs, jusqu’à retarder celui d’être mère, a si bien fixé ces visages refermés sur leurs secrets… Modersohn-Becker ne s’en acquitte pas en deux coups de pinceaux. Elle les peint plutôt comme si elle croisait ces petits êtres pour la première et la dernière fois. « Ils ont été là », commente Marie Darrieussecq, au détour de sa Vie de Paula M. Becker, qui emprunte aux Elégies de Duino son autre titre. Rilke ne sut pas retenir Paula vivante, il l’enveloppa donc, à sa mort, dans ses sombres stances, sublime mais triste compensation. Darrieussecq réussit le pari inverse. Sans paraphraser les lettres et le journal de Modersohn-Becker, une mine de franchise, de drôlerie et de crudité, et sans oublier sa peinture aux vertus identiques, la romancière donne chair à une présence, femme et peintre, peintre et femme, loin de la plénitude factice des biographies de commande. Un livre d’âme sœur. Stéphane Guégan
Continuons à caramboler puisque l’exercice est propice aux sentiers peu battus. Jeudi dernier, c’était jour de vernissage au musée d’Art moderne de la ville de Paris, cette merveille des années 30 à flanc de colline. Alger la blanche, loin de la casbah. L’exposition de Marquet l’Africain, du reste, y attire les visiteurs en grand nombre, juste retour des choses. Paula Modersohn-Becker (1876-1907) va rapidement, nécessairement susciter un élan comparable, car il est peu, très peu d’expositions aussi utiles et frappantes que celle-là. Jeudi dernier, Fabrice Hergott, le directeur du lieu, ne cachait pas son émotion. Un ancien rêve se réalisait, né à Cologne, en 2008, lors de la rencontre organisée par le Musée Ludwig entre les portraits intenses de Modersohn-Becker et la peinture du Fayoum. La gravité des chrétiens d’Egypte triomphait soudain des siècles et des kilomètres. Je me souviens encore de ma propre surprise lorsque je reçus le livre de Diane Radycki, livre d’une rare intelligence, immédiatement glosé ici. Rien ne remplace toutefois la vue des tableaux eux-mêmes, concentré de ce qu’a produit de mieux la peinture féminine (je crois à cette catégorie obsolète). Autour de 1900, entre Cézanne et Gauguin, deux artistes à qui Modersohn-Becker tint tête par admiration et indépendance, les femmes avaient enfin accédé à l’école des Beaux-Arts et à la plupart des ateliers privés, mais elles passaient encore pour les pourvoyeuses naturelles d’un art plus souriant et sucré que direct et incarné. Frontale, réaliste sous la synthèse des formes, la peinture de Modersohn-Becker saisit, elle, plus que le regard. On l’a dite parfois expressionniste, comme on parlerait d’une fatalité germanique. C’est exagéré, dommageable à la justesse dont elle dote chaque visage, ceux de l’enfance la tirant vers le meilleur d’elle-même. Allez savoir pourquoi cette femme libre, peu embarrassée de ses ambitions et ses désirs, jusqu’à retarder celui d’être mère, a si bien fixé ces visages refermés sur leurs secrets… Modersohn-Becker ne s’en acquitte pas en deux coups de pinceaux. Elle les peint plutôt comme si elle croisait ces petits êtres pour la première et la dernière fois. « Ils ont été là », commente Marie Darrieussecq, au détour de sa Vie de Paula M. Becker, qui emprunte aux Elégies de Duino son autre titre. Rilke ne sut pas retenir Paula vivante, il l’enveloppa donc, à sa mort, dans ses sombres stances, sublime mais triste compensation. Darrieussecq réussit le pari inverse. Sans paraphraser les lettres et le journal de Modersohn-Becker, une mine de franchise, de drôlerie et de crudité, et sans oublier sa peinture aux vertus identiques, la romancière donne chair à une présence, femme et peintre, peintre et femme, loin de la plénitude factice des biographies de commande. Un livre d’âme sœur. Stéphane Guégan
*Carambolages, jusqu’au 4 juillet 2016. Beau catalogue carambolé, en accordéon pour partie, sous la direction de Jean-Hubert Martin, RMN/Grand Palais éditions, 49€.
**Sophie Pujas, Ce qu’il reste de nuit. Lokiss, un portrait, Buchet Chastel, 12 €. Lokiss, Topologies, Galerie Celal, 45 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, jusqu’au16 avril. Sophie Pujas, à qui l’on doit un beau livre sur Zoran Music postfacé par Jean Clair (Z. M., Gallimard, 2013), nous donnait récemment Maraudes (Gallimard / L’Arpenteur, 16 €), où la littérature se plie et se déplie aux hasards du bitume, et d’une dérive programmée : « Parfois, la rue m’appelle – manie de solitaire – c’est mon vice secret, ma dinguerie, mon ivresse. » Bel incipit, le reste est à l’avenant.
***Paula Modersohn-Becker. L’intensité d’un regard, Musée d’art moderne de la ville de Paris, jusqu’au 21 août 2016. Splendide catalogue, Paris-Musées éditions, 35€, avec des contributions de Julia Garimorth (commissaire de l’exposition), Uwe M. Schneede, Maria Stavrinaki (excellente analyse de la Bildung, chère à Modersohn-Becker), Elisabeth Lebovici, Rainer Stamm et, last but not least, Marie Darrieussecq. Du même auteur, Être ici est une splendeur. Vie de Paula M. Becker, P.O.L., 15€.