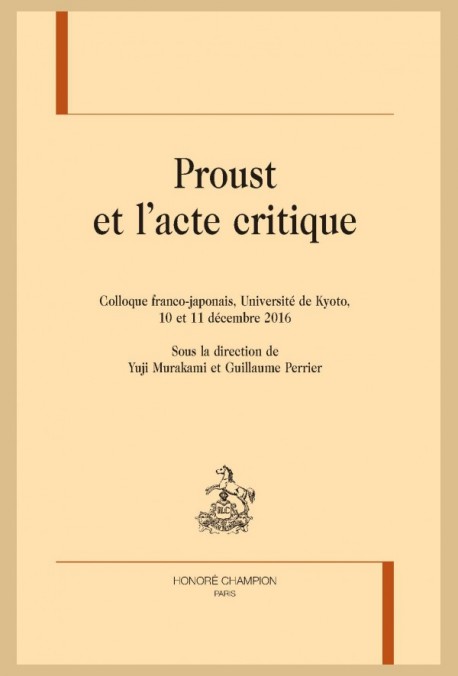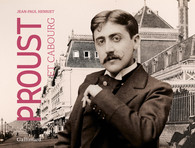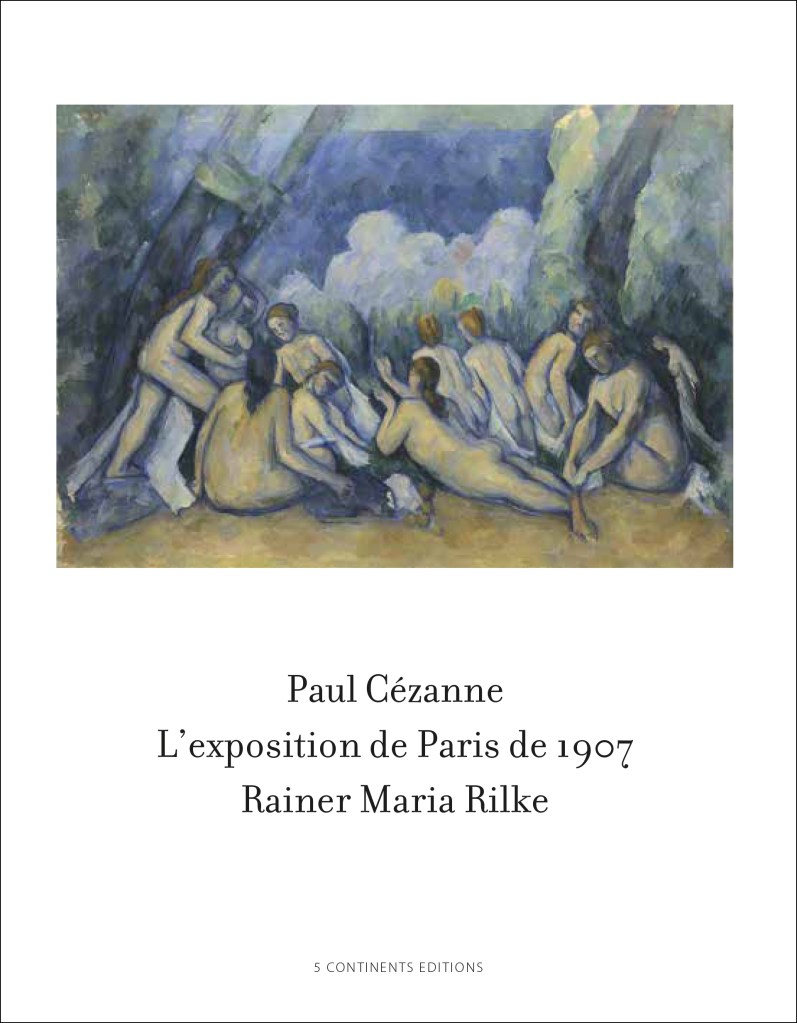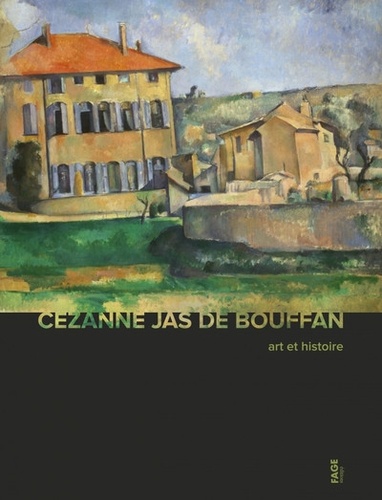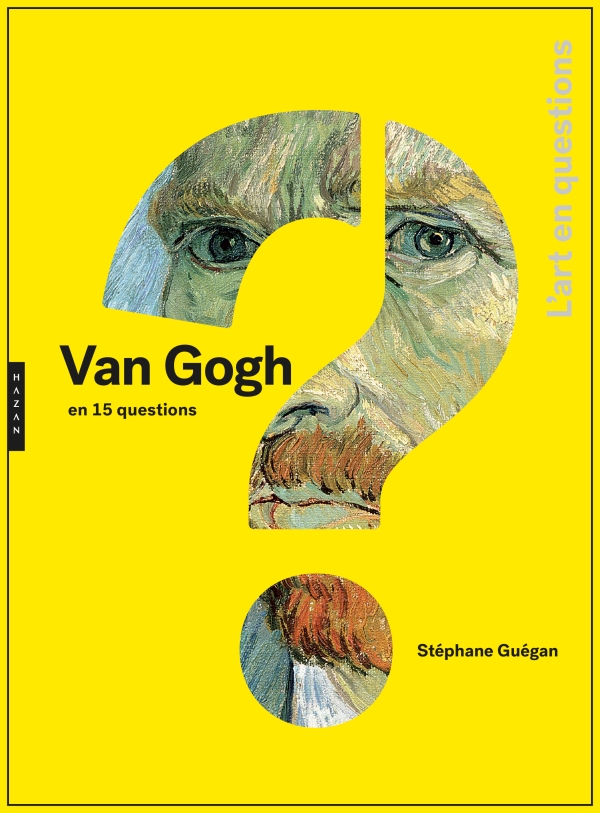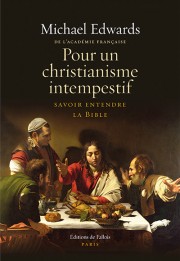Apparemment, une identique propension à souffrir aurait accompagné toute leur vie Jean-Paul Sartre et George Orwell. La différence est que le premier s’imposait la rédaction laborieuse de rouges pensums qui heurtaient souvent ses convictions ou ses scrupules, alors que le second, nous dit Bernard Crick, son meilleur biographe, ne pouvait vivre et écrire sans cette «mise à l’épreuve et [cette] mortification de soi-même». Là où il y avait nécessité d’enquête, l’humilité du moraliste était d’en baver. Dans la dèche à Paris et à Londres, Hommage à la Catalogne, La Ferme des animaux et 1984 décrivent autant de situations extrêmes qu’ils en dérivent. Sartre n’a pas connu le désir orwellien d’exposer au pire ses bronches de tubar et sa foi libérale. Des douleurs, des humiliations, le jeune Eric Blair eut son lot, malgré un milieu familial favorisé et une fort brillante scolarité. Le futur Orwell (1903-1950), en outre, n’est pas du genre causant, et sa sexualité tardera à s’épanouir, plus que la conscience d’un destin d’écrivain à large horizon. Si son « Socialisme démocratique », pour le citer, ne s’était pas déclaré auparavant, l’expérience des taudis de l’entre-deux-guerres, des deux côtés de la Manche, l’y aurait converti. Par esprit de corps et authenticité réaliste, il se clochardise, explore, observe et ne ménage pas ses premiers éditeurs. Crick donne maints exemples de leur stupéfaction et de leur embarras, souvent de leur refus de publier cette littérature potentiellement explosive. Son journalisme ne pratique pas plus l’euphémisation qui règne aujourd’hui, chaque jour chez nous en apporte la confirmation, qu’il s’agisse des attentats à répétition, de la marchandisation culturelle ou de la guerre dans le Haut-Karabagh…

Progressiste, malgré sa haine précoce des communistes inféodés au Parti, conservateur, car attaché à l’Angleterre et à la terre de son enfance, Orwell savait et affirmait que « celui qui pense sans crainte ne peut être politiquement orthodoxe ». Voire politiquement correct. L’orthodoxie révolutionnaire, cela signifiait le dressage des esprits et des corps pour le bien d’une autorité qui usurpait le droit des peuples à une existence plus décente. 1984, dont une nouvelle traduction paraît en poche, n’opère pas fortuitement la synthèse bouffonne et tragique du stalinisme et du nazisme. Crick avait raison d’écrire qu’Orwell « fut l’un des rares à gauche à ne pas considérer [le fascisme hitlérien] comme un capitalisme avancé mais comme une sinistre perversion du socialisme, un authentique mouvement de masse doté d’une philosophie élitiste, mais qui s’adressait au peuple. » La trahison, au risque de sa santé et même de sa vie, Orwell la côtoie et l’abomine en Espagne, prise au piège de la guerre civile et de l’instrumentalisation des deux camps. Le regard qu’il jette alors sur le terrorisme communiste et sur les médias de la désinformation organisée est unique, comme le sont ses derniers chefs-d’œuvre, La Ferme des animaux et 1984, deux allégories, entre le rire et l’horreur, de la tyrannie moderne, soit l’égalité dans le servage, et, plus près encore de nous, l’auto-censure pénitentielle. Le totalitarisme, comme le capitalisme, est plein de ressources… A rebours d’Orwell, la gauche marxisante avait héroïquement ignoré les procès de Moscou, elle ne se remit pas des «événements », euphémisme qui qualifia, à leur début, la guerre d’Algérie et la répression soviétique en Hongrie. Comme d’autres sceptiques professionnels, Sartre attend 1956 pour retirer son soutien au PCF, ce qui n’équivaudra pas, du reste, à une rupture avec le marxisme, les méthodes souvent brutales du publiciste et le refus de l’autocritique.

Situations VI, réunion des textes écrits entre 1958 et 1964, émane de ce difficile moment et confirme la nécessité nauséeuse qu’eut Sartre de vivre avec ses contradictions et ses concepts usés… Le triomphe des Mots a fait oublier que le douloureux rapport de l’auteur à soi débordait les années tendres. Pouvait-il même concéder, en cette longue après-guerre fortement déterminée par les communistes, qu’il y eût place pour autre que lui ? On peut comprendre que la sacralisation de De Gaulle l’ait irrité, De Gaulle qui, bien entendu, domine ce volume, d’une élection l’autre. L’Express, en 1958, se servit à trois reprises du lance-flamme de Sartre pour dénoncer le retour du fascisme quand il eût fallu pointer les ambiguïtés d’une gauche divisée sur la question algérienne et la chienlit institutionnelle qui en avait résulté. On confondait coup d’Etat et coup de génie, De Gaulle avait celui des situations justement… En plus de ceux qui s’empilaient en Algérie, d’autres cadavres obligèrent Sartre à sortir de son propre souverainisme. Qu’elles soient d’une écriture très brillante rend plus nécessaire une lecture serrée de ces manières de nécrologie. Les écrivains se découvrent souvent une grande générosité de cœur à l’heure suprême où disparaissent leurs confrères gênants : Paul Nizan était mort deux fois, en soldat dès mai 1940, puis en supposé traitre, ses anciens camarades n’ayant pas avalé sa dénonciation du pacte germano-soviétique. Pour s’être insurgé en 1947 contre leurs calomnies, Sartre était le préfacier rêvé, en mars 1960, à la réédition d’Aden Arabie. Autrement plus embarrassé apparaît son éloge funèbre de Camus, deux mois plus tôt, qui multiplie les allusions à ce qui ne peut être nommé, les épurations de 1944-45, le communisme et l’Algérie au sujet de laquelle leurs vues différaient. Ces anciens adversaires partis, le besoin de s’en donner d’autres se fit diablement sentir, comme de changer d’échelle. Les Damnés de la terre, le livre marquant de Frantz Fanon, permit à Sartre de prouver deux choses, son âme de pamphlétaire et sa fascination pour la violence des surréalistes. En septembre 1961, la rhétorique du meurtre légitime renaît donc et pervertit la cause respectable de la décolonisation. L’Europe et ses idéaux ont échoué, et de sujets, nous sommes devenus les objets de l’histoire, c’est le sens de sa préface. Les pires dérapages, doublés de dialectique scolaire, ne l’effraient pas : « abattre un Européen c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer un oppresseur et un opprimé. » Plutôt que de gloser une telle irresponsabilité en sa portée actuelle, finissons par une note positive. Sartre, s’il se fourvoie au sujet de Flaubert et Baudelaire, se métamorphose, face à Masson et Wols, en critique fertile et en formidable amoureux de la peinture libre. Stéphane Guégan

Bernard Crick, George Orwell, Grandes biographies, Flammarion, 29€ / George Orwell, 1984, Nouvelle traduction (Josée Kamoun), Folio, Gallimard, 8,50€ / Jean-Paul Sartre, Situations, VI, nouvelle édition revue et augmentée par Georges Barrère, Mauricette Berne, François Noudelmann, Annie Sornaga, Gallimard, 24,50€ // Dans Un tout autre Sartre (Gallimard, 18€), François Noudelmann comble les promesses de son titre et, tout de go, déclare : Sartre, c’était du vent. La formule, que j’exagère à peine, vient des Carnets de la drôle de guerre (Gallimard, 1995), où la déprime le dispute aux notes de lecture roboratives (les romans de Drieu notamment l’obsèdent). Frère des héros de Stendhal qu’il vénère, le soldat manqué se reproche en 1940 son assiette chancelante : « Il faut être fait d’argile et je le suis de vent. » Le terme a deux sens, comme Sartre deux visages, au moins. Le portrait officiel, continûment reproduit par l’institution scolaire et la rue Ulm, nous montre la conscience éthico-politique du siècle s’activant sur tous les fronts où l’appelle cette souffrance inguérissable qu’est notre condamnation à choisir, à se situer entre le bien et le mal. Apolitique avant la guerre, habile sous l’Occupation, Sartre change de panoplie en 1945, pour le dire comme Bernard Frank, qui fut son secrétaire et le premier à le deviner. Hors du communisme, point de salut. On s’encarte ici et là. Pas lui, tout de même. Il aime, à distance, mais conspue, sans nuance, la politique d’oncle Sam. Noudelmann ne passe rien au terroriste des Temps modernes. Il rappelle ces sorties inconvenantes sur la Russie et la Chine d’avant 1956, nous dit que la Hongrie ne l’empêcha aucunement de répondre aux invitations du Kremlin jusqu’en 1966. Une petite jalousie, il est vrai, l’opposait au délicieux Aragon quant à incarner, aux yeux du monde ébahi, la diva des damnés de la terre. Sartre, bousculé par Fanon, embrassera le tiers-mondisme avec le même empressement, conscient pourtant des ambiguïtés du FLN avant et après les accords d’Evian, informé aussi de la soviétisation de l’Algérie et d’une partie de l’Afrique. Il savait donc, mais oublia de parler, ça arrive aux meilleurs. Noudelmann le dit « divisé, non pas hypocrite ». Faible serait plus juste. Au registre des failles, il en est de plus sympathiques que d’humilier la vérité. La liste de ses addictions alcoolisées et médicamenteuses (sans jeu de mots) était aussi longue que le fil de sa mélancolie. On respire mieux en le suivant en voyage, au piano avec Chopin, ou au lit avec ses maîtresses de tous âges et toutes conditions, qu’il aimait et étreignait chacune à sa manière. De même qu’il envoyait régulièrement paître la littérature engagée, c’est-à-dire servile, Sartre parvenait au cours de ses ébats à sortir de la frigidité que Simone lui reprochait ou n’avait pas su faire fondre. Bref, un essai aussi lucide qu’incarné. SG
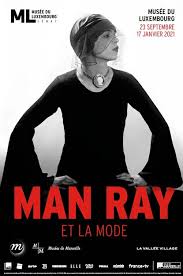
Le show de la semaine // En plus de deux expositions indispensables, Mark Tobey chez Jeanne Bucher et Luc Delahaye chez Nathalie Obadia, dont je parlerai ailleurs (Revue de deux mondes) ou plus tard, il faut dire un mot de Man Ray et la mode (Musée du Luxembourg, jusqu’au 17 janvier 2021, catalogue très chic, 39€). Car, outre sa beauté et son intérêt propres, elle est de nature à déniaiser ceux qui s’y rendraient chargés de tous les poncifs courants sur la subversion surréaliste. A New York, l’automne dernier, l’excellente galerie Di Donna, avec la complicité d’Andrew Strauss, réunissait 40 peintures de Man Ray qui, sur le thème de l’énigme et du désir, c’est-à-dire de l’énigme du désir, nous rappelaient que le sujet commande le style, et non l’inverse, chez les peintres conséquents. A certains indices, on devinait que sa longue pratique de la photo de mode n’avait pas été une parenthèse inutile… Peu de temps après son arrivée à Paris, en 1921, le peintre américain accepte de mauvaise grâce le médium alimentaire, poussé par Picabia auprès d’Elsa Schiaparelli et Paul Poiret. Comme il a tous les talents, nourrit une passion des femmes peu commune et ne crache pas sur l’argent facile, il domine vite le marché, travaillant pour Vogue et Harper’s Bazaar jusqu’à la guerre, voire au-delà depuis la Californie. Aucune incompatibilité, évidemment, entre le rêve et le luxe, l’art et l’argent, le surréalisme et la high society. Quand le comte et la comtesse de Beaumont régalent, Tzara et Picasso ne se font pas prier. Paul et Nush Eluard, très liés à Man Ray, s’associeront aussi à son entreprise. De même, La Révolution surréaliste, en sa livraison du 15 juillet 1925, fait sa couverture d’un manequin de bois et cire exhibant une robe légère aux lignes et charmes interminables. La photographie de mode, c’est la rencontre de deux magies, de deux appels au merveilleux. Son surréalisme en puissance résulte d’une troisième alliance, celle du sex appeal et de la déréalisation marmoréenne. Passionné d’Ingres, peignant avec la lumière, expert en transparences et cadrages insolites, Man Ray sculpta jusqu’à l’obsession les fantasmes de papier glacé. SG
MORE ABOUT ORWELL

La curiosité, l’intérêt, la logique même, commande de lire La Ferme des animaux avant Mil neuf cent quatre-vingt-quatre, dont Folio publie une nouvelle traduction, celle de Philippe Jaworski, détachée de la récente Pléiade Orwell. Parus respectivement en 1945 et 1949, ils puisent tous deux leur substance satirique dans la connaissance du stalinisme que l’auteur avait parfaite sur les terrains les plus divers, le journalisme d’investigation comme la guerre d’Espagne. Le pire peut naître du bien, la dictature découler de la légitime reconquête des libertés individuelles. La ferme de Mr. Jones sert de miroir de concentration à la folie utilitaire d’un capitalisme indifférent au règne de la mort sur lequel il repose, avant d’être le théâtre tragi-comique d’une révolte qui sera vite confisquée par les plus forts, au prix d’un dévoiement de ses principes initiaux, d’un contrôle incessant des corps et des psychismes, d’une violence capable de tuer à tout instant, et sans que le processus révolutionnaire ait jamais, en apparence, à se dédire. Tout change sans que rien ne change. La chair du cochon est très proche de celle de l’homme, sa capacité à la tyrannie et au mensonge d’Etat aussi. En moins de cent pages désopilantes, Orwell transforme les verrats de Jones en Staline au petit pied. Alors qu’ils réduisent leurs anciens camarades à l’esclavage de leur force de travail et au silence des consciences, à se coucher ou mourir, en somme, eux se dressent sur leurs pattes arrières et singent leurs anciens maîtres à la perfection, sexe, alcool et rubans compris. Quant à Napoléon, le plus malin des porcins, il « a toujours raison ». Il est des jours où l’on peut préférer la causticité et la poésie fantasques de La Ferme des animaux au plus démonstratif, fût-il génial, roman de Big brother. Concernant cette survivance de l’anglais dans les traductions françaises courantes, Jaworski pointe une incongruité contraire à l’esprit même d’un livre « où tout ce qui relève de la traduction est précisément réglé ». On parlera donc de Grand Frère désormais. De même, le traducteur et éditeur de La Pléiade Orwell rétablit-il le titre de 1984 en lettres, les chiffres arabes ayant pour effet d’éloigner dans un temps utopique ce que le romancier voulait rapprocher, au contraire, du présent des hommes et femmes de l’après-guerre. La distance, en enfer, fait tout, à l’instar de celle qui sépare, au pays des animaux faussement affranchis, le cocasse de la farce de l’apologie sanglante du bien collectif et du chef unique. Etanche aux marchands de bonheur, Orwell avait un dieu, il s’appelait Swift. SG / George Orwell, La Ferme des animaux, conte de fées, nouvelle traduction de Philippe Jaworski, Folio, Gallimard, 4,50€ / Mil neuf cent quatre-vingt-quatre, Folio classique, Gallimard, traduction et édition de Philippe Jaworski, 8,49€.

Avec Simon Leys (Orwell ou l’horreur de la politique, Hermann, 1984), Jean-Claude Michéa a puissamment contribué au regain d’intérêt des Français pour celui qui se disait « anarchiste tory ». Michéa, en 1995, dans l’agonie du mitterrandisme, intitulait ainsi le premier livre qu’il ait consacré à son auteur de prédilection. Le livre ressort, enrichi d’une postface inédite, Orwell, la gauche et la double pensée (Climats/Flammarion, 2020, 21€). C’est que l’anti-stalinisme de salon (façon Nouveaux philosophes) ne lui semble pas l’unique clef d’entrée de la pensée orwellienne, ni le kantisme la seule morale à rétablir dans l’organisation des choses humaines. Autant que l’adversaire inflexible de toutes les formes de totalitarisme, toujours appuyées sur la perversion de la langue de la Cité, Orwell fut le penseur de l’attachement, des racines (comme George Eliot), en opposition frontale aux prosélytes (de gauche et de droite) de la téléologie du Progrès. Sa méfiance envers les théories de la tabula rasa, envers les négateurs du donné et du passé, fait et faisait rire du réactionnaire, terme qu’il adoptait, et qui lui semblait désigner une meilleure maladie que l’aspiration au grand recommencement ou le mépris des campagnes pré-industrielles. L’Homo progressistus ne peut accepter la possibilité que les choses aient pu aller mieux avant ou ailleurs. La religion du Progrès tient seule ici et demain pour les lignes d’horizon de sa foi. Revenons, pour finir, à son anarchisme conservateur, concept qu’il forge en réfléchissant au Gulliver de Swift. Michéa nous aide à démêler cette fausse contradiction, car Orwell, individualiste et fraternel, n’a pas plus adhéré à l’idée d’une société sans État qu’au socialisme abstrait, soluble généralement dans le capitalisme et la souillure accélérée de l’éco-système. La common decency, que Michéa a l’audace de retrouver dans les admirables films de John Ford, Capra et Eastwood, lui semblait une meilleure sagesse que les vieilles lunes du marxisme ou les failles travesties de la social-démocratie. Le débat actuel, et plus qu’impératif, sur la nécessité d’introduire beaucoup plus de proportionnel dans notre système électoral nous y ramène. SG / Voir aussi Jean-Claude Michéa, Orwell éducateur, Climats/Flammarion, 2020, 17€.