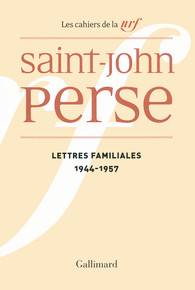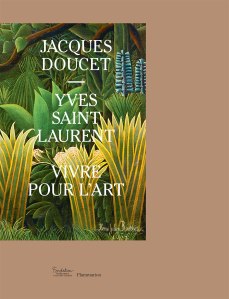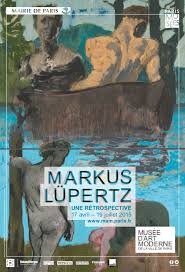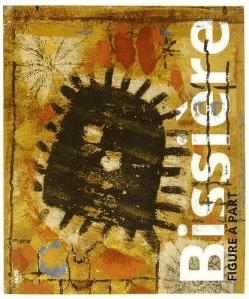Les meilleurs bilans en histoire de l’art ont une durée de vie qui n’excède pas 20/30 ans, après quoi le droit d’inventaire devrait s’appliquer à nouveau. Encore faut-il trouver de bonnes et patientes volontés ! On croit, par exemple, tout savoir sur la figuration de l’entre-deux-guerres depuis les années 1970-1980. Illusion, pourtant, et qu’il est urgent de dissiper… Or la grande paresse des vingtièmistes français n’a d’égale que leur cruelle absence de curiosité. Rien de comparable chez nous au formidable élan qui anime la recherche américaine en faveur du réalisme des années 30. De même qu’il ne se réduit pas outre-Atlantique à Edward Hopper, Grant Wood et Benton, comme vient de le rappeler la remarquable exposition du musée de l’Orangerie, « nos réalismes » débordent l’étiage des noms les plus publiés. Prenez Robert Humblot, que la Galerie Bernheim-Jeune a remis sous nos yeux sans que la presse d’art mainstream en ait parlé. Elle a eu tort, of course, mais vous aurez raison de vous jeter sur la publication qui accompagnait l’accrochage réparateur. Humblot, certes, est loin de s’être effacé de toutes les mémoires. Pour peu que vous vous intéressiez à l’école française du premier XXe siècle, le nom des Forces Nouvelles devrait vous être familier. Avec d’autres, Jannot, Lasne, Pellan, Rohner et Tal Coat, Humblot plongea sa belle insolence dans le ventre mou de l’académisme du temps. L’académisme ? Les avatars fatigués du post-impressionnisme, du nabisme, du fauvisme, du cubisme et même du surréalisme, qui eut aussi ses suiveurs inutiles et ses chromos.
Les meilleurs bilans en histoire de l’art ont une durée de vie qui n’excède pas 20/30 ans, après quoi le droit d’inventaire devrait s’appliquer à nouveau. Encore faut-il trouver de bonnes et patientes volontés ! On croit, par exemple, tout savoir sur la figuration de l’entre-deux-guerres depuis les années 1970-1980. Illusion, pourtant, et qu’il est urgent de dissiper… Or la grande paresse des vingtièmistes français n’a d’égale que leur cruelle absence de curiosité. Rien de comparable chez nous au formidable élan qui anime la recherche américaine en faveur du réalisme des années 30. De même qu’il ne se réduit pas outre-Atlantique à Edward Hopper, Grant Wood et Benton, comme vient de le rappeler la remarquable exposition du musée de l’Orangerie, « nos réalismes » débordent l’étiage des noms les plus publiés. Prenez Robert Humblot, que la Galerie Bernheim-Jeune a remis sous nos yeux sans que la presse d’art mainstream en ait parlé. Elle a eu tort, of course, mais vous aurez raison de vous jeter sur la publication qui accompagnait l’accrochage réparateur. Humblot, certes, est loin de s’être effacé de toutes les mémoires. Pour peu que vous vous intéressiez à l’école française du premier XXe siècle, le nom des Forces Nouvelles devrait vous être familier. Avec d’autres, Jannot, Lasne, Pellan, Rohner et Tal Coat, Humblot plongea sa belle insolence dans le ventre mou de l’académisme du temps. L’académisme ? Les avatars fatigués du post-impressionnisme, du nabisme, du fauvisme, du cubisme et même du surréalisme, qui eut aussi ses suiveurs inutiles et ses chromos.
 « Six jeunes peintres […] ont compris que le temps des escamotages […] était révolu », proclame Henri Héraut, lors de la première exposition de groupe, en avril 1935, Galerie Billiet-Vorms. J’ai dit ailleurs en quoi cette réaction n’avait rien de conservatrice (L’Art en péril, Hazan, 2016). On peut peindre grave sans renoncer à ce que la vie à de plus dramatique ou de plus intense. Sur fond de guerre d’Espagne et d’agitprop communiste, Humblot réinvente la peinture d’histoire et le nu sous la double étoile des peintres français du XVIIe siècle et du Quattrocento le plus sévère. D’autres alliances, plus modernes, pimentaient ce revival pur de tout pastiche. Lydia Harambourg voit bien ce que Picasso et Masson ont apporté de frénésie et d’inquiétude au groupe des Forces Nouvelles. En présence des Paysans de 1943, l’appel des Le Nain ne lui a pas échappé non plus. Quant à la somptueuse série de natures mortes de 1944, un genre que la défaite de 1940 et l’espoir de la Libération ont galvanisé, elle relie Humblot à Manet et Bazille. Ce que ce livre exhume aussi, c’est la pointe de saine grivoiserie qui titille l’artiste dès la fin de la guerre. On le verra jusqu’au début des années 1960 frayer dans les eaux, plutôt chaudes, de Balthus et Bernard Buffet. L’autre très bonne surprise du moment nous vient de Lyon et de l’éminente publication de Jean-Christophe Stuccilli sur Jean Martin, un peintre du cru, qui fit cause commune avec les Forces Nouvelles et les chrétiens du groupe Témoignage avant d’incarner, sous l’Occupation, une forme de Résistance que l’on pourrait croire aujourd’hui, par excès de manichéisme, plutôt paradoxale…
« Six jeunes peintres […] ont compris que le temps des escamotages […] était révolu », proclame Henri Héraut, lors de la première exposition de groupe, en avril 1935, Galerie Billiet-Vorms. J’ai dit ailleurs en quoi cette réaction n’avait rien de conservatrice (L’Art en péril, Hazan, 2016). On peut peindre grave sans renoncer à ce que la vie à de plus dramatique ou de plus intense. Sur fond de guerre d’Espagne et d’agitprop communiste, Humblot réinvente la peinture d’histoire et le nu sous la double étoile des peintres français du XVIIe siècle et du Quattrocento le plus sévère. D’autres alliances, plus modernes, pimentaient ce revival pur de tout pastiche. Lydia Harambourg voit bien ce que Picasso et Masson ont apporté de frénésie et d’inquiétude au groupe des Forces Nouvelles. En présence des Paysans de 1943, l’appel des Le Nain ne lui a pas échappé non plus. Quant à la somptueuse série de natures mortes de 1944, un genre que la défaite de 1940 et l’espoir de la Libération ont galvanisé, elle relie Humblot à Manet et Bazille. Ce que ce livre exhume aussi, c’est la pointe de saine grivoiserie qui titille l’artiste dès la fin de la guerre. On le verra jusqu’au début des années 1960 frayer dans les eaux, plutôt chaudes, de Balthus et Bernard Buffet. L’autre très bonne surprise du moment nous vient de Lyon et de l’éminente publication de Jean-Christophe Stuccilli sur Jean Martin, un peintre du cru, qui fit cause commune avec les Forces Nouvelles et les chrétiens du groupe Témoignage avant d’incarner, sous l’Occupation, une forme de Résistance que l’on pourrait croire aujourd’hui, par excès de manichéisme, plutôt paradoxale…
 À l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Humblot avait été l’élève de Lucien Simon, le meilleur représentant de la Bande noire. À Lyon, mais issu des quartiers ouvriers, Martin connaît d’abord le destin des autodidactes, ces innocents aux mains avides. À 15 ans, il est embauché par Noilly-Prat où il restera 15 ans… Nous sommes en 1926. L’année suivante, une exposition d’art belge le retourne. Permeke et son expressionnisme plébéien vont déterminer durablement sa peinture, réaliste à la manière aussi de Memling, Grünewald ou du dernier La Fresnaye, celui du Bouvier aux mains si parlantes. Une coïncidence historique, en profondeur, recharge de sens et d’urgence l’art le plus cruel, le passé le plus synchrone. On en verra la confirmation dans la rencontre qu’Henri Héraut favorise entre Martin et Forces Nouvelles. Une exposition générationnelle les réunit en 1938. C’est Humblot vers lequel Martin se sent le plus attiré. L’indécence de leurs nus les rapproche, de même que l’impératif de témoigner. La précision d’analyse de Stuccilli nous fait reconnaître ici une allusion aux déserteurs de la Wehrmacht, là un écho tragique à l’exil des Juifs de zone libre fin 1942. Martin n’était pas du genre à plier sous les boches. En contact avec la Résistance active et l’édition frondeuse, il ne fuit pas l’action des Jeune France, née du souhait qu’eut Vichy de galvaniser les nouvelles générations. Le cas de Martin confirme que le patriotisme prit des routes et des détours complexes après juin 40… A nous de les apprécier ! Humblot, dès 1936, et Martin, neuf ans plus tard, à l’heure de la reconstruction et du débat sur le nouvel art catholique, ont inspiré sympathie et respect au grand critique Waldemar-George (1893-1970), toujours incandescent dès qu’il se sera agi de promouvoir les « valeurs de l’esprit », et les « valeurs humaines », contre le formalisme. l’abstraction ou le primitivisme anti-occidental.
À l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Humblot avait été l’élève de Lucien Simon, le meilleur représentant de la Bande noire. À Lyon, mais issu des quartiers ouvriers, Martin connaît d’abord le destin des autodidactes, ces innocents aux mains avides. À 15 ans, il est embauché par Noilly-Prat où il restera 15 ans… Nous sommes en 1926. L’année suivante, une exposition d’art belge le retourne. Permeke et son expressionnisme plébéien vont déterminer durablement sa peinture, réaliste à la manière aussi de Memling, Grünewald ou du dernier La Fresnaye, celui du Bouvier aux mains si parlantes. Une coïncidence historique, en profondeur, recharge de sens et d’urgence l’art le plus cruel, le passé le plus synchrone. On en verra la confirmation dans la rencontre qu’Henri Héraut favorise entre Martin et Forces Nouvelles. Une exposition générationnelle les réunit en 1938. C’est Humblot vers lequel Martin se sent le plus attiré. L’indécence de leurs nus les rapproche, de même que l’impératif de témoigner. La précision d’analyse de Stuccilli nous fait reconnaître ici une allusion aux déserteurs de la Wehrmacht, là un écho tragique à l’exil des Juifs de zone libre fin 1942. Martin n’était pas du genre à plier sous les boches. En contact avec la Résistance active et l’édition frondeuse, il ne fuit pas l’action des Jeune France, née du souhait qu’eut Vichy de galvaniser les nouvelles générations. Le cas de Martin confirme que le patriotisme prit des routes et des détours complexes après juin 40… A nous de les apprécier ! Humblot, dès 1936, et Martin, neuf ans plus tard, à l’heure de la reconstruction et du débat sur le nouvel art catholique, ont inspiré sympathie et respect au grand critique Waldemar-George (1893-1970), toujours incandescent dès qu’il se sera agi de promouvoir les « valeurs de l’esprit », et les « valeurs humaines », contre le formalisme. l’abstraction ou le primitivisme anti-occidental.
 Cet Antimoderne de toujours, chantre précoce de l’identité malheureuse, a multiplié les causes, comme à plaisir, de la détestation et de la proscription dont il fut longtemps l’objet. Au temps de ma jeunesse, il ne faisait pas bon citer positivement ce Juif qu’on disait antisémite et fasciste parce qu’il n’avait pas chanté les vertus de l’École de Paris et qu’il avait claironné celles de Benito Mussolini et de sa conception latine de l’art comme transformateur social. La vieille Rome et le jeune christianisme, que le Quattrocento avait mariés, lui paraissaient constituer, vers 1930, un socle assez solide pour justifier la foi en un réalisme identitaire et universaliste à égalité. Je ne résume ici qu’à grands traits l’essai subtil et téméraire que vient de lui consacrer Yves Chevrefils Desbiolles, dont certains connaissent les travaux sur la presse d’art du premier XXe siècle. Nous voilà enfin armés pour comprendre l’homme et son parcours apparemment contradictoires. Car Waldemar-George, sous ses allures et vitupérations de prêtre réactionnaire, n’a pas taillé ses idées, et son obstination néo-humaniste, dans la soutane de Camille Mauclair et autres ténors de l’art aryanisé. Ils le lui rappelèrent sous l’Occupation… Après la Libération, d’autres voix s’indignent, à gauche cette fois-ci. Quoi ! lui, le survivant, le Juif écarté du Paris des années sombres, comment peut-il soutenir Derain et Despiau, dénoncer le culte de l’informel et de l’inhumain avec des accents vichystes, et défendre Édouard Pignon et Augustin Rouart plutôt que le camarade Picasso ? C’était mal connaître son courage et son refus des lynchages hâtifs. Faisant de la « négation de l’homme » et de la barbarie de salon les fléaux majeurs de l’art moderne, Waldemar-George est passé de la religion communiste à la conversion catholique, et de Roger de La Fresnaye à Cobra, par fidélité à soi. Yves Chevrefils Desbiolles invoque, au contraire, la fameuse « haine de soi », clef trompeuse, me semble-t-il, de sa judéité, ni confessionnelle, ni communautariste : « Je ne cherche pas le Juif par-delà l’homme, écrivait-il en 1929. Je cherche l’homme par delà le Juif. » Il tint parole.
Cet Antimoderne de toujours, chantre précoce de l’identité malheureuse, a multiplié les causes, comme à plaisir, de la détestation et de la proscription dont il fut longtemps l’objet. Au temps de ma jeunesse, il ne faisait pas bon citer positivement ce Juif qu’on disait antisémite et fasciste parce qu’il n’avait pas chanté les vertus de l’École de Paris et qu’il avait claironné celles de Benito Mussolini et de sa conception latine de l’art comme transformateur social. La vieille Rome et le jeune christianisme, que le Quattrocento avait mariés, lui paraissaient constituer, vers 1930, un socle assez solide pour justifier la foi en un réalisme identitaire et universaliste à égalité. Je ne résume ici qu’à grands traits l’essai subtil et téméraire que vient de lui consacrer Yves Chevrefils Desbiolles, dont certains connaissent les travaux sur la presse d’art du premier XXe siècle. Nous voilà enfin armés pour comprendre l’homme et son parcours apparemment contradictoires. Car Waldemar-George, sous ses allures et vitupérations de prêtre réactionnaire, n’a pas taillé ses idées, et son obstination néo-humaniste, dans la soutane de Camille Mauclair et autres ténors de l’art aryanisé. Ils le lui rappelèrent sous l’Occupation… Après la Libération, d’autres voix s’indignent, à gauche cette fois-ci. Quoi ! lui, le survivant, le Juif écarté du Paris des années sombres, comment peut-il soutenir Derain et Despiau, dénoncer le culte de l’informel et de l’inhumain avec des accents vichystes, et défendre Édouard Pignon et Augustin Rouart plutôt que le camarade Picasso ? C’était mal connaître son courage et son refus des lynchages hâtifs. Faisant de la « négation de l’homme » et de la barbarie de salon les fléaux majeurs de l’art moderne, Waldemar-George est passé de la religion communiste à la conversion catholique, et de Roger de La Fresnaye à Cobra, par fidélité à soi. Yves Chevrefils Desbiolles invoque, au contraire, la fameuse « haine de soi », clef trompeuse, me semble-t-il, de sa judéité, ni confessionnelle, ni communautariste : « Je ne cherche pas le Juif par-delà l’homme, écrivait-il en 1929. Je cherche l’homme par delà le Juif. » Il tint parole.
Stéphane Guégan
*Lydia Harambourg et Brigitte Humblot, Humblot (1907-1962), Somogy Éditions d’Art, 39€
*Jean-Christophe Stuccilli, Jean Martin (1911-1996). Peintre de la réalité, Somogy Éditions d’Art, 39€
 *Yves Chevrefils Desbiolles, Waldemar-George. Cinq portraits pour un siècle paradoxal. Essai et anthologie, Presses Universitaires de Rennes, 24€. Comme il est rappelé ici, Waldemar-George, au sortir de la guerre de 14, nourrit de Spengler et de Nietzsche sa vision pessimiste, c’est-à-dire lucide, d’un Occident en décadence et de la toute puissance des machines, génératrice d’une domination des hommes qui s’accomplirait sous couvert de la seule domination de la nature. Spengler publie L’Homme et la technique en 1931, peu de temps avant de dire son fait au nazisme (grosse différence avec Heidegger) et de tirer sa révérence. La lecture de Montaigne et Nietzsche l’avait vacciné contre l’euphorie progressiste et technocratique des modernes. Il observe avec le plus grand intérêt la naissance du sentiment écologique, le naufrage programmé du monde colonial et prédit ses conséquences à brève échéance. Que n’a-t-il parlé du retour (inversé) des guerres de religion, autre véhicule du loup prédateur ? (Oswald Spengler, L’Homme et la technique. Contribution à une philosophie de la vie, RN Éditions, 18,90€)
*Yves Chevrefils Desbiolles, Waldemar-George. Cinq portraits pour un siècle paradoxal. Essai et anthologie, Presses Universitaires de Rennes, 24€. Comme il est rappelé ici, Waldemar-George, au sortir de la guerre de 14, nourrit de Spengler et de Nietzsche sa vision pessimiste, c’est-à-dire lucide, d’un Occident en décadence et de la toute puissance des machines, génératrice d’une domination des hommes qui s’accomplirait sous couvert de la seule domination de la nature. Spengler publie L’Homme et la technique en 1931, peu de temps avant de dire son fait au nazisme (grosse différence avec Heidegger) et de tirer sa révérence. La lecture de Montaigne et Nietzsche l’avait vacciné contre l’euphorie progressiste et technocratique des modernes. Il observe avec le plus grand intérêt la naissance du sentiment écologique, le naufrage programmé du monde colonial et prédit ses conséquences à brève échéance. Que n’a-t-il parlé du retour (inversé) des guerres de religion, autre véhicule du loup prédateur ? (Oswald Spengler, L’Homme et la technique. Contribution à une philosophie de la vie, RN Éditions, 18,90€)