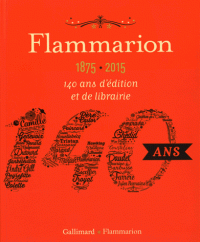1919, c’est l’an I de Dada, en sa flambée parisienne… A Tristan Tzara, gourou toujours suisse, André Breton écrit, le 4 avril : « Tuer l’art est ce qui me paraît le plus urgent». La destruction appelant la destruction, on mobilise les démobilisés, Paul Éluard et Louis Aragon, qui rentrent au printemps. Jacques Vaché a été rendu plus tôt à la vie civile, mais cet ange de l’excès s’est tué à l’opium. Qu’importe, Breton publie ses lettres de guerre en manière de béatification hâtive. Drieu, autre revenant, a quitté l’uniforme et comptera vite parmi les dadaïstes de la capitale, les habitués du Certa et de l’invective. Au Salon d’Automne, Picabia voit ses tableaux mécanistes relégués sous un escalier, marches détournées d’une gloire galopante. Bref, tout va bien, les années folles peuvent commencer, la vie pétiller… Car 1919, c’est aussi l’an I de la moutarde Amora, marque déposée simultanément à Dijon et aux États-Unis (on dirait un Duchamp). Au début des années 30, c’est déjà une institution. Comment douter que pareille coïncidence ait glissé sur Aragon lorsqu’il se mit à la rédaction du génial Aurélien, au lendemain de la débâcle de juin 1940, sous l’impression encore fraîche de Gilles. Drieu y avait démoli les surréalistes, Aurélien fait de Dada un de ses cœurs de cible, et de Picabia l’objet d’un portrait inoubliable. Car Picabia fait plus que percer sous le Zamora du roman, qui parut à l’automne 44. Partant du principe que le rêve est l’ami et l’ombre de la réalité, les livres d’Aragon se délectent de la mécanique freudienne du déplacement et de la condensation, ils cachent un tas de petits secrets, et souvent de petites vacheries, derrière l’étrange état civil de leurs personnages. Résurrection acide du Paris dadaïste de 1919-1922, Aurélien n’en épargne aucune des célébrités. Aragon, écrit justement Bougnoux, « ne se retient pas de régler de vieux comptes ».
1919, c’est l’an I de Dada, en sa flambée parisienne… A Tristan Tzara, gourou toujours suisse, André Breton écrit, le 4 avril : « Tuer l’art est ce qui me paraît le plus urgent». La destruction appelant la destruction, on mobilise les démobilisés, Paul Éluard et Louis Aragon, qui rentrent au printemps. Jacques Vaché a été rendu plus tôt à la vie civile, mais cet ange de l’excès s’est tué à l’opium. Qu’importe, Breton publie ses lettres de guerre en manière de béatification hâtive. Drieu, autre revenant, a quitté l’uniforme et comptera vite parmi les dadaïstes de la capitale, les habitués du Certa et de l’invective. Au Salon d’Automne, Picabia voit ses tableaux mécanistes relégués sous un escalier, marches détournées d’une gloire galopante. Bref, tout va bien, les années folles peuvent commencer, la vie pétiller… Car 1919, c’est aussi l’an I de la moutarde Amora, marque déposée simultanément à Dijon et aux États-Unis (on dirait un Duchamp). Au début des années 30, c’est déjà une institution. Comment douter que pareille coïncidence ait glissé sur Aragon lorsqu’il se mit à la rédaction du génial Aurélien, au lendemain de la débâcle de juin 1940, sous l’impression encore fraîche de Gilles. Drieu y avait démoli les surréalistes, Aurélien fait de Dada un de ses cœurs de cible, et de Picabia l’objet d’un portrait inoubliable. Car Picabia fait plus que percer sous le Zamora du roman, qui parut à l’automne 44. Partant du principe que le rêve est l’ami et l’ombre de la réalité, les livres d’Aragon se délectent de la mécanique freudienne du déplacement et de la condensation, ils cachent un tas de petits secrets, et souvent de petites vacheries, derrière l’étrange état civil de leurs personnages. Résurrection acide du Paris dadaïste de 1919-1922, Aurélien n’en épargne aucune des célébrités. Aragon, écrit justement Bougnoux, « ne se retient pas de régler de vieux comptes ».
 Se retenir, et se retenir de mordre, n’était pas dans les habitudes du beau Louis. Vingt-cinq ans après le chahut dont il avait été l’un des plus infatigables instigateurs, Aragon dissèque sa jeunesse, emballements esthétiques, fiascos sentimentaux et amitiés brisées. Aurélien regarde au-delà de Drieu, qu’il est loin d’assassiner, comme aiment à le dire ceux qui s’en tiennent à Wikipédia. On a plus commenté le pastiche de La Princesse de Clèves ou de Jacques le fataliste que l’espèce d’inventaire historique dans l’esprit de Hugo, Flaubert et Proust. Roman de l’amour impossible, dit-on, d’une Bérénice qui préfèrerait la chimère du sublime à l’expérience de l’imparfait, Aurélien est plutôt le chef-d’œuvre du désamour, un roman amer et noir, d’une drôlerie effrayante, où la sainte modernité de l’après-guerre passe un mauvais quart d’heure. Or quoi de plus moderne alors que Picabia ? Première apparition, Zamora surgit, of course, d’un dancing, le Lulli’s, «petit, engoncé dans son ventre, le visage spirituel, brun comme un Espagnol qu’il était, avec de l’argent aux tempes, tout rasé et mobile comme s’il avait été mince, des pieds d’une petitesse incroyable. Il se croyait le rival de Picasso, et cela l’avait jeté au dadaïsme, histoire de le dépasser. Il était méchant et drôle, trouvant tout affreux, pouvait tomber d’accord avec le pire philistin pour faire un mot d’esprit, faisait des tableaux métaphysiques en baleines de corset et n’aimait au fond que les jolies femmes, les tableaux de la Gandara, le luxe et les petits chiens.»
Se retenir, et se retenir de mordre, n’était pas dans les habitudes du beau Louis. Vingt-cinq ans après le chahut dont il avait été l’un des plus infatigables instigateurs, Aragon dissèque sa jeunesse, emballements esthétiques, fiascos sentimentaux et amitiés brisées. Aurélien regarde au-delà de Drieu, qu’il est loin d’assassiner, comme aiment à le dire ceux qui s’en tiennent à Wikipédia. On a plus commenté le pastiche de La Princesse de Clèves ou de Jacques le fataliste que l’espèce d’inventaire historique dans l’esprit de Hugo, Flaubert et Proust. Roman de l’amour impossible, dit-on, d’une Bérénice qui préfèrerait la chimère du sublime à l’expérience de l’imparfait, Aurélien est plutôt le chef-d’œuvre du désamour, un roman amer et noir, d’une drôlerie effrayante, où la sainte modernité de l’après-guerre passe un mauvais quart d’heure. Or quoi de plus moderne alors que Picabia ? Première apparition, Zamora surgit, of course, d’un dancing, le Lulli’s, «petit, engoncé dans son ventre, le visage spirituel, brun comme un Espagnol qu’il était, avec de l’argent aux tempes, tout rasé et mobile comme s’il avait été mince, des pieds d’une petitesse incroyable. Il se croyait le rival de Picasso, et cela l’avait jeté au dadaïsme, histoire de le dépasser. Il était méchant et drôle, trouvant tout affreux, pouvait tomber d’accord avec le pire philistin pour faire un mot d’esprit, faisait des tableaux métaphysiques en baleines de corset et n’aimait au fond que les jolies femmes, les tableaux de la Gandara, le luxe et les petits chiens.»
 On ne laisse pas filer un tel individu, il ne quittera plus le lecteur. Le portrait de Bérénice aux lignes brouillées, le vernissage de minuit, les sorties de Zamora sur Manet, Picasso ou la Légion d’honneur, les cadres Art Déco de Legrain, faire-valoir essentiel de ses machines songeuses, constituent autant de relances du récit : Aurélien a besoin de cet Espagnol qui plane au-dessus des frontières, de même qu’il ne peut se passer des doubles de Drieu, Breton, Jacques Doucet, Denise Lévy et d’Aragon lui-même, dont le poète Paul Denis personnifie l’un des avatars peu flattés. Portrait vitriolé et masochiste de la génération perdue, Aurélien eût été incomplet si Zamora l’avait déserté, comme Picabia avait fui les combats de 14-18 à la faveur de protections et de ce qu’Arnauld Pierre, le meilleur spécialiste du peintre, appelle une « névrose opportuniste », dûment soignée en Suisse… Aragon, l’ancien combattant, l’affranchi du surréalisme, n’a donc pas raté Picabia, l’embusqué, le mondain, le coureur, chic et scandaleux, un pompier déguisé en incendiaire. La Gandara ou Dada ? La Gandara et Dada, répond Aragon. Car Zamora, qu’il crédite anachroniquement des futures transparences de Picabia, est le seul protagoniste à avoir saisi la «ressemblance profonde» de la fuyante Bérénice, fuyante comme l’absolu. De ses chevauchements de lignes naissent de troublants palimpsestes !
On ne laisse pas filer un tel individu, il ne quittera plus le lecteur. Le portrait de Bérénice aux lignes brouillées, le vernissage de minuit, les sorties de Zamora sur Manet, Picasso ou la Légion d’honneur, les cadres Art Déco de Legrain, faire-valoir essentiel de ses machines songeuses, constituent autant de relances du récit : Aurélien a besoin de cet Espagnol qui plane au-dessus des frontières, de même qu’il ne peut se passer des doubles de Drieu, Breton, Jacques Doucet, Denise Lévy et d’Aragon lui-même, dont le poète Paul Denis personnifie l’un des avatars peu flattés. Portrait vitriolé et masochiste de la génération perdue, Aurélien eût été incomplet si Zamora l’avait déserté, comme Picabia avait fui les combats de 14-18 à la faveur de protections et de ce qu’Arnauld Pierre, le meilleur spécialiste du peintre, appelle une « névrose opportuniste », dûment soignée en Suisse… Aragon, l’ancien combattant, l’affranchi du surréalisme, n’a donc pas raté Picabia, l’embusqué, le mondain, le coureur, chic et scandaleux, un pompier déguisé en incendiaire. La Gandara ou Dada ? La Gandara et Dada, répond Aragon. Car Zamora, qu’il crédite anachroniquement des futures transparences de Picabia, est le seul protagoniste à avoir saisi la «ressemblance profonde» de la fuyante Bérénice, fuyante comme l’absolu. De ses chevauchements de lignes naissent de troublants palimpsestes !
 Fin 1944, témoin essentiel, Aragon jugeait le passé depuis son propre renoncement à l’avant-gardisme et les longs entretiens qu’il avait eus avec Matisse sous l’Occupation. Ce faisant, fertile paradoxe, il rendait possible une lecture de Picabia qui se serait délestée des poncifs modernistes et ferait son miel des tensions mises à jour par Aurélien. Pouvait-il imaginer que les historiens de l’art ne s’y résoudraient pas avant longtemps ? On se demande certains jours si les spécialistes de Picabia ont lu Aragon et Apollinaire, autre foyer de lumière qui me semble préférable à la vulgate dadaïste pour approcher le piquant Zamora. Si la rétrospective actuelle de Zurich et New York, d’une éblouissante richesse, invite au dépoussiérage, un reste de consensus baigne le catalogue malgré ses apports décisifs. On y voit l’éventail entier de l’historiographie picabiesque se déplier. Ils sont encore quelques-uns et unes à valoriser l’insolent dynamiteur, le sorcier d’un double jeu permanent, l’iconoclaste ou l’accoucheur putatif de la peinture abstraite. D’autres, on les préfèrera, contribuent à faire émerger un artiste dont l’ironie, la destruction de toute valeur et le cynisme n’auraient pas été les seules muses… Car cette rétrospective a le bon goût de rappeler que les débuts de Picabia n’eurent rien d’anarchique. On ne saurait le dire, en effet, de l’atelier de Cormon ou des tableaux qu’il expose au Salon des artistes français à l’orée du XXème siècle, d’un givernisme supposé suspect (comme si les impressionnistes n’avaient pas utilisé la photographie avant lui et répudié l’illusion du tableau reflet !).
Fin 1944, témoin essentiel, Aragon jugeait le passé depuis son propre renoncement à l’avant-gardisme et les longs entretiens qu’il avait eus avec Matisse sous l’Occupation. Ce faisant, fertile paradoxe, il rendait possible une lecture de Picabia qui se serait délestée des poncifs modernistes et ferait son miel des tensions mises à jour par Aurélien. Pouvait-il imaginer que les historiens de l’art ne s’y résoudraient pas avant longtemps ? On se demande certains jours si les spécialistes de Picabia ont lu Aragon et Apollinaire, autre foyer de lumière qui me semble préférable à la vulgate dadaïste pour approcher le piquant Zamora. Si la rétrospective actuelle de Zurich et New York, d’une éblouissante richesse, invite au dépoussiérage, un reste de consensus baigne le catalogue malgré ses apports décisifs. On y voit l’éventail entier de l’historiographie picabiesque se déplier. Ils sont encore quelques-uns et unes à valoriser l’insolent dynamiteur, le sorcier d’un double jeu permanent, l’iconoclaste ou l’accoucheur putatif de la peinture abstraite. D’autres, on les préfèrera, contribuent à faire émerger un artiste dont l’ironie, la destruction de toute valeur et le cynisme n’auraient pas été les seules muses… Car cette rétrospective a le bon goût de rappeler que les débuts de Picabia n’eurent rien d’anarchique. On ne saurait le dire, en effet, de l’atelier de Cormon ou des tableaux qu’il expose au Salon des artistes français à l’orée du XXème siècle, d’un givernisme supposé suspect (comme si les impressionnistes n’avaient pas utilisé la photographie avant lui et répudié l’illusion du tableau reflet !).
 Ses grands Pins de 1906, manifeste et chef-d’œuvre méditerranéen déjà, montrent avec quelle obstination et réussite Picabia – très proche des fils Pissarro – s’est voulu aussi l’émule de Monet et Sisley. Or l’habitude est d’en faire un exercice de second degré, l’annonce de ce que Picabia devait raffiner ensuite, la disqualification du médium par la déconstruction de ses modes et la déroute de ses fins. A écouter les tenants d’un dadaïsme précoce, la vanité de peindre lui serait déjà apparue, de même que la nécessité de s’en faire le fossoyeur loufoque. Cette théorie résiste peu aux faits, que le catalogue regroupe avec avidité et, parfois, malaise. On aimerait tant que Picabia ait été un sage petit soldat de l’avant-gardisme heureux, que ses machines à rêves aient broyé jusqu’au souvenir des corps sexués, qu’il n’ait pas plaidé le «retour à l’ordre » à la fin des années 1920, ni accepté la Légion d’honneur en juillet 1933, ni vendu des tableaux à l’État en 1935, ni conspué le Front populaire et l’anti-franquisme, ni chanté la jeunesse du Maréchal en 1941 avec Gertrude Stein, ni ridiculisé enfin le triomphe de l’abstraction après 1945, ultime pied-de-nez au nihilisme de sa légende. S’il y eut « leurre » chez lui, pour employer un mot dont on abuse à son endroit, c’est d’avoir faire croire qu’il était né pour brûler les musées. Le « contre-idéal » qu’il se targuait d’incarner mieux que quiconque, en écho à son cher Nietzsche, séparait « l’art démocratique » honni de la grande peinture, le banal du génial et surtout l’acte iconoclaste, son faux destin, de la recherche de l’absolu, son vrai credo. La peinture de Picabia, avec ou sans pigments, abonde en citations, qui ne proviennent pas toutes des revues de charme ou de naturisme : elle s’assigne d’emblée une hauteur d’idéal, une hygiène physique, une saveur érotique qu’Apollinaire, les partageant, a signalées. Pour ce lecteur du Zarathoustra, danser sa vie fut primordial. Ne sont-ce pas de meilleurs guides pour cheminer jusqu’aux toiles de l’Occupation et au-delà ? Nulle abstraction totale, nulle abjection fatale, c’est l’instinct de vie, ou de survie, qui flambe et chasse les démons du grand neurasthénique. Stéphane Guégan
Ses grands Pins de 1906, manifeste et chef-d’œuvre méditerranéen déjà, montrent avec quelle obstination et réussite Picabia – très proche des fils Pissarro – s’est voulu aussi l’émule de Monet et Sisley. Or l’habitude est d’en faire un exercice de second degré, l’annonce de ce que Picabia devait raffiner ensuite, la disqualification du médium par la déconstruction de ses modes et la déroute de ses fins. A écouter les tenants d’un dadaïsme précoce, la vanité de peindre lui serait déjà apparue, de même que la nécessité de s’en faire le fossoyeur loufoque. Cette théorie résiste peu aux faits, que le catalogue regroupe avec avidité et, parfois, malaise. On aimerait tant que Picabia ait été un sage petit soldat de l’avant-gardisme heureux, que ses machines à rêves aient broyé jusqu’au souvenir des corps sexués, qu’il n’ait pas plaidé le «retour à l’ordre » à la fin des années 1920, ni accepté la Légion d’honneur en juillet 1933, ni vendu des tableaux à l’État en 1935, ni conspué le Front populaire et l’anti-franquisme, ni chanté la jeunesse du Maréchal en 1941 avec Gertrude Stein, ni ridiculisé enfin le triomphe de l’abstraction après 1945, ultime pied-de-nez au nihilisme de sa légende. S’il y eut « leurre » chez lui, pour employer un mot dont on abuse à son endroit, c’est d’avoir faire croire qu’il était né pour brûler les musées. Le « contre-idéal » qu’il se targuait d’incarner mieux que quiconque, en écho à son cher Nietzsche, séparait « l’art démocratique » honni de la grande peinture, le banal du génial et surtout l’acte iconoclaste, son faux destin, de la recherche de l’absolu, son vrai credo. La peinture de Picabia, avec ou sans pigments, abonde en citations, qui ne proviennent pas toutes des revues de charme ou de naturisme : elle s’assigne d’emblée une hauteur d’idéal, une hygiène physique, une saveur érotique qu’Apollinaire, les partageant, a signalées. Pour ce lecteur du Zarathoustra, danser sa vie fut primordial. Ne sont-ce pas de meilleurs guides pour cheminer jusqu’aux toiles de l’Occupation et au-delà ? Nulle abstraction totale, nulle abjection fatale, c’est l’instinct de vie, ou de survie, qui flambe et chasse les démons du grand neurasthénique. Stéphane Guégan
*Anne Umland et Catherine Hug (dir.), Francis Picabia, une rétrospective, Fonds Mercator, 54,95€. Le même éditeur, merci à lui, rend enfin accessible L’Album Picabia d’Olga Mohler (39,95€). Olga fut successivement l’employée, la maîtresse et la compagne de Picabia. Ils traversèrent ensemble les années les plus controversées du peintre, de 1925 à 1953, celles qui, en conséquence, nécessitent compréhension sensible et documentation renouvelée. Olga était-elle consciente de la valeur que prendraient les notes et photographies, reproductions et coupures de presse qu’elle a colligées ? En tous cas, la dévotion amoureuse n’égare jamais ici le souci de se souvenir. Le keepsake d’Olga, qui remonte volontiers aux années qu’elle n’a pas connues, s’orne d’un nu féminin de l’époque Cormon, comme de toutes les déclarations anti-Dada de Picabia, dont la composante fêtarde est omniprésente. Un dessin de juillet 37, réalisé à Juan-les-Pins, montre Picabia et Picasso côte à côte : la guerre d’Espagne n’a pas l’air de les dresser l’un contre l’autre, ni de les empêcher de jouir de la plage. Cet album capital fait aussi danser les lignes. SG
Verbatim // « Le pays qui va sans doute émerger de cet affreux matérialisme débordant partout depuis des années, sera la France, il me semble, car dans ce pays il n’y a plus de place que pour la jeunesse, la vraie jeunesse, enfin la vie, pour ceux qui croient, vivent et pensent sans avoir besoin pour cela de s’étendre sur le divan des ambitions mercantiles ou législatives. […] Le Maréchal Pétain est un homme jeune, plus jeune que tous nos députés ou ministres, car ces pauvres êtres, pour la plupart, n’étaient que d’ignobles égoïstes, malfaiteurs exploitant avec facilité un pays comme la France, lequel ne demande qu’à croire, à aimer, à vivre librement. » Picabia, « Jeunesse », L’Opinion, 1er mars 1941
Regards de femmes
 **Le charme et la séduction, l’impulsive Louise de Vilmorin (1902-1969) n’en fut pas avare, et les hommes qu’elle aima, jusqu’au terrible Malraux, ne purent altérer cette vie des sens et de l’esprit dont le moindre de ses livres respire l’exigence et l’urgence. Le bonheur, disait-elle, est une disposition naturelle du caractère, une forme de courtoisie qu’on doit aux autres comme à soi-même. Elle fuyait les raseurs et les mélancoliques. Aussi appartient-elle à la veine si française des écrivains, de Mme de La Fayette au cher Nimier, pour lesquels la noblesse de comportement, la folie secrète des êtres s’offre partout à l’analyse et à l’humour. Son œil, son style et son manque d’argent chronique la destinaient à la presse. Elle y fut accueillie à bras ouverts dès 1934, quelques semaines après la parution de Sainte-Unefois dans la Blanche. Minotaure abrite son premier article. Les derniers, trente-cinq ans plus tard, bousculent des feuilles moins prestigieuses. Entretemps, elle avait gagné mille lecteurs, ceux de Vogue, de Marie-Claire, d’Arts et d’Opéra, à son éthique de la distinction et du plaisir. Peu importait le sujet pourvu qu’elle l’abordât avec l’aplomb cocasse des grandes causeuses. La mode et son théâtre, la façon de se vêtir ou de se dévêtir, Noël et ses soupirs de joie, le destin brisé de l’Aiglon, la métaphysique de l’ornement chez Théophile Gautier, l’enfance retrouvée, les grands livres, du Napoléon de Job à La Princesse de Clèves sur laquelle elle a écrit le texte définitif, tout comble sa fantaisie ou allume son indignation. Son billet sur l’écrasement de la Hongrie, en 1956, « Le Temps des assassins » vaut mieux que les faux-fuyants de Picasso! Après les Hussards de 1950 et Patrick Mauriès, Olivier Muth sert merveilleusement la mémoire de la princesse de Verrières-le-Buisson(Louise de Vilmorin, Objets-chimères. Artistes et textes rares 1935-1970, édition établie et présenté par Olivier Muth, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 23,50€). SG
**Le charme et la séduction, l’impulsive Louise de Vilmorin (1902-1969) n’en fut pas avare, et les hommes qu’elle aima, jusqu’au terrible Malraux, ne purent altérer cette vie des sens et de l’esprit dont le moindre de ses livres respire l’exigence et l’urgence. Le bonheur, disait-elle, est une disposition naturelle du caractère, une forme de courtoisie qu’on doit aux autres comme à soi-même. Elle fuyait les raseurs et les mélancoliques. Aussi appartient-elle à la veine si française des écrivains, de Mme de La Fayette au cher Nimier, pour lesquels la noblesse de comportement, la folie secrète des êtres s’offre partout à l’analyse et à l’humour. Son œil, son style et son manque d’argent chronique la destinaient à la presse. Elle y fut accueillie à bras ouverts dès 1934, quelques semaines après la parution de Sainte-Unefois dans la Blanche. Minotaure abrite son premier article. Les derniers, trente-cinq ans plus tard, bousculent des feuilles moins prestigieuses. Entretemps, elle avait gagné mille lecteurs, ceux de Vogue, de Marie-Claire, d’Arts et d’Opéra, à son éthique de la distinction et du plaisir. Peu importait le sujet pourvu qu’elle l’abordât avec l’aplomb cocasse des grandes causeuses. La mode et son théâtre, la façon de se vêtir ou de se dévêtir, Noël et ses soupirs de joie, le destin brisé de l’Aiglon, la métaphysique de l’ornement chez Théophile Gautier, l’enfance retrouvée, les grands livres, du Napoléon de Job à La Princesse de Clèves sur laquelle elle a écrit le texte définitif, tout comble sa fantaisie ou allume son indignation. Son billet sur l’écrasement de la Hongrie, en 1956, « Le Temps des assassins » vaut mieux que les faux-fuyants de Picasso! Après les Hussards de 1950 et Patrick Mauriès, Olivier Muth sert merveilleusement la mémoire de la princesse de Verrières-le-Buisson(Louise de Vilmorin, Objets-chimères. Artistes et textes rares 1935-1970, édition établie et présenté par Olivier Muth, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 23,50€). SG
 ***La valeur des Cahiers de la Petite Dame n’a pas à être redite. Gide, tout compte fait, n’eut pas de meilleure amie et observatrice, éditrice et complice, que Maria Van Rysselberghe. Elle était l’épouse, peu sage, du pointilliste Théo, trop sage lui, qui a immortalisé le réseau franco-belge où l’écrivain a tenu une place éminente au début du XXème siècle. La correspondance d’André et Maria, d’une ampleur unique, l’est aussi par le ton et la «surface» qu’elle donne à la liberté de pensée et de mœurs. Ces deux-là, en effet, se comprenaient, s’épaulaient, et presque s’épousaient, du politique au sexuel, sans avoir besoin de passer aux aveux complets. Est-ce trahir la ferveur fusionnelle qui les unissait que de d’y rattacher l’enfant que Gide fit à la propre fille de Maria, enfant qui devait convoler plus tard avec Pierre Herbart, ultime péripétie nuptiale et clanique ? On a compris que leurs échanges épistolaires donnent de la république des lettres un tableau ouvert. Ce volume de 1200 pages, contribution essentielle à l’histoire des arts des années 1899-1950, regorge aussi d’informations sur la peinture du temps, notamment le cercle des néo-impressionnistes et des Nabis, de Paris à Bruxelles. Dunoyer de Segonzac passe aussi une tête après la guerre de 14, qui a resserré les liens avec la Belgique et arraché définitivement Gide aux conforts de l’individualisme bourgeois. A son souci d’agir, les causes ne manquent pas. Certaines, comme l’homosexualité, vont mettre la NRF en émoi. D’autres, les colonies, l’antifascisme, le bolchevisme, l’opposeront vite à ses « amis » de gauche. Dès janvier 35, Maria exécute Les Cloches de Bâle, «salade sans style », « sentimentalité romantique », « lyrisme de grand opéra » et «coquetterie »… Aragon n’oubliera pas Gide à l’heure des règlements de compte de la Libération, qui ont charrié plus de mauvaise rancœur qu’on ne veut le dire. Car Gide fut moins présent qu’Aragon dans l’actualité éditoriale des années d’Occupation. Et cette correspondance rappelle que, sous la pression de Valéry et Martin du Gard, il refusa rapidement de collaborer à la NRF de Drieu. Il écrivit tout de même, apprend-on, à Abel Bonnard pour protéger une comédienne de son entourage. Depuis l’Afrique du Nord, rejointe dès 1942, son entregent restait actif. Au lendemain de sa mort, Maria rendra hommage à son souci d’«élever dans les cœurs le niveau de l’être humain » (André Gide et Maria Van Rysselberghe, Correspondance 1899-1950, édition présentée, établie et annotée par Peter Schnyder et Juliette Solvès, Gallimard, 40€). SG
***La valeur des Cahiers de la Petite Dame n’a pas à être redite. Gide, tout compte fait, n’eut pas de meilleure amie et observatrice, éditrice et complice, que Maria Van Rysselberghe. Elle était l’épouse, peu sage, du pointilliste Théo, trop sage lui, qui a immortalisé le réseau franco-belge où l’écrivain a tenu une place éminente au début du XXème siècle. La correspondance d’André et Maria, d’une ampleur unique, l’est aussi par le ton et la «surface» qu’elle donne à la liberté de pensée et de mœurs. Ces deux-là, en effet, se comprenaient, s’épaulaient, et presque s’épousaient, du politique au sexuel, sans avoir besoin de passer aux aveux complets. Est-ce trahir la ferveur fusionnelle qui les unissait que de d’y rattacher l’enfant que Gide fit à la propre fille de Maria, enfant qui devait convoler plus tard avec Pierre Herbart, ultime péripétie nuptiale et clanique ? On a compris que leurs échanges épistolaires donnent de la république des lettres un tableau ouvert. Ce volume de 1200 pages, contribution essentielle à l’histoire des arts des années 1899-1950, regorge aussi d’informations sur la peinture du temps, notamment le cercle des néo-impressionnistes et des Nabis, de Paris à Bruxelles. Dunoyer de Segonzac passe aussi une tête après la guerre de 14, qui a resserré les liens avec la Belgique et arraché définitivement Gide aux conforts de l’individualisme bourgeois. A son souci d’agir, les causes ne manquent pas. Certaines, comme l’homosexualité, vont mettre la NRF en émoi. D’autres, les colonies, l’antifascisme, le bolchevisme, l’opposeront vite à ses « amis » de gauche. Dès janvier 35, Maria exécute Les Cloches de Bâle, «salade sans style », « sentimentalité romantique », « lyrisme de grand opéra » et «coquetterie »… Aragon n’oubliera pas Gide à l’heure des règlements de compte de la Libération, qui ont charrié plus de mauvaise rancœur qu’on ne veut le dire. Car Gide fut moins présent qu’Aragon dans l’actualité éditoriale des années d’Occupation. Et cette correspondance rappelle que, sous la pression de Valéry et Martin du Gard, il refusa rapidement de collaborer à la NRF de Drieu. Il écrivit tout de même, apprend-on, à Abel Bonnard pour protéger une comédienne de son entourage. Depuis l’Afrique du Nord, rejointe dès 1942, son entregent restait actif. Au lendemain de sa mort, Maria rendra hommage à son souci d’«élever dans les cœurs le niveau de l’être humain » (André Gide et Maria Van Rysselberghe, Correspondance 1899-1950, édition présentée, établie et annotée par Peter Schnyder et Juliette Solvès, Gallimard, 40€). SG