Les expositions capables de dire un moment de l’histoire ou du goût ne courent pas les rues. Elles exigent travail, recherche et pensée, autant de soins devenus incompatibles avec l’industrie du divertissement. Francis Haskell et Jean Clair avaient prédit l’arrivée du spectacle muséal et des produits frelatés, affiches ronflantes et réalité décevante. Nous y sommes. Avec le public, désormais, les œuvres souffrent inutilement, dans trop de cas. Restent les exceptions, en voici.
 La sculpture, dit-on, ne déplace pas les foules. Elles auraient bien tort de bouder l’exposition de Lens et le pont subtil qu’elle jette entre le Paris des derniers capétiens (directs) et la Toscane des cités fleuries. En l’espace de 70 ans (1250-1320), le parcours fait advenir ce qu’on appelait jadis la proto-Renaissance. Par chance, cette façon de compter le temps, et d’anticiper un avenir préconçu, déplaît aux commissaires, plus attentifs aux effets de tuilage, aux évolutions multiples, à la modernité égale du gothique parisien et du giottisme florentin. L’erreur, ils le savent, serait de faire croire à une transformation obligée du langage des formes, enfin arraché à la nuit de l’occident que serait l’obscur Moyen Âge. D’or et d’ivoire se veut et se fait lumineuse dès son départ, qui coïncide avec les nouveaux chantiers de Notre-Dame de Paris et de la Sainte Chapelle. L’admirable Tête de roi mage de Jean de Chelles se rit des mutilations de 1793, elle a traversé les siècles avec la même puissance que l’œuvre des sculpteurs toscans contemporains, et leur bagage antique plus affirmé. L’Ange de Berlin, chef-d’œuvre de Nicola Pisano, annonce la souveraineté de son clan sur la statuaire siennoise. Les plis qui s’agitent dans le manteau de Gabriel mêlent l’accent de Paris à la leçon des vieux sarcophages. On a compris que le propos est tout sauf d’opposer le Nord au Sud. Au contraire, sculptures, peintures, vitraux et manuscrits enluminés invitent à suivre, en tous sens, l’ancienne Via Francigena, qui menait de Rome à Calais. Les migrations y étaient incessantes et touchaient aux flux bancaires comme à la mode. Il suffit d’ouvrir l’œil pour saisir comment des façons de se vêtir, de se coiffer et de séduire enjambèrent aussi les Alpes vers 1300.
La sculpture, dit-on, ne déplace pas les foules. Elles auraient bien tort de bouder l’exposition de Lens et le pont subtil qu’elle jette entre le Paris des derniers capétiens (directs) et la Toscane des cités fleuries. En l’espace de 70 ans (1250-1320), le parcours fait advenir ce qu’on appelait jadis la proto-Renaissance. Par chance, cette façon de compter le temps, et d’anticiper un avenir préconçu, déplaît aux commissaires, plus attentifs aux effets de tuilage, aux évolutions multiples, à la modernité égale du gothique parisien et du giottisme florentin. L’erreur, ils le savent, serait de faire croire à une transformation obligée du langage des formes, enfin arraché à la nuit de l’occident que serait l’obscur Moyen Âge. D’or et d’ivoire se veut et se fait lumineuse dès son départ, qui coïncide avec les nouveaux chantiers de Notre-Dame de Paris et de la Sainte Chapelle. L’admirable Tête de roi mage de Jean de Chelles se rit des mutilations de 1793, elle a traversé les siècles avec la même puissance que l’œuvre des sculpteurs toscans contemporains, et leur bagage antique plus affirmé. L’Ange de Berlin, chef-d’œuvre de Nicola Pisano, annonce la souveraineté de son clan sur la statuaire siennoise. Les plis qui s’agitent dans le manteau de Gabriel mêlent l’accent de Paris à la leçon des vieux sarcophages. On a compris que le propos est tout sauf d’opposer le Nord au Sud. Au contraire, sculptures, peintures, vitraux et manuscrits enluminés invitent à suivre, en tous sens, l’ancienne Via Francigena, qui menait de Rome à Calais. Les migrations y étaient incessantes et touchaient aux flux bancaires comme à la mode. Il suffit d’ouvrir l’œil pour saisir comment des façons de se vêtir, de se coiffer et de séduire enjambèrent aussi les Alpes vers 1300.
 François 1er a gagné par sa vie exemplaire le privilège d’être solidement ancré dans nos mémoires et nos références. Il n’était pas encore roi que Castiglione pensait lui dédier le livre du Courtisan. La combinaison accomplie du chevalier et de l’humaniste, c’était lui, plus que tout autre prince d’Europe… L’Arétin, un peu plus tard, lui fit présent du portrait de Titien, perle du Louvre. Le Vénitien avait su injecter la vie et l’ironie gauloise au profil de médaille qu’il avait utilisée pour brosser le roi de France. Sur la question des images d’apparat – les « state portraits », disent les Américains aux oreilles longues – on lira l’excellent essai d’Henri Zerner dans le catalogue de la passionnante exposition de la Bibliothèque nationale qui vient de se refermer. Il y réévalue le chef-d’œuvre de Clouet (ci-dessus), ornement des livres d’histoire, et se sépare nettement de ceux qui n’y voient qu’archaïsme français, au regard du portrait de Titien. Zerner retourne leur argument et rappelle que François Ier, tout amateur d’art italien qu’il fût, n’adhérait pas à notre culte du neuf. En outre, devenu roi faute d’héritier mâle dans la descendance de Louis XII, il lui fallait user de l’image pour asseoir un trône de circonstances. Or, en matière de portrait royal, un précédent existait, au prestige immense alors. C’est le Charles VII de Fouquet, auteur aussi d’un portrait perdu du pape Eugène, que Vasari n’omet pas de citer… Clouet n’avait plus qu’à se rattacher au modèle du vainqueur des Anglais pour faire sens. Chantant ses vertus guerrières (Marignan !) et sa piété chrétienne, tout une « stratégie de communication », au dire des commissaires, eut à cœur de légitimer ce grand Français de François. Leur exposition, il est vrai, ne le démentait pas.
François 1er a gagné par sa vie exemplaire le privilège d’être solidement ancré dans nos mémoires et nos références. Il n’était pas encore roi que Castiglione pensait lui dédier le livre du Courtisan. La combinaison accomplie du chevalier et de l’humaniste, c’était lui, plus que tout autre prince d’Europe… L’Arétin, un peu plus tard, lui fit présent du portrait de Titien, perle du Louvre. Le Vénitien avait su injecter la vie et l’ironie gauloise au profil de médaille qu’il avait utilisée pour brosser le roi de France. Sur la question des images d’apparat – les « state portraits », disent les Américains aux oreilles longues – on lira l’excellent essai d’Henri Zerner dans le catalogue de la passionnante exposition de la Bibliothèque nationale qui vient de se refermer. Il y réévalue le chef-d’œuvre de Clouet (ci-dessus), ornement des livres d’histoire, et se sépare nettement de ceux qui n’y voient qu’archaïsme français, au regard du portrait de Titien. Zerner retourne leur argument et rappelle que François Ier, tout amateur d’art italien qu’il fût, n’adhérait pas à notre culte du neuf. En outre, devenu roi faute d’héritier mâle dans la descendance de Louis XII, il lui fallait user de l’image pour asseoir un trône de circonstances. Or, en matière de portrait royal, un précédent existait, au prestige immense alors. C’est le Charles VII de Fouquet, auteur aussi d’un portrait perdu du pape Eugène, que Vasari n’omet pas de citer… Clouet n’avait plus qu’à se rattacher au modèle du vainqueur des Anglais pour faire sens. Chantant ses vertus guerrières (Marignan !) et sa piété chrétienne, tout une « stratégie de communication », au dire des commissaires, eut à cœur de légitimer ce grand Français de François. Leur exposition, il est vrai, ne le démentait pas.
 Roberto Longhi est mort sans avoir pu organiser une exposition sur son bilan d’historien de l’art, il l’eût fait avec précision et flamme, comme tout ce qu’il touchait. Ses états de service, tels que le musée Jacquemart-André les évoque de façon stimulante, font plus que rêver. Si le regard est une aventure infinie, il fut le plus grand explorateur du premier XXe siècle, à l’image d’un Sterling et de quelques autres. Ces fous de peinture n’aimaient rien tant que remuer les réserves, fouiller les sacristies, scruter la moindre collection à la recherche de la rareté qui leur permettrait de mettre un nom ou une date sur un tableau sans collier. Longhi, pour sa part, ne dissociait pas le travail d’attribution du travail d’analyse. Et, suprême don, il écrivait comme un dieu. On ne saurait trop en recommander la lecture aux historiens de l’art qui nous accablent de leur jargon souvent mal dominé, double crime. La géographie de ses trouvailles et de ses marottes devrait aussi les faire réfléchir. Nullement coupé de l’art de son temps, familier des futuristes et de la peinture métaphysique, très actif sous Mussolini (ce qui lui vaudra de pouvoir voyager en Espagne sous Franco), il s’est rendu vite célèbre par ses travaux sur les primitifs (son Piero della Francesca est un must), les oubliés de la Renaissance (Cosmè Tura) et le XVIIe siècle le moins bolonais possible. Il aurait donné tout Guido Reni pour un morceau de Caravage ! A ce dernier est consacrée sa thèse de 1911. Il avait à peine 20 ans. Caravage devait l’accompagner jusqu’au bout de la nuit.
Roberto Longhi est mort sans avoir pu organiser une exposition sur son bilan d’historien de l’art, il l’eût fait avec précision et flamme, comme tout ce qu’il touchait. Ses états de service, tels que le musée Jacquemart-André les évoque de façon stimulante, font plus que rêver. Si le regard est une aventure infinie, il fut le plus grand explorateur du premier XXe siècle, à l’image d’un Sterling et de quelques autres. Ces fous de peinture n’aimaient rien tant que remuer les réserves, fouiller les sacristies, scruter la moindre collection à la recherche de la rareté qui leur permettrait de mettre un nom ou une date sur un tableau sans collier. Longhi, pour sa part, ne dissociait pas le travail d’attribution du travail d’analyse. Et, suprême don, il écrivait comme un dieu. On ne saurait trop en recommander la lecture aux historiens de l’art qui nous accablent de leur jargon souvent mal dominé, double crime. La géographie de ses trouvailles et de ses marottes devrait aussi les faire réfléchir. Nullement coupé de l’art de son temps, familier des futuristes et de la peinture métaphysique, très actif sous Mussolini (ce qui lui vaudra de pouvoir voyager en Espagne sous Franco), il s’est rendu vite célèbre par ses travaux sur les primitifs (son Piero della Francesca est un must), les oubliés de la Renaissance (Cosmè Tura) et le XVIIe siècle le moins bolonais possible. Il aurait donné tout Guido Reni pour un morceau de Caravage ! A ce dernier est consacrée sa thèse de 1911. Il avait à peine 20 ans. Caravage devait l’accompagner jusqu’au bout de la nuit.
 Les occasions de voir ou revoir Matisse ne sont pas rares, mais il est rare qu’elles surprennent. S’y perpétue le plus souvent le blabla habituel sur l’explosion fauve, la religion de la surface, la décantation souveraine du signe ou la sensualité chaste des odalisques… On tremble à l’idée que l’indispensable rétrospective à venir ne s’échafaude sur de telles prémisses. Mais on se rassure en visitant, à Martigny, l’exposition que Cécile Debray consacre à cet artiste qu’elle connaît très bien et s’efforce de questionner autrement. De quel poids, par exemple, pesèrent l’héritage de Gustave Moreau (l’un de ses maîtres), le dialogue occulté avec le cubisme de Picasso et surtout de Juan Gris, et les deux guerres qu’il eut à vivre en observateur inquiet (son âge le protégea des uniformes en 1914 et 1939) ? Comme le dit le titre, Matisse est à comprendre « en son temps », dans son rapport au temps, le défi des autres comme la menace du même. Admirablement, en 1919, il confiait à un journaliste vouloir « chercher quelque chose de nouveau », pour échapper au « nouveau » fossilisé d’avant-guerre et d’avant-garde. En cela, il convient de le rapprocher, comme le fait Cécile Debray à plusieurs reprises, de Picasso et Derain, contemporains capitaux, et pareillement indifférents à toute téléologie moderniste. Au sortir de la guerre, ces trois-là abandonnent à la valetaille de l’époque le pauvre privilège de marcher droit et de traverser le siècle dans les clous. Toujours, en 1919, Matisse parle d’hygiène à propos de ce que nous nommons, avec condescendance, sa « période niçoise » (bête noire de Cocteau et des surréalistes) : « Si j’avais continué dans l’autre voie, que je connaissais si bien, j’aurais pu finir en maniériste. […] Du reste, je cherche une nouvelle synthèse. » On croyait Matisse en paix avec lui-même, on le découvre en proie à ses démons de mauvais père de famille (L’Algérienne, Lorette à la tasse de café, La Culotte rouge) et ses désirs de réincarnation. Le Renoir du XXe siècle, qu’il a tant regardé, comme le prouve Augustin de Butler, l’a précédé dans l’affolement des épidermes et des repères. Sous cette lumière, la période de l’Occupation et des années 1946-1947, très présente et prenante à Martigny, offre le spectacle d’un Matisse revenu du pays des morts, et inventant, me souffle Cécile Debray, le « Modern style » des années 1950. Très fort.
Les occasions de voir ou revoir Matisse ne sont pas rares, mais il est rare qu’elles surprennent. S’y perpétue le plus souvent le blabla habituel sur l’explosion fauve, la religion de la surface, la décantation souveraine du signe ou la sensualité chaste des odalisques… On tremble à l’idée que l’indispensable rétrospective à venir ne s’échafaude sur de telles prémisses. Mais on se rassure en visitant, à Martigny, l’exposition que Cécile Debray consacre à cet artiste qu’elle connaît très bien et s’efforce de questionner autrement. De quel poids, par exemple, pesèrent l’héritage de Gustave Moreau (l’un de ses maîtres), le dialogue occulté avec le cubisme de Picasso et surtout de Juan Gris, et les deux guerres qu’il eut à vivre en observateur inquiet (son âge le protégea des uniformes en 1914 et 1939) ? Comme le dit le titre, Matisse est à comprendre « en son temps », dans son rapport au temps, le défi des autres comme la menace du même. Admirablement, en 1919, il confiait à un journaliste vouloir « chercher quelque chose de nouveau », pour échapper au « nouveau » fossilisé d’avant-guerre et d’avant-garde. En cela, il convient de le rapprocher, comme le fait Cécile Debray à plusieurs reprises, de Picasso et Derain, contemporains capitaux, et pareillement indifférents à toute téléologie moderniste. Au sortir de la guerre, ces trois-là abandonnent à la valetaille de l’époque le pauvre privilège de marcher droit et de traverser le siècle dans les clous. Toujours, en 1919, Matisse parle d’hygiène à propos de ce que nous nommons, avec condescendance, sa « période niçoise » (bête noire de Cocteau et des surréalistes) : « Si j’avais continué dans l’autre voie, que je connaissais si bien, j’aurais pu finir en maniériste. […] Du reste, je cherche une nouvelle synthèse. » On croyait Matisse en paix avec lui-même, on le découvre en proie à ses démons de mauvais père de famille (L’Algérienne, Lorette à la tasse de café, La Culotte rouge) et ses désirs de réincarnation. Le Renoir du XXe siècle, qu’il a tant regardé, comme le prouve Augustin de Butler, l’a précédé dans l’affolement des épidermes et des repères. Sous cette lumière, la période de l’Occupation et des années 1946-1947, très présente et prenante à Martigny, offre le spectacle d’un Matisse revenu du pays des morts, et inventant, me souffle Cécile Debray, le « Modern style » des années 1950. Très fort.
 Restons en Suisse, puisque Marlene Dumas semble condamnée à ne jamais devoir faire l’affiche en France. Trente ans après ses premiers éclats, et le renouveau figuratif dont elle fut une actrice remarquée, elle suspend une manière de journal intime aux murs de la Fondation Beyeler. A quelques salles de là, Gauguin poursuit sa route. Dumas, qui jeune s’imaginait descendre du père des Trois mousquetaires, a trouvé à Bâle la compagnie qu’elle mérite. N’est-elle pas une artiste des frontières ? Frontière des médiums (la photographie conditionne maints tableaux), frontière des sexes (peu de femmes peintres fixent aussi bien l’Eros moderne), frontière des âges (il serait facile de montrer en quoi la prégnance des souvenirs débouche sur une forme d’autofiction picturale), frontière des cultures (une bande-son, entre punk et new wave, se mêle silencieusement à la fibre de ces images délestées du « fardeau » qu’elles sont supposées porter). Sa jeunesse, dans le Cape Town des années 1960, et la confrontation avec l’apartheid, a laissé quelques cicatrices. Et pourtant sa peinture, si réceptive à la question raciale et sociale, ne sacrifie jamais sa force expansive aux clins d’œil assommants du moralisme humanitaire, elle ne pèse pas. Dumas, du reste, sait donner de l’air à ses sujets les plus mordants ou les plus morbides, et de l’humour aux instantanées de son libertinage pornographique (Miss Pompadour, 1990). Rose et noire, en alternance ou tout ensemble, cette plongée autobiographique fait penser tantôt à Manet (Adrian Searle l’a bien senti derrière Stern, 2004), tantôt à Picasso, l’autre grand Français de son panthéon avec Géricault. Peinture référencée, et non référentielle, peinture centrée, et non nombriliste, toute la différence est là.
Restons en Suisse, puisque Marlene Dumas semble condamnée à ne jamais devoir faire l’affiche en France. Trente ans après ses premiers éclats, et le renouveau figuratif dont elle fut une actrice remarquée, elle suspend une manière de journal intime aux murs de la Fondation Beyeler. A quelques salles de là, Gauguin poursuit sa route. Dumas, qui jeune s’imaginait descendre du père des Trois mousquetaires, a trouvé à Bâle la compagnie qu’elle mérite. N’est-elle pas une artiste des frontières ? Frontière des médiums (la photographie conditionne maints tableaux), frontière des sexes (peu de femmes peintres fixent aussi bien l’Eros moderne), frontière des âges (il serait facile de montrer en quoi la prégnance des souvenirs débouche sur une forme d’autofiction picturale), frontière des cultures (une bande-son, entre punk et new wave, se mêle silencieusement à la fibre de ces images délestées du « fardeau » qu’elles sont supposées porter). Sa jeunesse, dans le Cape Town des années 1960, et la confrontation avec l’apartheid, a laissé quelques cicatrices. Et pourtant sa peinture, si réceptive à la question raciale et sociale, ne sacrifie jamais sa force expansive aux clins d’œil assommants du moralisme humanitaire, elle ne pèse pas. Dumas, du reste, sait donner de l’air à ses sujets les plus mordants ou les plus morbides, et de l’humour aux instantanées de son libertinage pornographique (Miss Pompadour, 1990). Rose et noire, en alternance ou tout ensemble, cette plongée autobiographique fait penser tantôt à Manet (Adrian Searle l’a bien senti derrière Stern, 2004), tantôt à Picasso, l’autre grand Français de son panthéon avec Géricault. Peinture référencée, et non référentielle, peinture centrée, et non nombriliste, toute la différence est là.
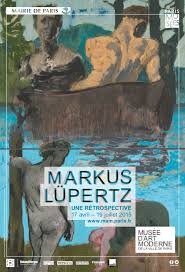 Cela se vérifie au musée d’art moderne de la ville de Paris, où Markus Lüpertz a pris ses quartiers avec l’autorité qu’on lui connaît. Une autorité que nul ne contestera à celui qui appartient au club fermé des quatre ou cinq plus grands peintres vivants (la mort précoce d’Immendorff l’a érigé, de fait, en maître de la mal nommée « bad painting » des années 1960-1980). Autorité qui ne se traduit pas seulement par l’aisance que déploient ses grands formats et sa façon de convoquer les grands ainés, de Mycènes à Polyclète, de Poussin et David à Ingres, Courbet et Manet, de Velázquez et Goya à Lovis Corinth (dont le prix éponyme le récompensa en 1990). On peut être un doctus pictor et entasser les rapines au lieu d’interroger le réel à nouveaux frais. Tel n’est pas le cas de Lüpertz, qui n’a jamais fermé les yeux sur la réalité du monde, et d’abord la réalité allemande, d’une après-guerre qui n’en finit pas d’étirer ses fureurs et ses ombres jusqu’à nous. Il y avait pourtant danger à se colleter à l’héritage du nazisme. Et, comme le jeune Kiefer, ou Richter plus récemment, Lüpertz s’est vu taxer de nostalgie alors que son art ne charrie la mémoire du IIIe Reich qu’en dévoilant ses subterfuges, ses mensonges et sa mythologie régressive. Ce faisant, il fait aussi la part du grand rêve d’énergie, et de renouveau arcadien, qui servit de paravent à la basse politique d’Hitler. Ignorer l’un, pour mieux démonétiser l’autre, eût affaibli l’acuité de son regard et la poésie souvent sombre de cet art dantesque, habité de bout en bout par les mannes d’Eschyle, et entraîné par un sens dionysiaque, et donc religieux, du baroquisme contemporain. Un demi-siècle de peinture et de sculpture s’est donc engouffré dans ce qui reste l’un des plus beaux espaces d’exposition de la capitale. L’expérience est à vivre. C’est l’une des plus fortes du moment. Stéphane Guégan
Cela se vérifie au musée d’art moderne de la ville de Paris, où Markus Lüpertz a pris ses quartiers avec l’autorité qu’on lui connaît. Une autorité que nul ne contestera à celui qui appartient au club fermé des quatre ou cinq plus grands peintres vivants (la mort précoce d’Immendorff l’a érigé, de fait, en maître de la mal nommée « bad painting » des années 1960-1980). Autorité qui ne se traduit pas seulement par l’aisance que déploient ses grands formats et sa façon de convoquer les grands ainés, de Mycènes à Polyclète, de Poussin et David à Ingres, Courbet et Manet, de Velázquez et Goya à Lovis Corinth (dont le prix éponyme le récompensa en 1990). On peut être un doctus pictor et entasser les rapines au lieu d’interroger le réel à nouveaux frais. Tel n’est pas le cas de Lüpertz, qui n’a jamais fermé les yeux sur la réalité du monde, et d’abord la réalité allemande, d’une après-guerre qui n’en finit pas d’étirer ses fureurs et ses ombres jusqu’à nous. Il y avait pourtant danger à se colleter à l’héritage du nazisme. Et, comme le jeune Kiefer, ou Richter plus récemment, Lüpertz s’est vu taxer de nostalgie alors que son art ne charrie la mémoire du IIIe Reich qu’en dévoilant ses subterfuges, ses mensonges et sa mythologie régressive. Ce faisant, il fait aussi la part du grand rêve d’énergie, et de renouveau arcadien, qui servit de paravent à la basse politique d’Hitler. Ignorer l’un, pour mieux démonétiser l’autre, eût affaibli l’acuité de son regard et la poésie souvent sombre de cet art dantesque, habité de bout en bout par les mannes d’Eschyle, et entraîné par un sens dionysiaque, et donc religieux, du baroquisme contemporain. Un demi-siècle de peinture et de sculpture s’est donc engouffré dans ce qui reste l’un des plus beaux espaces d’exposition de la capitale. L’expérience est à vivre. C’est l’une des plus fortes du moment. Stéphane Guégan
*D’or et d’ivoire. Paris, Pise, Florence, Sienne 1250-1320, Louvre-Lens, jusqu’au 28 septembre. Catalogue (Snoeck, 39€) sous la direction de Marie-Lys Marguerite et Xavier Dectot.
*François Ier. Pouvoir et image, catalogue sous la direction de Bruno Petey-Girard et de Magali Vène, BNF, 39 €
*De Giotto à Caravage, Musée Jacquemart-André, jusqu’au 20 juillet. Catalogue sous la direction de Mina Gegori, Maria Cristina Bandera et Nicolas Sainte Fare Garnot, Cultures Espaces / Fonds Mercator, 39 €.
*Matisse en son temps, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, jusqu’au 22 novembre, catalogue sous la direction de Cécile Debray, 42,50 €.
*Marlene Dumas. The Image as Burden, Fondation Beyeler, Bâle, jusqu’au 15 septembre. Catalogue, 48 €
*Markus Lüpertz. Une rétrospective, musée d’art moderne de la ville de Paris. Surprenant catalogue (Paris-Musées, 49,90€), un véritable objet éditorial, avec des contributions d’Eric Darragon, Pierre Wat et un entretien superbe entre Peter Doig et Lüpertz himself.




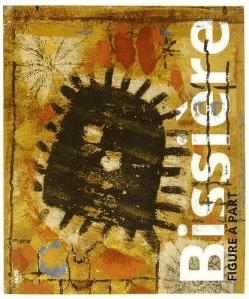






 Voilà belle lurette que la douceur a cessé d’être un attribut de la beauté moderne! L’heureux Quattrocento voyait les choses autrement. Nul besoin d’avoir lu le regretté
Voilà belle lurette que la douceur a cessé d’être un attribut de la beauté moderne! L’heureux Quattrocento voyait les choses autrement. Nul besoin d’avoir lu le regretté 
 Aussi savante qu’habile, Marie-Anne Lescourret a préféré les suivre à travers une biographie très vivante, captivante de bout en bout, où la réflexion de ce travailleur inlassable prend corps sous nos yeux et se dégage d’une existence plus saturée que nous ne l’imaginions. Dominer pareille profusion de faits et d’idées n’est pas donné à tout le monde… Ébauché à Bonn sous la lumière noire du Laocoon de Lessing, poursuivi dans les marges des peintures érotiques et médicéennes de Botticelli, nourri de l’expérience américaine et de l’apport des indiens hopis, le voyage de Warburg devait aboutir au fameux Atlas, inventaire génial des survivances de la création artistique, et au Déjeuner sur l’herbe… In extremis, Manet rallumait en lui l’étincelle initiale d’une autre Renaissance italienne, dont Burckhardt et Nietzsche avaient été de puissants médiateurs. Warburg se saisissait du chemin qui menait de l’antiquité à Manet, via le Jugement de Pâris de Raimondi et Raphaël. Il parle magnifiquement de l’impudique Victorine, «qui de symbole du fatalisme passif se transforme en être cynique – gagnée par l’optimisme, elle se redresse intérieurement». On pense à «l’amoureux cynisme» que Baudelaire prêtait en 1846 au jeune
Aussi savante qu’habile, Marie-Anne Lescourret a préféré les suivre à travers une biographie très vivante, captivante de bout en bout, où la réflexion de ce travailleur inlassable prend corps sous nos yeux et se dégage d’une existence plus saturée que nous ne l’imaginions. Dominer pareille profusion de faits et d’idées n’est pas donné à tout le monde… Ébauché à Bonn sous la lumière noire du Laocoon de Lessing, poursuivi dans les marges des peintures érotiques et médicéennes de Botticelli, nourri de l’expérience américaine et de l’apport des indiens hopis, le voyage de Warburg devait aboutir au fameux Atlas, inventaire génial des survivances de la création artistique, et au Déjeuner sur l’herbe… In extremis, Manet rallumait en lui l’étincelle initiale d’une autre Renaissance italienne, dont Burckhardt et Nietzsche avaient été de puissants médiateurs. Warburg se saisissait du chemin qui menait de l’antiquité à Manet, via le Jugement de Pâris de Raimondi et Raphaël. Il parle magnifiquement de l’impudique Victorine, «qui de symbole du fatalisme passif se transforme en être cynique – gagnée par l’optimisme, elle se redresse intérieurement». On pense à «l’amoureux cynisme» que Baudelaire prêtait en 1846 au jeune 
 Je mentirai en disant l’inverse d’El Lissitzky. L’expérience de la totalité, catalogue d’une exposition qui tourne, aujourd’hui à Malaga, demain à Barcelone… La France se serrera la ceinture! Demeure son catalogue qui préfère la minceur savante à l’obésité redondante. Maintes raisons justifient qu’on en parle après Arts and Architecture: la première est qu’
Je mentirai en disant l’inverse d’El Lissitzky. L’expérience de la totalité, catalogue d’une exposition qui tourne, aujourd’hui à Malaga, demain à Barcelone… La France se serrera la ceinture! Demeure son catalogue qui préfère la minceur savante à l’obésité redondante. Maintes raisons justifient qu’on en parle après Arts and Architecture: la première est qu’
 Si l’effroyable et humiliante guerre de Sept Ans (1756-1763) affecta passagèrement les Gobelins, elle empoisonna la vie et l’économie des soyeux lyonnais bien plus encore. Les exportations soudain dégringolèrent, ou rejoignirent les produits de contrebande, aux risques et périls des firmes françaises. En 1760, on lisait dans le London Chronicle: «dans tous les lieux publics, nos dames semblent plus françaises qu’anglaises. La législation a prohibé l’importation des soieries françaises, dentelles et lin; et pour cette raison même, les obtenir est devenu des plus désirables et des plus distingués.» Les obtenir, les copier ou les capter… Quatre ans plus tard, les douanes anglaises saisissaient un livre d’échantillons en provenance de Lyon, via Paris et Dunkerque. Il rejoindra en 1972 les collections du Victoria and Albert Museum, après avoir appartenu à la London Company of Weavers et d’autres manufactures britanniques. La Bibliothèque des Arts en publie un fac-similé et retrace l’histoire rocambolesque d’un volume qui passa de main en main durant deux siècles. Avec l’aide d’une ample documentation visuelle, et à partir des portraits de l’époque et de leurs accessoires, Lesley Ellis Miller montre à quelles extrémités délicieuses pouvaient déjà conduire la mode vestimentaire et la guerre commerciale que se livraient les pays d’Europe. Son enquête de très longue haleine l’a conduite à identifier les deux G du livre d’échantillons, qui appartient à son musée, et à reconstituer le marché conflictuel de l’habillement de luxe au mitan du XVIIIe siècle. Pierre Arizzoli-Clémentel, dans sa postface, parle en connaisseur du «voile» que lève cette «étude capillaire» sur «le monde industrieux et attachant des soyeux» de Lyon et des marchands-merciers de Paris.
Si l’effroyable et humiliante guerre de Sept Ans (1756-1763) affecta passagèrement les Gobelins, elle empoisonna la vie et l’économie des soyeux lyonnais bien plus encore. Les exportations soudain dégringolèrent, ou rejoignirent les produits de contrebande, aux risques et périls des firmes françaises. En 1760, on lisait dans le London Chronicle: «dans tous les lieux publics, nos dames semblent plus françaises qu’anglaises. La législation a prohibé l’importation des soieries françaises, dentelles et lin; et pour cette raison même, les obtenir est devenu des plus désirables et des plus distingués.» Les obtenir, les copier ou les capter… Quatre ans plus tard, les douanes anglaises saisissaient un livre d’échantillons en provenance de Lyon, via Paris et Dunkerque. Il rejoindra en 1972 les collections du Victoria and Albert Museum, après avoir appartenu à la London Company of Weavers et d’autres manufactures britanniques. La Bibliothèque des Arts en publie un fac-similé et retrace l’histoire rocambolesque d’un volume qui passa de main en main durant deux siècles. Avec l’aide d’une ample documentation visuelle, et à partir des portraits de l’époque et de leurs accessoires, Lesley Ellis Miller montre à quelles extrémités délicieuses pouvaient déjà conduire la mode vestimentaire et la guerre commerciale que se livraient les pays d’Europe. Son enquête de très longue haleine l’a conduite à identifier les deux G du livre d’échantillons, qui appartient à son musée, et à reconstituer le marché conflictuel de l’habillement de luxe au mitan du XVIIIe siècle. Pierre Arizzoli-Clémentel, dans sa postface, parle en connaisseur du «voile» que lève cette «étude capillaire» sur «le monde industrieux et attachant des soyeux» de Lyon et des marchands-merciers de Paris. Last but lot least, le catalogue de l’exposition François Boucher. Fragments d’une vision du monde, qui eut lieu au musée Gl. Holtegaard en 2012, nous arrive enfin. Comme il est superbe, on se dit qu’on a bien fait d’attendre… Montrer François Boucher au Danemark, l’un des pays d’ancrage de «l’Europe française» de Louis Réau, c’était le ramener à la maison! Soixante-dix dessins, rococo à souhait, très déshabillés le plus souvent, résument la trajectoire d’un artiste qui se joua des frontières avec constance. Frontières politiques, on l’a dit. Mais frontières esthétiques au même degré. Françoise Joulie a voulu donner un plein écho à cette plasticité, qui fait passer Boucher du tableau royal au dessin pour amateurs, de la tapisserie au livre illustré, de l’estampe au bibelot, mais aussi du rustique à l’exotique, du religieux au laïc, de la pastorale priapique au stoïcisme romain… La légende du libertin, n’écoutant que sa libido insatiable, n’a plus cours désormais. On préfère peindre le chéri de la Pompadour en redoutable chef d’entreprise, ajusté aux diverses options d’un marché centrifuge. Il n’existait guère de conflit majeur entre Mercure et Vénus. Si le meilleur de Boucher possède l’énergie érotique et l’accent de vérité des meilleurs peintres de nu, c’est que le modèle vivant, femmes et hommes, scrutés sous tous les angles, fragmentés à plaisir, a très souvent précédé le monde plus idéal du tableau. Ce marivaudage sérieux, récompense méritée, retiendra les plus grands, de
Last but lot least, le catalogue de l’exposition François Boucher. Fragments d’une vision du monde, qui eut lieu au musée Gl. Holtegaard en 2012, nous arrive enfin. Comme il est superbe, on se dit qu’on a bien fait d’attendre… Montrer François Boucher au Danemark, l’un des pays d’ancrage de «l’Europe française» de Louis Réau, c’était le ramener à la maison! Soixante-dix dessins, rococo à souhait, très déshabillés le plus souvent, résument la trajectoire d’un artiste qui se joua des frontières avec constance. Frontières politiques, on l’a dit. Mais frontières esthétiques au même degré. Françoise Joulie a voulu donner un plein écho à cette plasticité, qui fait passer Boucher du tableau royal au dessin pour amateurs, de la tapisserie au livre illustré, de l’estampe au bibelot, mais aussi du rustique à l’exotique, du religieux au laïc, de la pastorale priapique au stoïcisme romain… La légende du libertin, n’écoutant que sa libido insatiable, n’a plus cours désormais. On préfère peindre le chéri de la Pompadour en redoutable chef d’entreprise, ajusté aux diverses options d’un marché centrifuge. Il n’existait guère de conflit majeur entre Mercure et Vénus. Si le meilleur de Boucher possède l’énergie érotique et l’accent de vérité des meilleurs peintres de nu, c’est que le modèle vivant, femmes et hommes, scrutés sous tous les angles, fragmentés à plaisir, a très souvent précédé le monde plus idéal du tableau. Ce marivaudage sérieux, récompense méritée, retiendra les plus grands, de  Entre la mort de César et le flop d’Actium, qui mit un terme aux ambitions de Marc-Antoine, tout s’est joué pour Octave. Fils adoptif du premier, ennemi juré du second, il peut prendre désormais les poses d’un dieu vivant. Auguste en tout, il a le physique de l’emploi, nous dit
Entre la mort de César et le flop d’Actium, qui mit un terme aux ambitions de Marc-Antoine, tout s’est joué pour Octave. Fils adoptif du premier, ennemi juré du second, il peut prendre désormais les poses d’un dieu vivant. Auguste en tout, il a le physique de l’emploi, nous dit On n’a jamais autant bâti, reconstruit, embelli Rome et ses capitales satellitaires. Non que tout y fût de marbre, comme le voudrait la légende. Mais le bilan monumental, architecture, sculpture et peinture, reste confondant. Qui d’autre qu’un fils d’Énée, à la fois Mars et Vénus, aurait pu autant professer la saine simplicité rustique des anciens, manifester autant de superbe et s’adonner aux plaisirs? Xavier Darcos, à qui rien de l’antiquité amoureuse n’est étranger, nous dépeint un Auguste ardent au sexe et actif jusqu’à sa mort. Ne descendait-il pas de Vénus en droite ligne? Le fameux portait du Vatican, trouvé dans la villa de son épouse Livie, l’affuble de deux accessoires liés à sa noble ascendance, une armure à trophées militaires et un Cupidon espiègle, qui singe le bras tendu de l’imperator. Les écrits licencieux de Properce, Tibulle et
On n’a jamais autant bâti, reconstruit, embelli Rome et ses capitales satellitaires. Non que tout y fût de marbre, comme le voudrait la légende. Mais le bilan monumental, architecture, sculpture et peinture, reste confondant. Qui d’autre qu’un fils d’Énée, à la fois Mars et Vénus, aurait pu autant professer la saine simplicité rustique des anciens, manifester autant de superbe et s’adonner aux plaisirs? Xavier Darcos, à qui rien de l’antiquité amoureuse n’est étranger, nous dépeint un Auguste ardent au sexe et actif jusqu’à sa mort. Ne descendait-il pas de Vénus en droite ligne? Le fameux portait du Vatican, trouvé dans la villa de son épouse Livie, l’affuble de deux accessoires liés à sa noble ascendance, une armure à trophées militaires et un Cupidon espiègle, qui singe le bras tendu de l’imperator. Les écrits licencieux de Properce, Tibulle et