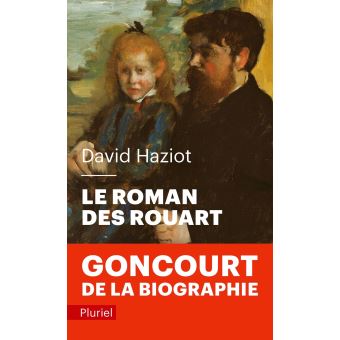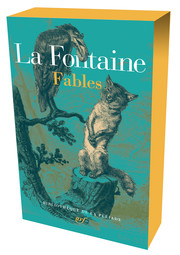D… Don Juan a mauvaise mine ces temps-ci, et le donjuanisme se terre par peur des gros mots : « mâle blanc », « stéréotype sexiste » ou « fin de race » fusent et se diffusent. Avec le flair digne du père de Cyrano de Bergerac (que le film banalise la pièce de 1897 !), Rostand avait remis le mythe sur le métier en 1911, mais il meurt en décembre 1918 sans être parvenu à boucler le manuscrit. La pièce après raccommodage est donnée en 1921 avec un certain succès ; on la redonne en ce moment, comme si elle avait annoncé la déconstruction en cours d’une masculinité désormais hors d’âge. Était-ce bien le propos de Rostand, cette ironie qu’on lui prête à l’endroit du parangon de la virilité conquérante ? Certes l’écrivain s’en amuse, pas plus que Molière cependant ; et pas moins que Baudelaire, il n’oublie la morsure mélancolique du désir insatiable, ou du vieillissement. Ombres de ce Faust détourné, les 1003 maîtresses tentent de nous faire croire que l’érotomane a été leur dupe. Le lecteur, avec l’auteur, a le droit de douter de ce Me too précoce. Pour l’avisée Anna de Noailles, la morale de l’ouvrage se dégageait de ce vers pascalien : « Plaire est le plus grand signe, et c’est le plus étrange. » Le prêt-à-penser actuel n’a pas de ces traits-là.

I… Ida Pfeiffer (1797-1858) n’était pas destinée à trotter autour du globe et à prendre la route ou la mer, au mépris de tous les dangers, pour assouvir une curiosité du monde que sa plume, pas assez connue par chez nous, rend merveilleusement excitante. Certains voyageurs du XIXe siècle, poussés par l’époque et ses nouveaux moyens de transport, oublient d’embarquer leurs lecteurs avec eux et se bornent à une ennuyeuse nomenclature de faits et gestes. La viennoise Ida est autrement généreuse de ses sensations et de ses observations, marquées au coin d’une femme forte. Après s’être séparée de son mari, avoir vu s’éloigner ses deux fils et mourir sa mère, elle s’était saisie pleinement de la liberté qui s’offrit. Elle avait reçu l’enseignement d’un précepteur très géographe. L’enfant a voyagé en elle avant que la femme ne s’élance, jusqu’à faire deux fois le tour du monde. Dans le livre qu’elle tira du premier, effectué en 1846-48, livre traduit par Hachette dès 1859, un chapitre est réservé à Tahiti, le meilleur du périple. Son regard sur les populations balance entre l’apriori, souvent peu flatteur, et la glane correctrice ou pas du terrain. Vie sociale, mœurs intimes, considérations anatomiques et bonheurs de la table, tout fait image : on pense à Gauguin et Matisse à lire la volupté qu’elle éprouva à partager fruits et mets, dont elle donne, en gourmande dévoilée, le menu.

S… Surprenant musée du Havre qui décentre doublement son approche de l’impressionnisme. Claude Monet, parisien de naissance, avait plus d’une raison de rester fidèle à l’une de ses villes d’adoption… La Normandie, c’était plus qu’une chambre d’hôtel, plus qu’un balcon ouvert, au petit matin, sur l’un des ports essentiels de la IIIe République. Là où les romantiques avaient élu le culte du passé national, là où Français et Anglais avaient réinventé la peinture de marine dès avant 1830, un autre champ d’expérience s’ouvrit, 10 ans plus tard, la mémoire déjà pleine d’images donc : l’autre modernité normande prit le visage d’une myriade de photographes, gloires locales (Brébisson) ou de passage (Le Gray), qui étaient loin de penser leur pratique, poncif irritant, en conflit avec la peinture. L’exposition actuelle réunit clichés, tableaux et estampes par leur défi commun aux éléments, l’eau, l’air, la fumée, le transitoire sous les trois espèces. La figure de Jean-Victor Warnod se signale par son ouverture d’esprit et son sens de l’entreprise. En exposant Daubigny au Havre, il montrait le premier paysagiste dont on ait dit qu’il s’effaçait complètement, fiction flaubertienne, devant le motif, comme livré, en déshabillé, dans sa plénitude organique et sa lumière frémissante.

S… Succès renouvelé pour le festival Normandie impressionniste et son vaste maillage de lieux ! Fêtant ici Whistler et Hockney, Vuillard ailleurs, débarquant au Havre, à Rouen, comme à Trouville-sur-Mer, il prend aussi, cette année, les couleurs et les lignes délicatement tamisées d’Augustin Rouart. Le filet du Petit pêcheur de 1943 (illustration) avait valeur de symbole, il disait le bonheur d’être au monde, à de rares instants, et la nécessité d’en filtrer les éléments pour qui rêvait d’égaler Albert Dürer, « peintre pensif » (Victor Hugo), et signait d’un A gothique. Nous avons souvent parlé ici de cet Augustin, lecteur de l’autre, mais ne lui sacrifiant pas la Cité des Hommes par amour de Dieu. Riche en vagues et fleurs, promeneurs solitaires et Vénus modernes, avec rouleaux d’écume et maillots de bain obligés, l’exposition de la Villa Montebello, visible jusqu’au 19 septembre, pousse une autre porte du souvenir, qui mène à Manet par Julie, à Degas par Henri Rouart, aux Lerolle par Henry et Christine, et au miracle de la vie par Maurice Denis. Que de belles prises ! Et quelle belle invitation de réfléchir au destin à la peinture française !

O… On ne saurait mieux dire. Ce 3 juillet 1874, Flaubert informe sa bonne amie George Sand du bonheur qu’il a eu de découvrir un biologiste allemand, inconnu de lui, mais aussi friand des dessous marins et des observatoires salés de la vie élémentaire : « Je viens de lire La Création naturelle de Haeckel ; joli bouquin ! joli bouquin ! Le darwinisme m’y semble plus clairement exposé que dans les livres de Darwin même. » Aujourd’hui ternie par la renommée de l’Anglais, écornée par sa récupération nationale-socialiste, la biologie haeckelienne peine à retrouver en France le succès qui fut le sien, malgré les réactions patriotiques provoquées par 1870 et 1914. Un nouveau volume des Entretiens de la fondation des Treilles, conduit par Laura Bossi, l’une des meilleures connaisseuses du sujet, et Nicolas Wanlin, secoue le cocotier des idées reçues et nous oblige à réintroduire Haeckel dans l’analyse et l’imaginaire du vivant à la Belle Epoque. Pas à pas, filiations et affinités, surgies souvent du fond des océans, se reconstituent sous les yeux du lecteur émerveillé. Huysmans cite Haeckel à propos de Redon ; la Galatée (Orsay) de Gustave Moreau s’en inspire, le Matisse tahitien aussi, suggère avec raison Philippe Comar ; René Binet, l’homme de la porte d’entrée de l’Exposition universelle de 1900, façon madrépore, l’a vampirisé, et Gallé l’a lu probablement, l’associant à Baudelaire et Gautier au gré de sa rêverie sur les formes flottantes. Par Mirbeau et Geffroy, on arrive à Monet et aux Nymphéas. Si Haeckel mène à tout, revenons à lui. Laura Bossi met la dernière main au livre qui le ressuscitera entièrement.

L… La dernière livraison de la N.R.F. a choisi d’évaluer les traces résiduelles du surréalisme et nous épargne ainsi sa glorification de commande. Le centenaire du manifeste, vraie contradiction dans les termes, nous vaudra bientôt un déluge de gloses et gnoses, qui claironnant l’amour fou, qui la liberté de l’esprit, qui le salut par l’Orient, qui la destruction de l’Occident fasciste ou mécréant, qui la mort de l’ordre bourgeois… Cette dernière prophétie, serpent de mer inusable depuis que le romantisme en fit son cri de guerre contre les perruques de la plume ou du pinceau, ne semble pas avoir perdu tout charme : Nicolas Mathieu, l’un des écrivains sondés par la N.R.F., ne craint pas, sans rire, d’identifier la raison à une « religion bourgeoise ». Appelée aussi à se prononcer sur le surréalisme du bel aujourd’hui, Philippe Forest est plus inspiré en revenant à Anicet, le premier roman d’Aragon et, comme Drieu le diagnostique dès 1921, l’aveu des trahisons à venir. Et trahison, d’abord, à l’interdit du roman en soi. Je ne suis pas sûr que l’on comprenne bien le sens de l’article de Gide à ce sujet. Dès la N.R.F. d’avril 1920, ce dernier adoube moins la bande de Tzara qu’il n’en pardonne la candeur au nom du droit au changement propre à la génération de la guerre. On lira aussi l’article d’Eric Reinhardt, parti sur les pas de Max Ernst dans le New York de Pollock, Arshile Gorky et Julien Levy. On suivra enfin Antoine Gallimard, parti lui à la rencontre des illusions et des crimes de l’IA, ce surréalisme de l’imposture et de l’irresponsabilité.

U… Une fois n’est pas coutume, André Masson fait l’objet d’une ample rétrospective, laquelle célèbre le peintre autant que l’adepte fervent de la naturphilosophie. Les pensées philosophiques d’Héraclite, dans l’édition des fragments préfacé par Anatole France en 1918, l’ont-elles jamais quitté ? On sait Masson lecteur de Darwin ; peut-être a-t-il touché à Haeckel et ses planches botaniques enivrantes? Goethe et sa théorie transformiste des plantes ont aussi compté pour celui qui peignit l’inachèvement du monde, le devenir au travail et plus encore le dualisme des êtres et de leurs « violentes passions », comme l’écrit Kahnweiler en 1941, alors que le peintre et son épouse, juive et sœur de Sylvia Bataille, ont migré aux Etats-Unis. L’exposition du Centre Pompidou-Metz, sous un titre emprunté à l’artiste, ne le réduit pas à sa période américaine, longtemps héroïsée chez ceux qui le défendirent. Le premier Masson, contemporain de la cordée et de la discorde surréalistes, ne pouvait être minoré ; la place donnée aux années 1950-1960, en porte-à-faux avec l’hégémonie abstraite ou primitiviste du moment, constitue elle un utile pied-de-nez à la vulgate post-bretonienne. Constitué essentiellement d’extraits de textes connus, le catalogue donnera aux plus jeunes la joie de découvrir d’autres écritures de la métamorphose, de Georges Limbour à William Rubin.

T… Tiens, L’Enlèvement des Sabines, l’un des Poussin du Louvre les plus tragiques dans son frénétisme déchiré, loge au musée Picasso pour quelques mois, le temps de dissiper quelques illusions à propos de l’iconoclaste qu’aurait été le peintre de Guernica. On l’a compris, l’intention de Cécile Godefroy se situe aux antipodes de la diabolisation de Don Pablo en machiste carnassier, et adepte du rapt… Picasso iconophage rend au terrain des images ce qui lui appartient, l’élaboration hypermnésique d’un imaginaire nourri du réel, intime ou politique, et d’une myriade de souvenirs, conscients ou inconscients. Il se trouve que la donation Picasso de 1979 s’est doublée du don de l’archive de l’artiste, deux océans ouvertement ou secrètement reliés en permanence. L’Espagnol gardait tout, de la carte postale d’Olympia au ticket de corrida, et regardait tout : c’était sa façon de faire et défaire. Cette exposition fascinante a ceci de remarquable qu’elle s’organise selon la circulation visuelle qu’elle veut mettre au jour, elle tient donc de l’arachnéen et du feuilletage, de l’affinité distante et du télescopage imprévisible. Certaines sources étaient connues des experts, d’autres oubliées ou négligées. Qui eût osé projeter sur Massacre en Corée la lumière de Winckelmann ? Sur ce Mousquetaire de mars 1967 les mains du Castiglione de Raphaël ? Il fallait oser. C’est fait.

I… Il fut l’homme des toiles lacérées, trouées, et de la statuaire à fentes. Lucio Fontana (1899-1968) reprend pied en France, chez feu Soulages, à Rodez. Le cas de ce moderne absolu semble simple. Malgré son étrange élégance, ses allusions érotiques ou les échos telluriques qu’il affectionnait, notre Italo-Argentin est généralement rattaché à l’avant-gardisme de la geste radicale. Celui qui croisa Picasso vers 1950 serait à ranger parmi les partisans les plus sûrs de la défiguration, peinture et sculpture. Les preuves n’abondent-elles pas ? Les œuvres aussi, où, avec Yves Klein par exemple, le salut consistait à dématérialiser la forme afin de la spiritualiser ? J’imagine que nombreux seront les visiteurs de l’exposition et les lecteurs de son catalogue, très documenté quant aux débuts de l’artiste, à découvrir que l’homme des Concetti spaziali et des Buchi cachait bien son jeu. Médaillé pour sa bravoure au terme de la guerre de 14, il entre dans la carrière sous le fascisme, s’expose avec enthousiasme à la plupart des courants esthétiques de la modernité d’alors, le futurisme deuxième génération, le groupe Novecento et, plus étonnant, le symbolisme tardif et tordu d’un Adolfo Wildt, dont il fut l’un des disciples les plus sûrs. A quoi s’ajoute peut-être l’influence du père, sculpteur « impressionniste » qui explique peut-être le côté Medardo Rosso, « non finito », de certaines pièces. Merci à Benoît Decron d’avoir rétabli l’unité des deux Fontana, pensé ensemble la vie tenace et les béances trompeuses. L’idée d’une fatalité de l’abstraction, et qu’il y ait même jamais eu abstraction chez lui, s’en trouve renversée.

O… On n’avait jamais vu ça. En 1969, au lendemain des « événements » qui avaient réveillé sa jeunesse intrépide, Christian de La Mazière accepta de se raconter devant les caméras d’Ophuls. Aplomb incroyable, numéro inoubliable… Le choc du Chagrin et la pitié, c’est lui. Proche alors de la cinquantaine, il révèle au public ébahi son incorporation volontaire dans la Charlemagne, division SS ouverte aux jeunes Français décidés à repousser les Russes en Prusse orientale, à quelques mois de la fin. La camaraderie, la trouille, les neiges de Poméranie, les paysans offrant leurs filles, de peur qu’elles tombent entre des mains slaves, La Mazière en déroulait le film avec une désinvolture et une absence de forfanterie qui faisaient presque oublier l’effrayante cause qu’il avait servie par anticommunisme (adolescence d’Action française) et folie compensatoire du risque. Condamné pour collaboration, il fut enfermé à Clairvaux, il avait 23 ans. C’est là, parmi « les politiques », qu’il rencontre Pierre Vitoux, ancien journaliste du Petit Parisien, autre humilié de juin 40, pas plus nazi que lui. L’âge, la culture et le tempérament les séparent assez pour qu’une amitié profonde naisse de leurs différences. L’Ami de mon père s’adresse à ces deux idéalistes que la guerre avait floués et l’après-guerre réunis : Frédéric Vitoux n’ouvre aucun procès en réhabilitation, même après avoir rappelé que les positions paternelles, avant et après les accords de Munich, ciblaient Hitler, au point d’en appeler à l’alliance avec Staline. Amusant détail si l’on songe à la russophobie de La Mazière… Ce livre de 2000, admirable de sincérité, de courage et d’impressions vraies, forme son Education sentimentale, voire sexuelle. C’est l’adolescent qu’il fut qui revit ici. A l’été 61, sans s’annoncer, – ce n’était pas son genre, l’ancien de la Charlemagne débarque en Triumph sur la Côte d’azur avec deux Américaines, une mère et sa fille… Frédéric, 17 ans, n’en croit pas ses yeux, ni ses oreilles. Tout un passé vrombit soudain. Et ce n’est qu’un début. Des accords d’Evian à Mai 68, L’Ami de mon père entraîne, pied au plancher, les lecteurs derrière lui, et ils en redemandent.

N… Nu, le roi est nu, c’est la leçon de l’autoportrait. Nous n’avons pas besoin d’être peintre pour en faire l’expérience, un miroir suffit, notre image inversée guérit en un instant toute velléité de tricher, toute illusion de ne faire qu’un avec soi, et d’échapper complètement aux limites de la raison. C’est l’erreur des surréalistes de l’avoir cru possible et bénéfique. Paul Klee, qu’André Breton rattacha de force à l’écriture automatique, fut une sorte de Goya moderne, égaré au XXe siècle, et rétif aux leurres de la folie volontaire. La couverture du dernier Marc Pautrel lui emprunte une de ses toiles de 1927, une tempera tempérée, instruite des allégories piranésiennes de l’être avide de lumière chères à Gautier et Baudelaire. J’aime bien Pautrel, sa passion pour Manet, qu’il tient pour le plus abyssal des réalistes, sa façon de confier au présent de l’indicatif le fil ininterrompu de sa vie songeuse, nageuse, buveuse (du Bordeaux !), affective et vertueusement active, puisque l’écriture est autant travail que prière. Le seul fou, m’écrit-il, est un « long poème », il a raison ; une « histoire d’amour », cela me rassure ; et « presque un autoportrait », où s’équilibrent l’ascèse de son Pascal (Gallimard, 2016) et les émois nécessaires, puisque mon corps est un autre, puisque les femmes sont belles : « La vie ne me laisse jamais de pourboire. » On n’est jamais seul à ce compte-là.
Stéphane Guégan

Edmond Rostand, La Dernière Nuit de Don Juan, édition établie par Bernard Degott, Folio Théâtre, Gallimard, 8,90€ / Ida Pfeiffer, Voyage d’une femme autour du monde, Mercure de France, 12,50€ / Sylvie Aubenas, Benoît Eliot et Dominique Rouet (dir.), Photographier en Normandie 1840-1890, MuMa / Infine, 35€ / Augustin Rouart en son monde, Cahiers du Temps, 22€. Lire aussi, très complet, Augustin Rouart. La splendeur du vrai, Artlys, 2024, avec une préface de Jean-Marie Rouart / Voir aussi Anka Muhlstein, Camille Pissarro. Le premier impressionniste, Plon, 22,90€. Cette efficace synthèse parvient à éclairer la complexité des rapports de Pissarro à sa judéité (homme de gauche, il va jusqu’à écrire que « le peuple n’aime pas la banque juive avec raison »), à ses coreligionnaires collectionneurs et à ses « camarades » (Renoir, Degas) lors de l’Affaire Dreyfus. La correspondance du peintre, d’une richesse inouïe, est bien mise à contribution.

Olivia Gesbert (dir.), La NRF, n°658, été 2024, Gallimard, 20€ / Chiara Parisi (dir.), André Masson. Il n’y a pas de monde achevé, Centre Pompidou-Metz, 40€ / Peu d’écrivains peuvent se prévaloir du souffle de Raphaël Confiant, de sa faconde à fulgurances créoles, de sa drôlerie pimentée, surtout quand ses récits se heurtent à la xénophobie anti-Noirs ou simplement au choc des rencontres et des épidermes. A deux pas de l’atelier de Masson, rue Blomet, le « Bal nègre », immortalisé par Desnos et Brassaï, faisait tomber bien des barrières, privilège de la transe transraciale, magie sombre du jazz aux couleurs antillaises. Anthénor, qui a survécu aux Dardanelles, comme Drieu, s’installe à Paris en 1919 et nous maintient en haleine jusqu’aux années 30, et même à l’Occupation, durant laquelle certains musiciens des îles continuèrent à se produire au su des boches. Céline disait que Paul Morand avait réussi à faire jazzer le français, on y est, on y reste. / Raphaël Confiant, Le bal de la rue Blomet, Gallimard, Folio, 8,90€.

Cécile Godefroy (dir.), Picasso iconophage, Grand Palais RMN / Musée Picasso Paris, 49,90€ / Tel chien, dit-on, tel maître. L’équation s’applique peu à Picasso, qui vécut entouré d’espèces les plus diverses, pareilles aux emplois qu’en fit sa peinture. Jean-Louis Andral, expert espiègle, nous initie à cette ménagerie, où un dalmatien peut succéder à un teckel, un saluki à un saint-bernard, de même que les « périodes » de l’artiste n’obéissent à une aucune logique linéaire. Inaugurant une collection imaginée par Martin Bethenod, le livre d’Andral se penche aussi sur le devenir pictural du chenil. Car ces chiens de tout poil courent l’œuvre entier et contribuent, symboles de loyauté ou d’énergie, à son mordant unique. Jean-Louis Andral, Picasso et les chiens, Norma éditions, 24€.

Laura Bossi et Nicolas Wanlin (dir.), Haeckel et les Français, Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 22€. Philippe Comar, l’un des contributeurs, signe un nouveau roman où l’angoisse et la drôlerie, le style et le baroquisme des situations servent, mais avec la grâce de l’accidentel, une parabole ajustée à nos temps de déconstruction : quand les mots et la grammaire de la communauté se délitent, retournent au limon genré, avertit Langue d’or (Gallimard, 21€), c’est la mort assurée du groupe, puisque la transmission des signes constitue la seule chance de perpétuer un destin collectif qui ne soit pas que violence. Dans le monde d’après, l’imparfait du subjonctif est devenu le contraire de l’inclusif, les auteurs d’antan des fauteurs de trouble.

Paolo Campiglio et Benoît Decron (dir.), Lucio Fontana, Un futuro c’è stato – Il y a bien eu un futur, Musée Soulages Rodez – Gallimard, 35€ / Frédéric Vitoux, de l’Académie française, L’Ami de mon père, préface de Frédéric Beigbeder, Points, 8,30€ / Marc Pautrel, Le seul fou, Allia, 8€. / Puisque Pierre Bonnard, cet été, est l’invité de Saint-Paul de Vence et de l’Hôtel de Caumont, concluons avec quelques mots sur l’exposition aixoise et sa publication fort utile, l’une et l’autre abritent trois des estampes nippones, femmes fluides et acteur de kabuki, que le « Nabi très japonard » (Fénéon, 1892) posséda. Les travaux fondateurs d’Ursula Peruchi-Petri, voilà un demi-siècle, ont involontairement poussé les commentateurs à faire du japonisme (le mot est de 1872) l’une des voies royales de la déréalisation symboliste. Or les « Japonneries », pour le dire comme Baudelaire en décembre 1861 – images qu’il jugeait « d’un grand effet », ont aussi conforté Bonnard dans son refus de rompre avec l’empirisme et de se plier au synthétisme abstrait : « c’était quelque chose de bien vivant, d’extrêmement savant », dit-il de l’ukiyo-e à la presse de 1943. Bonnard en affectionne « l’impression naïve » et le coup de crayon, le feuilletage spatial, proche de la perception vécue, et le cinétisme, comme le note Mathias Chivot. Quelques mois avant de disparaître, il étoffait sa collection de trois nouveaux achats, signe d’une vraie passion et d’un dialogue que seule la mort interrompt. Isabelle Cahn est parvenue à réunir, au-delà des œuvres attendues, un certain nombre de raretés, dont deux ou trois choses essentielles, et qui ont nourri le Picasso 1900. Une vraie leçon de peinture jusqu’aux œuvres visant, sujet et forme, Matisse. Je ne suis pas sûr que Bonnard ait pu visiter la fameuse exposition de l’Ecole des Beaux-Arts, La Gravure japonaise, en avril-mai 1890, une période militaire a dû l’en priver. Une petite erreur de légende enfin s’est glissée sous le paravent de la collection Marlene et Spencer Hays, trois feuilles orphelines de trois autres aujourd’hui non localisées, l’ensemble ayant été photographié vers 1902-1905, comme nous l’apprend le catalogue. SG / Isabelle Cahn (dir.), Bonnard et le Japon, In fine / Culturespaces, 32€, l’exposition se voit jusqu’au 6 octobre.