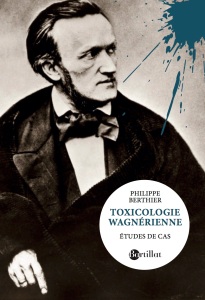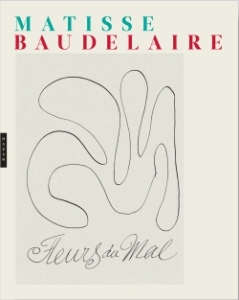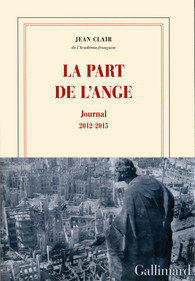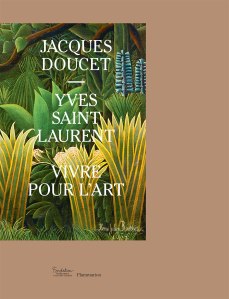A première vue, les années 1844-1847 n’ont pas marqué d’un éclat particulier notre vie théâtrale. Nul choc, hors des fureurs d’antan. Lors de la deuxième reprise d’Hernani, en mars 1845, le calme règne : «C’est maintenant une pièce classique», écrit Théophile Gautier, privé du chahut de ses vingt ans. 1843, au contraire, fait date : après l’échec tout relatif des Burgraves, Hugo renonce à écrire de nouveaux drames, et se contente d’encaisser le bénéfice des anciens ou de pousser quelques ingénues. Quant au succès tout relatif, lui aussi, de la médiocre Lucrèce de Ponsard, cette année-là, il continue à accréditer l’idée d’une agonie du romantisme en cette fin de la monarchie de Juillet, qui voit le jeune Baudelaire appeler à un sursaut. Mais «l’avènement du neuf», écrit-il en 1845, ne se fera pas au prix d’un iconoclasme aveugle ! Gautier, dont Baudelaire dévore le moindre article alors, développe une conception semblable de la modernité, une modernité inclusive, et non exclusive du romantisme, une modernité annonciatrice du Manet de L’Acteur tragique (ci-dessus). J’en veux pour preuve ses chroniques théâtrales, luxueusement et doctement éditées par les éditions Champion, dans le cadre des Œuvres complètes de l’écrivain. Les deux derniers volumes parus sont le meilleur démenti qui se puisse apporter au supposé «crépuscule du romantisme» et à la légendaire monotonie dont le règne désormais contesté de Louis-Philippe aurait été le moment. Ils vérifient, au contraire, la richesse oubliée de ces années de mutation. Coup d’œil et audace de pensée, Gautier reste le témoin unique de ce que la scène parisienne offrait de plus stimulant. Du feu roulant des salles de spectacle, qui vont de l’actuelle Comédie-Française aux Funambules, il tire un feu d’artifice. Que Jules Janin paraît terne et sournois en comparaison ! Tandis que le prince flétri du boulevard enregistre ses mauvaises aigreurs, Gautier brosse vivement la chose, autant qu’il la dissèque. Bonnes et exécrables pièces revivent sous sa verve, et la magie scénique, si rebelle à la plume, se répand à travers ces milliers de pages. La fougue de Théo ne mollit pas. C’est qu’il ne consent, ni ne concède, quoi qu’on en ait dit, malgré les facilités plus ou moins digestes de la production courante, vaudevilles, mélodrames, comédies trop bordées ou pire.
A première vue, les années 1844-1847 n’ont pas marqué d’un éclat particulier notre vie théâtrale. Nul choc, hors des fureurs d’antan. Lors de la deuxième reprise d’Hernani, en mars 1845, le calme règne : «C’est maintenant une pièce classique», écrit Théophile Gautier, privé du chahut de ses vingt ans. 1843, au contraire, fait date : après l’échec tout relatif des Burgraves, Hugo renonce à écrire de nouveaux drames, et se contente d’encaisser le bénéfice des anciens ou de pousser quelques ingénues. Quant au succès tout relatif, lui aussi, de la médiocre Lucrèce de Ponsard, cette année-là, il continue à accréditer l’idée d’une agonie du romantisme en cette fin de la monarchie de Juillet, qui voit le jeune Baudelaire appeler à un sursaut. Mais «l’avènement du neuf», écrit-il en 1845, ne se fera pas au prix d’un iconoclasme aveugle ! Gautier, dont Baudelaire dévore le moindre article alors, développe une conception semblable de la modernité, une modernité inclusive, et non exclusive du romantisme, une modernité annonciatrice du Manet de L’Acteur tragique (ci-dessus). J’en veux pour preuve ses chroniques théâtrales, luxueusement et doctement éditées par les éditions Champion, dans le cadre des Œuvres complètes de l’écrivain. Les deux derniers volumes parus sont le meilleur démenti qui se puisse apporter au supposé «crépuscule du romantisme» et à la légendaire monotonie dont le règne désormais contesté de Louis-Philippe aurait été le moment. Ils vérifient, au contraire, la richesse oubliée de ces années de mutation. Coup d’œil et audace de pensée, Gautier reste le témoin unique de ce que la scène parisienne offrait de plus stimulant. Du feu roulant des salles de spectacle, qui vont de l’actuelle Comédie-Française aux Funambules, il tire un feu d’artifice. Que Jules Janin paraît terne et sournois en comparaison ! Tandis que le prince flétri du boulevard enregistre ses mauvaises aigreurs, Gautier brosse vivement la chose, autant qu’il la dissèque. Bonnes et exécrables pièces revivent sous sa verve, et la magie scénique, si rebelle à la plume, se répand à travers ces milliers de pages. La fougue de Théo ne mollit pas. C’est qu’il ne consent, ni ne concède, quoi qu’on en ait dit, malgré les facilités plus ou moins digestes de la production courante, vaudevilles, mélodrames, comédies trop bordées ou pire.
 Son profond dégoût des tragédies contemporaines, caricatures bavardes et bâtardes de ce qu’elles prétendent continuer, aurait pu l’écarter du mouvement de faveur qui pousse le clan romantique à brandir le théâtre grec contre les faux émules de Corneille. Censé lui-même traduire L’Orestie d’Eschyle, et capable de la sentir brûler sous la glace des Burgraves, Gautier est fasciné par ces tentatives de restitution qui annoncent l’archéologisme du XXe siècle. L’Antigone de Meurice et Vacquerie, adaptée de Sophocle avec un soin filial, enchante autant le vieil Ingres que l’ancien Jeune-France. Idéalement, comme le dira Roland Barthes, il faut jouer les Grecs comme ils l’eussent fait eux-mêmes. Gautier en est convaincu qui soutient un Hippolyte Lucas, scrupuleux serviteur d’Aristophane et d’Euripide. Distinguer la «traduction» de la «réécriture» affadie, ce fut bien l’un des enjeux des années 1844-1847 et de la nouvelle flambée shakespearienne, la plus forte depuis les années 1820 et le pamphlet de Stendhal que l’on sait. La réapparition des acteurs anglais, de même, excite fortement la nostalgie du premier romantisme dont Baudelaire, plus que tous, forge le mythe. Pour Gautier, pareilles occasions de ferrailler avec les éteignoirs professionnels sont pain béni. Shakespeare n’a pas fini de symboliser ces «beautés choquantes» dont les Français ont horreur et dont Le Roi Lear et Hamlet abondent. Meurice, encore lui, et Alexandre Dumas donnent au second drame, en septembre 1846, une allure rêveuse et sanglante qui venge la pièce danoise des adaptations frileuses, tristement infidèles, que la France avait produites depuis la fin du XVIIIe siècle. Dumas, collectionneur de Delacroix, et Rouvière, principal interprète de la pièce et élève du peintre, s’étaient donc gardés de franciser le prince noir et son espèce de folie mortifère. Gautier y souscrit et rappelle qu’il a toujours préféré les traductions de Letourneur aux inutiles périphrases de Ducis. Passant des Nuées d’Aristophane au Roi Lear avec une aisance diabolique, incarnation née du drame moderne dont Manet fixera le souvenir à sa mort (ci-dessus), Rouvière imprime à tout le meilleur du romantisme 1830, un «sentiment pittoresque» qui fait tableau et donne la vie.
Son profond dégoût des tragédies contemporaines, caricatures bavardes et bâtardes de ce qu’elles prétendent continuer, aurait pu l’écarter du mouvement de faveur qui pousse le clan romantique à brandir le théâtre grec contre les faux émules de Corneille. Censé lui-même traduire L’Orestie d’Eschyle, et capable de la sentir brûler sous la glace des Burgraves, Gautier est fasciné par ces tentatives de restitution qui annoncent l’archéologisme du XXe siècle. L’Antigone de Meurice et Vacquerie, adaptée de Sophocle avec un soin filial, enchante autant le vieil Ingres que l’ancien Jeune-France. Idéalement, comme le dira Roland Barthes, il faut jouer les Grecs comme ils l’eussent fait eux-mêmes. Gautier en est convaincu qui soutient un Hippolyte Lucas, scrupuleux serviteur d’Aristophane et d’Euripide. Distinguer la «traduction» de la «réécriture» affadie, ce fut bien l’un des enjeux des années 1844-1847 et de la nouvelle flambée shakespearienne, la plus forte depuis les années 1820 et le pamphlet de Stendhal que l’on sait. La réapparition des acteurs anglais, de même, excite fortement la nostalgie du premier romantisme dont Baudelaire, plus que tous, forge le mythe. Pour Gautier, pareilles occasions de ferrailler avec les éteignoirs professionnels sont pain béni. Shakespeare n’a pas fini de symboliser ces «beautés choquantes» dont les Français ont horreur et dont Le Roi Lear et Hamlet abondent. Meurice, encore lui, et Alexandre Dumas donnent au second drame, en septembre 1846, une allure rêveuse et sanglante qui venge la pièce danoise des adaptations frileuses, tristement infidèles, que la France avait produites depuis la fin du XVIIIe siècle. Dumas, collectionneur de Delacroix, et Rouvière, principal interprète de la pièce et élève du peintre, s’étaient donc gardés de franciser le prince noir et son espèce de folie mortifère. Gautier y souscrit et rappelle qu’il a toujours préféré les traductions de Letourneur aux inutiles périphrases de Ducis. Passant des Nuées d’Aristophane au Roi Lear avec une aisance diabolique, incarnation née du drame moderne dont Manet fixera le souvenir à sa mort (ci-dessus), Rouvière imprime à tout le meilleur du romantisme 1830, un «sentiment pittoresque» qui fait tableau et donne la vie.
 L’acteur imprévisible appartenait à la famille des génies capables de transcender le plus atroce navet, à l’instar d’un Frédérick Lemaître ou d’une Rachel. Les chroniques théâtrales de 1844-1847 résonnent de la gloire de ces dieux de la rampe, ils en photographient surtout le jeu en termes précis. Sans le superbe feuilleton que Gautier consacre aux Chiffonniers de Paris, pièce abracadabrante et socialisante du singulier Félix Pyat, serions-nous capables de rapprocher le «sublime» Frédérick de certains poèmes urbains des Fleurs du Mal et des parias de Manet? D’un volume à l’autre, Rachel ne quitte jamais non plus l’attention du critique. Il avait pris sous son aile, dès décembre 1840, la protégée de Delphine de Girardin. La jeune Juive n’avait pas vingt ans (1). Une carrière fulgurante commençait. Cinq ans plus tard, bien que de santé très fragile, elle domine le Théâtre-Français et mène la vie dure à ses directeurs par ses prétentions financières, ses caprices et ses absences. Gautier ne pouvait nier «son implacable férocité tragique». Mais il avait compris que le succès de la nouvelle diva, seule apte à électriser Racine, Corneille et leurs épigones oubliés, réduirait la place des modernes sur les planches les plus prestigieuses de la capitale. Aussi l’enjoint-il à servir Hugo, Vigny, Dumas, ou l’aider à inscrire enfin Balzac et Musset au répertoire, d’autant que l’alexandrin convient mal au souffle court de Rachel et devient prose dans sa bouche aux contractions expressives. La sauvagerie d’autodidacte et l’altérité ethnique dont elle portait fièrement les signes, du reste, étaient loin de déplaire à Gautier. Les années 1844-1847 ne sont pas seulement celles où le poète voyageur se sera rendu en Algérie et intéressé aux portraits de «peaux rouges» de Catlin, proches du primitivisme d’un Fenimore Cooper, elles le confrontent à d’autres manifestations d’une énergie qu’on disait «populaire» par nostalgie des «sources vitales de l’inspiration», danseuses espagnoles, spectacles équestres, cirque ou pantomime. Dans son mémorable Portrait de l’artiste en saltimbanque, publié en 1970 par les soins de Gaëtan Picon et Skira, Jean Starobinski fut le premier à réévaluer les textes de Gautier, et notamment son fameux Shakespeare aux Funambules de 1842, après le Prévert des Enfants du Paradis. La mort de Deburau, génial Pierrot, aurait pu porter un coup fatal au genre, elle en accélère, au contraire, la renaissance avec l’aide des jeunes écrivains. Champfleury, l’ami de Baudelaire et Courbet, est l’un des plus actifs à pratiquer l’écriture du silence. L’auteur de Chien-Caillou et de Pierrot pendu peut compter, en 1847-1848, sur l’appui de Gautier, plus ouvert au «réalisme» qu’on ne le croit, et plus soucieux d’ouverture au présent. Gavarni, moderne absolu et autre invité du feuilleton théâtral, en scelle aussi le sens profond. Stéphane Guégan
L’acteur imprévisible appartenait à la famille des génies capables de transcender le plus atroce navet, à l’instar d’un Frédérick Lemaître ou d’une Rachel. Les chroniques théâtrales de 1844-1847 résonnent de la gloire de ces dieux de la rampe, ils en photographient surtout le jeu en termes précis. Sans le superbe feuilleton que Gautier consacre aux Chiffonniers de Paris, pièce abracadabrante et socialisante du singulier Félix Pyat, serions-nous capables de rapprocher le «sublime» Frédérick de certains poèmes urbains des Fleurs du Mal et des parias de Manet? D’un volume à l’autre, Rachel ne quitte jamais non plus l’attention du critique. Il avait pris sous son aile, dès décembre 1840, la protégée de Delphine de Girardin. La jeune Juive n’avait pas vingt ans (1). Une carrière fulgurante commençait. Cinq ans plus tard, bien que de santé très fragile, elle domine le Théâtre-Français et mène la vie dure à ses directeurs par ses prétentions financières, ses caprices et ses absences. Gautier ne pouvait nier «son implacable férocité tragique». Mais il avait compris que le succès de la nouvelle diva, seule apte à électriser Racine, Corneille et leurs épigones oubliés, réduirait la place des modernes sur les planches les plus prestigieuses de la capitale. Aussi l’enjoint-il à servir Hugo, Vigny, Dumas, ou l’aider à inscrire enfin Balzac et Musset au répertoire, d’autant que l’alexandrin convient mal au souffle court de Rachel et devient prose dans sa bouche aux contractions expressives. La sauvagerie d’autodidacte et l’altérité ethnique dont elle portait fièrement les signes, du reste, étaient loin de déplaire à Gautier. Les années 1844-1847 ne sont pas seulement celles où le poète voyageur se sera rendu en Algérie et intéressé aux portraits de «peaux rouges» de Catlin, proches du primitivisme d’un Fenimore Cooper, elles le confrontent à d’autres manifestations d’une énergie qu’on disait «populaire» par nostalgie des «sources vitales de l’inspiration», danseuses espagnoles, spectacles équestres, cirque ou pantomime. Dans son mémorable Portrait de l’artiste en saltimbanque, publié en 1970 par les soins de Gaëtan Picon et Skira, Jean Starobinski fut le premier à réévaluer les textes de Gautier, et notamment son fameux Shakespeare aux Funambules de 1842, après le Prévert des Enfants du Paradis. La mort de Deburau, génial Pierrot, aurait pu porter un coup fatal au genre, elle en accélère, au contraire, la renaissance avec l’aide des jeunes écrivains. Champfleury, l’ami de Baudelaire et Courbet, est l’un des plus actifs à pratiquer l’écriture du silence. L’auteur de Chien-Caillou et de Pierrot pendu peut compter, en 1847-1848, sur l’appui de Gautier, plus ouvert au «réalisme» qu’on ne le croit, et plus soucieux d’ouverture au présent. Gavarni, moderne absolu et autre invité du feuilleton théâtral, en scelle aussi le sens profond. Stéphane Guégan
(1) Une des tendances de l’historiographie actuelle, en matière de littérature ou de peinture, consiste à accuser le XIXe siècle d’antisémitisme à tout propos. Tendance aussi fâcheuse que peu soucieuse de nuance et de contextualisation. Pour avoir laissé entendre, en 1844, que le silence de son cher Rossini serait dû à «l’invasion des tribus israélites», Meyerbeer et Fromental Halévy en tête, Gautier n’échappe plus aux procès rétroactifs. On oublie, ce faisant, qu’il a constamment soutenu ces musiciens dans la mesure de leur talent, qu’il noua des liens très forts avec l’éditeur Michel Lévy et que la judéité de Rachel et de sa famille lui semblait, sur scène, le contraire d’un obstacle : «La tragédie grecque a été admirablement jouée par la famille juive», écrit-il au sujet de Phèdre en novembre 1846. En outre, il ne lui avait pas échappé que La Juive d’Halévy, paradoxe apparent, n’était pas étrangère à la vision voltairienne des fils de Juda enfermés dans leur foi. La Juive de Constantine, son propre drame algérien en 1846, montre que Gautier ne vise que l’intolérance communautaire quand il y a lieu de la mettre à nu.
*Théophile Gautier, Œuvres complètes. Section VI. Critique théâtrale. Tome V septembre 1844-1845, textes établis, présentés et annotés par Patrick Berthier avec la collaboration de Claudine Lacoste-Veysseyre, Honoré Champion, 140 €
*Théophile Gautier, Œuvres complètes. Section VI. Critique théâtrale. Tome VI. 1846-juin 1847, textes établis, présentés et annotés par Patrick Berthier avec la collaboration de François Brunet, Honoré Champion, 180 €.
 Vie parisienne (suite) // «Il connaît parfaitement les modes ; c’est lui qui les fait; – et ses personnages ont toujours la toilette qui convient.» En ce printemps 1845, au détour d’une de ses recensions théâtrales, Gautier désigne en Gavarni le crayon du jour, le moderne exclusif, celui qui traque le saillant sous ce quotidien, invisible parce que banal, que nous ne voyons pas ou plus. Gavarni expose nos yeux au bel aujourd’hui, pensent inséparablement Gautier et Baudelaire ; il ouvre aussi la voie à Manet, Degas, Tissot, trois des acteurs essentiels de la modernité des années 1860, trois peintres dont la recherche actuelle tend à préciser les liens avec les sphères de la mode et de la mondanité, autant de poupées emboîtables sous le Second Empire. L’excellent séminaire que Philippe Thiébaut anime à l’INHA autour de ces questions m’a récemment permis de revenir à James Tissot (1836-1902). Je le remercie également d’avoir rendu possible la consultation de cette revue essentielle que fut La Vie parisienne, dont même la bibliothèque nationale ne possède pas une série complète. En attendant l’occasion d’en dire plus, je voudrais faire un petit ajout et deux sérieux correctifs à ce que j’ai déjà pu écrire de Tissot dans le catalogue de L’Impressionniste et la mode (Paris, New York, Chicago, 2013) et ma petite synthèse de 2012 (Skira). Si le scrupule vestimentaire fascine dès les reconstitutions historiques qui firent connaître le peintre nantais vers 1860, petits tableaux bichonnés où passent le souvenir d’Holbein et l’ingrisme de sa formation, l’attrait de la mode, et son usage comme métaphore du Moderne, s’imposent à partir de 1864 et du Portrait de Mlle L.L. (Orsay). Depuis quatre ans, Tissot fréquente Degas, Whistler et s’intéresse à la peinture de Millais, autant d’artistes avec lesquels il partage un japonisme attesté et une certaine dilection pour Carpaccio et Bellini. Vie et noblesse, c’est ce que Degas et lui apprécient chez les maîtres d’un Quattrocento tourné vers la vie réelle.
Vie parisienne (suite) // «Il connaît parfaitement les modes ; c’est lui qui les fait; – et ses personnages ont toujours la toilette qui convient.» En ce printemps 1845, au détour d’une de ses recensions théâtrales, Gautier désigne en Gavarni le crayon du jour, le moderne exclusif, celui qui traque le saillant sous ce quotidien, invisible parce que banal, que nous ne voyons pas ou plus. Gavarni expose nos yeux au bel aujourd’hui, pensent inséparablement Gautier et Baudelaire ; il ouvre aussi la voie à Manet, Degas, Tissot, trois des acteurs essentiels de la modernité des années 1860, trois peintres dont la recherche actuelle tend à préciser les liens avec les sphères de la mode et de la mondanité, autant de poupées emboîtables sous le Second Empire. L’excellent séminaire que Philippe Thiébaut anime à l’INHA autour de ces questions m’a récemment permis de revenir à James Tissot (1836-1902). Je le remercie également d’avoir rendu possible la consultation de cette revue essentielle que fut La Vie parisienne, dont même la bibliothèque nationale ne possède pas une série complète. En attendant l’occasion d’en dire plus, je voudrais faire un petit ajout et deux sérieux correctifs à ce que j’ai déjà pu écrire de Tissot dans le catalogue de L’Impressionniste et la mode (Paris, New York, Chicago, 2013) et ma petite synthèse de 2012 (Skira). Si le scrupule vestimentaire fascine dès les reconstitutions historiques qui firent connaître le peintre nantais vers 1860, petits tableaux bichonnés où passent le souvenir d’Holbein et l’ingrisme de sa formation, l’attrait de la mode, et son usage comme métaphore du Moderne, s’imposent à partir de 1864 et du Portrait de Mlle L.L. (Orsay). Depuis quatre ans, Tissot fréquente Degas, Whistler et s’intéresse à la peinture de Millais, autant d’artistes avec lesquels il partage un japonisme attesté et une certaine dilection pour Carpaccio et Bellini. Vie et noblesse, c’est ce que Degas et lui apprécient chez les maîtres d’un Quattrocento tourné vers la vie réelle.
 Lors du Salon de 1866, qui vaut une médaille à Tissot, Gautier enregistre la double direction qu’a prise sa peinture : «M.Tissot imite tantôt Leys, tantôt Alfred Stevens, selon qu’il traite un sujet moyen âge ou un sujet moderne, et cependant il est bien lui-même et parfaitement reconnaissable sous ses deux aspects. […] Une femme à l’église ressemble à une vieille peinture de l’école allemande, et la Confession pourrait être gravée en vignette pour la Vie parisienne.» Homme des doubles postulations, comme le dirait Baudelaire (qui fut proche des frères Stevens), le désormais fashionable Tissot ne déparerait donc pas, au dire de Gautier, la presse de mode. La consultation de La Vie parisienne le confirme. Quelques mois avant le Salon de 1866, Tissot avait fait admirer son superbe Portrait du marquis et de la marquise de Miramon (ci-dessus) sur les murs du Cercle de l’Union artistique, 12 rue de Choiseul, «réunion de gens de monde et d’artistes qui ont toujours vécu en parfait accord», écrivait Gaston Jollivet en 1927 (1). En 2013, je citais l’entrefilet mitigé que Léon Lagrange, plume de la Gazette des Beaux-Arts, avait consacré au tableau d’Orsay. Mais La Vie parisienne lui fit bien meilleur accueil. La toile a certes des défauts aux yeux du scripteur anonyme, il préfère pourtant s’en tenir à ses «rares qualités»: «dans le style d’abord beaucoup d’élégance et de naïveté, et dans la coloration une harmonie grise d’une extrême douceur, sans que personnages ou accessoires manquent de vigueur. (2)» Tissot est des nôtres.
Lors du Salon de 1866, qui vaut une médaille à Tissot, Gautier enregistre la double direction qu’a prise sa peinture : «M.Tissot imite tantôt Leys, tantôt Alfred Stevens, selon qu’il traite un sujet moyen âge ou un sujet moderne, et cependant il est bien lui-même et parfaitement reconnaissable sous ses deux aspects. […] Une femme à l’église ressemble à une vieille peinture de l’école allemande, et la Confession pourrait être gravée en vignette pour la Vie parisienne.» Homme des doubles postulations, comme le dirait Baudelaire (qui fut proche des frères Stevens), le désormais fashionable Tissot ne déparerait donc pas, au dire de Gautier, la presse de mode. La consultation de La Vie parisienne le confirme. Quelques mois avant le Salon de 1866, Tissot avait fait admirer son superbe Portrait du marquis et de la marquise de Miramon (ci-dessus) sur les murs du Cercle de l’Union artistique, 12 rue de Choiseul, «réunion de gens de monde et d’artistes qui ont toujours vécu en parfait accord», écrivait Gaston Jollivet en 1927 (1). En 2013, je citais l’entrefilet mitigé que Léon Lagrange, plume de la Gazette des Beaux-Arts, avait consacré au tableau d’Orsay. Mais La Vie parisienne lui fit bien meilleur accueil. La toile a certes des défauts aux yeux du scripteur anonyme, il préfère pourtant s’en tenir à ses «rares qualités»: «dans le style d’abord beaucoup d’élégance et de naïveté, et dans la coloration une harmonie grise d’une extrême douceur, sans que personnages ou accessoires manquent de vigueur. (2)» Tissot est des nôtres.
 Le Cercle de l’Union artistique et son exposition de mars 1866 réservent d’autres surprises. En rouvrant La Vie parisienne, nous apprenons que Manet y accrocha ce qui semble bien être le magistral Portrait de jeune homme en majo (Met, New York), vedette du Salon des refusés. Sauf erreur, nous l’ignorions. «On dit que le grand Espagnol de M. Manet est le portrait de son frère, écrit La Vie parisienne. Il est librement posé et brossé. Pourquoi a-t-on refusé ce tableau, il y a deux ans, aux Champs-Elysées? Bon ou mauvais, il témoigne d’une aspiration vers la grande peinture, et c’est quelque chose aujourd’hui. (3)» Il est fort probable que, toujours conscient des attentes propres à chaque espace d’exposition, Manet ait choisi un tableau plein de dandysme hispanique bien fait pour plaire au Cercle de la rue de Choiseul, dont La Vie parisienne condense l’ethos et les goûts. Ce Cercle émancipé, à en juger par ses statuts, tenait le milieu entre le club mondain et la société d’émulation esthétique. Son comité d’administration associait le beau monde aux artistes, le vicomte de Ganay et le marquis du Lau à Fromentin et Gautier. Ce dernier préside la Commission de littérature, où siègent Fromentin, Charles Haas, le prince Alphonse de Polignac et, last but not least, le marquis de Miramon. Parmi les membres de la Commission de peinture et de sculpture, on retrouve Fromentin, Gautier, Haas, Ganay, le marquis de Lau, auxquels se joint le comte Albert de Balleroy, un proche de Manet… Se retissent ainsi des liens de sociabilité et de sensibilité mal connus et qui éclairent d’un jour neuf la commande du Cercle de la rue royale (Orsay), que Tissot peint en 1866-1867 et où devaient se regrouper autour de Miramon quelques-uns des noms précités. On ajoutera qu’Edmond de Polignac, figure éminente du portrait collectif et prince que Proust chérira, appartient aussi au Cercle de l’union artistique puisqu’il partage la vice-présidence de la Commission de musique avec Félicien David, un proche de Gautier… Quant à Haas, qu’on dit trop vite marginalisé par «antisémitisme» dans le tableau de Tissot, il avait été adoubé par La Vie parisienne, laquelle annonça en fanfare sa nomination aux fonctions d’inspecteur des Beaux-Arts en février 1870 (4). C’était, à plusieurs titres, gratifier le collectionneur (d’Holbein, notamment) et l’homme de réseaux actifs, entre art et banque : «Les relations intimes que M. Haas s’est toujours plu à entretenir avec presque tous les artistes modernes, sont d’ailleurs un sûr garant pour eux de trouver en lui la sympathie la plus éclairée. (5)» Très mêlées étaient les élites du Second Empire. SG
Le Cercle de l’Union artistique et son exposition de mars 1866 réservent d’autres surprises. En rouvrant La Vie parisienne, nous apprenons que Manet y accrocha ce qui semble bien être le magistral Portrait de jeune homme en majo (Met, New York), vedette du Salon des refusés. Sauf erreur, nous l’ignorions. «On dit que le grand Espagnol de M. Manet est le portrait de son frère, écrit La Vie parisienne. Il est librement posé et brossé. Pourquoi a-t-on refusé ce tableau, il y a deux ans, aux Champs-Elysées? Bon ou mauvais, il témoigne d’une aspiration vers la grande peinture, et c’est quelque chose aujourd’hui. (3)» Il est fort probable que, toujours conscient des attentes propres à chaque espace d’exposition, Manet ait choisi un tableau plein de dandysme hispanique bien fait pour plaire au Cercle de la rue de Choiseul, dont La Vie parisienne condense l’ethos et les goûts. Ce Cercle émancipé, à en juger par ses statuts, tenait le milieu entre le club mondain et la société d’émulation esthétique. Son comité d’administration associait le beau monde aux artistes, le vicomte de Ganay et le marquis du Lau à Fromentin et Gautier. Ce dernier préside la Commission de littérature, où siègent Fromentin, Charles Haas, le prince Alphonse de Polignac et, last but not least, le marquis de Miramon. Parmi les membres de la Commission de peinture et de sculpture, on retrouve Fromentin, Gautier, Haas, Ganay, le marquis de Lau, auxquels se joint le comte Albert de Balleroy, un proche de Manet… Se retissent ainsi des liens de sociabilité et de sensibilité mal connus et qui éclairent d’un jour neuf la commande du Cercle de la rue royale (Orsay), que Tissot peint en 1866-1867 et où devaient se regrouper autour de Miramon quelques-uns des noms précités. On ajoutera qu’Edmond de Polignac, figure éminente du portrait collectif et prince que Proust chérira, appartient aussi au Cercle de l’union artistique puisqu’il partage la vice-présidence de la Commission de musique avec Félicien David, un proche de Gautier… Quant à Haas, qu’on dit trop vite marginalisé par «antisémitisme» dans le tableau de Tissot, il avait été adoubé par La Vie parisienne, laquelle annonça en fanfare sa nomination aux fonctions d’inspecteur des Beaux-Arts en février 1870 (4). C’était, à plusieurs titres, gratifier le collectionneur (d’Holbein, notamment) et l’homme de réseaux actifs, entre art et banque : «Les relations intimes que M. Haas s’est toujours plu à entretenir avec presque tous les artistes modernes, sont d’ailleurs un sûr garant pour eux de trouver en lui la sympathie la plus éclairée. (5)» Très mêlées étaient les élites du Second Empire. SG
(1) Gaston Jollivet, Souvenirs de la vie de plaisir sous le Second Empire, Tallandier, 1927
(2) Anonyme, « Choses et autres », La Vie parisienne, 3 mars 1866, p. 124.
(3) Idem. L’auteur ajoute : « M. Manet embrasse d’un coup d’œil puissant l’ensemble d’un personnage, et c’est le seul peintre aujourd’hui qui ait aussi évidemment cette qualité ; de là vient que, sans être ce qu’on appelle un dessinateur, il attache bien des bras et des jambes à un corps ; de là vient que, sans être un grand peintre, il a des hardiesses d’exécution souvent heureuses. Poussé par son impression à peindre largement et du premier coup, il réussit dans les parties les plus simples, dans les vêtements, par exemple, où sa brosse a du champ ; il brille moins dans la facture des têtes, où pour dessiner et modeler par la simple juxtaposition des tons, il faut… il faut, ne vous déplaise, être M. Velazquez !… »
(4) Jean-Yves Tadié, dans son beau livre sur Proust et Freud (Le Lac inconnu, Gallimard, 2012), Jean-Paul et Raphaël Enthoven, dans leur Dictionnaire amoureux de Proust (Plon, 2013), sont catégoriques: Tissot n’a pas conféré à Charles Haas, modèle du Swann de La Recherche, un rang égal aux autres figures de la gentry parisienne qu’il fait parader, très chics, à l’étage noble de l’hôtel Coislin. Présent et «exclu» à la fois, le Juif Haas ferait tache parmi les Gentils et le peintre n’aurait exprimé que l’antisémitisme, la judéophobie à tout le moins, du milieu qu’il avait à peindre. On rappellera que la toile fit l’objet d’une commande collective, et que rien ne semble laisser penser que Charles Haas ait peiné à rejoindre le club de la rue Royale. Dans la toile d’Orsay, il porte seul les valeurs du vrai dandysme (Proust évoquera ses chapeaux de chez Delion) et anime toute la scène depuis la porte-fenêtre d’où il surgit, comme au théâtre… Le vrai Parisien, c’est lui.
(5) Anonyme, « Choses et autres », La Vie Parisienne, 5 février 1870, p. 113.

 Avec Charlus, les signes proustiens, chers à Deleuze, s’affolent. C’est le destin des mots et des apparences, dit aussi bien Berthier, lorsque les désirs ne peuvent s’afficher publiquement. Ils finiront, du reste, par crucifier Charlus, catholique pascalien ou baudelairien, quand le temps de la vieillesse et de la mort ouvrira celui des confessions ultimes. À la fois Prométhée enchaîné aux rochers de Jupien, et ruine christique, sous laquelle percent les fragments « d’une belle femme en sa jeunesse », le plus grand des Guermantes, le plus jouisseur des arts et de la vie, meurt toutefois, dit Proust, dans l’impuissance de ne pas avoir été un créateur de formes. Il ne fut qu’un « professeur de beauté », en somme, pour revenir à la fameuse formule que Proust appliquait à Robert de Montesquiou au milieu des années 1890, et que l’auteur de la Recherche, devenu le mentor de toute une jeunesse, fera sienne, vingt ans plus tard. Parmi ces jeunes gens qui enchantèrent et désolèrent son crépuscule, il y eut Pierre de Polignac, que Morand lui fit connaître au cours de l’été 17, loin des tranchées meurtrières auxquelles, à rebours de Bertrand de Fénelon, ils échappaient tous trois. La cristallisation amoureuse exigera un peu plus de temps que prévu, car Polignac déploie une froideur nobiliaire et un besoin de reconnaissance qui tranchent sur l’entourage aristocratique de l’écrivain, moins héraldique… Puis le courant passe, ce sera une brève éclaircie. Voilà que le « sweet prince », bien que « distant du beau sexe » (Jean Gallois), se fiance et, très vite, se marie, abandonne même « un des plus grands noms de France » pour celui de son épouse, fille reconnue des seigneurs de Monaco. La Recherche n’a-t-elle pas intégré à son spectre mondain ce type de mésalliances intéressées ?
Avec Charlus, les signes proustiens, chers à Deleuze, s’affolent. C’est le destin des mots et des apparences, dit aussi bien Berthier, lorsque les désirs ne peuvent s’afficher publiquement. Ils finiront, du reste, par crucifier Charlus, catholique pascalien ou baudelairien, quand le temps de la vieillesse et de la mort ouvrira celui des confessions ultimes. À la fois Prométhée enchaîné aux rochers de Jupien, et ruine christique, sous laquelle percent les fragments « d’une belle femme en sa jeunesse », le plus grand des Guermantes, le plus jouisseur des arts et de la vie, meurt toutefois, dit Proust, dans l’impuissance de ne pas avoir été un créateur de formes. Il ne fut qu’un « professeur de beauté », en somme, pour revenir à la fameuse formule que Proust appliquait à Robert de Montesquiou au milieu des années 1890, et que l’auteur de la Recherche, devenu le mentor de toute une jeunesse, fera sienne, vingt ans plus tard. Parmi ces jeunes gens qui enchantèrent et désolèrent son crépuscule, il y eut Pierre de Polignac, que Morand lui fit connaître au cours de l’été 17, loin des tranchées meurtrières auxquelles, à rebours de Bertrand de Fénelon, ils échappaient tous trois. La cristallisation amoureuse exigera un peu plus de temps que prévu, car Polignac déploie une froideur nobiliaire et un besoin de reconnaissance qui tranchent sur l’entourage aristocratique de l’écrivain, moins héraldique… Puis le courant passe, ce sera une brève éclaircie. Voilà que le « sweet prince », bien que « distant du beau sexe » (Jean Gallois), se fiance et, très vite, se marie, abandonne même « un des plus grands noms de France » pour celui de son épouse, fille reconnue des seigneurs de Monaco. La Recherche n’a-t-elle pas intégré à son spectre mondain ce type de mésalliances intéressées ? La rupture est consommée en octobre 1920. Le billet avec lequel le nouveau duc de Valentinois prend congé en aurait glacé de plus affranchis que Proust. Brillent et brûlent tout autrement les cinq lettres qu’il adressa à Polignac, diluviennes, sensibles et aussi digressives que l’écrivain, malade et bourré de barbituriques, put l’être à la fin de sa vie. À leur lecture, rendue possible par S.A.S le prince Albert II, on ressent à la fois le génie épistolaire du « vieux » Proust et l’espèce de détresse shakespearienne qui tinte la fin de la Recherche, notamment les dernières touches, plus Lautrec que Manet, de son inoubliable portrait de Charlus. Sodome et Gomorrhe s’achève dans l’expérience de sa propre déchéance et la folie possessive, chauffée à blanc, qu’il avait toujours mise à vampiriser son cercle chéri. Qui n’a connu autour de lui « l’épreuve de la trop grand amabilité », ce mélange de flatteries et de reproches, de tendresses et de rosseries, où la correspondance de Proust puise son sel? Il était capable des pires mensonges et manipulations pour mêler le roman à sa vie et la rendre respirable… On ne pourra plus prononcer ce mot désormais sans faire référence au beau livre de François-Bernard Michel, médecin de grand renom et écrivain de race. L’un de ses ouvrages les plus accomplis nous a édifiés sur la folie de Van Gogh et les compétences variables de ceux qui eurent à la soigner. Il lui a donné, en 2016, un pendant proustien, qui fascine davantage, tant Marcel, de la fameuse crise d’asthme de 1881 aux ultimes convulsions, s’est battu pour comprendre son mal, a fréquenté mille docteurs illustres, donné lui même des conseils supposés guérisseurs et fait de sa mystérieuse croix la chance de la littérature.
La rupture est consommée en octobre 1920. Le billet avec lequel le nouveau duc de Valentinois prend congé en aurait glacé de plus affranchis que Proust. Brillent et brûlent tout autrement les cinq lettres qu’il adressa à Polignac, diluviennes, sensibles et aussi digressives que l’écrivain, malade et bourré de barbituriques, put l’être à la fin de sa vie. À leur lecture, rendue possible par S.A.S le prince Albert II, on ressent à la fois le génie épistolaire du « vieux » Proust et l’espèce de détresse shakespearienne qui tinte la fin de la Recherche, notamment les dernières touches, plus Lautrec que Manet, de son inoubliable portrait de Charlus. Sodome et Gomorrhe s’achève dans l’expérience de sa propre déchéance et la folie possessive, chauffée à blanc, qu’il avait toujours mise à vampiriser son cercle chéri. Qui n’a connu autour de lui « l’épreuve de la trop grand amabilité », ce mélange de flatteries et de reproches, de tendresses et de rosseries, où la correspondance de Proust puise son sel? Il était capable des pires mensonges et manipulations pour mêler le roman à sa vie et la rendre respirable… On ne pourra plus prononcer ce mot désormais sans faire référence au beau livre de François-Bernard Michel, médecin de grand renom et écrivain de race. L’un de ses ouvrages les plus accomplis nous a édifiés sur la folie de Van Gogh et les compétences variables de ceux qui eurent à la soigner. Il lui a donné, en 2016, un pendant proustien, qui fascine davantage, tant Marcel, de la fameuse crise d’asthme de 1881 aux ultimes convulsions, s’est battu pour comprendre son mal, a fréquenté mille docteurs illustres, donné lui même des conseils supposés guérisseurs et fait de sa mystérieuse croix la chance de la littérature. François-Bernard Michel, après Jean-Yves Tadié et avec le savoir professionnel qui est le sien, ouvre les portes à l’arrière-plan médical de l’écrivain et de la Recherche, il décrit les cinq moments qui en marquent l’évolution parallèle. Au jeune Proust et à ses insuffisances pectorales, qu’ils croyaient pouvoir rattacher à l’emprise des névroses ou d’une sexualité déviante, les professeurs de la Belle Époque n’avaient pas grand chose à proposer. D’autres, plus tard, admettront mieux la souche physiologique du mal. Mais, alors, c’est Proust, devenu freudien avant l’heure, qui comprendra combien son souffle court avait conditionné sa psyché et son génie. Le Professeur Marcel Proust est dédié à Roger Grenier dont vient de paraître la correspondance qu’il échangea avec Brassaï entre 1950 et 1983. À maints égards, leur dialogue intéresse, émeut et touche à l’essentiel. Il éclaire surtout le primat du littéraire et du pictural chez un photographe qui n’est venu au nouveau médium, à la fin des années 20, qu’au hasard de voies détournées. On aimerait parfois que les spécialistes de la photographie aient la tête aussi lettrée que ceux dont il parlent en ignorant leur vraie culture. Ce n’est pas le cas de Grenier, qui l’a déjà prouvé, et dont l’avant-propos peint ici son vieil ami en multipliant les focales, les raccourcis temporels et quelques anecdotes lumineuses… Henri Miller mis à part, deux géants reviennent au fil des lettres et cartes postales, Picasso et Proust firent, certes, un bon bout de chemin avec Brassaï. Quiconque a lu ses Conversations avec Picasso (1964) sait qu’il reste le meilleur livre jamais écrit sur le sujet avec ceux de John Richardson. L’autre chef-d’œuvre, c’est le livre sur Proust, aussi testamentaire que le Balzac de Zweig. L’étude est pionnière à plus d’un titre. Comme certains peintres qu’il a aimés, dit Brassaï, Proust laisse la photographie l’envahir, choc et latences, fragmente le récit et l’approche de ses personnages, redéfinit l’espace et le temps, jusqu’à friser le voyeurisme du roman-photo, sorte de monstre générique où le dieu de la Recherche eût peut-être accepté de se reconnaître. Stéphane Guégan
François-Bernard Michel, après Jean-Yves Tadié et avec le savoir professionnel qui est le sien, ouvre les portes à l’arrière-plan médical de l’écrivain et de la Recherche, il décrit les cinq moments qui en marquent l’évolution parallèle. Au jeune Proust et à ses insuffisances pectorales, qu’ils croyaient pouvoir rattacher à l’emprise des névroses ou d’une sexualité déviante, les professeurs de la Belle Époque n’avaient pas grand chose à proposer. D’autres, plus tard, admettront mieux la souche physiologique du mal. Mais, alors, c’est Proust, devenu freudien avant l’heure, qui comprendra combien son souffle court avait conditionné sa psyché et son génie. Le Professeur Marcel Proust est dédié à Roger Grenier dont vient de paraître la correspondance qu’il échangea avec Brassaï entre 1950 et 1983. À maints égards, leur dialogue intéresse, émeut et touche à l’essentiel. Il éclaire surtout le primat du littéraire et du pictural chez un photographe qui n’est venu au nouveau médium, à la fin des années 20, qu’au hasard de voies détournées. On aimerait parfois que les spécialistes de la photographie aient la tête aussi lettrée que ceux dont il parlent en ignorant leur vraie culture. Ce n’est pas le cas de Grenier, qui l’a déjà prouvé, et dont l’avant-propos peint ici son vieil ami en multipliant les focales, les raccourcis temporels et quelques anecdotes lumineuses… Henri Miller mis à part, deux géants reviennent au fil des lettres et cartes postales, Picasso et Proust firent, certes, un bon bout de chemin avec Brassaï. Quiconque a lu ses Conversations avec Picasso (1964) sait qu’il reste le meilleur livre jamais écrit sur le sujet avec ceux de John Richardson. L’autre chef-d’œuvre, c’est le livre sur Proust, aussi testamentaire que le Balzac de Zweig. L’étude est pionnière à plus d’un titre. Comme certains peintres qu’il a aimés, dit Brassaï, Proust laisse la photographie l’envahir, choc et latences, fragmente le récit et l’approche de ses personnages, redéfinit l’espace et le temps, jusqu’à friser le voyeurisme du roman-photo, sorte de monstre générique où le dieu de la Recherche eût peut-être accepté de se reconnaître. Stéphane Guégan