
Baudelaire aurait jugé puérile la tentative des surréalistes visant à faire de l’art le moyen d’éradiquer les contradictions du réel et de l’expérience que nous en faisons. Passer du poète des Fleurs du Mal à ces cadets qui ne l’aimaient guère, c’est passer d’un « cerveau catholique », fort de ses conflits, fier de sa morale propre, à un unanimisme de rêve, c’est-à-dire aux chimères délivrées des imperfections de l’ici-bas. Théodore de Banville ne dit rien d’autre lorsqu’il parla, le 2 septembre 1867, sur les restes de son ami, avec sa justesse coutumière. A Baudelaire qu’il pleure, il attribue une « œuvre essentiellement française », le contraire donc des phraseurs creux et des rhéteurs trop lisses. Comme Balzac, Daumier et Delacroix, précise Banville en oubliant Manet, il « accepta tout l’homme moderne ». Cette modernité-là, si elle désignait le siècle qui s’était fermé les cieux, englobait un moment plus large de notre culture, puisque ce discours d’adieu fait « remonter » la poétique chrétienne de Baudelaire aux guerres de religion. Agrippa d’Aubigné avait été son frère d’armes, plus que Hugo et Lamartine, lus plus qu’élus. Ces mots, ces rapprochements si perspicaces de Banville n’ont pas été écartés de ses Œuvres complètes, ils sont dignes de la préface que Gautier donna à la troisième édition des Fleurs du Mal afin d’innocenter leur auteur du satanisme athée qui lui fut reproché avant et après sa mort. Banville et Gautier ont largement mérité de figurer parmi les voix dont Baudelaire et ses autres a fait son miel. L’idée de ce collectif revient à Patrick Labarthe, grand baudelairien s’il en est, et profond connaisseur des langages qui se télescopent sous l’apparente harmonie de l’œuvre. Qui d’autre que Baudelaire, pour paraphraser Claudel, se plut autant à la cohabitation des classiques (Bossuet ou Racine) et de ce qui en semblait l’antithèse, de Pétrus Borel au journalisme boulevardier, d’Edgar Poe à l’idiome des peintres ou des chiffonniers ? Les alliages hétérogènes et les alliances dissonantes eurent sa bénédiction, il fallait frapper les esprits au lieu de les conforter et les endormir, réveiller les consciences plutôt que de les dédouaner de leur part de responsabilité dans la léthargie générale. Pour mieux saisir de quoi était faite cette éthique de la discordance, pour la suivre de ses sources aux traces qu’elle a laissées chez des écrivains de tout bord, Labarthe a réuni une vingtaine de contributeurs aux spécialités, perspectives et horizons aussi divers que leur objet. Sur le versant des lectures baudelairiennes, Villon et Pascal font l’objet de réexamens, quand Barbey, Huysmans, Valéry ou Drieu, sur le versant des lecteurs, nous aident à serrer notre Dante, qu’on a décrété, et Georges Blin le premier, un peu vite indocile à la rédemption. Ces autres qui l’éclairent à leur tour, ce peut être encore telle ou telle pratique du monde des lettres, comme l’éreintage forcé, et des arts, comme les joutes du Salon. La pensée, en bonne littérature, doit naître de la sensation pour conserver son étincelle de vie et sa marge d’ambivalence, ce volume, pour s’y tenir, ne trahit jamais le poète.

Le Spleen de Paris confirme son hégémonie actuelle, un peu surfaite, auprès des baudelariens en occupant presque entièrement la troisième partie du volume Labarthe. La dépendance des poèmes en prose envers la presse de grand tirage, notamment celle du fait divers, leur dette envers Sainte-Beuve (celui de Joseph Delorme) ou Hoffmann, sont discutés autant que l’obsession jouissive et douloureuse du transitoire. A cet égard, certains commentateurs du Spleen me semblent un peu oublieux du programme annoncé par le poète lui-même, notamment de « la morale désagréable » qui doit s’en dégager au gré des observations du flâneur. La raillerie, dit Baudelaire à Jules Troubat en 1866, autant que le détail réaliste et grinçant, se veut la vertu première de cette tentative de poésie nouvelle, débarrassée du vers et de sa pureté, vouée aux misères et aux rares bonheurs que réserve la vie moderne. Adepte de la sociocritique et de la sociologie littéraire, Jean-Michel Gouvard s’est proposé de revaloriser le contexte des années 1857-1867 dans son analyse de ce corpus inachevé, et de ses thèmes permanents. Si certains relèvent bien du sociétal (pauvreté, vieillesse, veuvage, prostitution), d’autres sont de nature existentielle (ennui, résignation, aspiration à un autre monde), et aussi familiers aux lecteurs des Fleurs du Mal dont le Spleen fut le pendant rieur et railleur. Les illusions du politique en dressent l’arrière-plan, bien que Gouvard stigmatise les apories du Second Empire, décrit comme impérialiste en tout, plus que ce Baudelaire nomme les « élucubrations de tous ces entrepreneurs de bonheur public ». Assommons les pauvres !, est-ce un pamphlet nourri de Proudhon, selon Gouvard, ou le contraire ? Que Baudelaire peigne et critique le monde moderne d’un même mouvement, c’est l’évidence. Que le lyrisme traditionnel de la poésie y vire à la désublimation, on ne saurait le contester. Mais Gouvard ne réduit pas le Spleen à une esthétique du constat, fût-elle acide, dans le sillage avoué de Goya et Poe, il lit en Baudelaire la volonté persistante de contester l’ordre établi et la loi d’airain de l’économie, position que 1848 et le référendum de 1851 n’auraient pas douchée. Ne se payant pas de mots, le présent ouvrage collecte un flot d’informations, voire d’images et de caricatures, relatives au temps du « dictateur » Napoléon III, autant d’indices supposés de la portée subversive des instantanés baudelairiens. Il faut admettre que le lecteur est parfois ébranlé par cet apport documentaire passionnant, mais qui ne suffit pas toujours à le désarmer, ainsi quand L’Etranger, cette figure du déclassement idéologique et de la résistance chrétienne, est rapproché des travailleurs immigrés que le Paris d’Haussmann aspire alors. Gouvard décèle partout des allégories de la condition du poète indocile, devenu indésirable en régime autoritaire. Mais Le Vieux saltimbanque, comme Baudelaire l’énonce nettement, personnifie « l’homme de lettres qui a survécu à sa génération dont il fut le brillant amuseur », symbolise donc cette mort qui double l’autre et effraie le poète, non moins que la liesse d’un public impitoyable. Les avertissements de Baudelaire, du reste, émaillent le Spleen ; et les multiples occurrences de l’enfant, dont la perversité native transcende les classes sociales, sont porteuses de métaphysique, cette morale désagréable, qui donne leur grandeur à ces petits poèmes.

De toutes les trouvailles dont fourmille ou fait état le livre d’Amaury Chardeau sur Caillebotte, son lointain parent, la plus éminente, à mes yeux, concerne Baudelaire. Nous savons maintenant que le jeune Gustave, alors que le Second Empire connaissait son dernier éclat, eut entre les mains quelques-uns des sept volumes formant les Œuvres complètes (posthumes) de l’écrivain mort en 1867, deux volumes des traductions de Poe et le volume de L’Art romantique. Ce dernier abritait, comme on sait, deux textes décisifs sur Delacroix et, non moins crucial, Le Peintre de la vie moderne. J’aurais tant aimé disposer de cette information quand s’écrivait ma monographie (Hazan, 2021), laquelle s’ouvre par un double parallélisme. L’un touche justement à Baudelaire dont je proposais de rapprocher les grandes compositions urbaines du peintre, construites comme autant de théâtres improvisés, propices à l’aléatoire des rencontres et l’imprévisibilité des perceptions. L’un des poèmes en prose les mieux venus, Les Foules, leur fournit peut-être la meilleure exégèse : « Le poëte jouit de cet incomparable privilège, qu’il peut à sa guise être lui-même et autrui. […] Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. » L’autre parallélisme concerne Flaubert, dont Caillebotte parle à Monet avec enthousiasme et réserve. D’un côté, l’auteur de Bovary incarne le réalisme comme le peintre l’entend, pur de toute sentimentalité et trompeusement impersonnel, afin de donner à l’effet de réel une force imprescriptible, et irréductible au regard des récits transparents. La réserve, révélatrice de la philosophie que le peintre a toujours pratiquée, vise la surenchère flaubertienne dans le désenchantement, le dégoût de tout. Car, comme le souligne Chardeau, après avoir utilement sondé les résultats scolaires (« esprit fin, juste, plein d’émulation ») et les états de service de Gustave en 1870-1871, nous avons bien à faire à une âme vaillante. Cette nature d’entrepreneur (les expositions impressionnistes lui doivent tant), de collectionneur (Orsay lui doit tout), ce chantre du geste sûr, de l’effort sportif, de l’hygiène corporelle, accorde très tôt sa ferveur positive à une imagerie unique, qui ne sépare jamais, quoi qu’en en dise, le privé du collectif. On ajoutera que le livre de Chardeau, d’une verve souvent drôle, croule sous les photographies inédites, les renseignements de toute nature et les fines analyses de l’œuvre. Je ne le suivrais pas en tout, mais cela ne diminue en rien la valeur de son ouvrage serré, qui dote d’un relief neuf certains membres de la famille : Martial, le père hyperactif, dont il a retrouvé le portrait par Béraud, et étudié la bibliothèque (Racine, Rabelais, Voltaire, la Revue des deux mondes, Walter Scott, Fenimore Cooper) ; ou René, le plus beau des trois frères, le plus coureur de jupons, le plus dispendieux, le plus tête-brûlée, avant de nous tourner le dos dans le tableau du Getty, car privé d’un destin d’artiste. Le soin d’enquêteur que Chardeau met à rétablir l’identité et la personnalité de Charlotte Berthier, la dernière maîtresse de Gustave, invisibilisée par sa belle-soeur mais chantée par Jean Renoir, mérite enfin d’être salué, d’autant plus que les féministes anglo-saxonnes se préoccupent moins d’elle, que de la libido clivée, dit-on, du peintre. Stéphane Guégan

Amaury Chardeau, Caillebotte. La peinture est un jeu sérieux, Norma Editions, 32€ / Patrick Labarthe (dir.), Baudelaire et ses autres, Droz, 36,90€ / Jean-Michel Gouvard, L’Apocalypse Baudelaire, Classiques Garnier, 45€ / Baudelaire, Les Fleurs du Mal, édition de Jacques Dupont et préface de Fabrice Luchini, GF, 9€. Diseur de Baudelaire, lecteur de Baudelaire, ce dernier en a fait, dit-il, son recueillement. Et comme la mémoire ne lui manque pas, ni la touche du peintre, il nous livre le souvenir de Michel Houellebecq susurrant : « Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. /Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici : »

Gustave Caillebotte mis à nu, de Raboteurs à Homme au bain / France Culture / Répliques d’Alain Finkielkraut / Peindre les hommes / avec Dominique Bona et Stéphane Guégan, samedi 16 novembre 2024
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/repliques/peindre-les-hommes-4184286
DEUX LECTURES

Il n’est pas un jour où l’actualité, du recul général de la civilisation au recul du français chez nos collégiens, ne vérifie la justesse d’Hannah Arendt, nous dit Bérénice Levet, experte de sa pensée et de la place qu’y trouve la réflexion esthétique, tellement éclairante quant à ce monde menacé par les progrès de toutes sortes. En lisant Arendt, le souvenir du Baudelaire de 1855, accablant de son ironie l’Exposition universelle, nous vient souvent à l’esprit. Pourquoi ne pas imaginer que Walter Benjamin, l’un de ses frères en philosophie, l’ait conduite au plus conséquent, car au plus chrétien, des antimodernes ? « Le christianisme a bien connu l’homme », résumait Pascal ; Bérénice Levet nous le refait entendre à l’appui d’un des arguments majeurs de son essai. Le sacré, quelque explication qu’on lui donne, ne saurait être congédié sans contribuer à la déshumanisation galopante de nos sociétés et de nos existences. Arendt décida d’étudier très tôt la théologie. Pour une Juive allemande, d’autres choix, et d’autres sujets de thèse que Saint Augustin, auraient pu ou dû s’imposer. Mais penser la religion, penser l’enseignement du Christ, en dehors même de la possibilité de la foi, c’était s’armer, avant Hitler, avant la Bombe, avant les bébés éprouvettes, avant la déresponsabilisation du Mal, contre les fléaux d’une modernité déjà grisée de soi. Nous payons chaque jour le prix fort de l’atomisation et de l’instabilité des démocraties en proie aux maux que l’on sait. La souveraineté du moi, le triomphe de l’individu sans attaches ni devoirs, de l’humain délié du monde et du passé, n’en est pas le moindre. Or, Arendt, nourrie des Grecs et de la Bible, entraînée par la phénoménologie de sa jeunesse, refuse d’entériner les logiques séparatistes, soit le divorce des hommes et du monde, des hommes et du politique, ou, mieux, du conservatisme et du progressisme. La terre, la langue, la culture, l’histoire, les croyances éprouvées par le temps, ce sont les véhicules, prêts à se réveiller, d’une transcendance aussi utile que l’air que nous respirons ou que l’art que nous défendons. SG / Bérénice Levet, Penser ce qui nous arrive avec Hannah Arendt, Éditions de L’Observatoire, 2024, 21€.
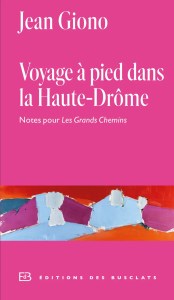
Imprévisibles sont les détours du miracle. Un inédit du grand Giono, mentionné par son Journal, mais perdu de vue, nous revient. On comprend pourquoi aujourd’hui ; il croupissait aux Archives nationales avec le reste des cartons de la Section spéciale de la cour d’appel. Sous Vichy, elle s’occupait des communistes que la rupture du pacte Molotov-Ribbentrop et les attentats contre l’Occupant soumettaient à une traque incessante de la part du nouveau régime. Sans avoir jamais été stalinien à la mode 1932-36, Giono s’était laissé embobiner au temps de l’AEAR et des entourloupettes d’Aragon. L’idéologie est donc étrangère à son ralliement prudent ; les charniers de 14-18 qu’il a vus de plus près que d’autres lui étaient restés sur l’estomac. Plus jamais ça, c’est sa ligne de conduite, voire d’inconduite. En mars-avril 1941, soupçonné d’action clandestine de « nature à nuire à l’intérêt national », Giono est interrogé à plusieurs reprises. Lente instruction, jusqu’au non-lieu prononcé le 20 novembre. Le 13, en effet, ses arguments avaient convaincu ; Giono rappela son rejet de toute accointance avec le PCF entre la guerre d’Espagne et la drôle de guerre (son pacifisme lui avait d’ailleurs valu d’être emprisonné en septembre 1939). Lors de l’interrogatoire du 13, il réitère son soutien à la Révolution nationale, synonyme, à ses yeux, d’une politique de la Terre en réaction au technicisme et à l’internationalisation du capitalisme. Enjoint à justifier de son emploi du temps au cours de l’été 1939, il confie à ses juges le journal de la semaine qu’il avait passée sur les routes secondaires de la Haute-Drôme, du 20 au 27 juillet, en ces mois de veille d’armes. Ces pages magnifiques, pour employer un mot que Giono réservait aux révélations de la route ou de la table, possèdent la fraîcheur de croquis oubliés près de 90 ans à l’abri du jour. La solitude du marcheur lui fait éprouver la « vie de tout », et opter pour la note, concentré d’odeurs ici, de couleurs là. Les Grands chemins sont en marche. / Jean Giono, Voyage à pied dans la Haute-Drôme, édition présentée et annotée par Antoine Crovella (disciple d’Alya Aglan), Éditions des Busclats, 2024, 15€).
















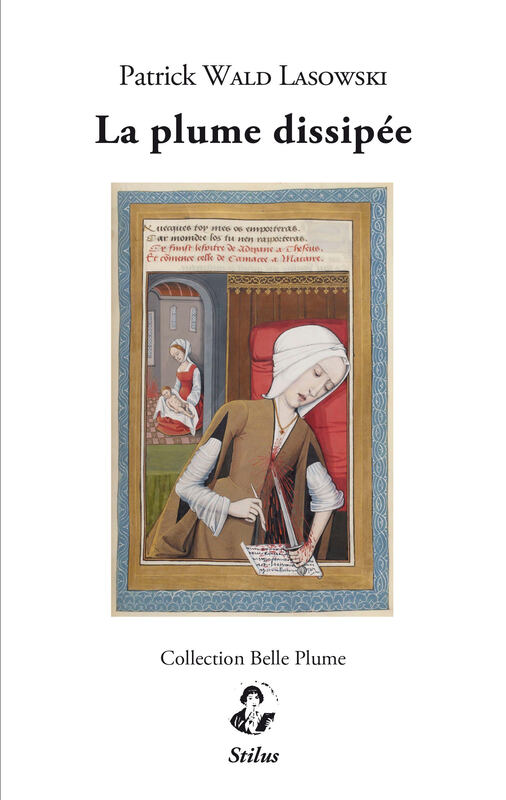
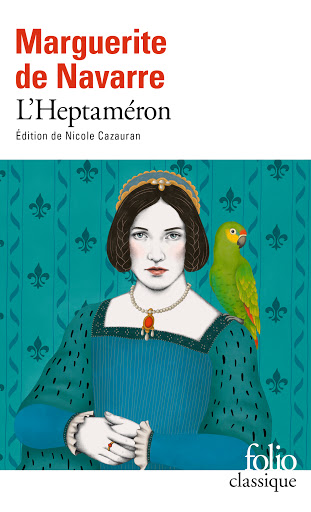








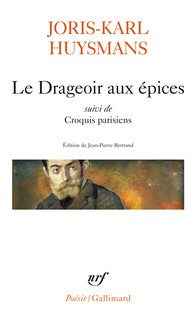








 La littérature abonde sur l’érotisme de Bataille. Bien que le sujet ait perdu l’attrait de l’interdit, il continue à susciter réflexions et contorsions plus ou moins inspirées. Le thème n’est-il pas consubstantiel à son auteur, à sa pensée, être et esthétique, des premiers contes licencieux au livre final sur
La littérature abonde sur l’érotisme de Bataille. Bien que le sujet ait perdu l’attrait de l’interdit, il continue à susciter réflexions et contorsions plus ou moins inspirées. Le thème n’est-il pas consubstantiel à son auteur, à sa pensée, être et esthétique, des premiers contes licencieux au livre final sur  Ce tournant structure le bel essai de Juliette Feyel, qui ne craint pas de s’aventurer sur un terrain surinvesti. Elle le fait avec un grand calme et une érudition maîtrisée, sans héroïser Bataille, ni le dédouaner de ses concepts les plus faibles, les plus éculés aujourd’hui, la sortie du rationnel, la dépense gratuite et l’animalité retrouvée. Feyel prend même plaisir à explorer ces failles afin d’étayer la thèse du livre : les récits les plus lubriques de Bataille, ceux qu’il ne put faire paraître sous son nom, constituent encore la «part maudite» de l’œuvre. Mais ce serait celle où l’auteur de L’Histoire de l’œil se serait «approché au plus près» de son objet et de sa subversion agissante. Si l’ethnologie a souvent coloré ses textes théoriques d’un primitivisme douteux, arqué sur l’opposition convenue entre le civilisé et le sauvage, les grands mystiques ont révélé Bataille à lui-même autant que
Ce tournant structure le bel essai de Juliette Feyel, qui ne craint pas de s’aventurer sur un terrain surinvesti. Elle le fait avec un grand calme et une érudition maîtrisée, sans héroïser Bataille, ni le dédouaner de ses concepts les plus faibles, les plus éculés aujourd’hui, la sortie du rationnel, la dépense gratuite et l’animalité retrouvée. Feyel prend même plaisir à explorer ces failles afin d’étayer la thèse du livre : les récits les plus lubriques de Bataille, ceux qu’il ne put faire paraître sous son nom, constituent encore la «part maudite» de l’œuvre. Mais ce serait celle où l’auteur de L’Histoire de l’œil se serait «approché au plus près» de son objet et de sa subversion agissante. Si l’ethnologie a souvent coloré ses textes théoriques d’un primitivisme douteux, arqué sur l’opposition convenue entre le civilisé et le sauvage, les grands mystiques ont révélé Bataille à lui-même autant que  La réflexion sur la peinture restant aux marges de cet essai, rappelons ici que Manet, et notamment Olympia, aura offert à l’ontologie paradoxale de Bataille une manière d’épiphanie. Le chef-d’œuvre de l’art français ouvre ses lourds rideaux sur la pure présence : «C’est la majesté retrouvée dans la suppression de ses atours. C’est la majesté de n’importe qui, et déjà de n’importe quoi… – qui appartient, sans plus de cause, à ce qui est, et que révèle la force de la peinture.» On retrouvera Manet, Picasso, Masson et quelques autres peintres de son musée imaginaire dans mon livre, Cent peintures qui font débat (Hazan, 39€).
La réflexion sur la peinture restant aux marges de cet essai, rappelons ici que Manet, et notamment Olympia, aura offert à l’ontologie paradoxale de Bataille une manière d’épiphanie. Le chef-d’œuvre de l’art français ouvre ses lourds rideaux sur la pure présence : «C’est la majesté retrouvée dans la suppression de ses atours. C’est la majesté de n’importe qui, et déjà de n’importe quoi… – qui appartient, sans plus de cause, à ce qui est, et que révèle la force de la peinture.» On retrouvera Manet, Picasso, Masson et quelques autres peintres de son musée imaginaire dans mon livre, Cent peintures qui font débat (Hazan, 39€). Ce fut d’abord une rumeur, alimentée par le premier intéressé : Yann Moix allait accoucher d’un livre de poids. En d’autres temps, on aurait parlé d’un livre de prix… C’est que le bébé avait eu le temps de s’arrondir in utero. Maintenant qu’il respire et fait ses premières nuits, le dernier né de Moix embarrasse autant la gent littéraire que le héros de Naissance consterne papa et maman. S’agit-il, en effet, d’un gros livre ou d’un grand livre ? Difficile à dire tant il alterne le meilleur et de sacrés tunnels, retient et refroidit, fait rire et fait peur. On n’est peut-être pas forcé de le lire en entier, ou d’une traite, comme me le souffle une amie à qui rien ne fait peur. Moix, éternel moderne, aurait-il ajusté au papier les nouvelles pratiques du net, où l’on butine au hasard en ajoutant benoitement au panier ses glanes aléatoires ? Il y a fort à parier pourtant que ce flot ininterrompu de mots, et de bons mots très souvent, et même de vraie littérature, affronte secrètement de plus grandes ombres que la lobotomie mémorielle de la toile. Moix ne répète-t-il ici et là que le roman du siècle dernier s’est joué entre Proust et
Ce fut d’abord une rumeur, alimentée par le premier intéressé : Yann Moix allait accoucher d’un livre de poids. En d’autres temps, on aurait parlé d’un livre de prix… C’est que le bébé avait eu le temps de s’arrondir in utero. Maintenant qu’il respire et fait ses premières nuits, le dernier né de Moix embarrasse autant la gent littéraire que le héros de Naissance consterne papa et maman. S’agit-il, en effet, d’un gros livre ou d’un grand livre ? Difficile à dire tant il alterne le meilleur et de sacrés tunnels, retient et refroidit, fait rire et fait peur. On n’est peut-être pas forcé de le lire en entier, ou d’une traite, comme me le souffle une amie à qui rien ne fait peur. Moix, éternel moderne, aurait-il ajusté au papier les nouvelles pratiques du net, où l’on butine au hasard en ajoutant benoitement au panier ses glanes aléatoires ? Il y a fort à parier pourtant que ce flot ininterrompu de mots, et de bons mots très souvent, et même de vraie littérature, affronte secrètement de plus grandes ombres que la lobotomie mémorielle de la toile. Moix ne répète-t-il ici et là que le roman du siècle dernier s’est joué entre Proust et