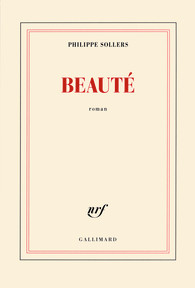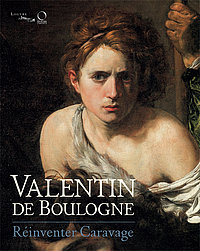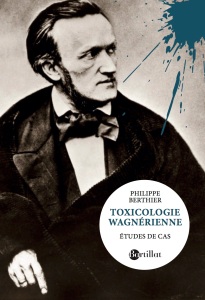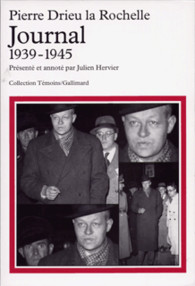Maintenant que sa mémoire est harcelée par les tenants des cultural et/ou gender studies, Clement Greenberg (1909-1994) m’est devenu éminemment sympathique. L’ancien pape du modernisme, le chantre indiscuté de l’expressionnisme abstrait, le mentor de Jackson Pollock et de David Smith, sert désormais de repoussoir à la nouvelle doxa. Outre l’élitisme que Greenberg a toujours revendiqué par mépris de la « culture de masse » et du « kitch » (dont la dernière FIAC donna l’effarant spectacle), il lui est surtout fait grief d’avoir incarné une démarche « occidentalo-phallocentrée », combattu le penchant des années 1960 pour les formes hybrides et poussé son anti-stalinisme jusqu’à servir le maccarthysme. On lui reproche même d’avoir été un mauvais Juif pour n’avoir ni soutenu la cause sioniste, ni applaudi au pittoresque de Chagall, ni souligné la judéité des artistes de son cercle, de Barnett Newman à Rothko. Bref, il est devenu, vingt ans après sa mort, l’homme de toutes les tares qui servent de morale négative à notre sinistre époque. Comme il serait trop long de les examiner une à une, je m’en tiendrai à quelques remarques de bon sens, avant d’en venir au formalisme étroit dans lequel Greenberg, dit-on, se serait enfermé, lui et l’art américain des années 1940-1950. On rappellera, d’abord, que ce fils d’émigrés juifs lithuaniens a fait le coup de poing, dans sa jeunesse, aux côtés de son frère, quand les néo-nazis paradaient sur la Vème avenue. Les procès de Moscou l’ont simultanément édifié sur le supposé bouclier/ bonheur soviétique. Le pacte d’août 39 fera le reste.
Maintenant que sa mémoire est harcelée par les tenants des cultural et/ou gender studies, Clement Greenberg (1909-1994) m’est devenu éminemment sympathique. L’ancien pape du modernisme, le chantre indiscuté de l’expressionnisme abstrait, le mentor de Jackson Pollock et de David Smith, sert désormais de repoussoir à la nouvelle doxa. Outre l’élitisme que Greenberg a toujours revendiqué par mépris de la « culture de masse » et du « kitch » (dont la dernière FIAC donna l’effarant spectacle), il lui est surtout fait grief d’avoir incarné une démarche « occidentalo-phallocentrée », combattu le penchant des années 1960 pour les formes hybrides et poussé son anti-stalinisme jusqu’à servir le maccarthysme. On lui reproche même d’avoir été un mauvais Juif pour n’avoir ni soutenu la cause sioniste, ni applaudi au pittoresque de Chagall, ni souligné la judéité des artistes de son cercle, de Barnett Newman à Rothko. Bref, il est devenu, vingt ans après sa mort, l’homme de toutes les tares qui servent de morale négative à notre sinistre époque. Comme il serait trop long de les examiner une à une, je m’en tiendrai à quelques remarques de bon sens, avant d’en venir au formalisme étroit dans lequel Greenberg, dit-on, se serait enfermé, lui et l’art américain des années 1940-1950. On rappellera, d’abord, que ce fils d’émigrés juifs lithuaniens a fait le coup de poing, dans sa jeunesse, aux côtés de son frère, quand les néo-nazis paradaient sur la Vème avenue. Les procès de Moscou l’ont simultanément édifié sur le supposé bouclier/ bonheur soviétique. Le pacte d’août 39 fera le reste.
 La correspondance de la famille Pollock, que Charles Dantzig et Grasset eurent la bonne idée de publier dès 1999, témoigne d’une même lucidité. Greenberg se méfie assez vite également de l’enthousiasme que suscite l’alternative trotskyste et refuse catégoriquement la tendance des gens de gauche à vouloir embrigader les artistes, sans parler du réalisme socialiste qu’il a en horreur, comme toute forme d’illusionnisme néo-pompier. L’alternative, c’est plus que jamais l’éthique du médium. « On ne dira jamais assez l’importance de l’honnêteté en art », écrit-il en 1952. Le processus de transformation sociale, dont Greenberg se dit solidaire, passe uniquement par le langage des formes et leur mise à nu. Quand bien même l’artiste d’avant-garde est lié économiquement à la société dont il entend se séparer, il en prépare la réforme. Modernisme et formalisme, on le sait, trouvent leurs racines dans la fin du XIXème siècle et Greenberg, à cet égard, systématise l’héritage de Roger Fry et Maurice Denis. Plus près de lui, Alfred Barr en avait fait le credo du jeune MoMA. Greffée sur le marxisme, la pureté que Greenberg requiert du médium, au regard des données figuratives, aboutit à rejeter le « sujet » du côté de « la culture officielle bourgeoise », le dit sujet ferait appel à un savoir de classe, et écran au langage des formes. Plus le médium est libre de se déployer dans son être, en somme, plus il est esthétiquement et politiquement révolutionnaire ! L’atmosphère intellectuelle du New York de la fin des années 1930, sous sa plume, pourra se résumer ainsi : « Il faudra raconter un jour comment l’anti-stalinisme, qui commença par être plus ou moins du trotskysme, mena à l’art pour l’art et ce faisant ouvrit la voie, héroïquement, à ce qui devait suivre. »
La correspondance de la famille Pollock, que Charles Dantzig et Grasset eurent la bonne idée de publier dès 1999, témoigne d’une même lucidité. Greenberg se méfie assez vite également de l’enthousiasme que suscite l’alternative trotskyste et refuse catégoriquement la tendance des gens de gauche à vouloir embrigader les artistes, sans parler du réalisme socialiste qu’il a en horreur, comme toute forme d’illusionnisme néo-pompier. L’alternative, c’est plus que jamais l’éthique du médium. « On ne dira jamais assez l’importance de l’honnêteté en art », écrit-il en 1952. Le processus de transformation sociale, dont Greenberg se dit solidaire, passe uniquement par le langage des formes et leur mise à nu. Quand bien même l’artiste d’avant-garde est lié économiquement à la société dont il entend se séparer, il en prépare la réforme. Modernisme et formalisme, on le sait, trouvent leurs racines dans la fin du XIXème siècle et Greenberg, à cet égard, systématise l’héritage de Roger Fry et Maurice Denis. Plus près de lui, Alfred Barr en avait fait le credo du jeune MoMA. Greffée sur le marxisme, la pureté que Greenberg requiert du médium, au regard des données figuratives, aboutit à rejeter le « sujet » du côté de « la culture officielle bourgeoise », le dit sujet ferait appel à un savoir de classe, et écran au langage des formes. Plus le médium est libre de se déployer dans son être, en somme, plus il est esthétiquement et politiquement révolutionnaire ! L’atmosphère intellectuelle du New York de la fin des années 1930, sous sa plume, pourra se résumer ainsi : « Il faudra raconter un jour comment l’anti-stalinisme, qui commença par être plus ou moins du trotskysme, mena à l’art pour l’art et ce faisant ouvrit la voie, héroïquement, à ce qui devait suivre. »
 On voit que « l’art pour l’art », selon Greenberg, bon lecteur de Théophile Gautier, ne saurait signifier une forme hautaine d’indifférence au monde et au sens, voir le pur règne du visuel. J’y insiste, car je l’ai longtemps pensé. Je m’aperçois que je l’avais lu trop vite et pas assez, entraîné par la vulgate post-moderne des années 1980. La republication de son opus magnum, Art et Culture, offre l’occasion d’un mea culpa dont je m’acquitte d’autant plus volontiers que les éditions Macula y ont mis un soin admirable. Au livre de 1961, bilan du théoricien, une série d’articles des années 1940-1950 ont été ajoutés, préambule indispensable à l’intelligence d’un parcours qui débuta dans Partisan Review. Ces textes portent aussi bien sur Delacroix, Seurat, Klee, la peinture surréaliste que l’expressionnisme abstrait, ils permettent de se faire une idée plus fine de Greenberg. Ceux qui l’imaginaient incapable de parler des œuvres autrement qu’à travers la fameuse grille de la spécificité du médium, le présent volume les fera réfléchir. Certes, Clem, comme disait Peggy Guggenheim, définit l’art moderne, celui qui va de Manet à Pollock, par la primauté progressive des formes et de leur matérialité sur l’iconique. C’est, du moins, ainsi qu’on résume habituellement sa pensée. Il est vrai que l’héritier déclaré du Laocoon de Lessing et des Salons de Baudelaire ne cesse de condamner la « tricherie des moyens », de l’anecdote à l’imagerie du surréalisme. Mais le théoricien de « l’autonomie » de la peinture, et de sa marche prédéterminée vers l’abstraction, n’aveugle pas complètement le critique soucieux de la diversité des œuvres. Aux marges du dogme, il y a liberté du regard et l’acceptation que le contenu de l’œuvre d’art déborde parfois les enjeux de médium. Si La Liberté de Delacroix lui paraît le « tableau le plus révolutionnaire qui soit », le sujet n’y est pas pour rien, non moins que le chapeau de l’homme en noir. A propos de Seurat et Lautrec, il parle de « l’aura inhumaine des acteurs comiques ». De Pollock, il admet le sceau existentialiste et l’écriture symbolique quand vécu et style fusionnent : « Son émotion qui est d’emblée picturale n’a pas besoin d’être castrée ni traduite pour devenir tableau. »
On voit que « l’art pour l’art », selon Greenberg, bon lecteur de Théophile Gautier, ne saurait signifier une forme hautaine d’indifférence au monde et au sens, voir le pur règne du visuel. J’y insiste, car je l’ai longtemps pensé. Je m’aperçois que je l’avais lu trop vite et pas assez, entraîné par la vulgate post-moderne des années 1980. La republication de son opus magnum, Art et Culture, offre l’occasion d’un mea culpa dont je m’acquitte d’autant plus volontiers que les éditions Macula y ont mis un soin admirable. Au livre de 1961, bilan du théoricien, une série d’articles des années 1940-1950 ont été ajoutés, préambule indispensable à l’intelligence d’un parcours qui débuta dans Partisan Review. Ces textes portent aussi bien sur Delacroix, Seurat, Klee, la peinture surréaliste que l’expressionnisme abstrait, ils permettent de se faire une idée plus fine de Greenberg. Ceux qui l’imaginaient incapable de parler des œuvres autrement qu’à travers la fameuse grille de la spécificité du médium, le présent volume les fera réfléchir. Certes, Clem, comme disait Peggy Guggenheim, définit l’art moderne, celui qui va de Manet à Pollock, par la primauté progressive des formes et de leur matérialité sur l’iconique. C’est, du moins, ainsi qu’on résume habituellement sa pensée. Il est vrai que l’héritier déclaré du Laocoon de Lessing et des Salons de Baudelaire ne cesse de condamner la « tricherie des moyens », de l’anecdote à l’imagerie du surréalisme. Mais le théoricien de « l’autonomie » de la peinture, et de sa marche prédéterminée vers l’abstraction, n’aveugle pas complètement le critique soucieux de la diversité des œuvres. Aux marges du dogme, il y a liberté du regard et l’acceptation que le contenu de l’œuvre d’art déborde parfois les enjeux de médium. Si La Liberté de Delacroix lui paraît le « tableau le plus révolutionnaire qui soit », le sujet n’y est pas pour rien, non moins que le chapeau de l’homme en noir. A propos de Seurat et Lautrec, il parle de « l’aura inhumaine des acteurs comiques ». De Pollock, il admet le sceau existentialiste et l’écriture symbolique quand vécu et style fusionnent : « Son émotion qui est d’emblée picturale n’a pas besoin d’être castrée ni traduite pour devenir tableau. »
 Quant à l’impact des surréalistes, qu’il a un peu croisés à Paris avant la guerre, et ensuite à New York, Greenberg fait évidemment le bon choix en préférant Miró et Masson à Dali et Magritte : « En outre, écrit-il en 1953, nous avons énormément gagné à la présence d’André Masson de ce côté-ci de l’Atlantique pendant la guerre. Si peu accompli soit-il, et c’est là chose tragique, il demeure le plus fécond de tous les peintres de la génération d’après Picasso, Miró inclus. Plus que tout autre, il a anticipé la nouvelle peinture abstraite, et je ne pense pas que justice lui soit en l’occurrence suffisamment rendue. » André Breton eût été saisi d’une violente nausée à la lecture d’un pareil « statement ». L’art abstrait lui donnait des boutons, comme tout ce qui lui semblait tendre à la négation de la pensée. Certes, le risque qu’il ait jamais lu Greenberg, pendant et après ses années d’exil, reste fort limité. A cela, plusieurs raisons. Le barrage de la langue constitue la première, le Français ayant refusé d’apprendre l’anglais, sans doute par esprit de résistance… Breton, dont Varian Fry avait rendu possible le transfert depuis Marseille, n’avait même pas la reconnaissance du ventre. L’Amérique libérale une fois rattrapée par le conflit, elle lui devint presque un objet de détestation. Il convient de lire attentivement, à cet égard, le nouveau volume de sa correspondance, dont on ne saura trop remercier Aube Breton et Antoine Gallimard de nous y donner accès. Les plus attendues de ces lettres sont celles qu’il échangea avec Benjamin Péret, le fidèle des fidèles parmi ses généraux dévoués corps et âme. Or, ce sont les années 1941-1945 qui retiennent avant tout, et notamment ce qu’il dit du milieu intellectuel où il est supposé avoir fait fonction de mage écouté. Au contraire, assez isolé et fauché, bientôt plaqué par Jacqueline, Breton ne comprend pas grand-chose à l’intelligentsia new yorkaise et ses codes. Il semble inapte à saisir et exploiter les tensions du milieu marxiste, voire repérer les staliniens qu’il déteste autant que Péret. Ce dernier, chose rare parmi les surréalistes, avait le courage de ses opinions et s’était battu en Espagne contre les franquistes. Il eut tout loisir là-bas d’examiner les hommes de Moscou à l’œuvre, il en conçut à jamais une haine envers la Russie soviétique et ses sbires. Est-il encore nécessaire de recommander son Déshonneur des poètes de 1945, réponse tonique aux nouveaux « cadres » du PCF, Aragon, Eluard, Tzara ? Avant cela, celui qui ne « mangeait pas de ce pain-là » aura applaudi à toutes les démarches de Breton visant à démonétiser la mobilisation des artistes de New York, américains ou pas, en faveur de la guerre contre Hitler. Du côté de Duchamp, pas de risque de prurit patriotique, il flottait dans le déni de réalité depuis la première guerre mondiale, qu’il avait su contourner. Devenu scénographe de Peggy Guggenheim, il avait déjà fort à faire.
Quant à l’impact des surréalistes, qu’il a un peu croisés à Paris avant la guerre, et ensuite à New York, Greenberg fait évidemment le bon choix en préférant Miró et Masson à Dali et Magritte : « En outre, écrit-il en 1953, nous avons énormément gagné à la présence d’André Masson de ce côté-ci de l’Atlantique pendant la guerre. Si peu accompli soit-il, et c’est là chose tragique, il demeure le plus fécond de tous les peintres de la génération d’après Picasso, Miró inclus. Plus que tout autre, il a anticipé la nouvelle peinture abstraite, et je ne pense pas que justice lui soit en l’occurrence suffisamment rendue. » André Breton eût été saisi d’une violente nausée à la lecture d’un pareil « statement ». L’art abstrait lui donnait des boutons, comme tout ce qui lui semblait tendre à la négation de la pensée. Certes, le risque qu’il ait jamais lu Greenberg, pendant et après ses années d’exil, reste fort limité. A cela, plusieurs raisons. Le barrage de la langue constitue la première, le Français ayant refusé d’apprendre l’anglais, sans doute par esprit de résistance… Breton, dont Varian Fry avait rendu possible le transfert depuis Marseille, n’avait même pas la reconnaissance du ventre. L’Amérique libérale une fois rattrapée par le conflit, elle lui devint presque un objet de détestation. Il convient de lire attentivement, à cet égard, le nouveau volume de sa correspondance, dont on ne saura trop remercier Aube Breton et Antoine Gallimard de nous y donner accès. Les plus attendues de ces lettres sont celles qu’il échangea avec Benjamin Péret, le fidèle des fidèles parmi ses généraux dévoués corps et âme. Or, ce sont les années 1941-1945 qui retiennent avant tout, et notamment ce qu’il dit du milieu intellectuel où il est supposé avoir fait fonction de mage écouté. Au contraire, assez isolé et fauché, bientôt plaqué par Jacqueline, Breton ne comprend pas grand-chose à l’intelligentsia new yorkaise et ses codes. Il semble inapte à saisir et exploiter les tensions du milieu marxiste, voire repérer les staliniens qu’il déteste autant que Péret. Ce dernier, chose rare parmi les surréalistes, avait le courage de ses opinions et s’était battu en Espagne contre les franquistes. Il eut tout loisir là-bas d’examiner les hommes de Moscou à l’œuvre, il en conçut à jamais une haine envers la Russie soviétique et ses sbires. Est-il encore nécessaire de recommander son Déshonneur des poètes de 1945, réponse tonique aux nouveaux « cadres » du PCF, Aragon, Eluard, Tzara ? Avant cela, celui qui ne « mangeait pas de ce pain-là » aura applaudi à toutes les démarches de Breton visant à démonétiser la mobilisation des artistes de New York, américains ou pas, en faveur de la guerre contre Hitler. Du côté de Duchamp, pas de risque de prurit patriotique, il flottait dans le déni de réalité depuis la première guerre mondiale, qu’il avait su contourner. Devenu scénographe de Peggy Guggenheim, il avait déjà fort à faire.
 Dès Pearl Harbour, depuis le Connecticut où il s’est retiré (et où Gorky le visita), Masson, lui, se collette à l’Histoire. Le désir d’en découdre, de la part du miraculé du Chemin des Dames, déplaît à Breton et à Péret. Début janvier 1942, le premier écrit au second, exilé au Mexique : « Masson, également très éveillé (agité aussi, je n’ai pas besoin de te le dire). Il habite la campagne où nous allons souvent le voir. […] il estime qu’il faut commencer par soutenir tous les efforts, même militaires, qui ont pour but d’abattre Hitler (grande méfiance à l’égard des mots d’ordre révolutionnaires, tendance à professer passionnément son mépris du prolétariat, etc.). » La correspondance Breton / Péret cède souvent aux petites vacheries. Elles vont se corser après que Masson, le 14 juillet 1942, eut exposé son allégorie au titre frontal, Liberté, Égalité, Fraternité (voir notre Art en péril, Hazan, 2016, p. 94-95). Malgré l’absence de note à cet endroit, je pense que la réaction tardive de Péret, le 6 avril 1943, est à mettre en relation avec ce tableau trop tricolore à son goût : « L’histoire de Masson ne me plaît guère : je ne peux pas m’empêcher de penser que cette inscription figurait aux frontons des prisons. Cela indique de sa part, à coup sûr, une grande confusion. » Le meilleur, c’est la réponse de Breton, le 19, au sujet des revues et des artistes qu’il juge compromis : « Par contre, je crois à la nécessité absolue de briser ici avec View (c’est-à-dire une fois de plus la pédérastie internationale). Rompu avec [Kurt] Seligmann qui, sans me prévenir, a cru nécessaire à sa publicité de recouvrir de ses chenilles écrasées le dernier numéro. En difficulté avec Masson à ce même sujet mais tu connais l’antienne avec les peintres ! » Que diraient nos bons esprits si une telle lettre était signée de Drieu la Rochelle ? On préfère, évidemment, la violence d’André quand elle s’exerce sur la clique communiste. Fin 1944, alors qu’il s’agit de réussir son après-guerre mieux que sa guerre, Breton crache avec justesse sur le ralliement de Picasso au PCF, propulsé aux premières loges désormais avec Aragon et Eluard. Mais la logique clivante des surréalistes et leur vœu d’extériorité à toute action commune, en faveur des vieilles démocraties, exigeaient que Breton tapât simultanément sur elles. Aussi Masson, toujours lui, se voit-il accuser, en février 1945, de s’être « perdu dans le conformisme gaulliste le plus exalté ». Mais soudain, avant que la lettre ne se referme, un moment de lucidité involontaire, freudien : « Force est de reconnaître que dans l’ensemble les surréalistes se sont plus plutôt moins bien tenus que les autres éléments de l’immigration. Et pourtant ! »
Dès Pearl Harbour, depuis le Connecticut où il s’est retiré (et où Gorky le visita), Masson, lui, se collette à l’Histoire. Le désir d’en découdre, de la part du miraculé du Chemin des Dames, déplaît à Breton et à Péret. Début janvier 1942, le premier écrit au second, exilé au Mexique : « Masson, également très éveillé (agité aussi, je n’ai pas besoin de te le dire). Il habite la campagne où nous allons souvent le voir. […] il estime qu’il faut commencer par soutenir tous les efforts, même militaires, qui ont pour but d’abattre Hitler (grande méfiance à l’égard des mots d’ordre révolutionnaires, tendance à professer passionnément son mépris du prolétariat, etc.). » La correspondance Breton / Péret cède souvent aux petites vacheries. Elles vont se corser après que Masson, le 14 juillet 1942, eut exposé son allégorie au titre frontal, Liberté, Égalité, Fraternité (voir notre Art en péril, Hazan, 2016, p. 94-95). Malgré l’absence de note à cet endroit, je pense que la réaction tardive de Péret, le 6 avril 1943, est à mettre en relation avec ce tableau trop tricolore à son goût : « L’histoire de Masson ne me plaît guère : je ne peux pas m’empêcher de penser que cette inscription figurait aux frontons des prisons. Cela indique de sa part, à coup sûr, une grande confusion. » Le meilleur, c’est la réponse de Breton, le 19, au sujet des revues et des artistes qu’il juge compromis : « Par contre, je crois à la nécessité absolue de briser ici avec View (c’est-à-dire une fois de plus la pédérastie internationale). Rompu avec [Kurt] Seligmann qui, sans me prévenir, a cru nécessaire à sa publicité de recouvrir de ses chenilles écrasées le dernier numéro. En difficulté avec Masson à ce même sujet mais tu connais l’antienne avec les peintres ! » Que diraient nos bons esprits si une telle lettre était signée de Drieu la Rochelle ? On préfère, évidemment, la violence d’André quand elle s’exerce sur la clique communiste. Fin 1944, alors qu’il s’agit de réussir son après-guerre mieux que sa guerre, Breton crache avec justesse sur le ralliement de Picasso au PCF, propulsé aux premières loges désormais avec Aragon et Eluard. Mais la logique clivante des surréalistes et leur vœu d’extériorité à toute action commune, en faveur des vieilles démocraties, exigeaient que Breton tapât simultanément sur elles. Aussi Masson, toujours lui, se voit-il accuser, en février 1945, de s’être « perdu dans le conformisme gaulliste le plus exalté ». Mais soudain, avant que la lettre ne se referme, un moment de lucidité involontaire, freudien : « Force est de reconnaître que dans l’ensemble les surréalistes se sont plus plutôt moins bien tenus que les autres éléments de l’immigration. Et pourtant ! »
Stéphane Guégan
 *Clement Greenberg, Katia Schneller (éd.), Ecrits choisis des années 1940, Art et Culture, Macula, 48€. Dans L’Abstraction avec ou sans raisons (Gallimard, collection Art et Artistes, 26€), Eric de Chassey ausculte et discute à maintes reprises l’esthétique de Greenberg, son obsession de la planéité, sa remise en cause du tableau de chevalet (limites, loi du cadre) et l’idée d’un leadership américain au sortir des années 1940. Notons aussi la reparution indispensable de Jackson Pollock, Lettres américaines 1927-1957, Grasset, Les Cahiers rouges, 10,90€.
*Clement Greenberg, Katia Schneller (éd.), Ecrits choisis des années 1940, Art et Culture, Macula, 48€. Dans L’Abstraction avec ou sans raisons (Gallimard, collection Art et Artistes, 26€), Eric de Chassey ausculte et discute à maintes reprises l’esthétique de Greenberg, son obsession de la planéité, sa remise en cause du tableau de chevalet (limites, loi du cadre) et l’idée d’un leadership américain au sortir des années 1940. Notons aussi la reparution indispensable de Jackson Pollock, Lettres américaines 1927-1957, Grasset, Les Cahiers rouges, 10,90€.
**André Breton et Benjamin Péret, Correspondance (1920-1959), édition et présentation de Gérard Roche, Gallimard, 29€. Le même éditeur fait paraître la Correspondance de Breton avec Tzara et Picabia (26€) dont Henri Béhar reconnaît lui-même qu’elle était presque entièrement connue des lecteurs du grand livre, bien que vieilli, de Michel Sanouillet, Dada à Paris (Pauvert,1965). L’introduction du volume en résume la matière, au lieu de la réviser dans un sens critique. Qui mettra fin à La Légende dorée du dadaïsme ?
 D’autres Amériques… Détesté des surréalistes, ce qui est souvent une preuve de mérite, Paul Claudel pratiqua l’amour fou en donnant bien plus de sa personne que certains d’entre eux ? Il est vrai que sa fougue sexuelle, dévorante et dévoreuse, ne se révèle à lui, et ne se libère que fort tardivement. En matière de révélations, Dieu et Rimbaud, qu’il ne dissociait guère, suffisaient à Claudel. Dans son premier théâtre, qu’on dit symboliste quoique tout y ramène à la vraie vie, il est plus de femmes désirées que de corps unis. Ainsi la fameuse Lâla descend-elle naturellement des chimères du romantisme, êtres de rêve et de nuées : « Je suis la promesse qui ne peut être tenue. » Or, voilà qu’à 32 ans, encore vierge, Claudel croise, sur le bateau qui les mène en Chine, l’élue. Nous sommes en octobre 1900. Et le nouveau siècle semble tenir ses engagements. Rosalie Vetch n’appartient pas aux communes allumeuses, prédatrices au long cours que la Belle Époque ne cantonne pas aux hôtels internationaux. Native de Cracovie, mariée et mère de quatre enfants, convaincue de voler très au-dessus du tout-venant, elle s’offre tous les luxes et répond à l’instant sans penser au lendemain. Quatre années va pourtant durer cette intense et étrange liaison. Puis les amants, en 1904, se séparent d’un commun accord, Rosie porte et déporte l’enfant du péché, Louise, à qui on cachera tout. D’autres hommes remplacent immédiatement le consul torturé de remords. Claudel se sent à la fois trahi et obligé de dire son malheur dans Partage du Midi. Rosie se mue en Ysé, l’être de chair rejoint les tentatrices claudéliennes, porteuses de malheur et de rédemption. Mais l’histoire, trop belle, refuse de s’arrêter. Après 13 ans, une lettre de Rosie surgit du silence et réveille les ardeurs de l’amant à bicorne. Les lettres reprennent, les étreintes aussi, puis les unes et les autres s’espacent, l’Amitié efface Éros. Leur correspondance, filtre interdit, touchait au mythe. Elle se fait entendre enfin, merveilleusement présentée et éditée par Jacques Julliard et Gérald Antoine, le meilleur connaisseur de Claudel. Elle confirme que le désir de possession, au double sens de la plénitude et de la pénitence que l’écrivain y cherchait désespérément, resta frappé d’insatisfaction. On découvre une Rosie plus attachée à ses intérêts et ses besoins d’argent qu’à son amant et ses livres. Le plus motivé
D’autres Amériques… Détesté des surréalistes, ce qui est souvent une preuve de mérite, Paul Claudel pratiqua l’amour fou en donnant bien plus de sa personne que certains d’entre eux ? Il est vrai que sa fougue sexuelle, dévorante et dévoreuse, ne se révèle à lui, et ne se libère que fort tardivement. En matière de révélations, Dieu et Rimbaud, qu’il ne dissociait guère, suffisaient à Claudel. Dans son premier théâtre, qu’on dit symboliste quoique tout y ramène à la vraie vie, il est plus de femmes désirées que de corps unis. Ainsi la fameuse Lâla descend-elle naturellement des chimères du romantisme, êtres de rêve et de nuées : « Je suis la promesse qui ne peut être tenue. » Or, voilà qu’à 32 ans, encore vierge, Claudel croise, sur le bateau qui les mène en Chine, l’élue. Nous sommes en octobre 1900. Et le nouveau siècle semble tenir ses engagements. Rosalie Vetch n’appartient pas aux communes allumeuses, prédatrices au long cours que la Belle Époque ne cantonne pas aux hôtels internationaux. Native de Cracovie, mariée et mère de quatre enfants, convaincue de voler très au-dessus du tout-venant, elle s’offre tous les luxes et répond à l’instant sans penser au lendemain. Quatre années va pourtant durer cette intense et étrange liaison. Puis les amants, en 1904, se séparent d’un commun accord, Rosie porte et déporte l’enfant du péché, Louise, à qui on cachera tout. D’autres hommes remplacent immédiatement le consul torturé de remords. Claudel se sent à la fois trahi et obligé de dire son malheur dans Partage du Midi. Rosie se mue en Ysé, l’être de chair rejoint les tentatrices claudéliennes, porteuses de malheur et de rédemption. Mais l’histoire, trop belle, refuse de s’arrêter. Après 13 ans, une lettre de Rosie surgit du silence et réveille les ardeurs de l’amant à bicorne. Les lettres reprennent, les étreintes aussi, puis les unes et les autres s’espacent, l’Amitié efface Éros. Leur correspondance, filtre interdit, touchait au mythe. Elle se fait entendre enfin, merveilleusement présentée et éditée par Jacques Julliard et Gérald Antoine, le meilleur connaisseur de Claudel. Elle confirme que le désir de possession, au double sens de la plénitude et de la pénitence que l’écrivain y cherchait désespérément, resta frappé d’insatisfaction. On découvre une Rosie plus attachée à ses intérêts et ses besoins d’argent qu’à son amant et ses livres. Le plus motivé 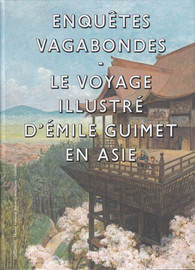 des deux fut donc Claudel, ses lettres d’amour brûlent en autarcie. C’est aussi l’Asie, la Chine et surtout le Japon, qui rendit possible la belle rencontre d’Émile Guimet et de Félix Régamey. L’un est l’héritier entreprenant d’industriels lyonnais, lecteur de Renan, féru de religions et impatients de les comparer sur le terrain… L’autre est un peintre qui attend toujours son livre, cet ami de Fantin-Latour appartient à la « génération de 1863 » (Michael Fried). Républicain, il se cogna à Verlaine et Rimbaud à Londres au moment où la Commune en fait le refuge des indésirables de toutes espèces. Van Gogh appréciait ses contributions à The Illustrated London News. Passé au service de Guimet en 1873, il mettra en images leurs pérégrinations et les rites religieux dont ils furent les témoins précis. Ethnographie moderne et « japonisme interprété » (Philippe Burty) expliquent le succès de toiles qu’on est plus qu’heureux, reconnaissants, de voir revenir sur les murs du grand musée parisien. SG // Paul Claudel, Lettres à Ysé, édition de Gérald Antoine, sous la direction de Jean-Yves Tadié, préface de Jacques Julliard, Gallimard, 29€ / Cristina Cramerotti et Pierre Baptiste (dir.), Enquêtes vagabondes. Le voyage illustré d’Émile Guimet en Asie, Musée national des arts asiatiques – Guimet / Gallimard, 39€.
des deux fut donc Claudel, ses lettres d’amour brûlent en autarcie. C’est aussi l’Asie, la Chine et surtout le Japon, qui rendit possible la belle rencontre d’Émile Guimet et de Félix Régamey. L’un est l’héritier entreprenant d’industriels lyonnais, lecteur de Renan, féru de religions et impatients de les comparer sur le terrain… L’autre est un peintre qui attend toujours son livre, cet ami de Fantin-Latour appartient à la « génération de 1863 » (Michael Fried). Républicain, il se cogna à Verlaine et Rimbaud à Londres au moment où la Commune en fait le refuge des indésirables de toutes espèces. Van Gogh appréciait ses contributions à The Illustrated London News. Passé au service de Guimet en 1873, il mettra en images leurs pérégrinations et les rites religieux dont ils furent les témoins précis. Ethnographie moderne et « japonisme interprété » (Philippe Burty) expliquent le succès de toiles qu’on est plus qu’heureux, reconnaissants, de voir revenir sur les murs du grand musée parisien. SG // Paul Claudel, Lettres à Ysé, édition de Gérald Antoine, sous la direction de Jean-Yves Tadié, préface de Jacques Julliard, Gallimard, 29€ / Cristina Cramerotti et Pierre Baptiste (dir.), Enquêtes vagabondes. Le voyage illustré d’Émile Guimet en Asie, Musée national des arts asiatiques – Guimet / Gallimard, 39€.